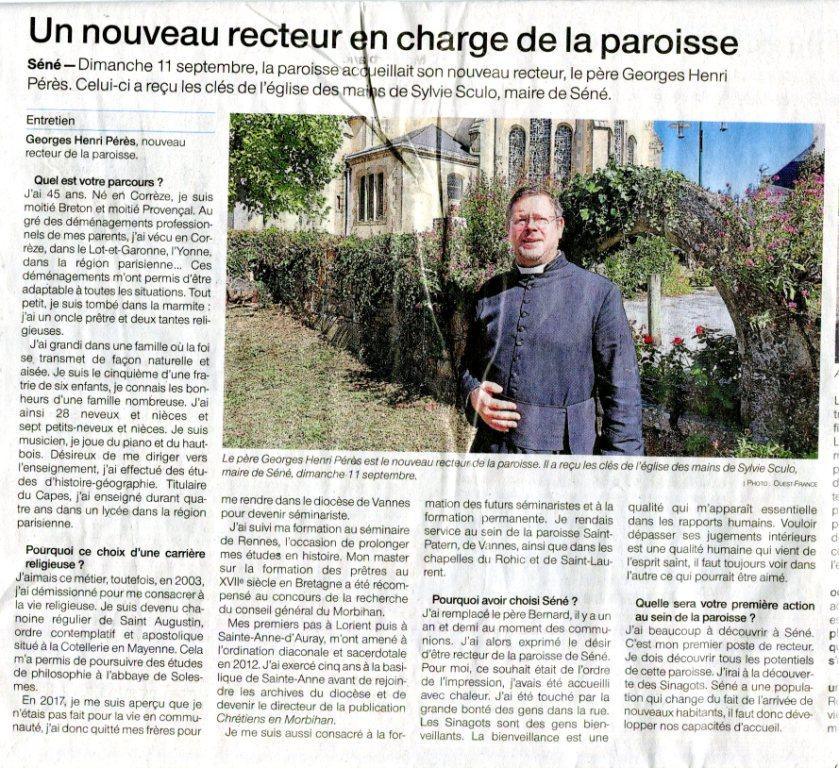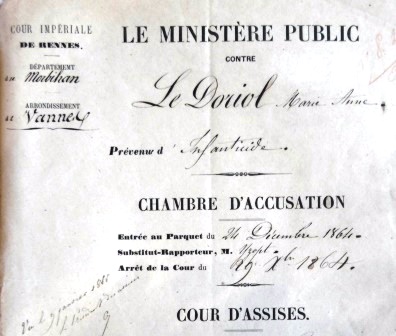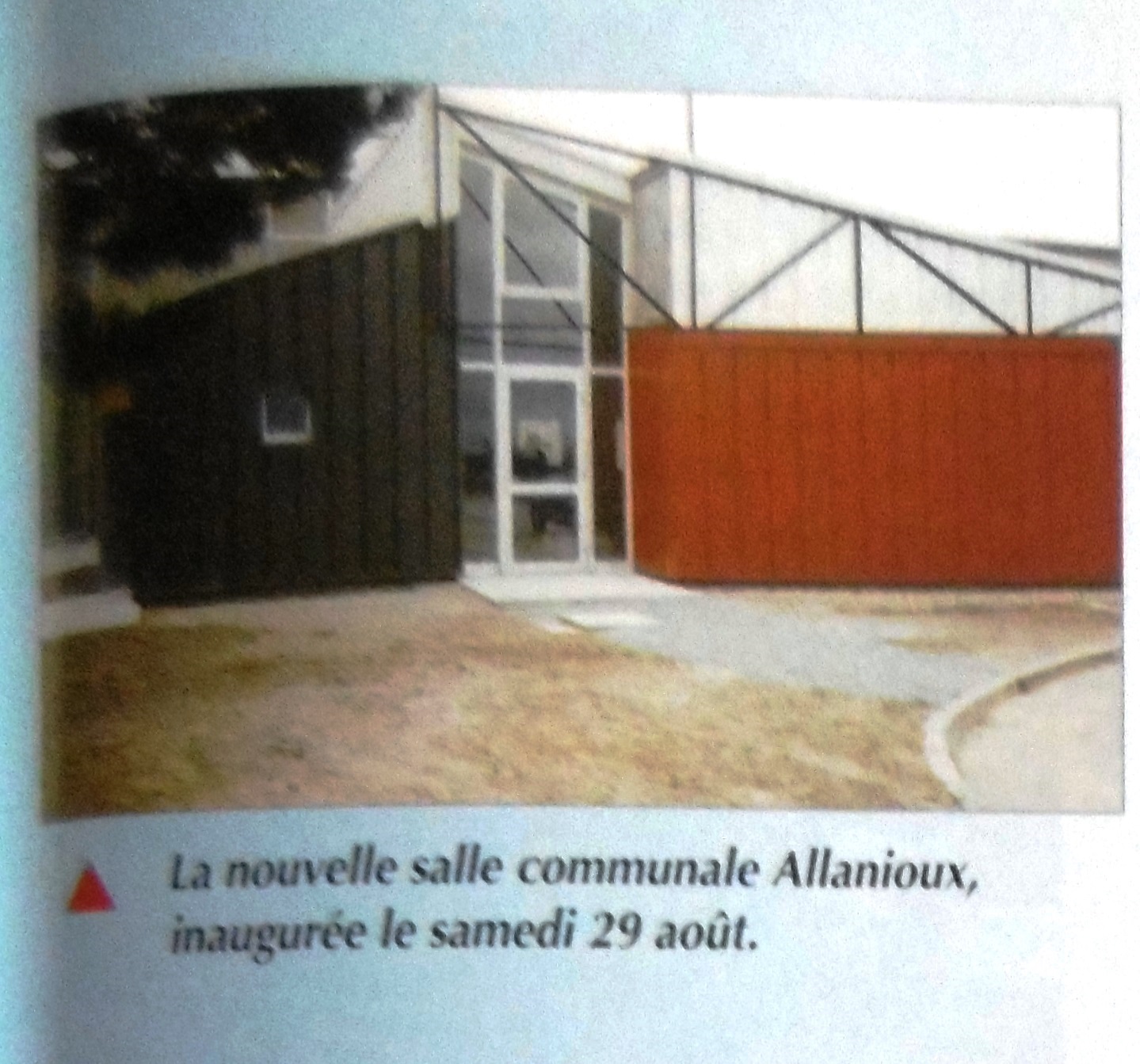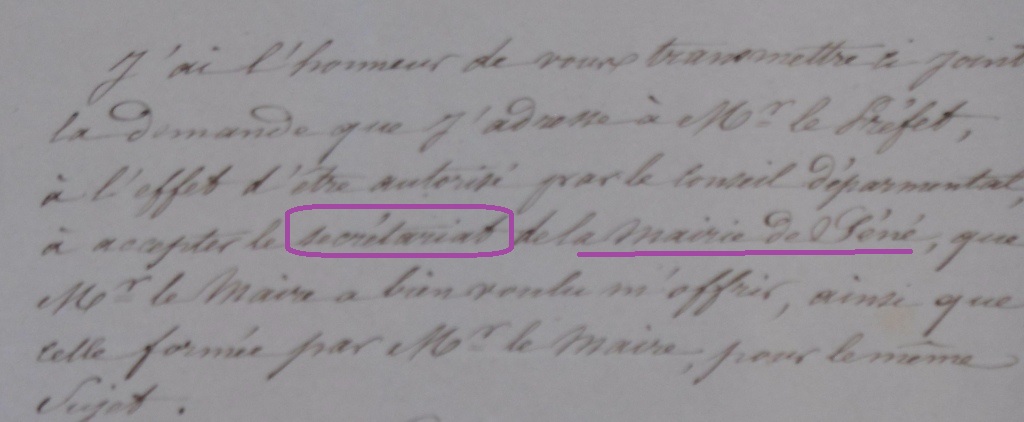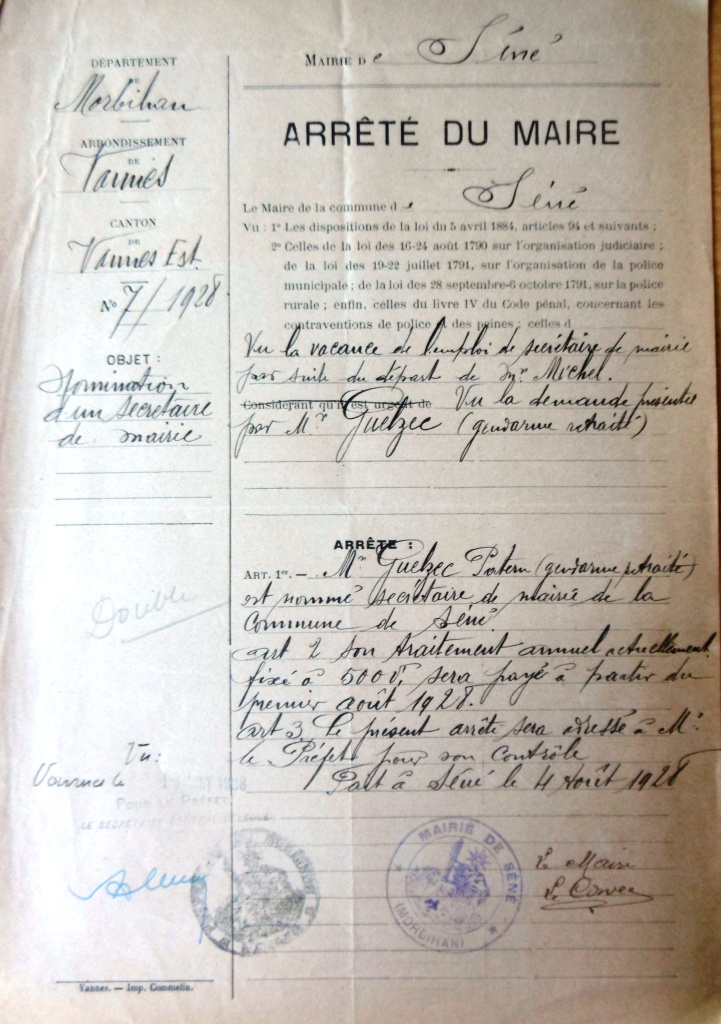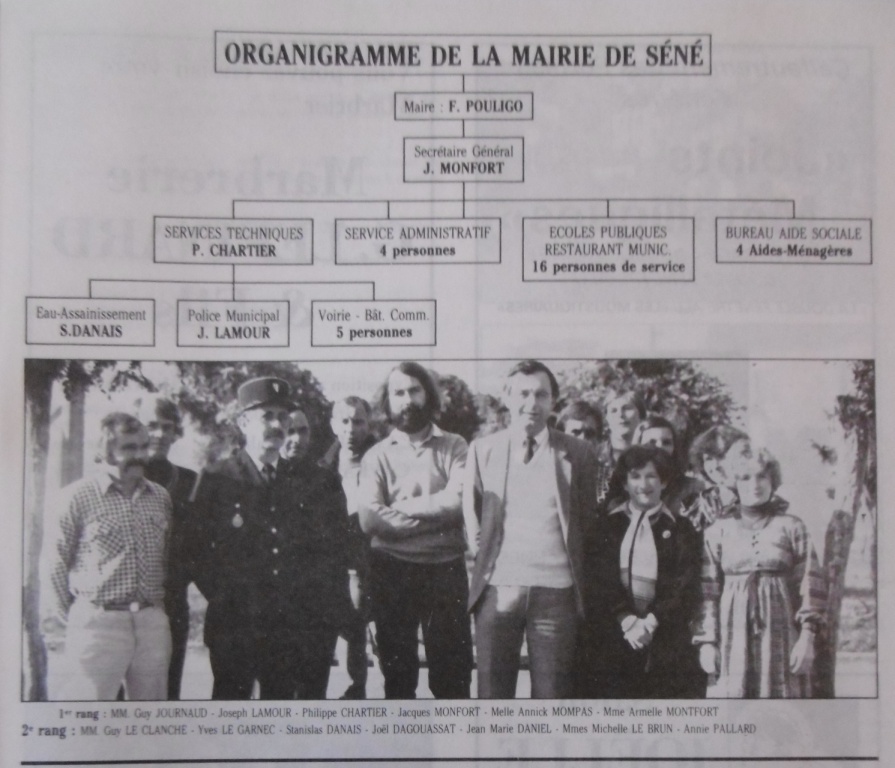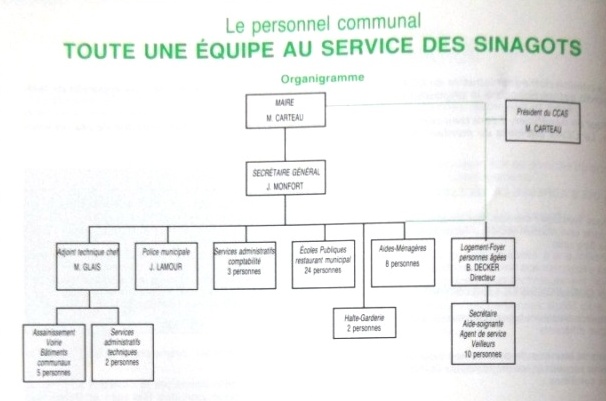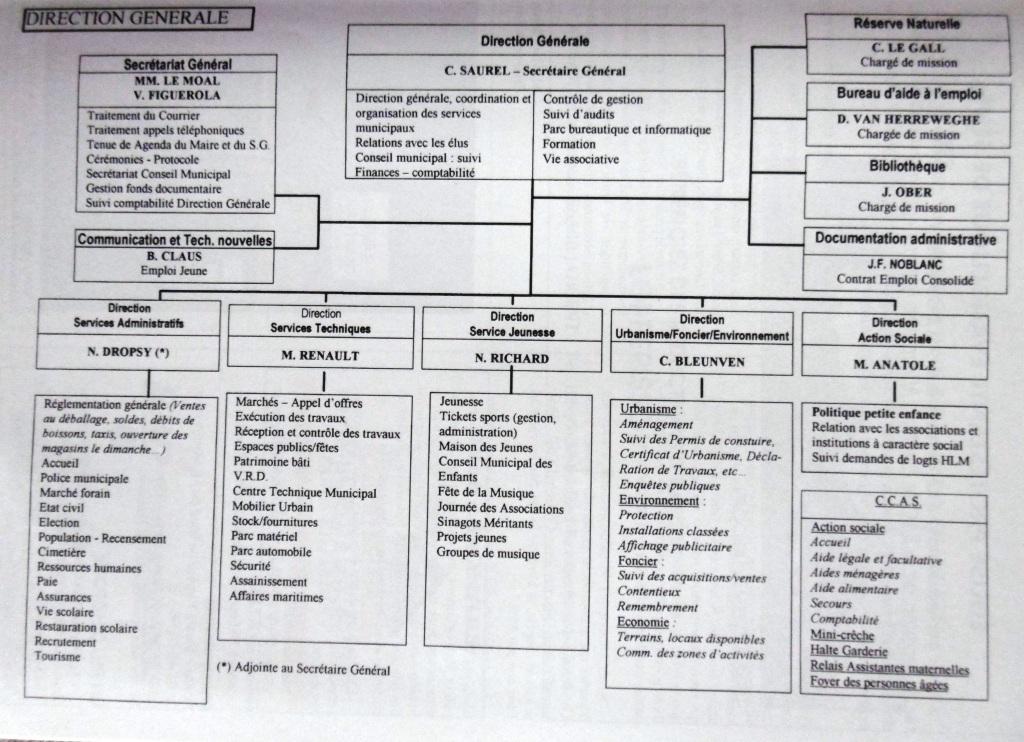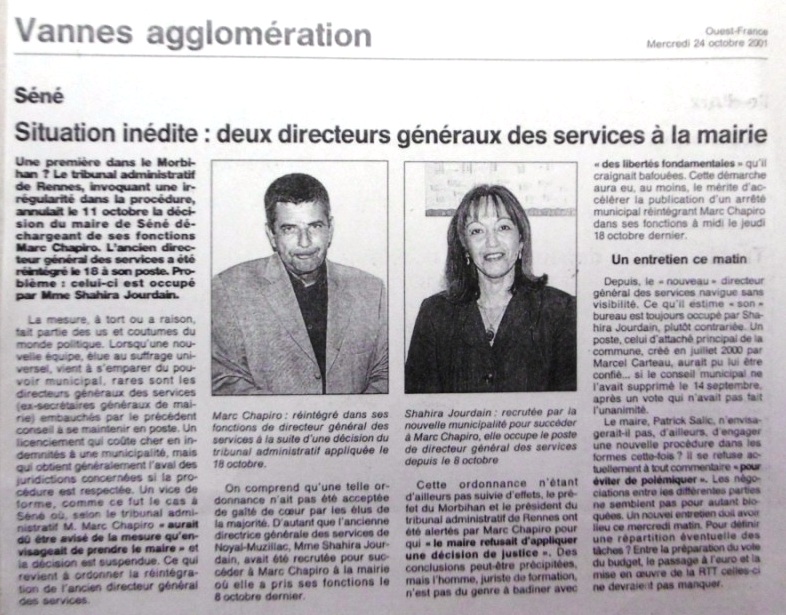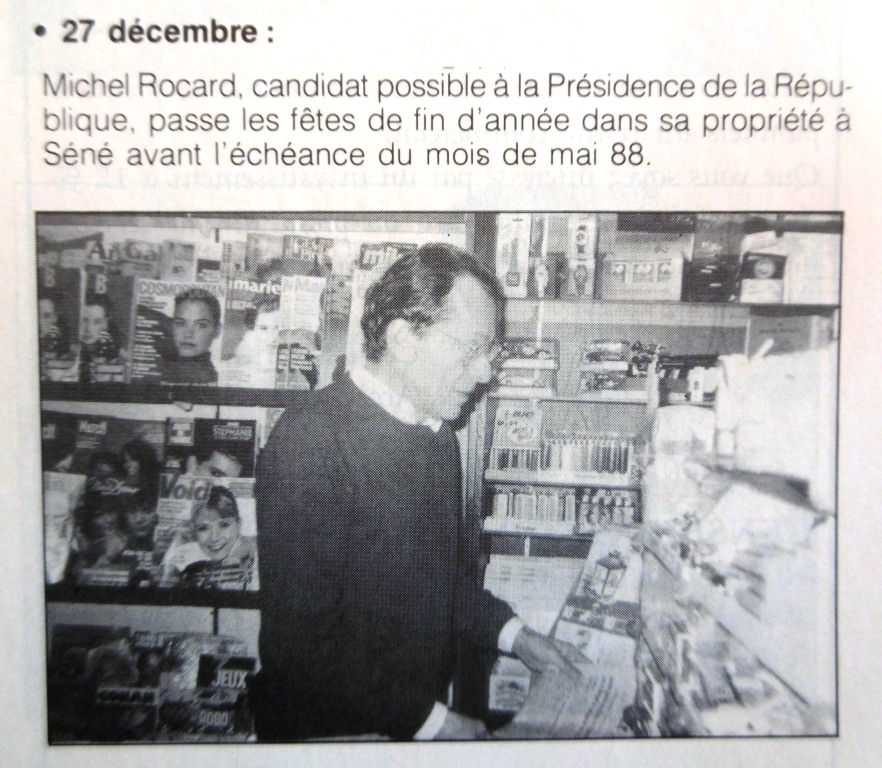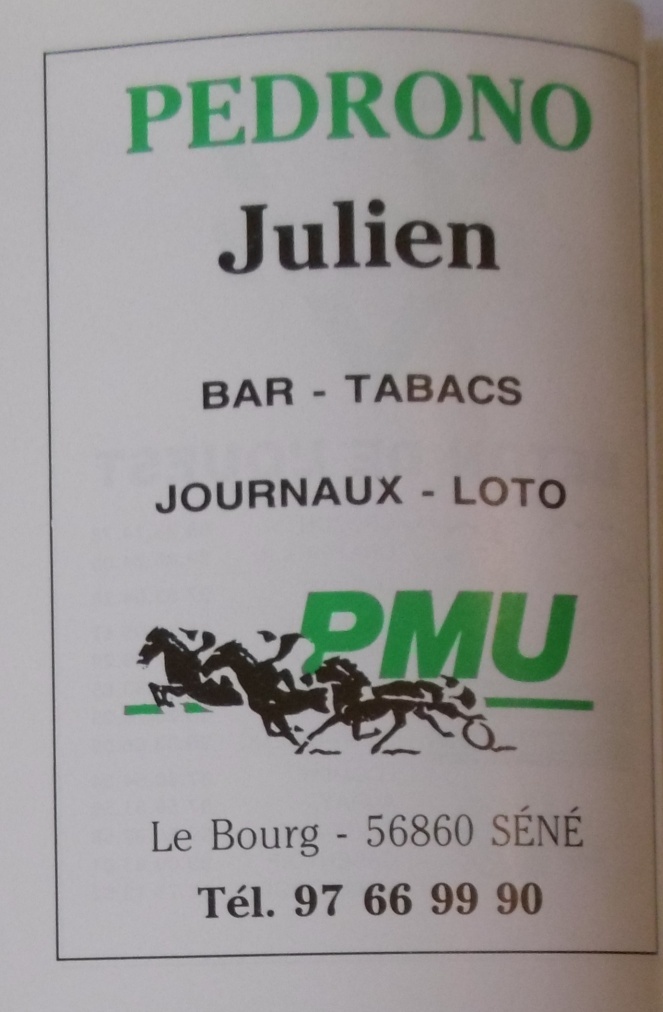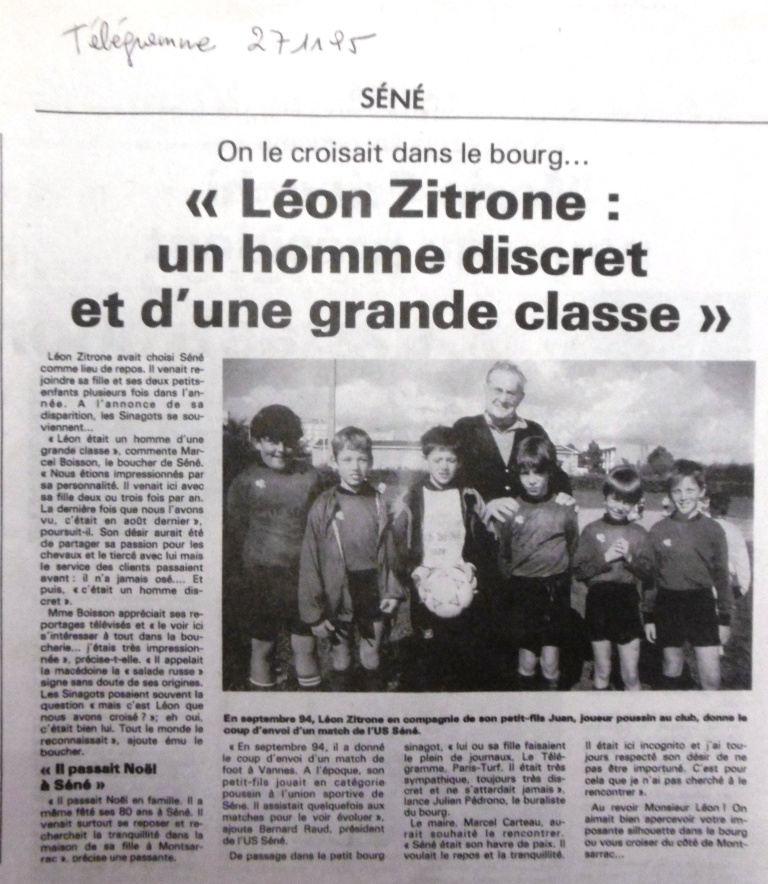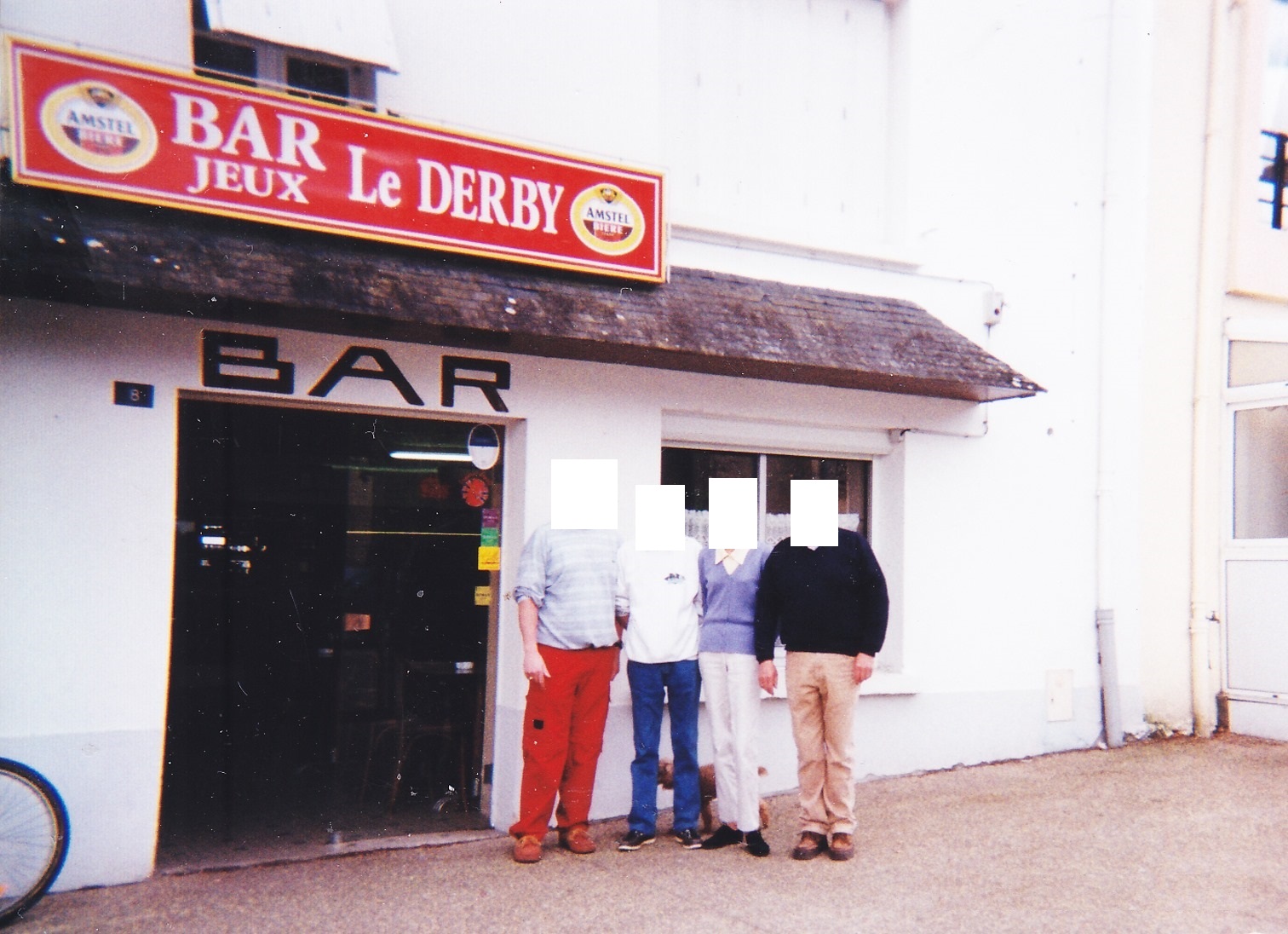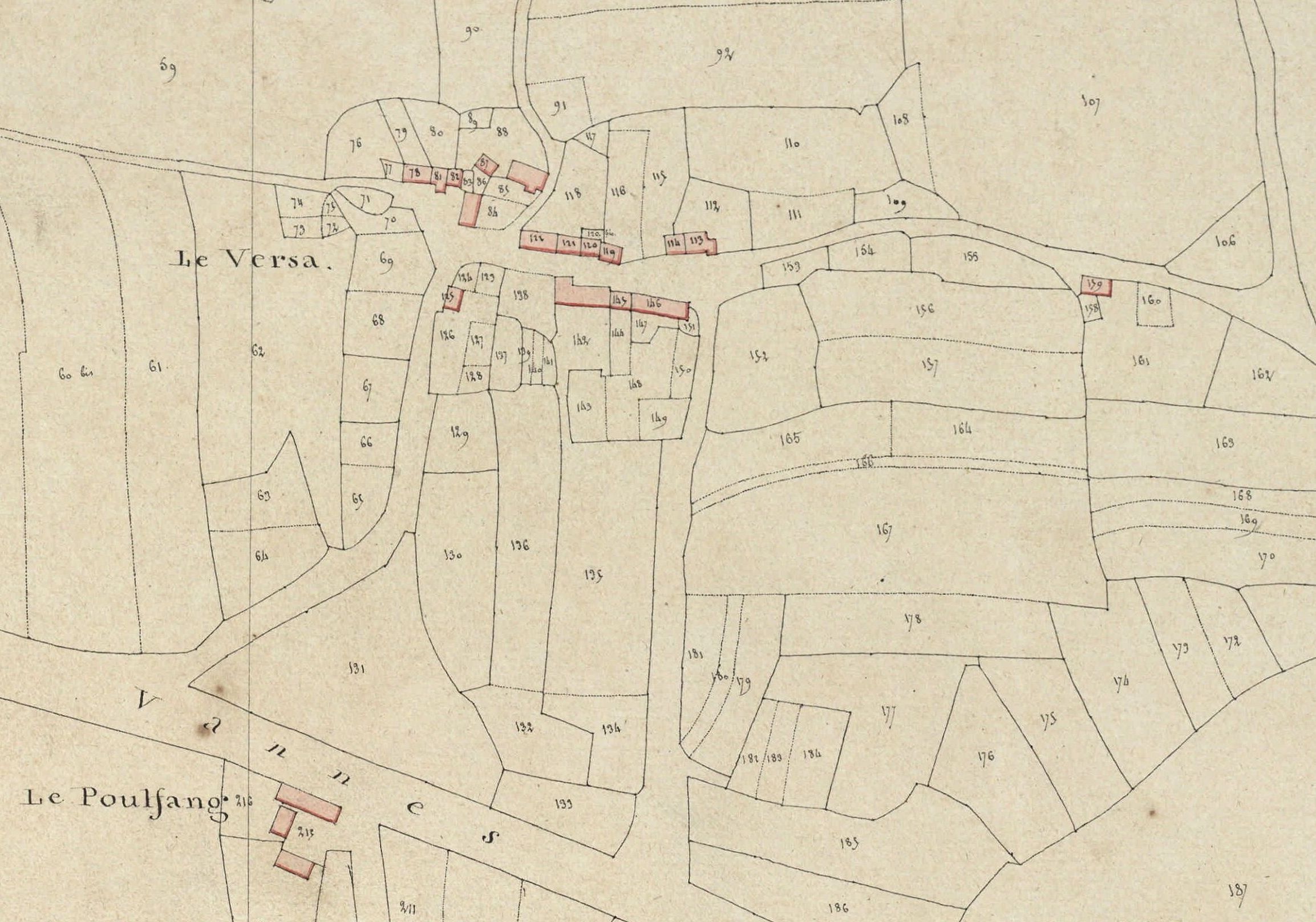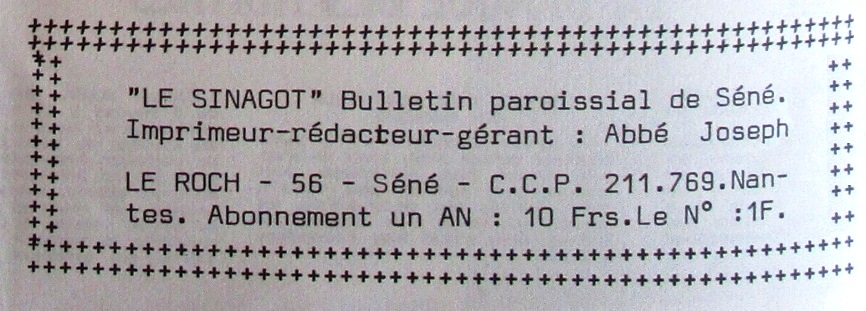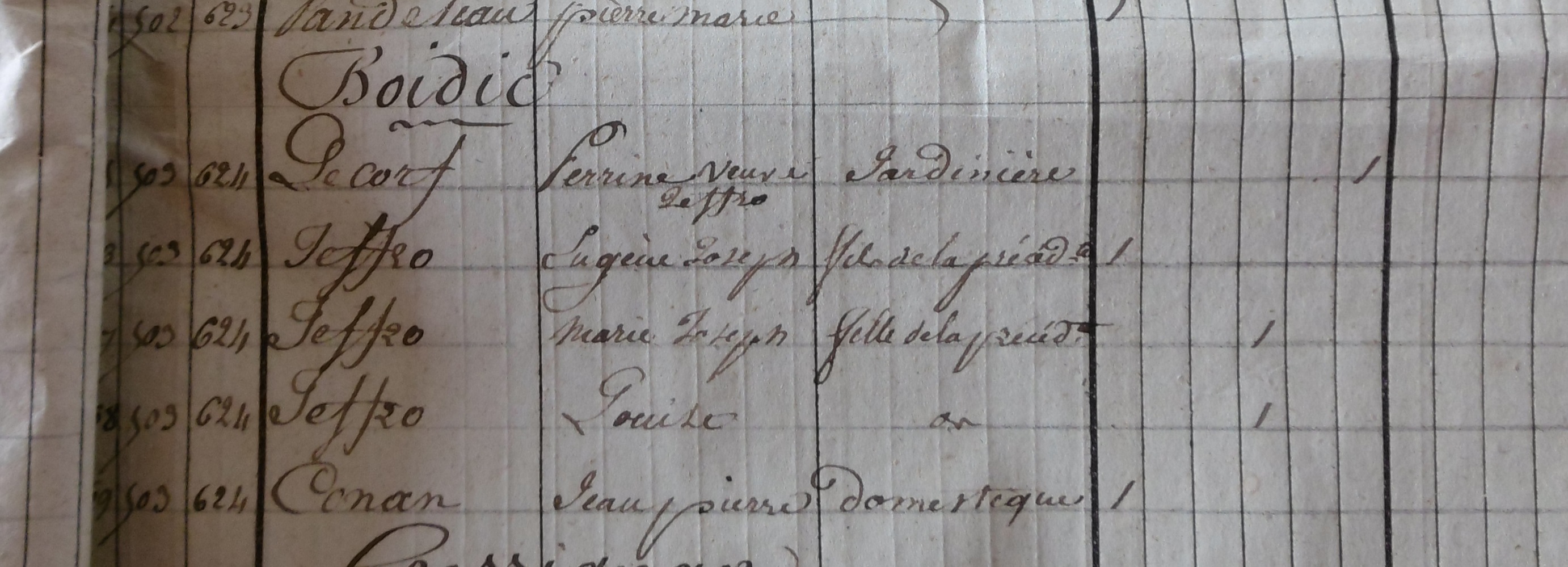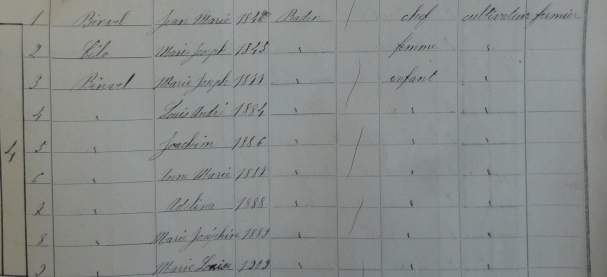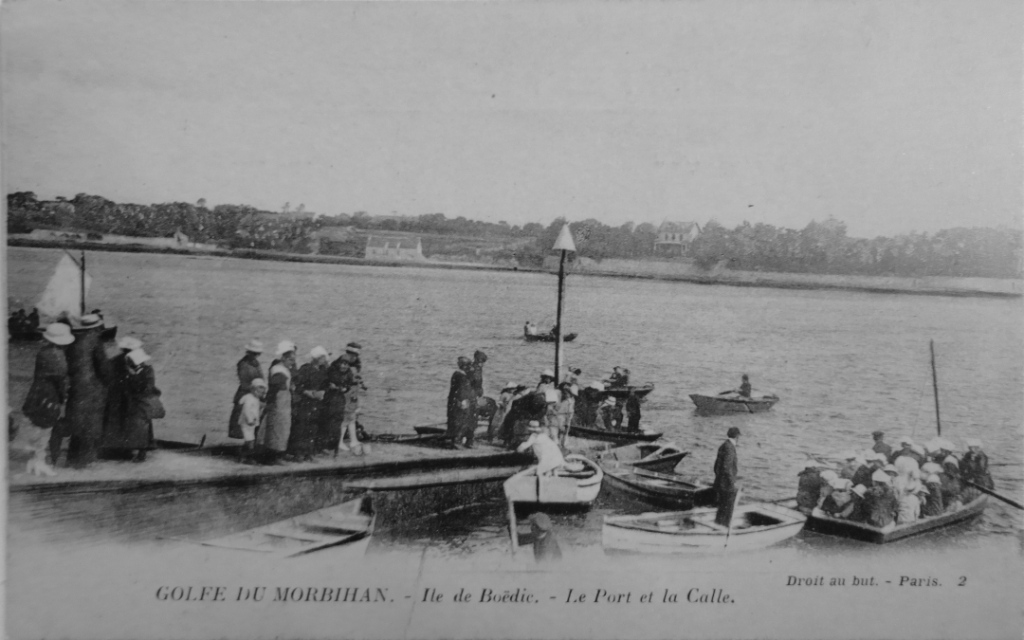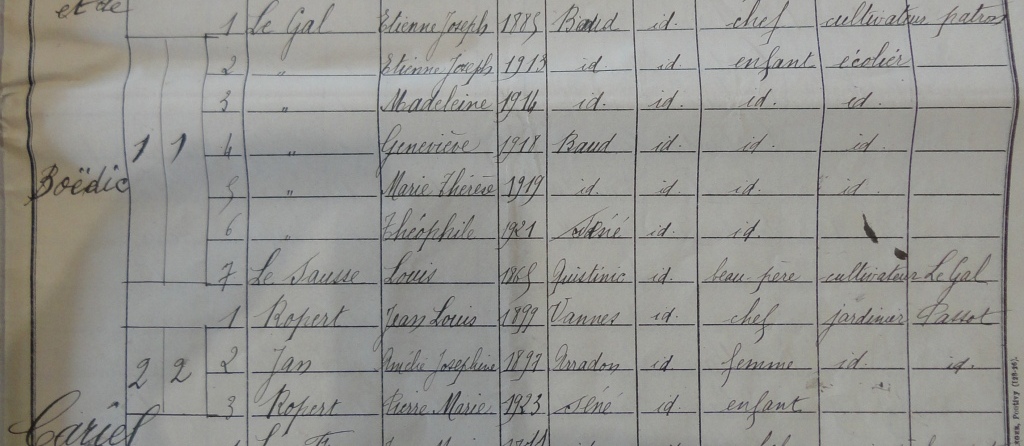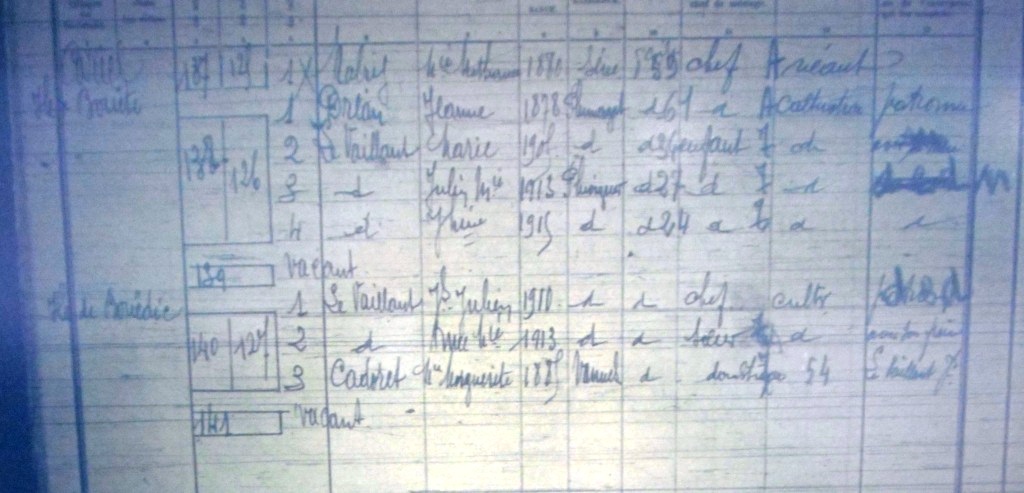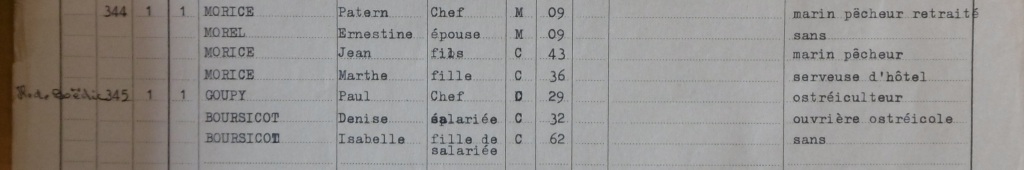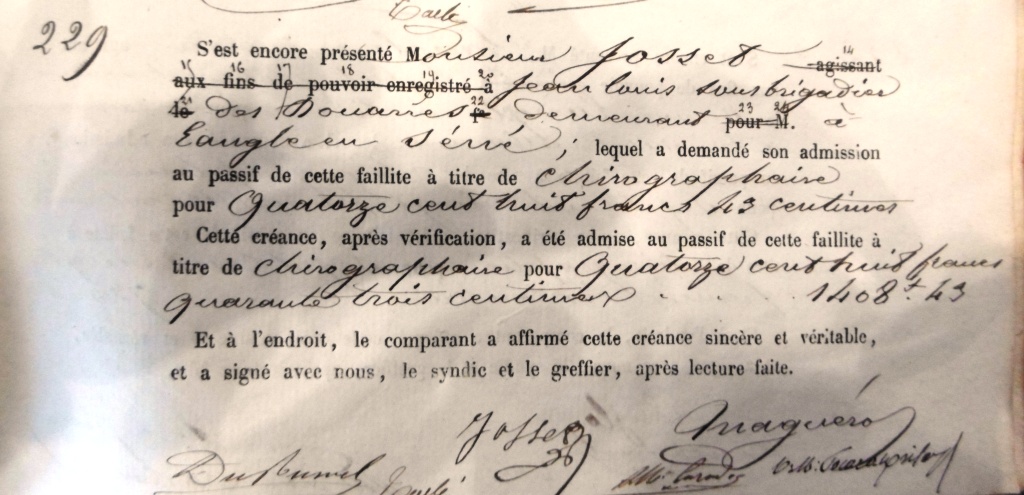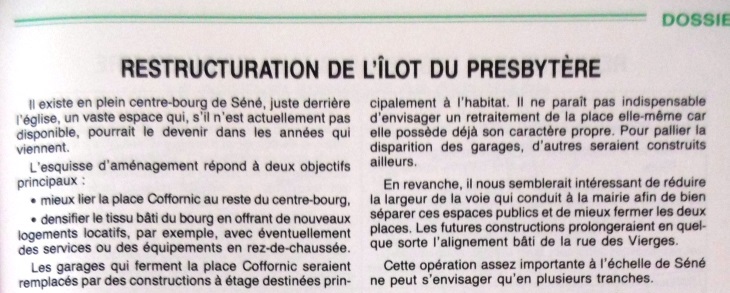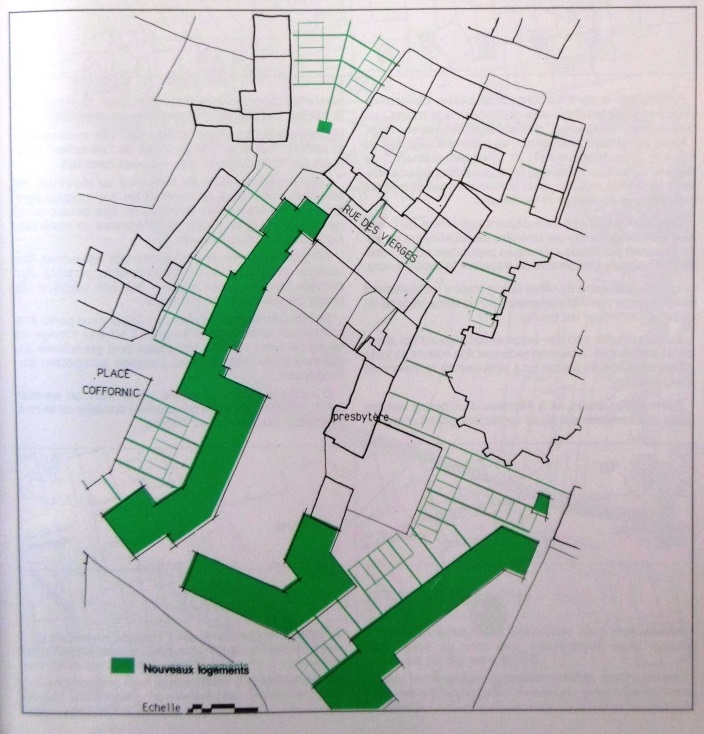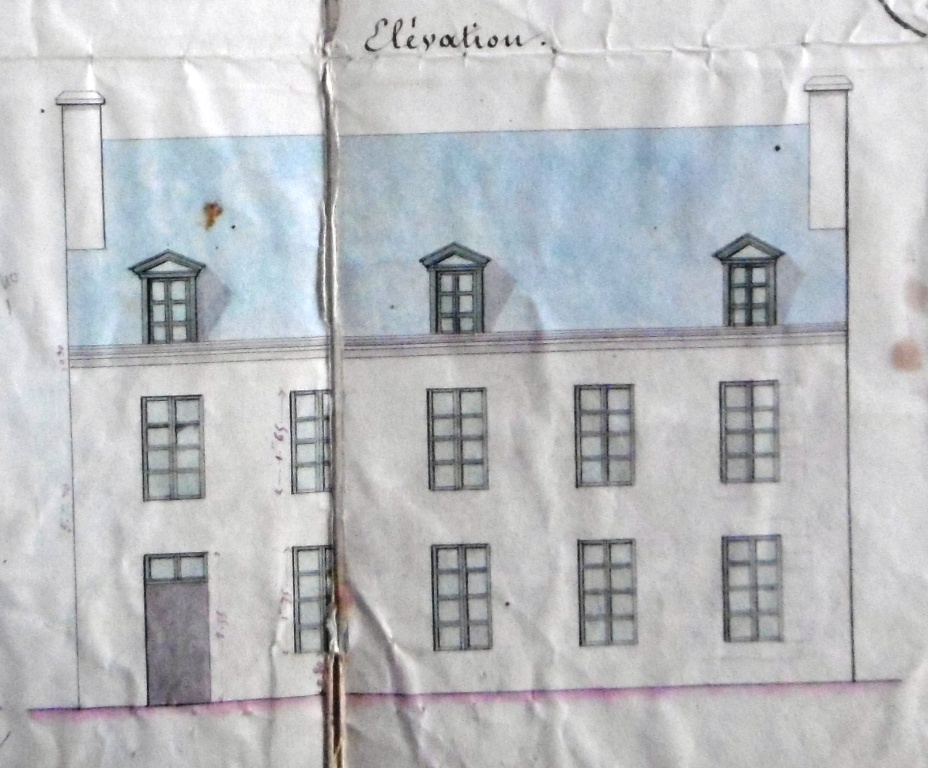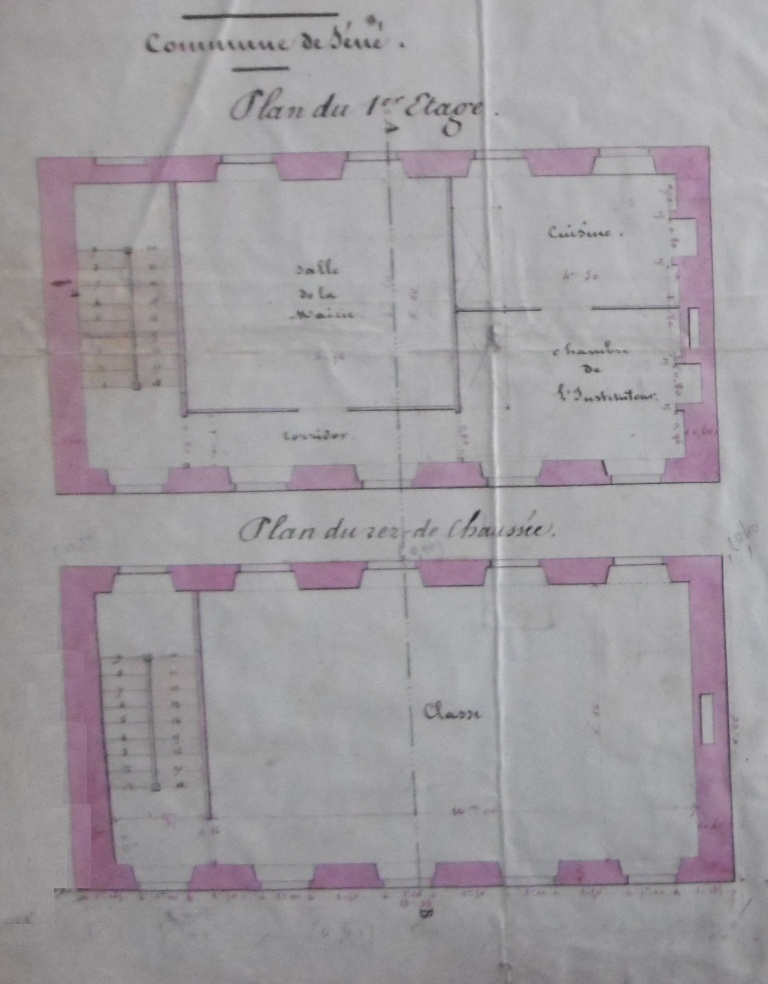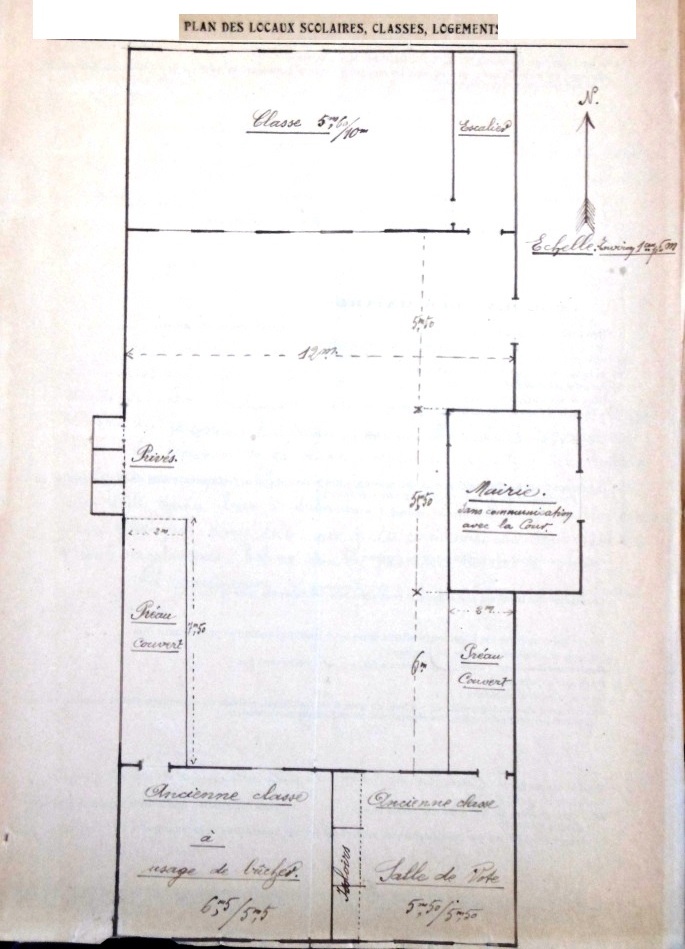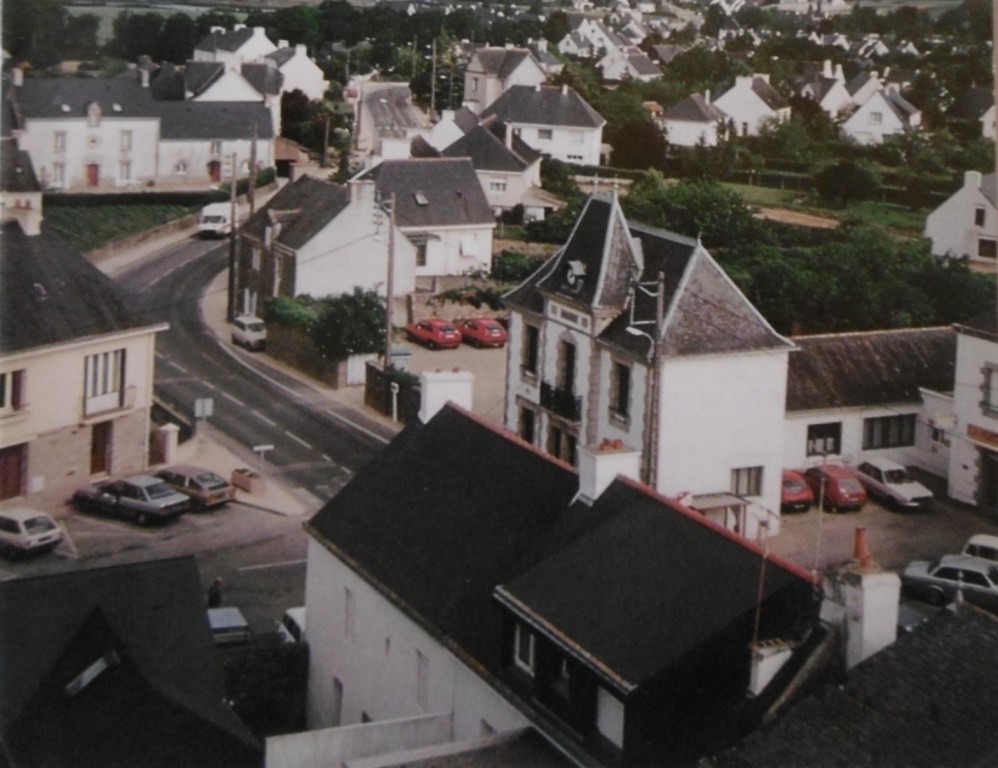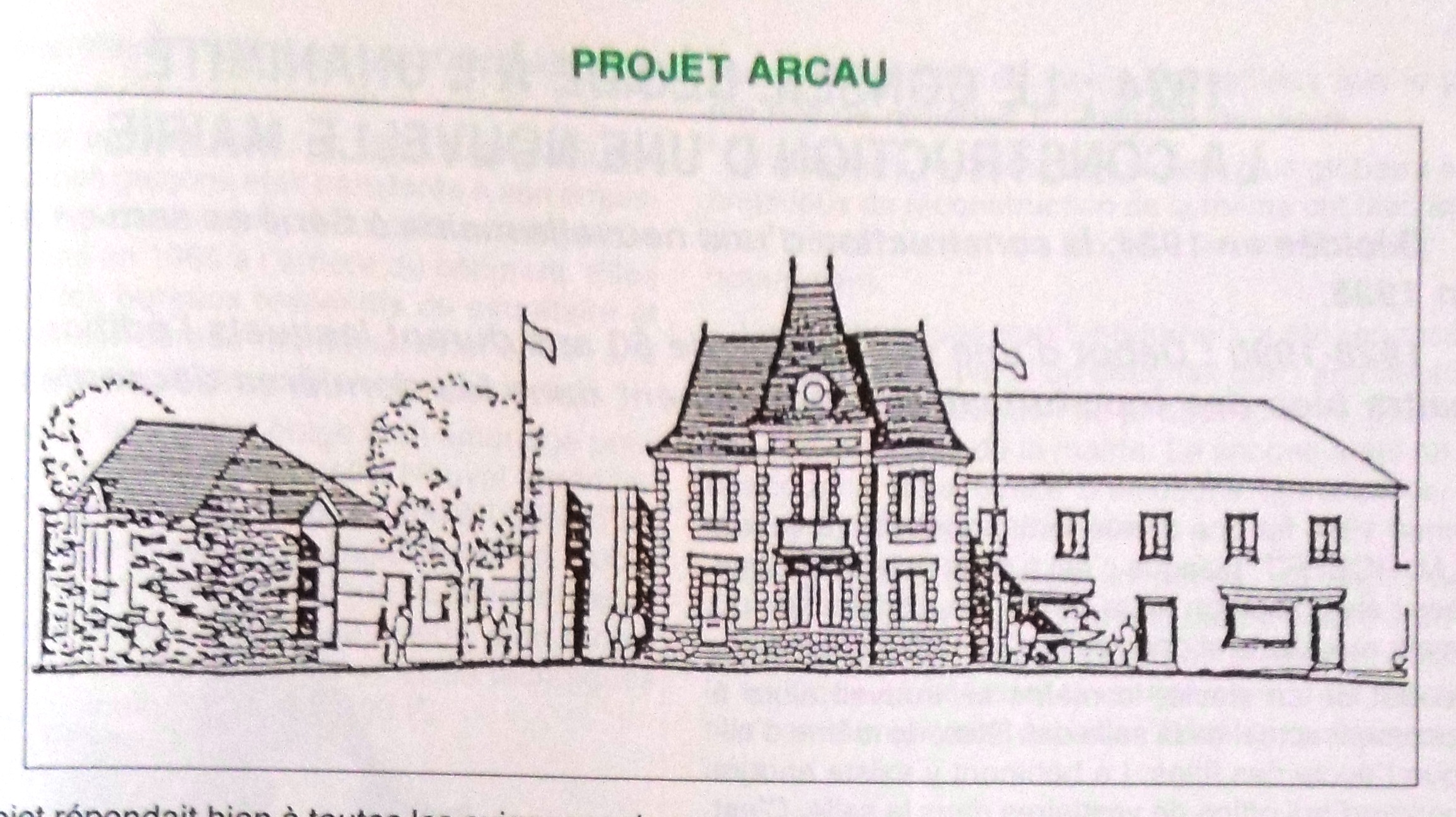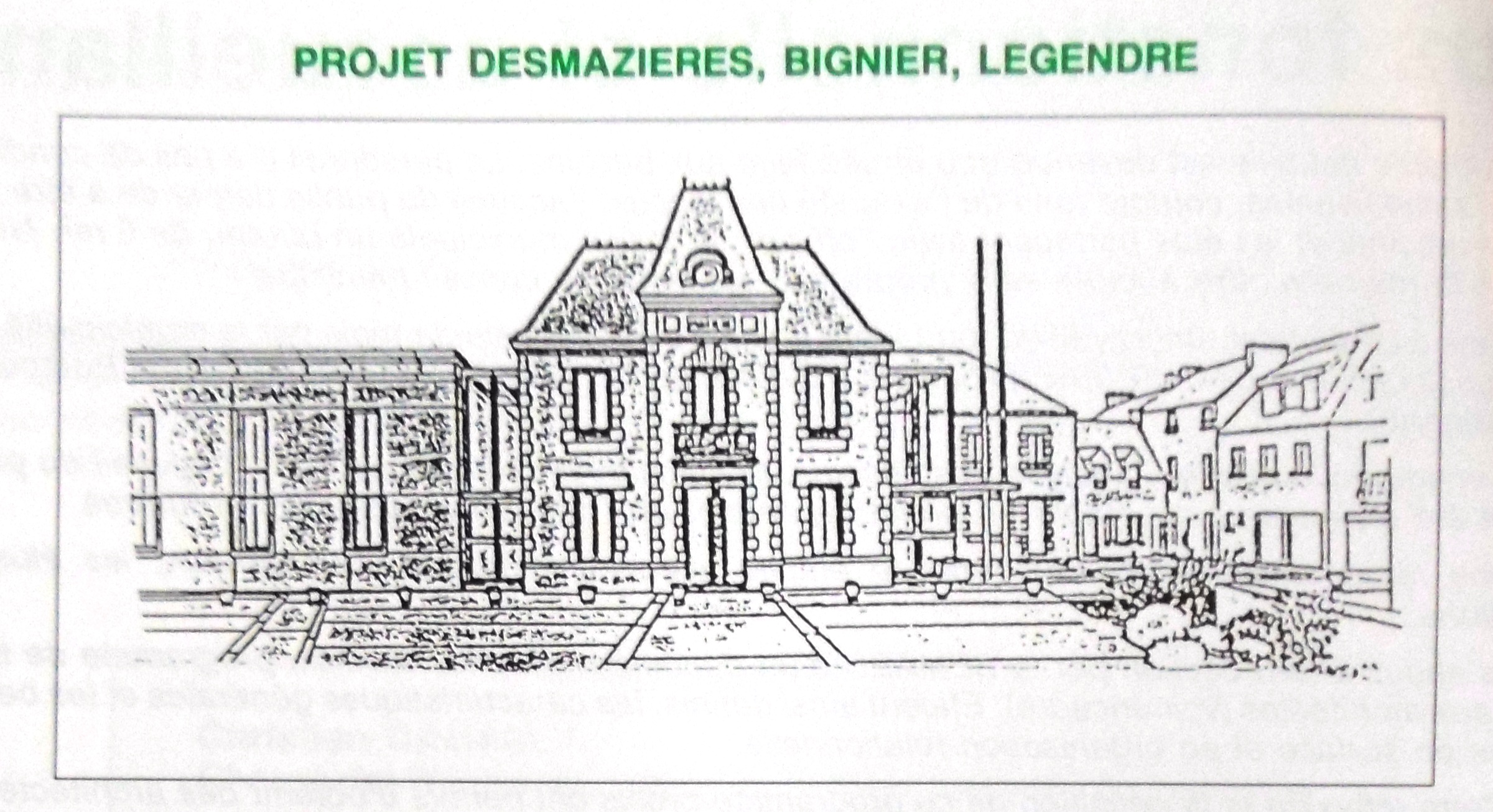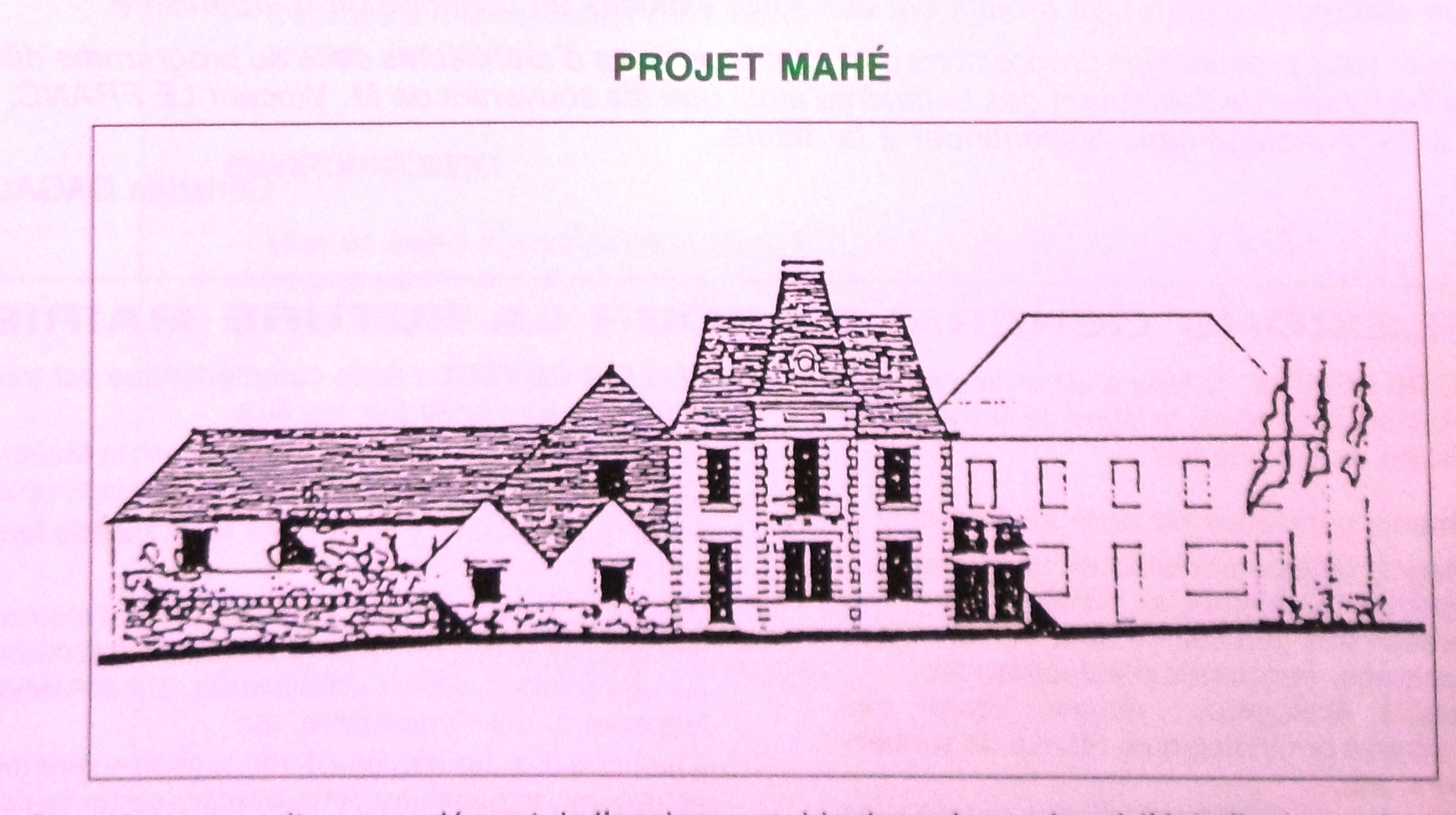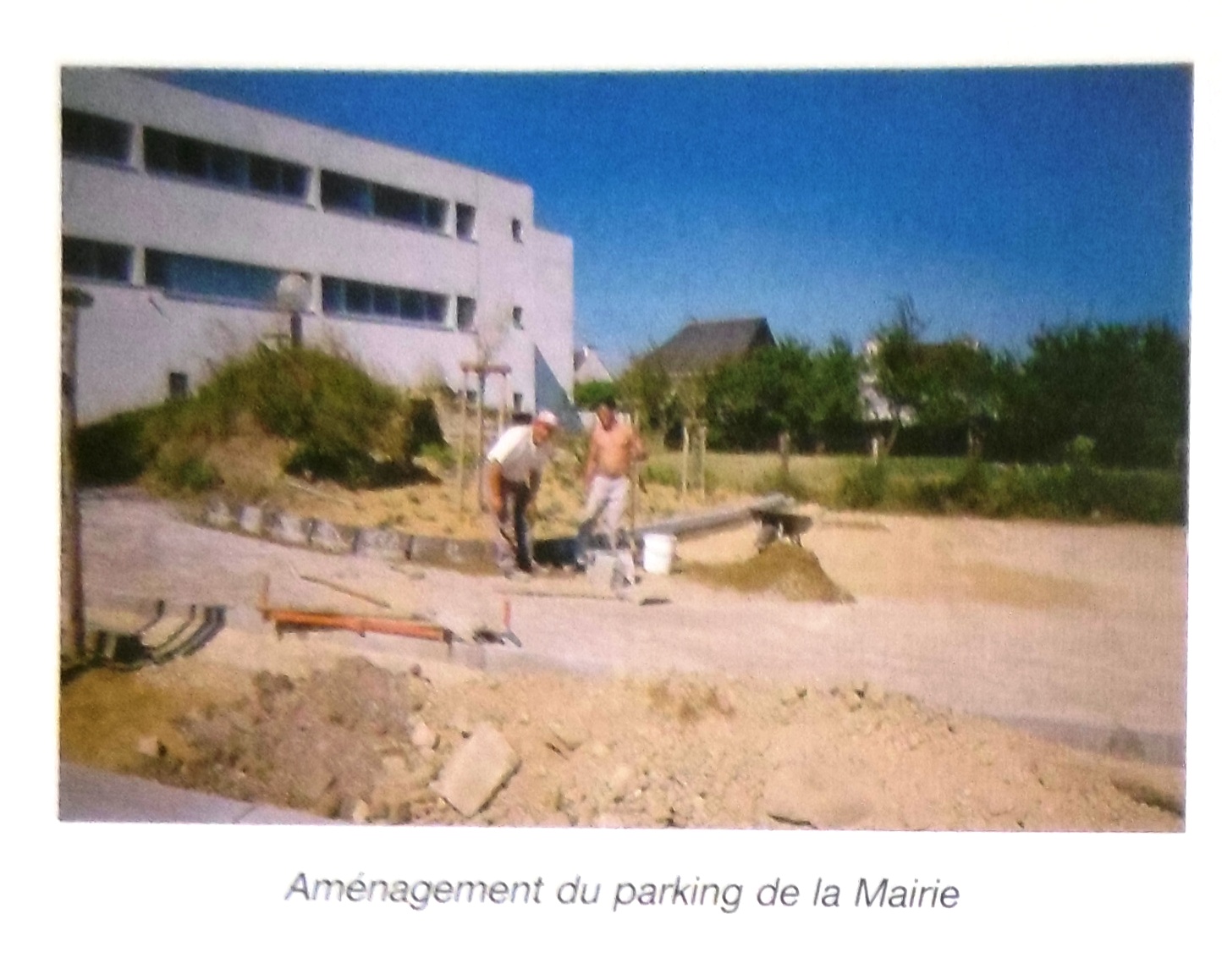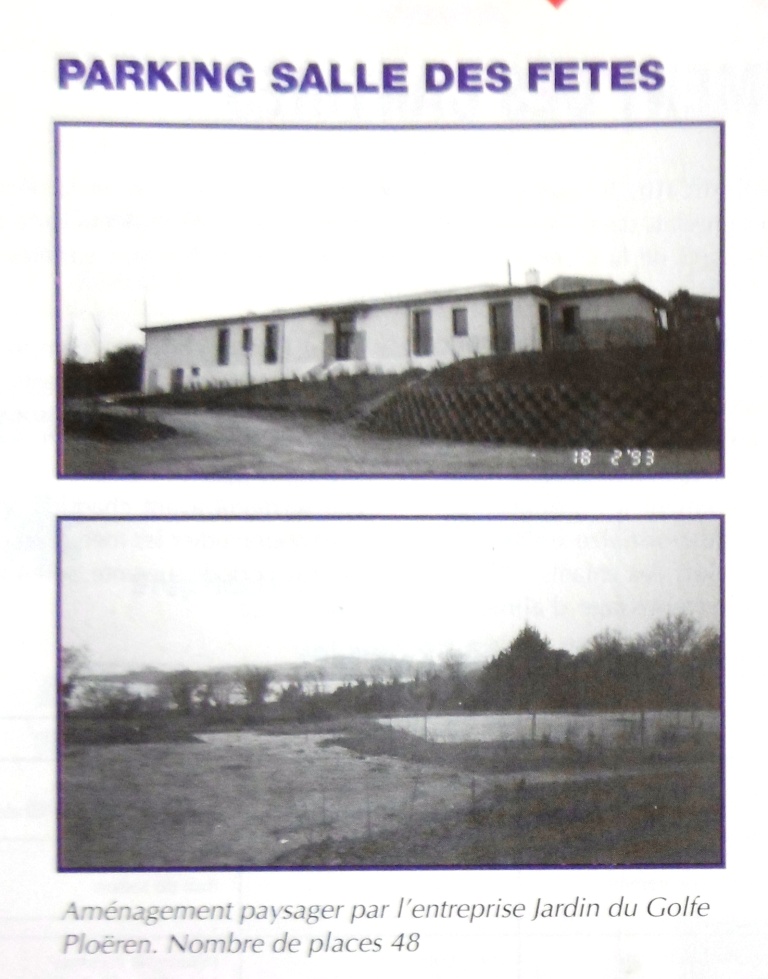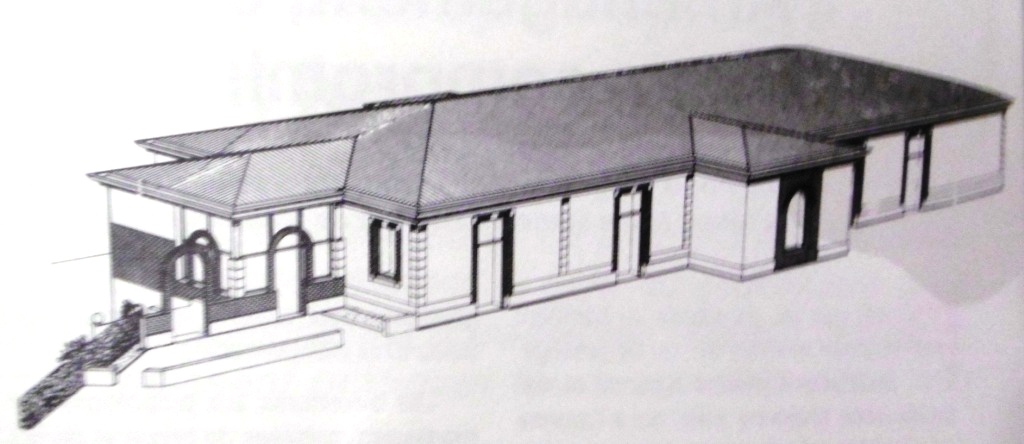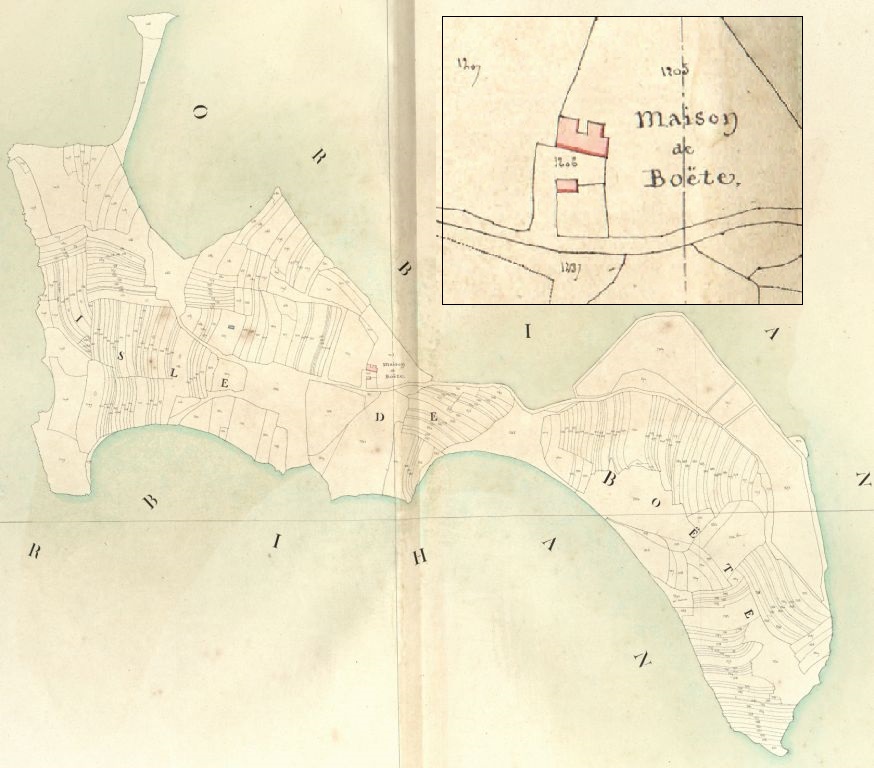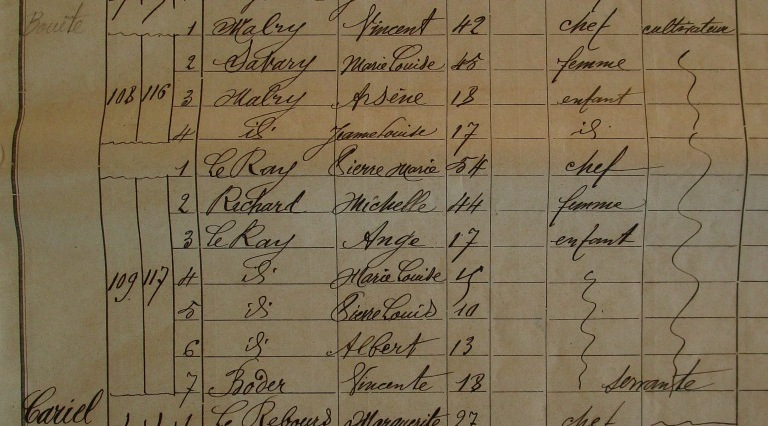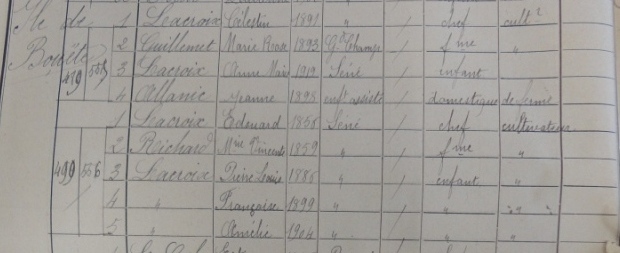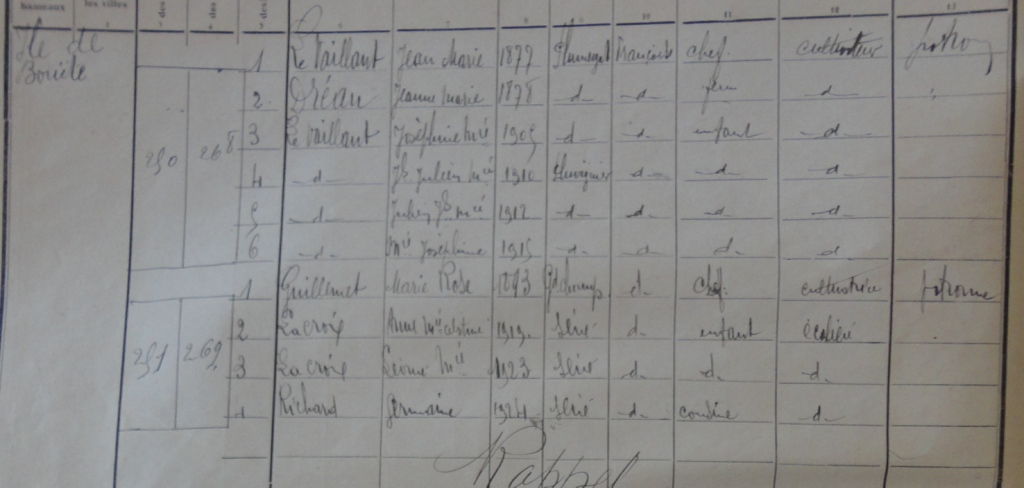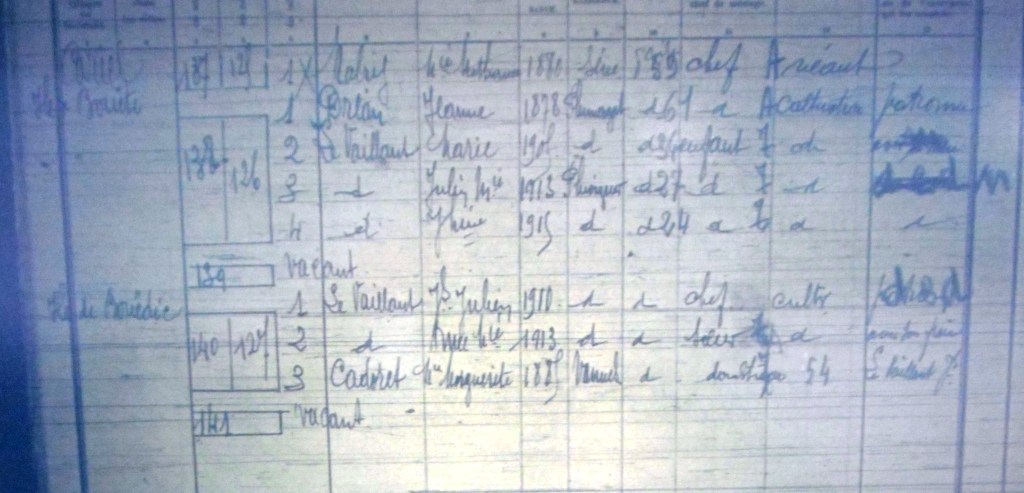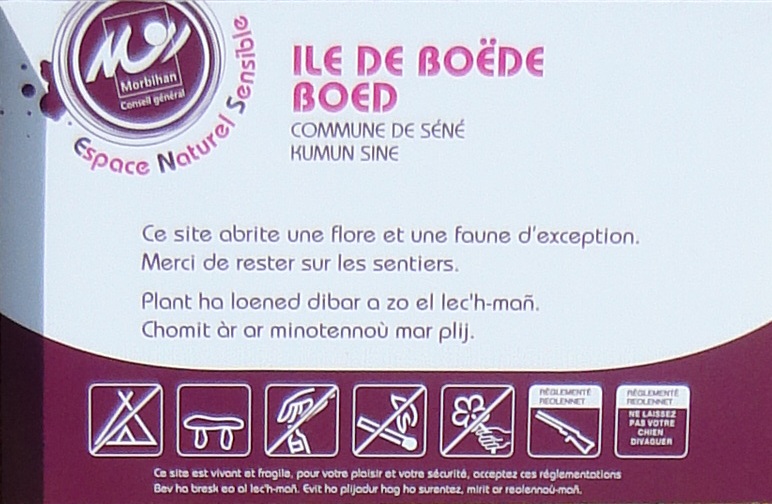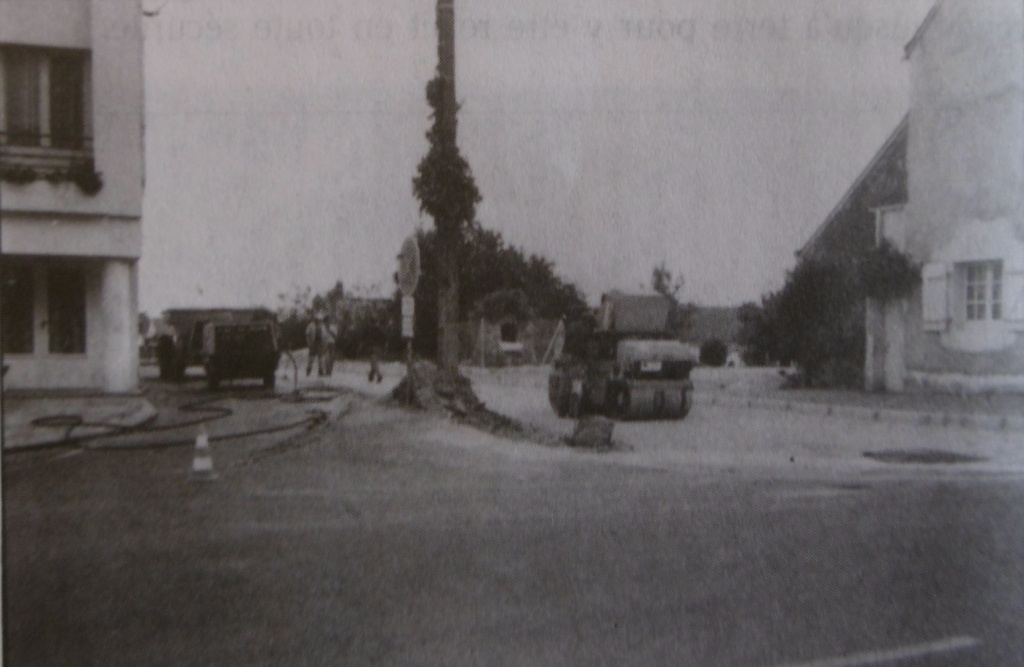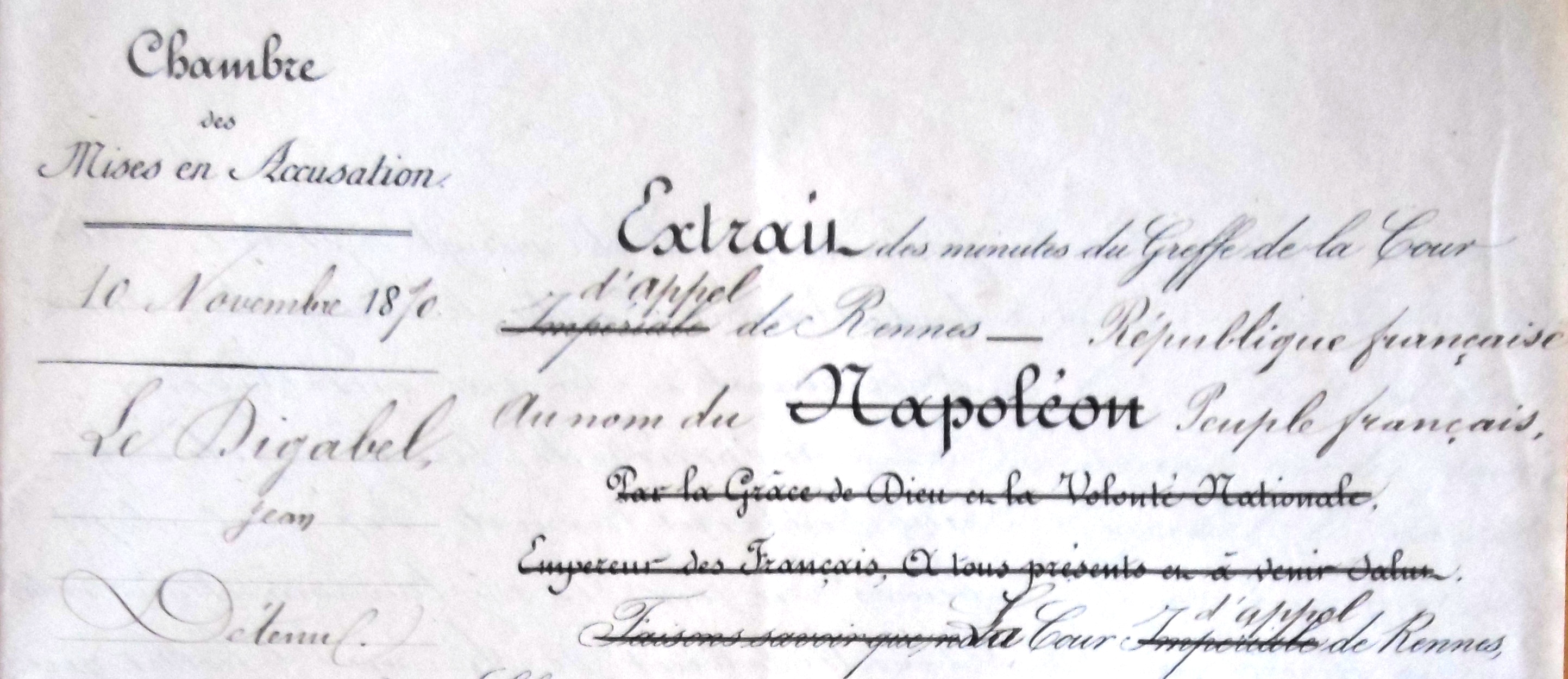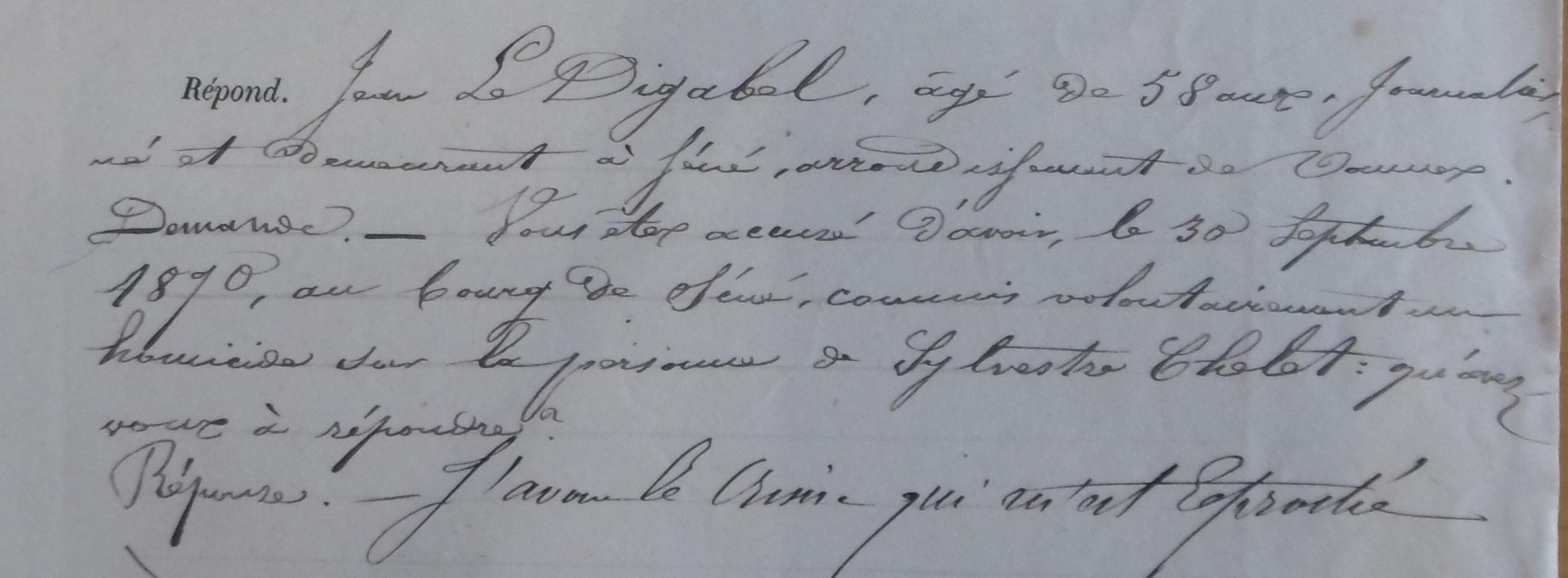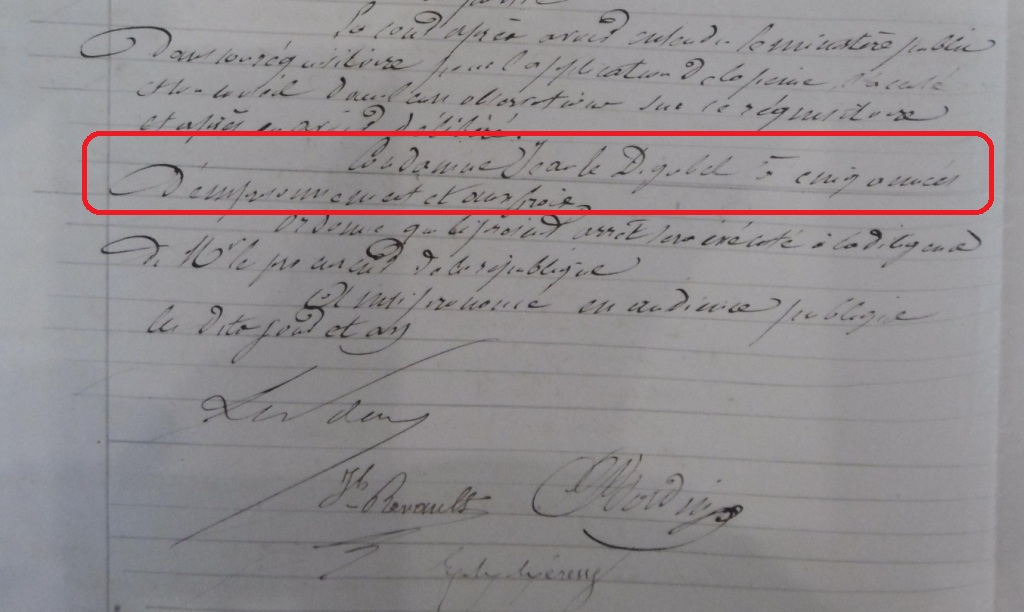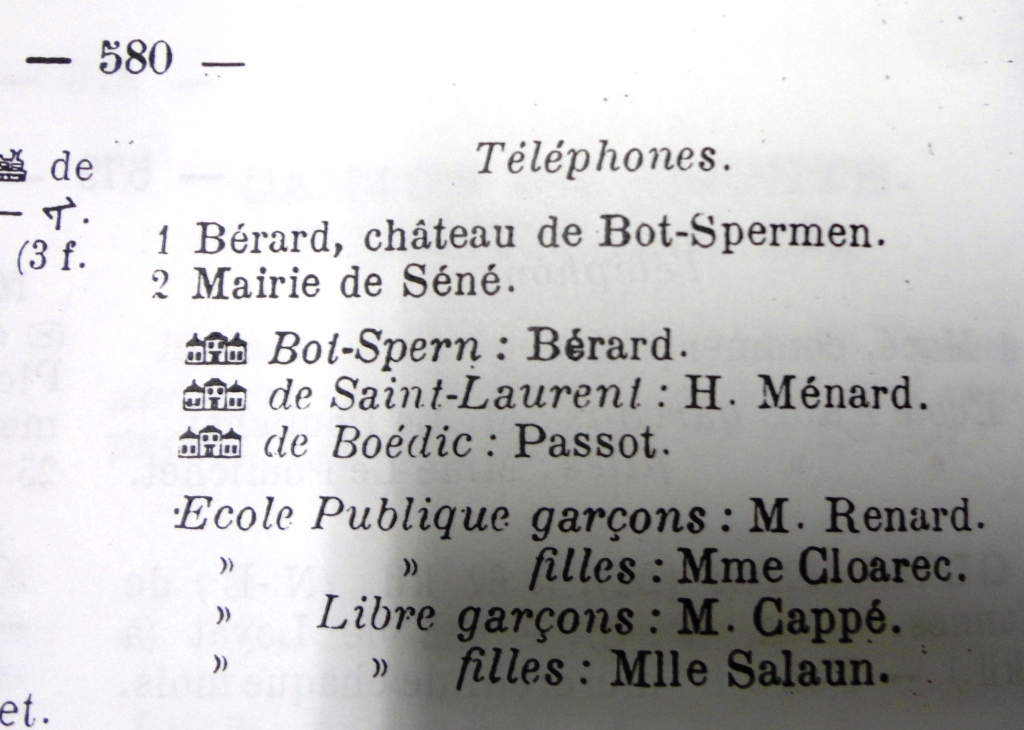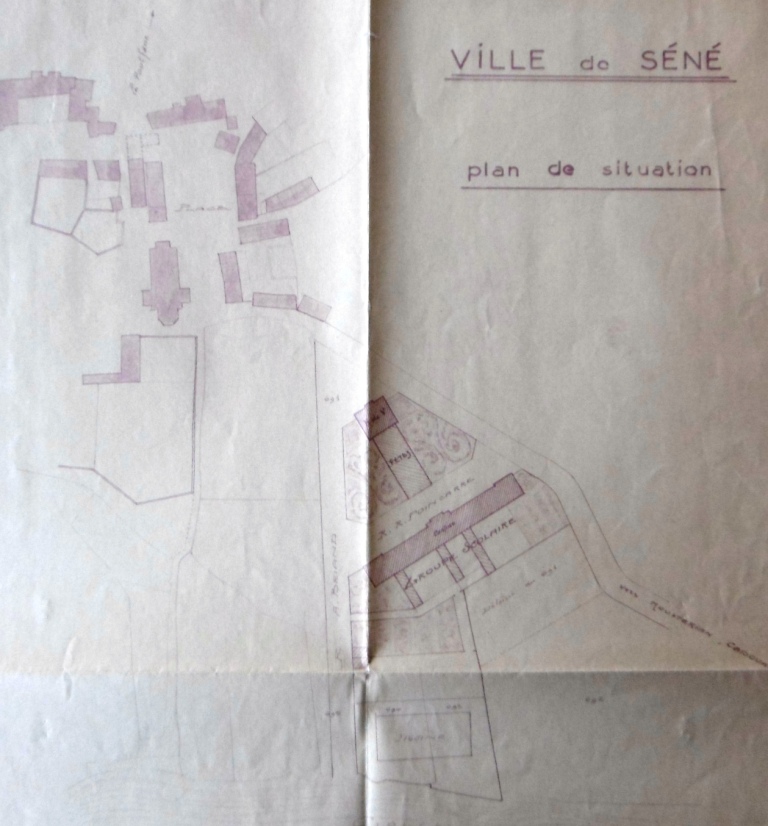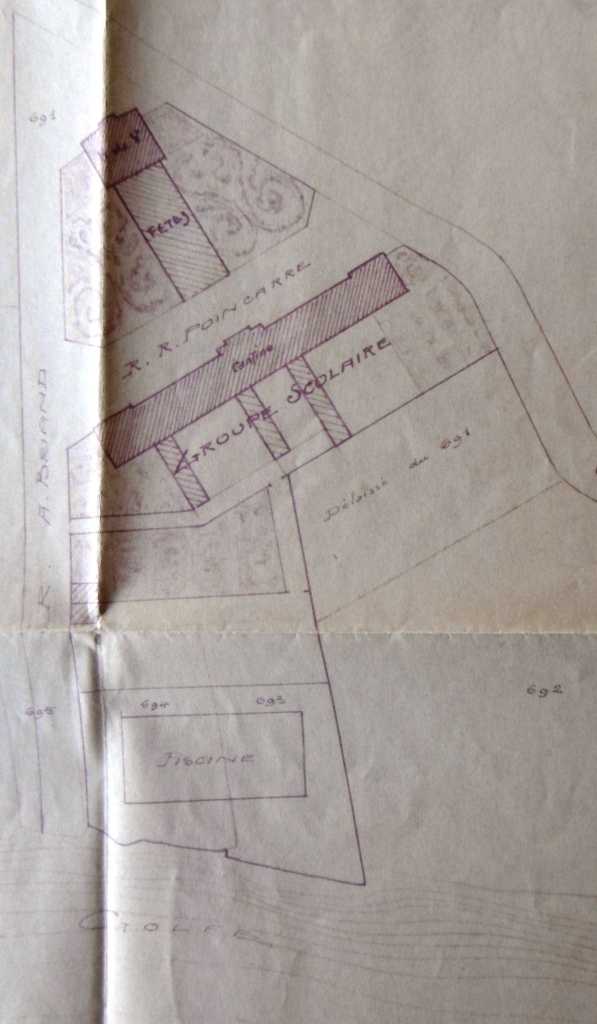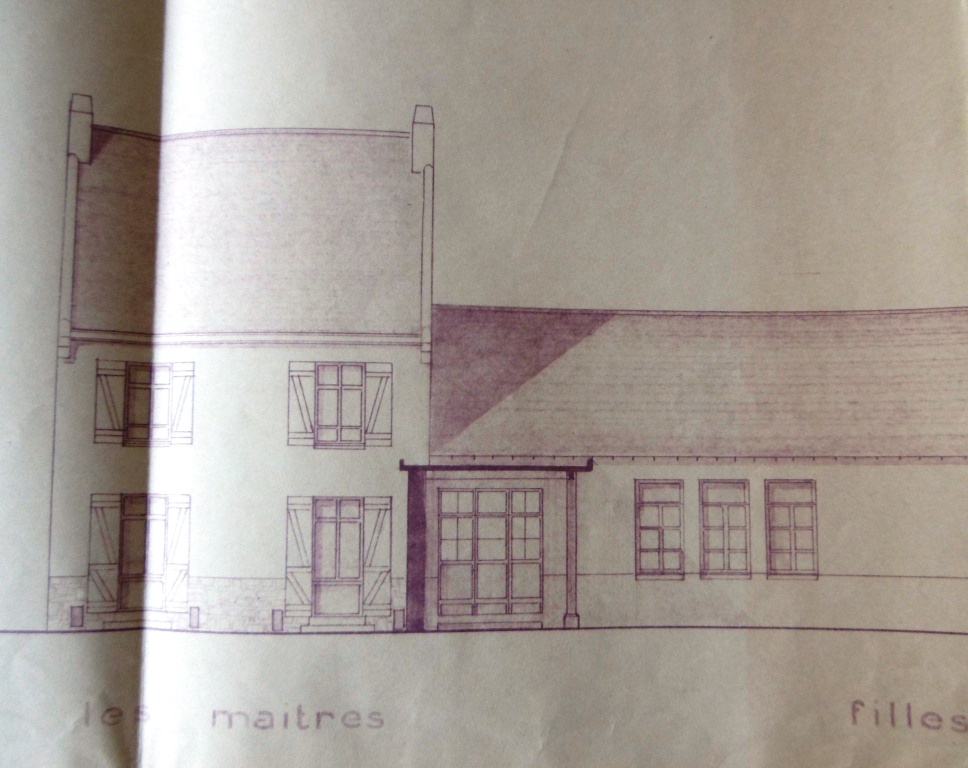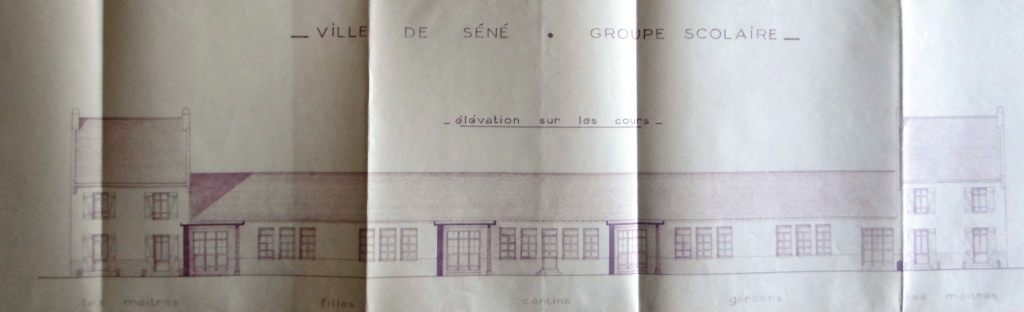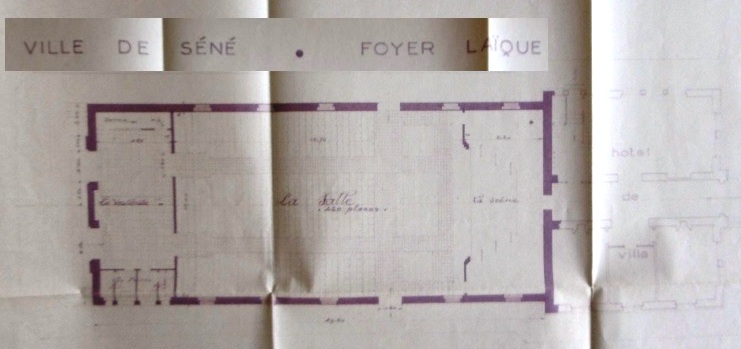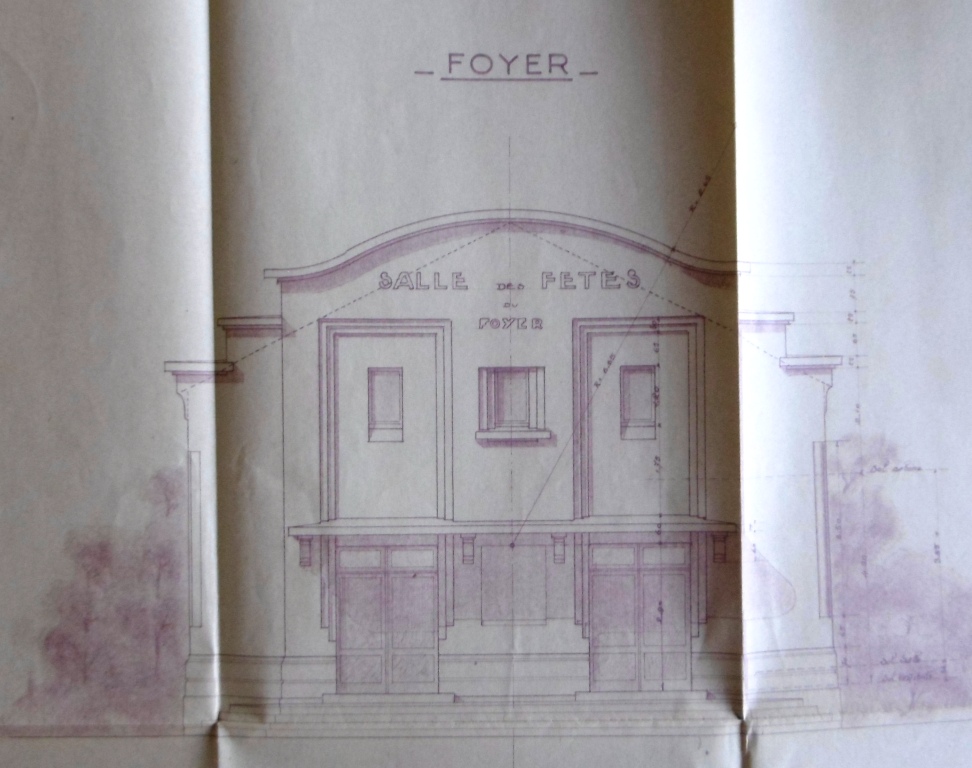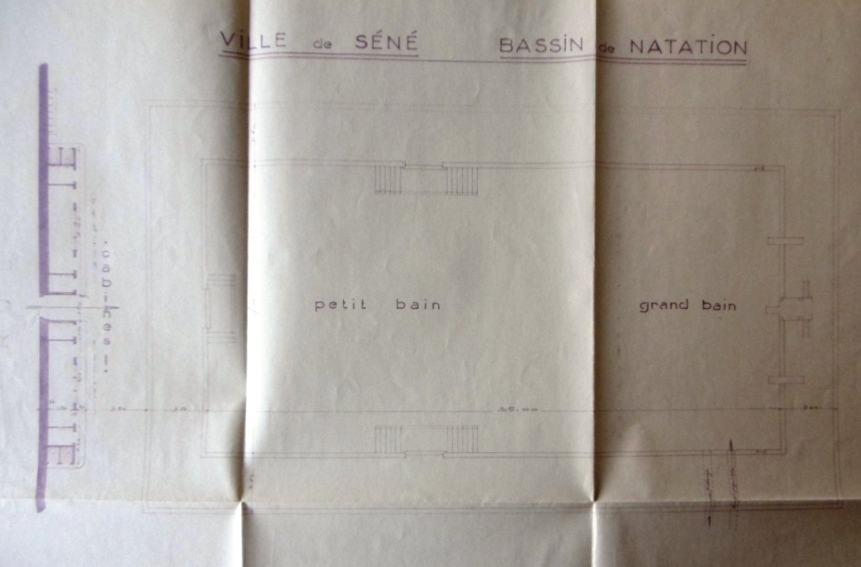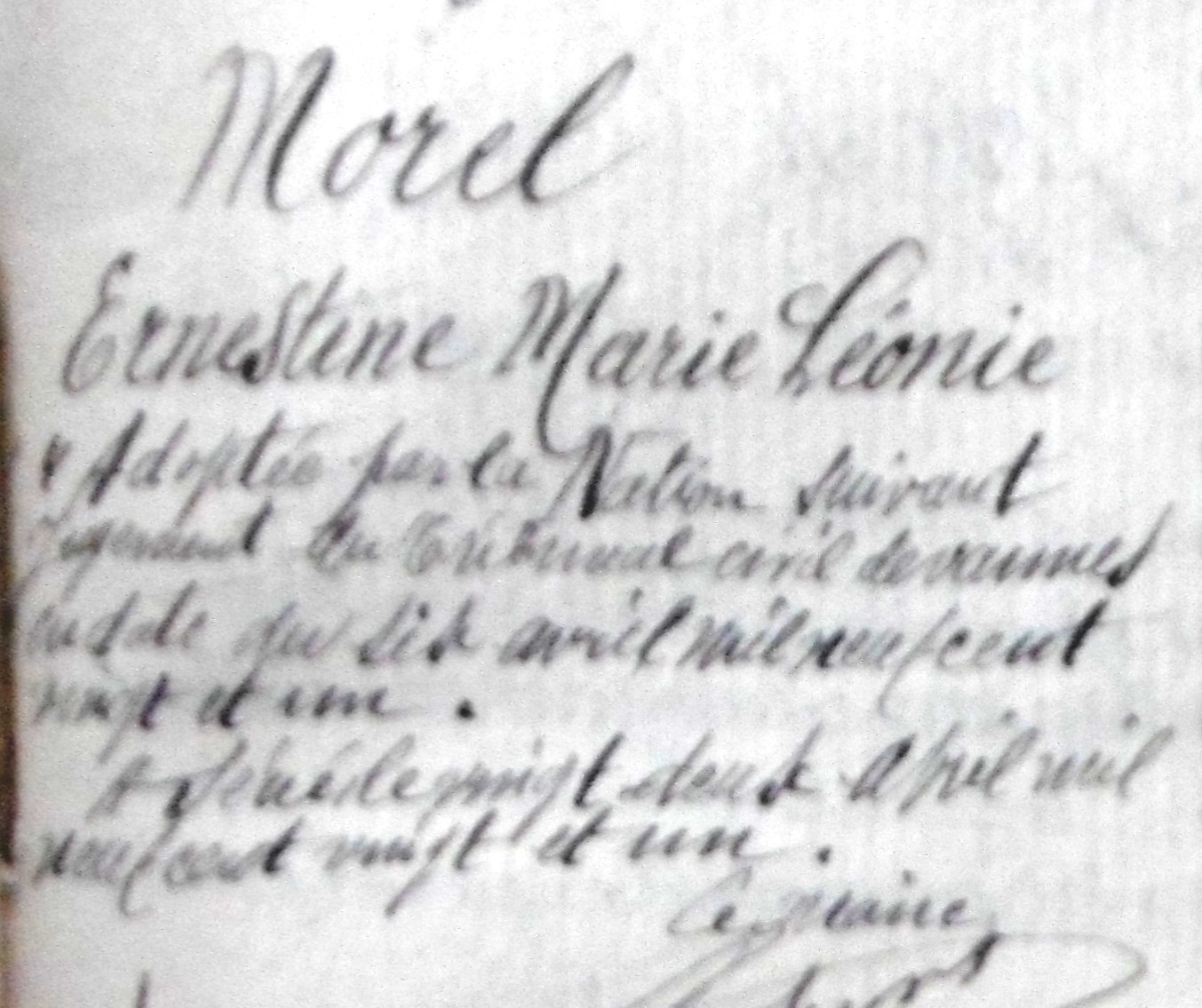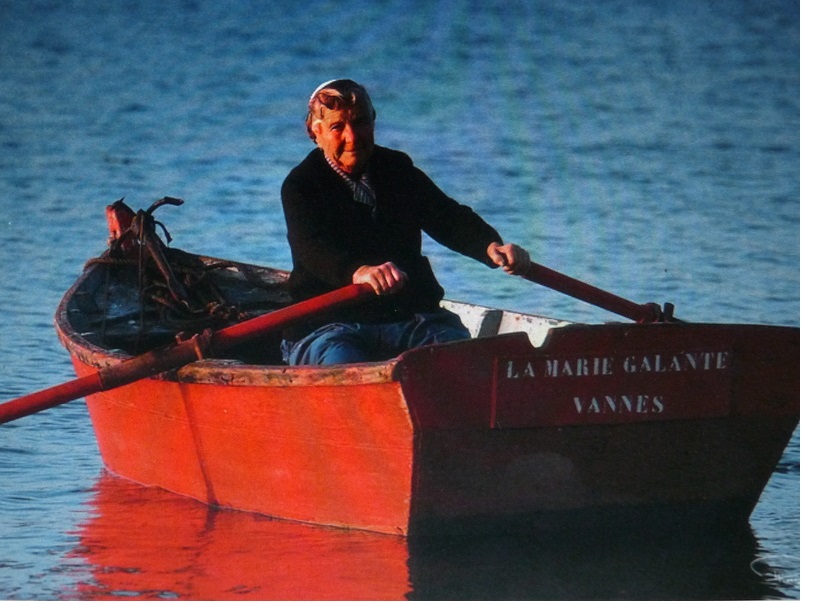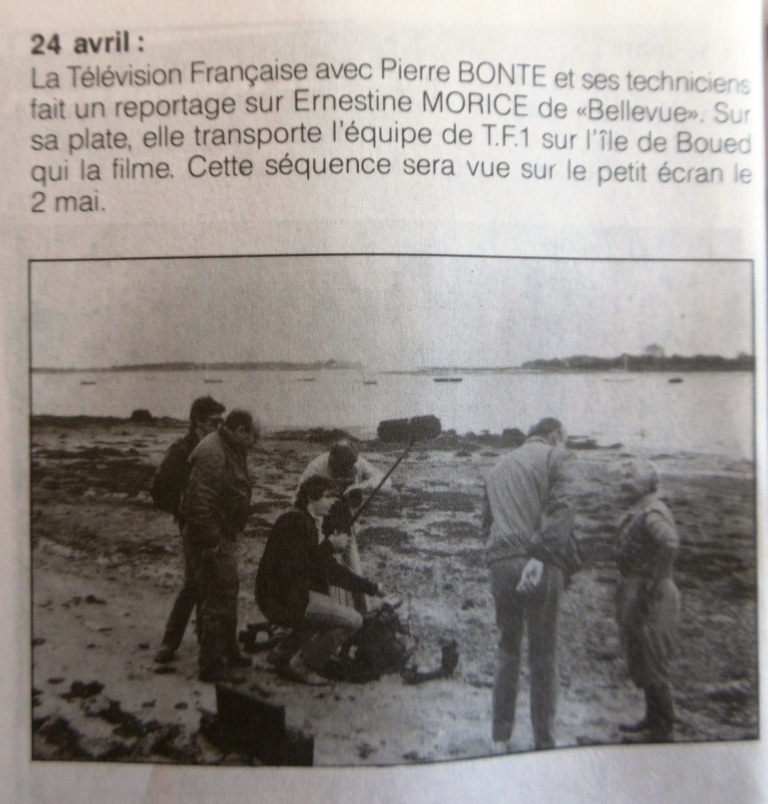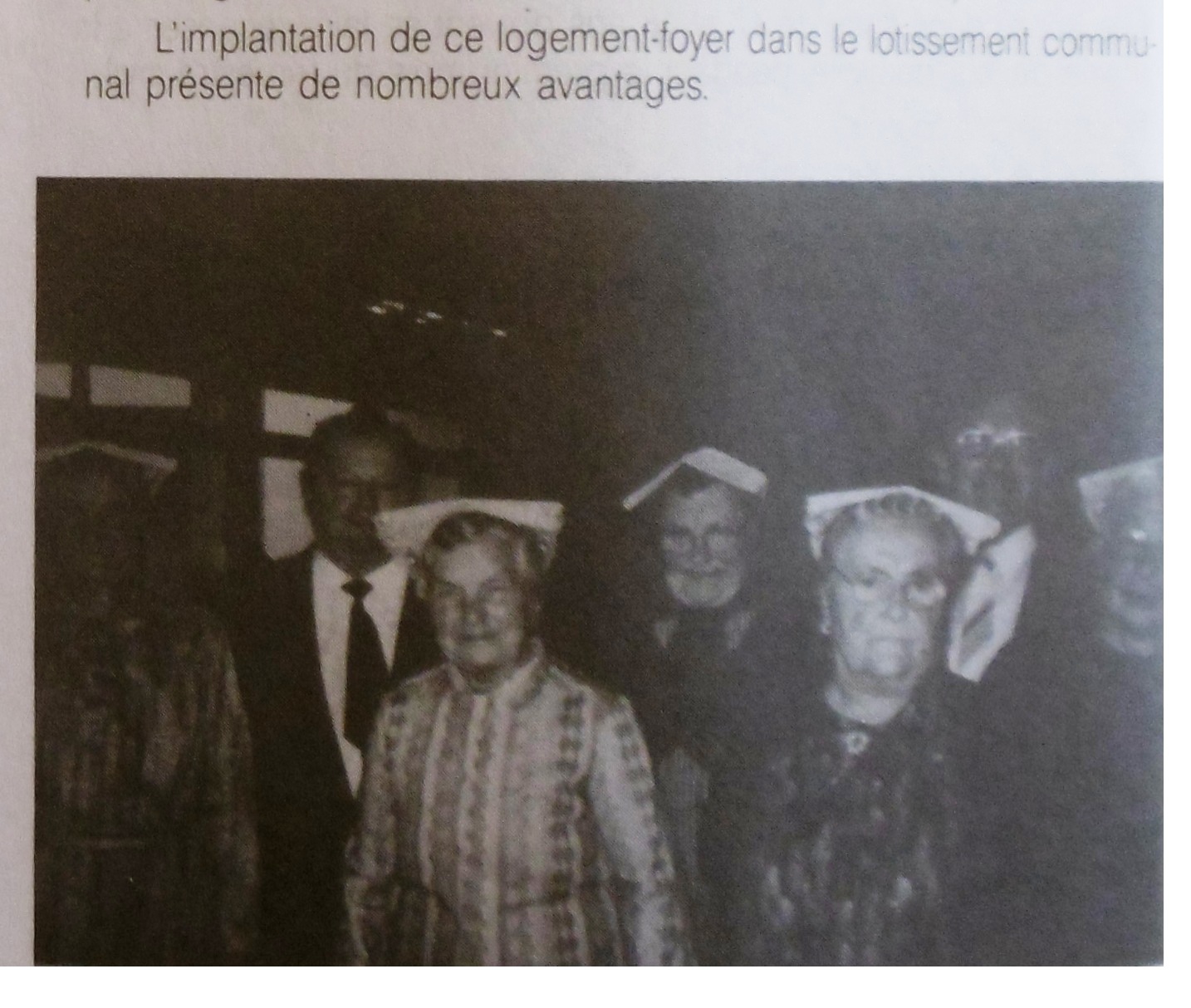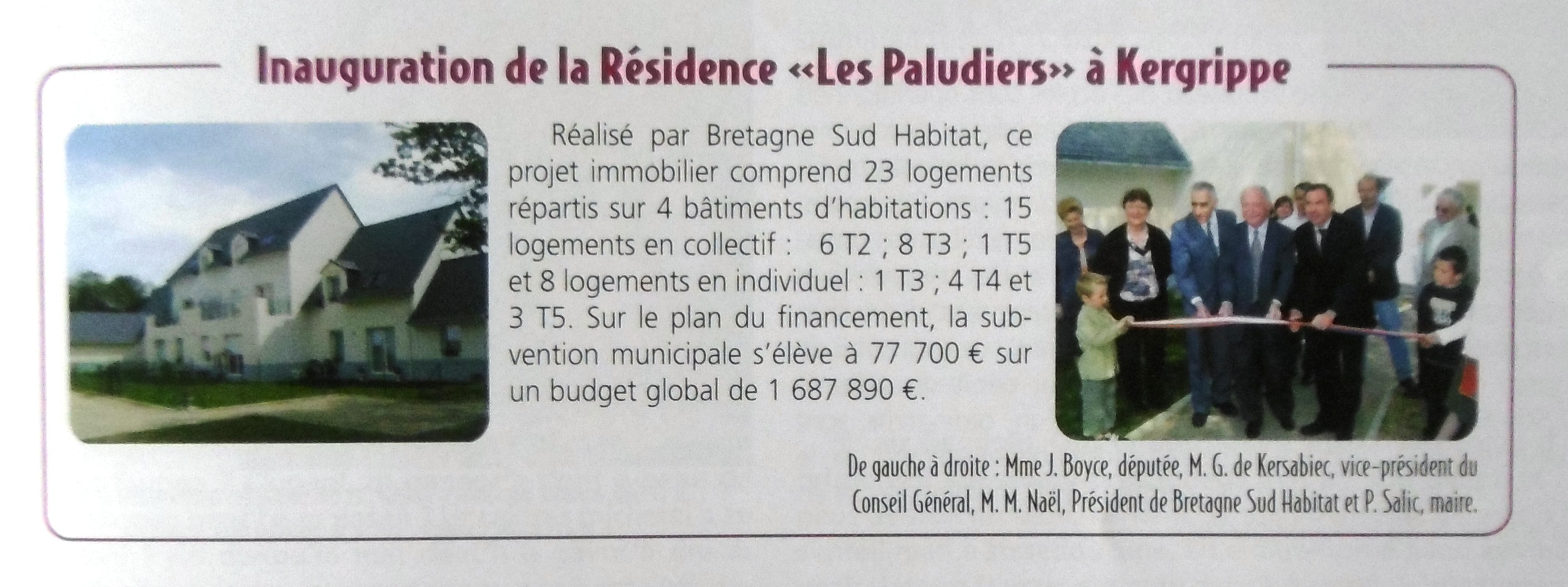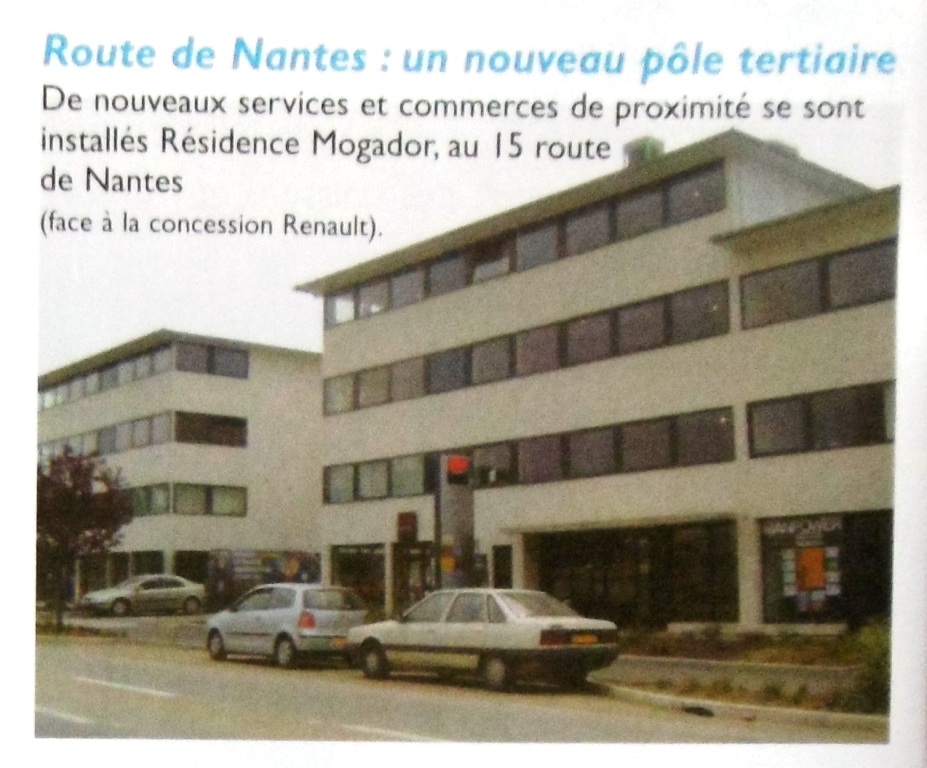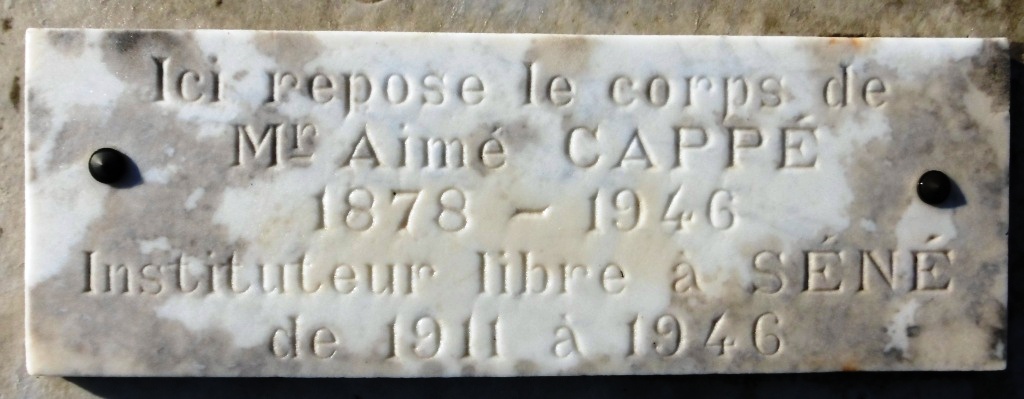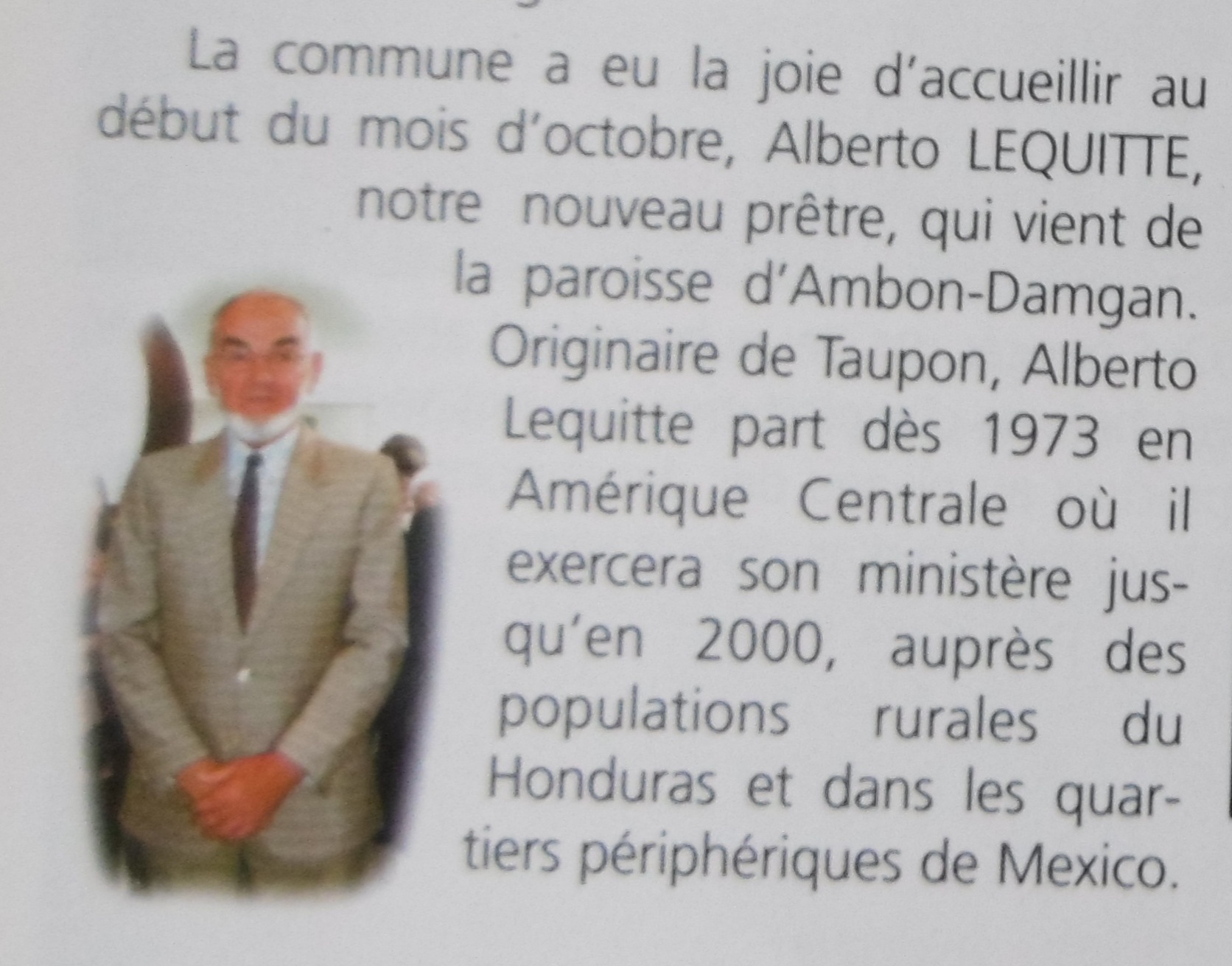CHRONIQUE
Les possessions des Sœurs de la Visitation à Séné
L'ordre de la Visitation fout fondé en 1604 à Annecy. Jeanne-Françoise Frémyot, baronne de Chantal, jeune veuve de 28 ans et mère de quatre enfants, rencontre à Dijon l'évêque de Genève, François de Sales. Entre eux, va s'établir une grande amitié spirituelle, qui va la pousser à venir s'installer près de lui à Annecy et à fonder l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie.

L'ordre va se développer rapidment et parvenir dans l'ouest de la France, En 1635, les soeurs de la Visitation, à l'étroit dans leur couvent du Croisic viennent s'établir à Vannes, où elle construisent un couvent en 1652. Aujourd'hui, derrière la mairie, sur la parking subsiste des arcs, ultimes vestige de ce couvent qui fut également le siège de la Caserne des Trente.
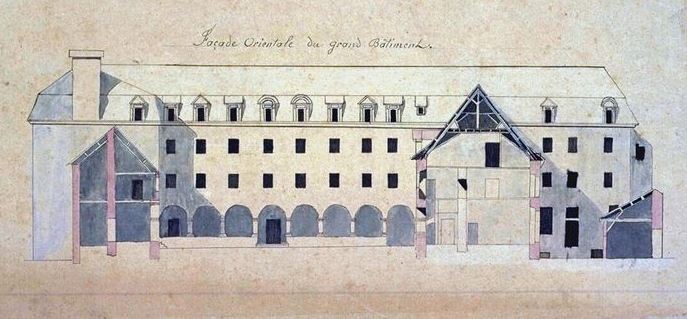
Outre les immeubles situés à Vannes, les religieuses de la Visitation avaient aussi quelques propriétés répandues dans les paroisses limitrophes comme Elven et Séné.
En 1714, le 30 janvier, par acte au rapport de M. Le Barbier, notaire royal, les religieuses de la Visitation de Vannes acquirent de dame Renée Truillot, épouse et procuratrice générale d’écuyer Guillaume Le Bartz, « avec promesse et obligation de toute garantie, le lieu et maison noble d'Auzon, avec ses appartenances et dépendances, situées en la paroisse de Séné, y compris une pièce de terre sous vigne, cernée de murailles, contenant environ un journal de terre, autrefois appelée la vigne de Randrecar ou de Callac, proche la dite maison d'Auzon, et une autre pièce de terre, contenant environ deux journaux, située en la motte d'Auzon, à la charge aux dites religieuses de tenir et relever les dites maisons d'Auzon et deux pièces de terre prochement et noblement du Roi notre sire, sous la cour de Vannes, à devoir de rachat, foi et hommage ;
On reconnait là la belle demeure d'Ozon avec son enceinte en mur de pierre, qui ironie de l'histoire, a été planté d'une vigne en 2020-2024.
En 1714 encore, le 22 février, par acte au rapport de M. Le Barbier, « Messire Jean de la Monneraye, [5/12/1666-16/12/1737] chevalier, seigneur de Bourgneuf, et dame Marguerite Le Mézec,[10/12/1682-25/11/1755] son épouse d'Auray, vendirent aux Religieuses de la Visitation la maison, terre noble et seigneurie de Cantizac et la Salle, situées en la paroisse de Séné, comprenant : le manoir principal et ancien du dit Cantizac avec les logements, pourpris, cours, jardins, vergers, fuie, garennes, bois de haute futaie et de décoration, rabines et taillis, prés et prairies ; — la métairie de Cantizac, avec tous ses logements, terres labourables, pâtures et friches, prés et prairies, jardins et vergers, vignes et étang ; — les quatre métairies nommées le grand et le petit Guergelen et le Guerneué : deux desquelles métairies sont à présent appelées Kervilio, et les deux autres Keravelo ; — la maison du moulin de Cantizac et celle du clos de Coetihuel, dépendant des dits pourpris, — les deux moulins à mer de Cantizac et d'Herbon, avec leurs chaussées, étangs, refouls, logements, issues et franchises ; — une maison ruinée, avec ses prés, terres labourables, landes, pâtures et vignes, nommée Penn-er-Sal ; — les rentes foncières et censives, dépendant des dites terres de Cantizac et de la Salle, droit de banc et enfeu prohibitifs, tombes élevées dans le choeur et chanceau de l’église paroissiale de Séné, et autres droits honorifiques et de prééminence appartenant aux dites terres et seigneuries de Cantizac et de la Salle ; — de plus le droit de four à ban de la paroisse de Séné et droit de bannalité, reconnus par les commissaires du roi le 28 décembre 1689 et le 19 mai 1690 ; — le tout échu à la dite dame de Bourgneuf des successions d’écuyer Julien Le Mézec, sieur de Saint-Jean, et de dame Marguerite Champoing, ses père et mère ;
« A la charge eaux dites religieuses de les tenir et relever prochement et noblement du roi notre sire, sous son domaine et juridiction de Vannes, et de payer pour l’avenir, et à compter du jour de Toussaint dernier, les rentes par argent et grains, qui se trouveront dues tant au dit domaine qu’à autres ; la dite vente et cession ainsi faite entre parties, pour et en faveur de la somme de 30,000 livres tournois de principal et accessoires... » (Présidial. B. 315. p. 69).
En la même année le 23/08/1714, les mêmes religieuses restèrent adjudicataires des maisons et métairies de Kerdavy et de Cariel, avec un moulin à vent, le tout situé en la paroisse de Séné ; ces biens provenaient de la succession bénéficiaire de Robert Loyer et de Nicole de la Roche, sa femme, et furent vendus, en la juridiction de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes, pour la somme de 15,050 livres tournois. (Présidial. B. 315. p. 119)
Les biens de la communauté étaient administrés par la supérieure, assistée d’un conseil de discrètes. Chacune d’elles était élue pour trois ans, et pouvait être continuée pendant trois autres années, après lesquelles il fallait une interruption.
A la Révolution, la terre de Cantizac et ses dépendances furent acquises, le 20 avril 1791, par M. Périer, de Lorient, au prix de 85,000 livres.
Pêche en fraude, 1729, par l'Abbé LE ROCH
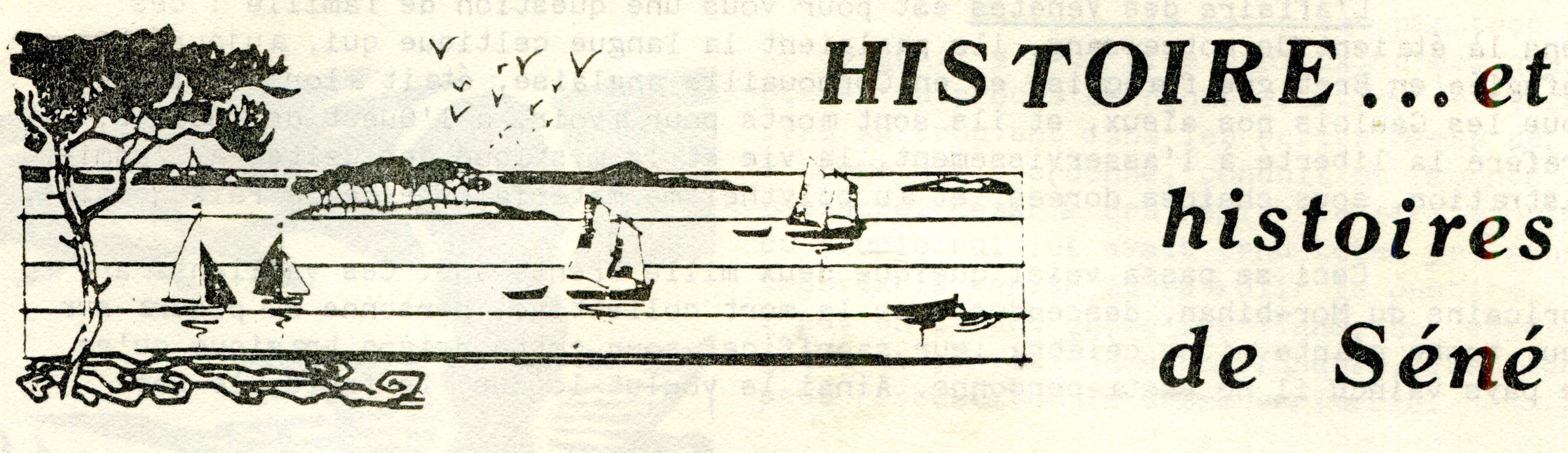
3.- DU MOYEN-ÂGE A LA REVOLUTION
Le Sinagot vu par "le petit bout de la lorgnette": une anecdote en date de 1729, qui montre que, pour sa survie et celle de sa famille, le Sinagot sait "tirer des bords" face à la "LOI"...Ci-dessous le texte "en clair" que vous aimerez auparavant essayer de déchiffrer dans les pages qui suivent. MERCI à M. Bertrand, de l'Inscription Maritime qui nous les a communiquées.
22 Septembre 1729- Interrogatoire du Particulier Cy-après fais par Nous Noël Bourgeois Escuyer, Sieur de Limur, Conseiller du Roy, et Lieutenant Général del'Amirautée de l'Esveschée de Vannes ayant avec nous pour greffier Vincent Gavelo Le Thieis duquel le Serment pris il a promis et juré la main levée de se comporter fidellement ayant aussi pour Interprette de la langue bretonne à la française Pierre Auffrédo duquel pareillement le Serment pris il a promis et juré la main levée de se comporter fidellement auquel interrogatoire avons vacque à Requeste du Substitut du procureur du Roy comme suit à Lisledarts. Ce jour Vingt deux Septembre mil sept cent vingt neuff..?.. Conduit devant nous par nos huissiers, un particulier duquel le serment pris, il a promis et juré la main levée de dire vérté.
Interrogé de Son nom, qualitée et demeure. Répond par l'interprette s'appeler Le Ridant et Reffusant de nous dire son nom de Baptêsme, calfat de profession, âgé de (45) quarante cinq ans, demeurant au village du Mousterian en Sene.
Interrogé d'ou vient. Il fuyait devant nous ce jour dans la chaloupe et d'ou vient il a reffusé aussi bien que son Equipage se voyant arresté de nous dire son nom de Baptêsme, Répond qu'il allait son chemin et que s'il n'a pas voulu dire son nom c'est qu'il pensait pas et qu'il ne se souvient pas de son nom de Baptêsme.
Interrogé d'au vient naviguant en qualitè de pescheur qu'il se dispense de prendre de passeport d'un an de Monseigneur l'Amiral et depuis quand Il n'en a pris. Répond qu'il n'a point pris de passeport depuis que le dernier est finy et qu'il ne se souvient depuis quand le dernier est finy.
Interrogé s'il ignore les déffenses de pescher avec la drague si ce n'est en dehorsde la Rivière et du moins à une lieue long des Costes et d 'ou vient il pratique cette sorte de pesche ainsi que la plupart des pescheurs de Séné de jour et encore plus de nuit en dedans de la Rivière et tout près des Costes. Répond qu'il a ouy dire qu'il y a des déffenses et que s'il pesche de cette façon, c'est pour avoir du pain.
Interrogé d'ou vient il ne sort pas hors, de la Rivière pour pescher du moins une li lieue de la Coste; Répond qu'il ne savait pas qu'il fallait sortir hors de la Rivière.
Interrogé d'ou vient, il se sert de battons ferrés en forme de trident pour battre l'eau et prendre du poisson, ce qui est deffendu par les ordonnances.
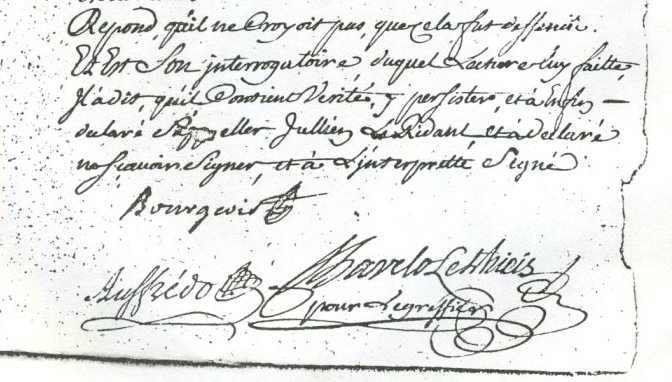
Répond qu'il ne croyait pas que cela fut deffend son interrogatoire duquel lecture luy faitte, il a dit qu'il convient vérité, y persister et a enfin déclaré s'appeller Julien Le Ridant et a déclaré ne savoir signer et a l'interprette signé.
Bourgeois - Auffredo Gavelo Le Thieis - Pr le greffier
N.D.L.R : "NIHIL NOVI SUB SOLE"
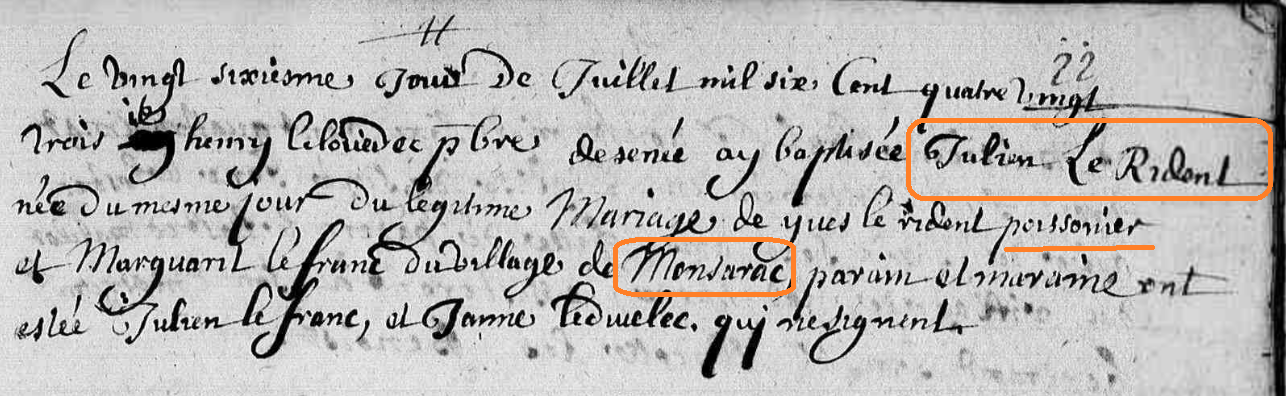
Sur la base des déclaration du pêcheur en fraude, Julien LE RIDANT, âgé de 45 ans, on retrouve sur les registres de bâpteme son identité. Il s'agit de Julien LE RIDANT, né le 26 juillet de l'an de grâce 1683, au village de Montsarrac, fils du poisonnier, Yves et de Marguerite LE FRANC.
Ci-après copie du procès verbal d'époque, 1ère page sur 3.
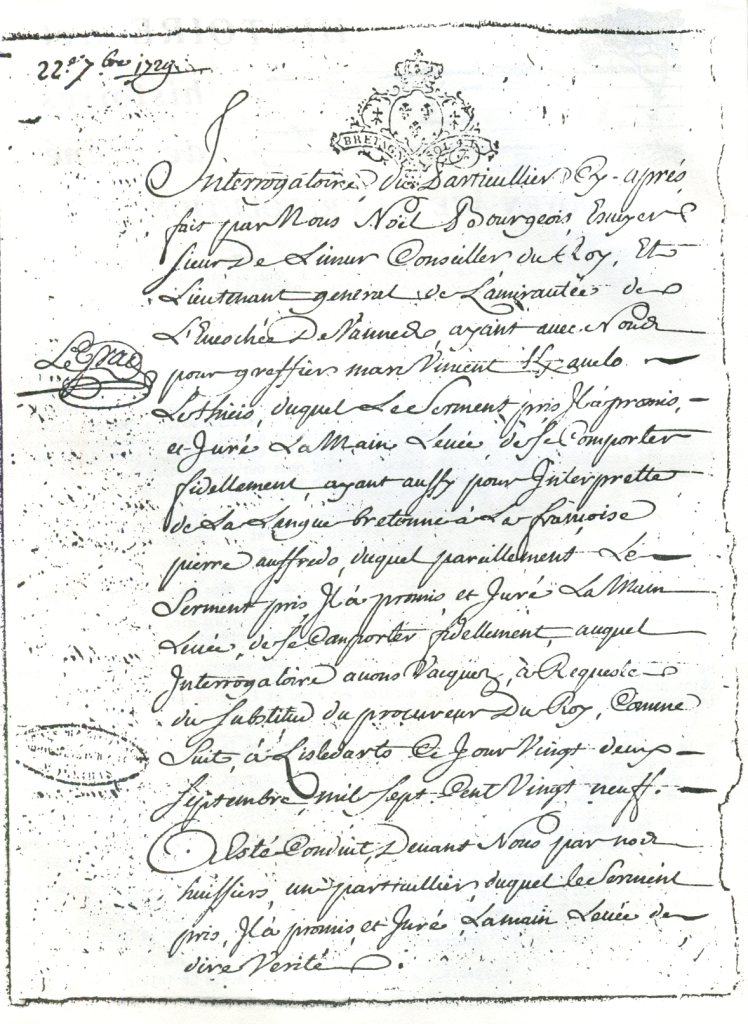
Anne LE DORIOL, infanticide 1864
Les Archives du Morbihan conserve les archives des Assises et des tribunaux de Vannes. Finalement, depuis la Révolution, les Sinagots auront été un peuple pacifique. On ne conserve de trace que de quelques crimes parmi lesquels l'infanticide commis par Marie Anne LE DORIOL de Montsarrac.
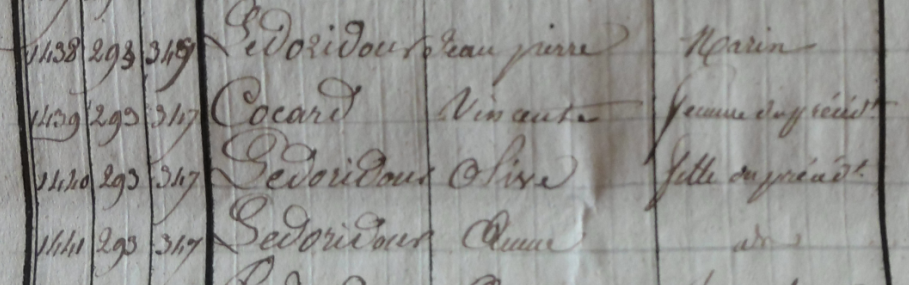
Marie Anne LE DORIOL nait au village de Monsarrec le 27/9/1840. Son père, Jean Pierre est marin. Sa mère, Marie Vicente COCARD est ménagère. La famille est pointée lors du dénombrement de 1841. Mais il faut noter l'erreur de l'employé qui enregistre la famille sous le patronyme LE DORIDOUR.
L'aîné de la famille est Jean Louis [7/07/1835-18/06/1854] qui sera marin comme son père. Le deuxième enfant, s'appelle Olive qui décèdera en bas âge [1838-1842]. La famille était déjà endeuillée par le décès du papa à l'hôpital de Pointe à Pitre en Guadeloupe, alors qu'il était embarqué sur La Renaissance. Séné détient un nombre élevé de marins péris en mer et sans doute un nombre tout aussi élevé de marins décédés de maladie contractée à bord...
Anne et Jean Louis se retrouvent orphelins au décès de leur mère en 1850. Jean Louis continue sa carrière dans la marine qui le conduit à bord de La Semillante pendant la Guerre de Crimée. Le matelot de 3° classe décède de maladie à bord, au large de l'île de Furusund en Suède. La Sémillante aura un destin tragique au large de Bonifacio en février 1855 où périront d'autres marins sinagots.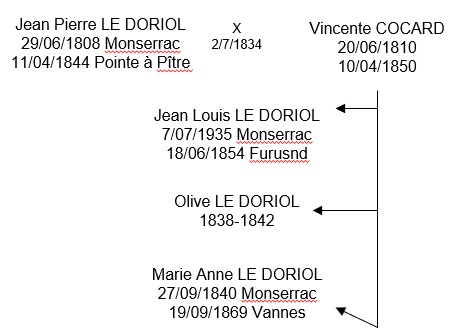
Marie Anne LE DORIOL se retrouve seule à l'été 1854 au village de Montsarrac, elle a 14 ans à peine. Si la jeune Marie Anne a été scolarisée, elle a peut-être suvi les cours de la toute première institutrice, Anne DANET, présente sur la commune de 1835 à 1854, date de l'arrivée de Soeur Esther et des Filles de la Charité, à l'initiative du recteur Toumelin.
Elle déclarera le métier de lingère qu'elle a dû apprendre par apprentissage sur Vannes.
Un métier va suivre le même développement et le même déclin que celui des coiffes, c'est celui de lingère. D'une activité de simple entretien de linge au début du siècle, il va devenir une activité de création nécessitant un long apprentissage et des doigts d'or.
"Au début du XIXe siècle, les lingères entretiennent le linge, surtout le blanc. Elles lavent, repassent, amidonnent jupons, bonnets, chemises, les mettent en forme. Mais ce métier va exploser au cours du siècle avec le développement des coiffes. Les lingères qui jusque là travaillaient dans les maisons nobles et bourgeoises vont se voir solliciter par les paysannes qui ont désormais accès aux dentelles et à la soie, matériaux qu'elles ne savent pas entretenir.
En effet on ne s'improvise pas lingère. On accède à ce statut après un apprentissage de trois ans. Une condition pour devenir apprentie, c'est d'avoir les ongles longs pour réaliser le fameux plissé à l'ongle. Une vieille grand-mère de 90 ans se souvenait encore il y a dix ans de son émerveillement, quand elle était petite, devant la longueur des ongles de la lingère. Ceux de l'index, du majeur et de l'annulaire mesuraient au moins 1 centimètre et elle les voyait encore saisir prestement deux plis qu'ils bloquaient et tiraient. Puis elle les repassait par petite surface, environ 4 cm2 après 4 cm2. Il fallait aussi avoir le souci de la perfection sinon gare aux coups d'aiguille à tricoter sur les doigts."
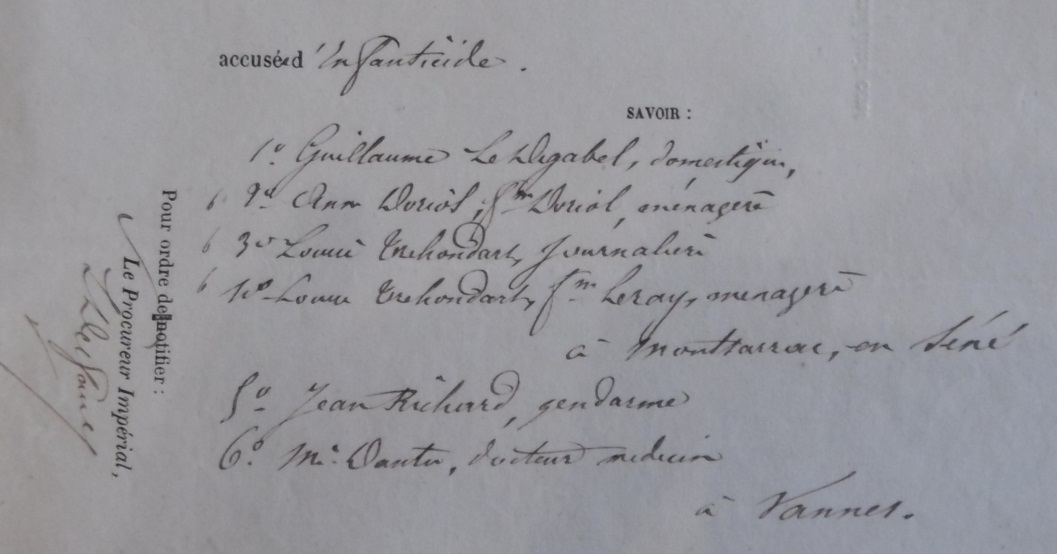
Quelques temps avant son accouchement, elle est accueillie par Mme Veuve LERAY, née Louise Tréhondart [17/6/1823-17/9/1903]. Il s'agit de la soeur de Julien Tréhondart, marin, Chevalier de la Légion d'Honneur, qui se noiera dans le Golfe avec sa fille Marie Jeanne. C'est aussi la soeur de Jean Louis Tréhondart, marin décédé lors de la Guerre de Crimée. Louise LERAY sera témoin lors du procès avec 5 autres personnes : "quelques jours avant la foire de Saint Laurent qui a lieu dans le mois de spetembre, la nommée Marie Anne Le Doriol vint demeurer chez moi dans une petite chambre .... attenante à celle où je demeurrai moi même, je ne lui avais demandé aucun frais pour la location et s'était par amitié que je l'avais accueillie chez moi comme elle était lingère qu'elle allait souvent en journée et qu'elle en revenait que le soir, je ne m'imaginais pâs qu'elle fut enceinte."
Louise Trehondard, une ami eintime de l'accusée déclarera avoir ignorer que son amie était enceinte. Ainsi au village de Montsarrac, Marie Anne LE DORIOL réussit a masquer sa grossesse.
Selon l'adjoint au maire Le Douarin, François Surzur, qui deviendra maire également, il s'agissait d'une fille coquette. Lors de l'année de ces 20 ans, elle rencontre un marin qui la met enceinte. Lors de sa déposition, elle avouera qu'elle devait épouser un préposé des douanes et pour cette raison, elle cachera sa grossesse au village de Montsarrac.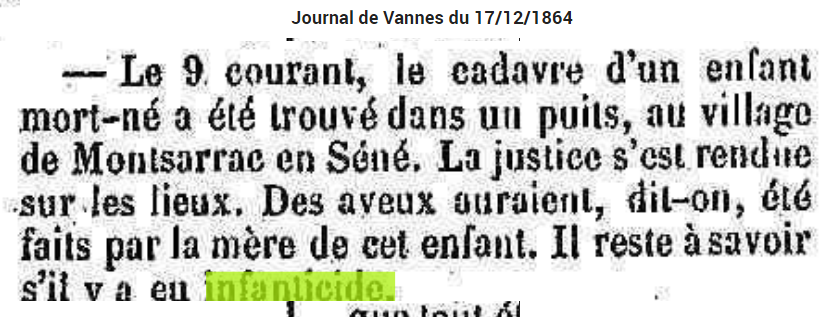
Elle accouche d'une petite fille le 12 novembre 1864. Elle tombe malade à la suite de cet accouchement clandestin. Elle ira quémander un vomitif à Soeur Esther quelques jours après avoir donné vie à un enfant dont elle abandonnera le corps dans un puits et qui sera retouvé par des enfants le 8/12/1864. Aussitôt, la maire Le Douarin en informera la justice.
Le chef d'accusation précise les circonstances de l'infanticide: "Le huit décembre 1864, deux enfants ayant aperçu flottant à la surface d'un puits xxxx, près du village de Montsarrac en la commune de Séné un paquet assez volumineux, avertirent Guilllaume Le Digabel et François Le Didrouch qui le retirèrent de l'eau. Le paquet dont l'enveloppe en grosse toile était cousue avec soin de tous les côtés, contenait avec une chemise de femme tachée de sang, le corps d'un enfant nouveau né, la tête était entièrement recouverte d'un tablier que l'on avait fortement attaché autour du cou au moyen d'une lisière de laine. Le médecin chargé de l'autopsie constata que cet enfant, bien qu'il fut venu au monde un peu avant terme, était né vivant et viable et qu'il avait succombé par suite d'une asphyxie déterminée par la constriction qui avait été opérée sur la bouche et sur le cou. La mort devait remonter à trois semaines environ.
Marie Anne Le Doriol, jeune fille de vingt quatre ans, qui habitait avec la femme Leray une maison située au village de Montsarrac, s'était trouvée malade à l'époque correspondant à celle de la naissance de cet enfant. Après quelques dénégations, cette fille déclara qu'après une grossesse de huit mois, elle avait été prise le onze novembre 1864 des premières douleurs de l'enfantement et avait accouché le lendemain pendant l'absence de la femme Leray. Elle avait baptisé son enfant et lui avait enveloppé la tête dans un tablier qu'elle avait serré avec force autour du cou dans le but de lui donner la mort.
Elle avait ensuite déposé son cadavre dans une armoire et après l'avoir mis dans un morceau de toile qu'elle avait cousu de tous les côtés, elle était allé huit jours après le jeter dans le puits où on l'a trouvé. Elle a persisté dans cette déclaraiton en maintenant toutefois qu'elle n'avait pas entendu son enfant crier et quelle ne savait s'il avait vécu. Elle ajoutera avoir baptisé l'enfant né.
En conséquence, Marie Anne Le Doriol est accusée d'avoir le douze novembre 1864 commis un homicide volontaire en la personne de son enfant nouveau né.
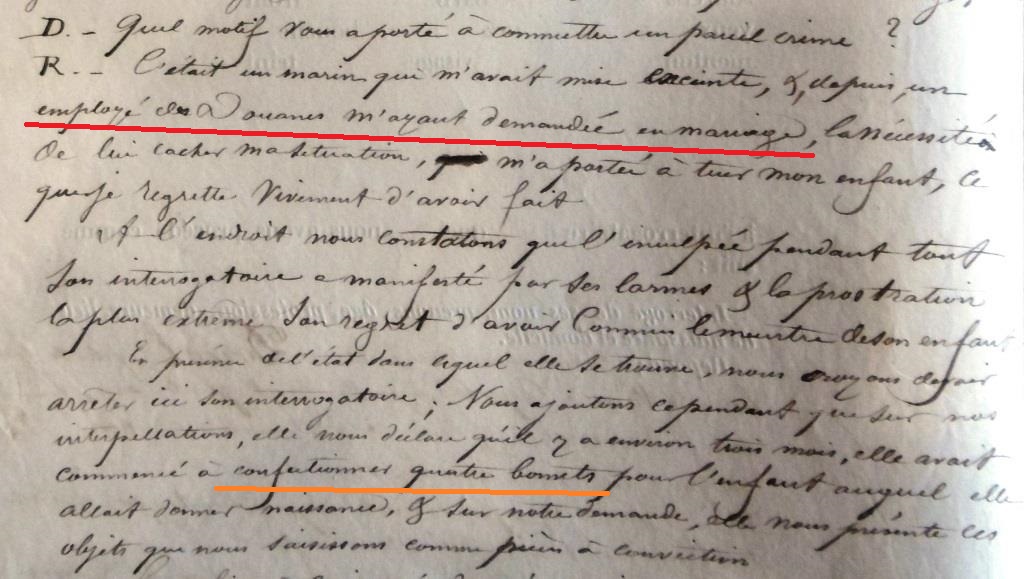
Marie Anne Le Doriol ajoutera qu'elle acceptait sa maternité et pour preuve avait confectionné quatre bonnets pour son futur enfant. C'est la perspective d'épouser un préposé des douanes qui la convainc de se débarasser de son enfant.
Le gendarme la questionna rudement: "
D:Quelques jours avant votre accouchement n'allâtes-vous pas trouver les Soeurs de la Charité au bourg de Séné, en leur disant que vous aviez mal au ventre et que vous aviez les jambes enflées, et ne leur demandates vous pas un vomitif qu'elle vous donnèrent?
R: ce en fut pas avant mon accouchement que les Soeurs de la Charité de Séné me donnèrent ce vomitif mais le dimanche lendemain de moin accouchement. (Cette réponse fut confirmé par Soeur Esther qui fut entendu comme témoin.)
Le procès se tient aux Assises de Vannes, le 7 mars 1865. 12 jurés sont choisis parmi une liste de 36 nomùs. Elle sera accusée à la majorité d'assassinat sur son enfant et condamnée à 6 ans de travaux forcés, bénéficiant de circonstances atténuantes. Elle sera incarcérée à la "maison centrale" de Vannes. Par un recours en grâce déposé le 28/5/1869 et accepté le 9/08/1869, elle bénéficera d'une remise de peine de un an.
Cependant, Marie Anne LE DORIOL décède le 19/9/1869 à la prison de Vannes.
Léon TREMBLE, la mosaïste de passage à Séné
En se promenant sur la presqu'île de Séné, on est interpelé par des décorations qui ornent certaines maisons. L'auteur de ces décorations est Léon TREMBLE, platrier de son métier et mosaïste à ses heures perdues.
Léon Louis TREMBLE [23/9/1908-19/9/1988] nait à Vannes, au 34 rue Thiers. Son père, Marcel [17/5/1876- 11/02/1963], natif de Nantes, est plâtrier et s'est marié à la Vannetaise, Germaine Fougeray à Vannes le 18/7/1903. On pense que le plâtrier nantais en a fait la connaissance à Vannes alors qu'il était venu travailler. Sa fiche de matricule militaire nous indique que le plâtrier réside en 1902, Rue du Mené, et en 1905, rue Saint-Salomon. A la naissance de Léon, Mme TREMBLE a déjà la charge de son frère aîné, Marcel [19/7/1904-4/1/1969] né, Place du Marché au Seigle. Il sera plâtrier comme son père et son frère Léon.
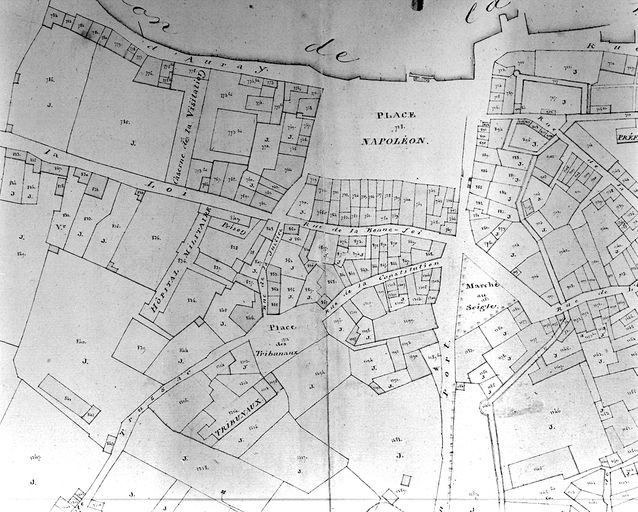
Son père, Léon Marcel [17/5/1876-11/2/1963] fait acte de courage en 1909, comme nous le relate le Journal Officiel, en sauvant des flammes une fillette. Le couple bas de l'aile et divorce le 17/12/913, les enfants ont respectivement 9 et 5 ans. S'en suit la guerre. Le père est mobilisé. La mention de son acte de sauvetage et de la médaille reçue, semble lui avoir épargné le front.
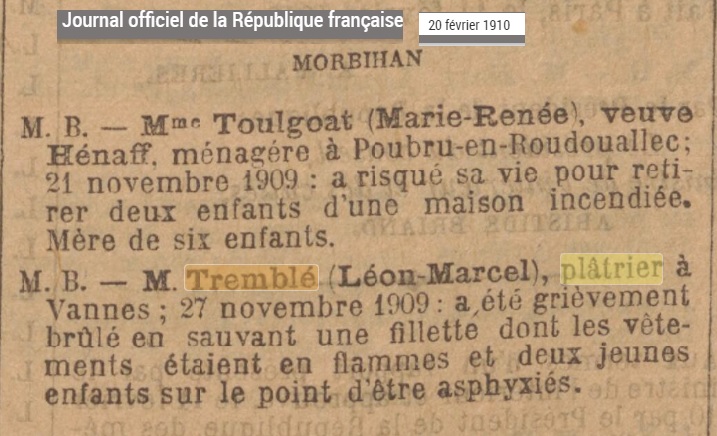
Au sortir de la guerre, le père se remarie à Nantes le 7/11/1922 avec Julie Déabbera. Il est diplômé en 1933, lors de l'Exposition Régionale du Travail. Il décèdera à Nantes en 1963.
Les enfants suivent la voie de leur père et seront plâtriers. Léon Louis entreprend à partir de 1925 un compagnonage. Pendant l'été 1926, le jeune plâtier sauve un baigneur à Conleau, comme nous le relate cet article de l'Ouest Républicain.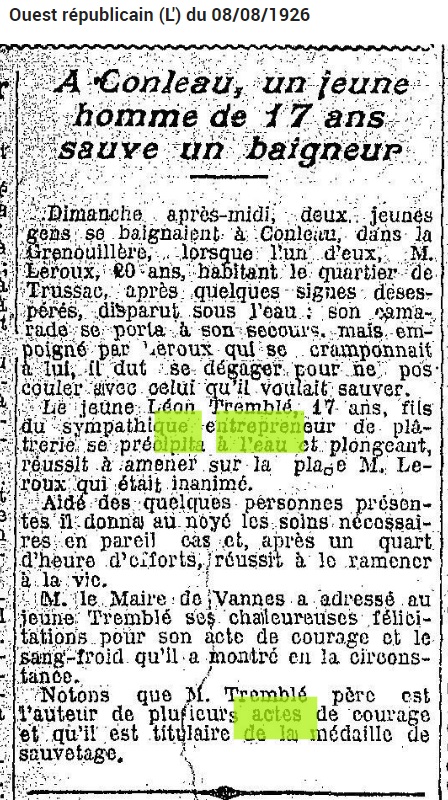
Son apprentissage le conduit à travailler pour différentes entreprises.."C'est ainsi qu'à chaque étape, Léon enrichit son savoir faire de techniques nouvelles, de Paris à Angers, de Saint-Nazaire à Lyon, de La Baule à Marseille" (1). Pour son examen, Léon TREMBLE présente une façade de cathédrale en staff et la réplique miniature d'un temple grec. Il est reçu à Angers le 25/8/1928 et baptisé par ses pairs, "Vannetais va sans crainte".
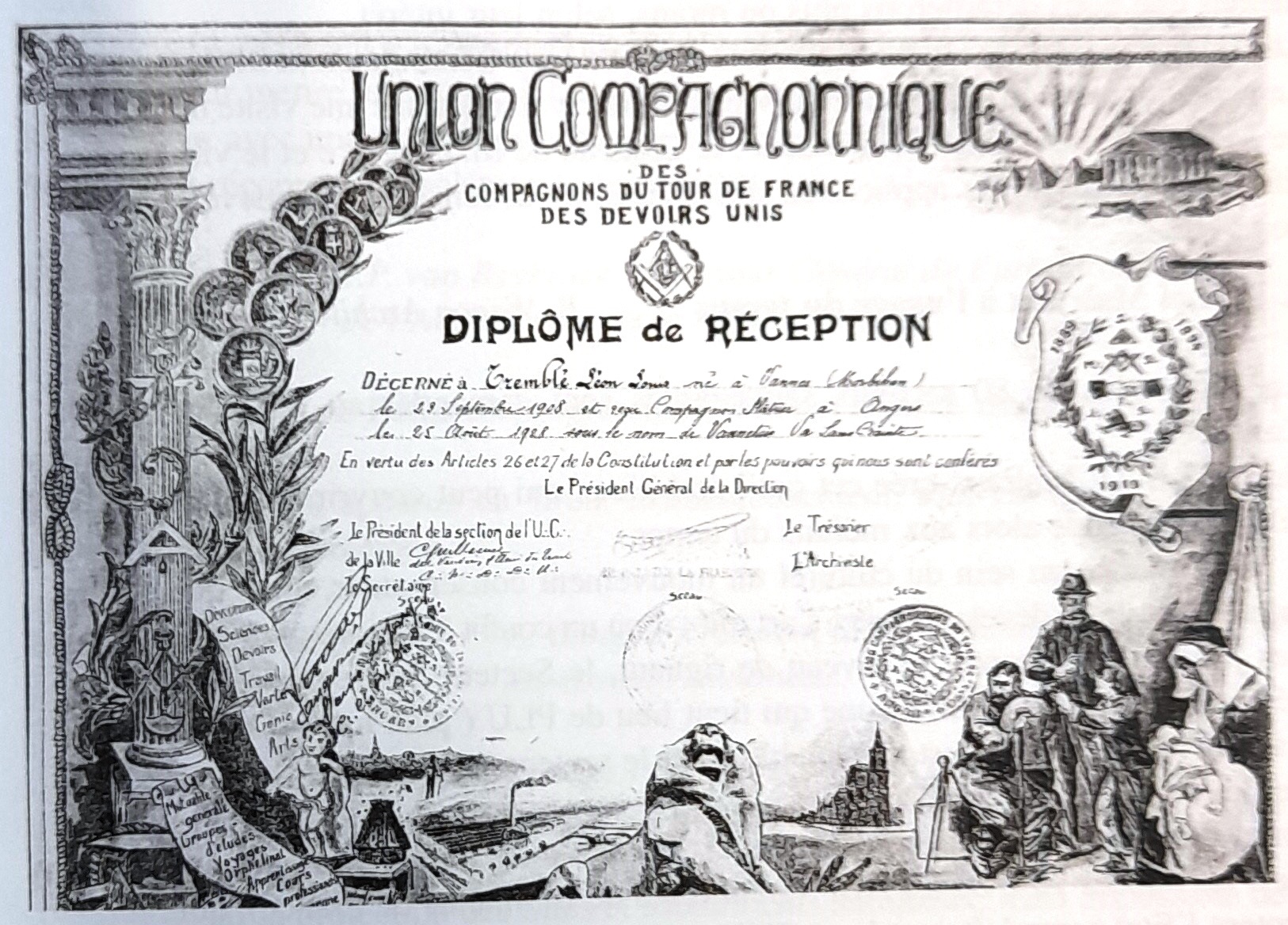
Il se marie à Vannes le 5/9/1931 avec Germaine DEMARQUET. La famille loge en 1932 au 20 rue des Vierges. Le métier de plâtrier n'est pas sans risque, comme en témoigne cet article de l'Avenir du Morbihan de 1931.
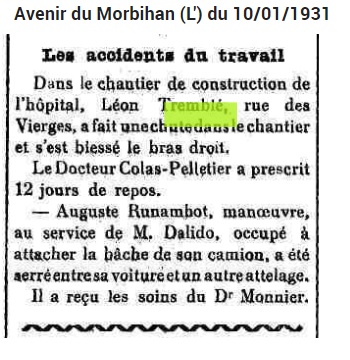
En 1936, il fait construire une demeure ruelle du Pont Vert, maison toujours visible à Vannes. "Cette maison reste le témoignage le plus remarquable de sa production. Tous les motifs décoratifs ont été conçus et réalisés par lui. A l'entrée on peut lire Mon Trimard, nom de travail. Sur la façade de la ruelle, nous découvrons une multitude de motifs géométriques et colorés, parfois exhubérants, dans la tradition artisanale de l'art moresque ou de l'Espagnol Gaudi".
L'entrée est orné de jardinières de mosaïque, rouge, vert, bleu, un oiseau décore la boite aux lettres. Ces productions sont d'autant plus remarquables que l'ensemble a été exécuté à la main. Sur la galerie du balcon trône un globe terrestre, l'imposte de la porte figure un homme sous lequel est inscrit "Mon Trimard".
Parralèlement à ces motifs géométriques simples, Léon Tremblé nous offre à voir un répertoire animalier, plutôt aquatique, avec des animaux tel que la pieuvre, la grenouille, la méduse qui ornent le portail de l'entrée. Le thème de l'eau revient fréquemment comme le montre l'installaion dans la cour donnant sur la rue et dans le jardin à l'arrière de la maison, de fontaines, jets d'eau et bassins".
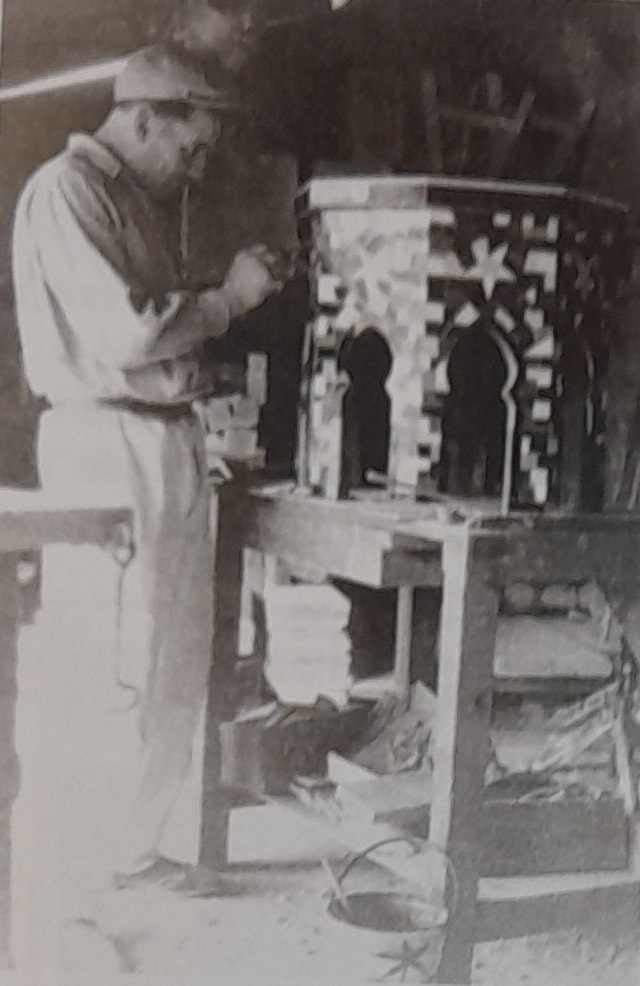
Léon TREMBLE s'illustrera également dans la décoration de nombreux magasins, comme la poissonnerie rue Saint Nicolas, le fronton du Café de la Pointe à Séné et de nombreuses maisons sinagotes.
Léon TREMBLE décède à Vannes le 19/9/1988.
Plus...
Salles de sport à Séné
Notre commune est riche de ses associations et notamment de ses clubs sportifs. Parmi nos équipements, certaines salles portent le nom d'une personne: salle Allanioux, salle Chantal Daniel, salle Denis le Nechet, salle Claude Prunier. Tachons de dresser le portrait de ces personnes et d'éclairer les circonstances qui amnenèrent nos associations à rendre ainsi hommage à une personnalité locale.
LA SALLE ROGER ALLANIOUX
Lors de la construction de la nouvelle école de la Grenouillère au Poulfanc, l’ancien maire Albert GUYOMARD, récupère les anciens préfabriqués qui servaient de salles de classe. Il offre le premier préfabriqué au quartier de Saint-Laurent où il est toujours visible.

Le deuxième est attribué à la toute jeune association sportive US Séné. Il s’agissait alors d’un club de football. L’US Séné deviendra par la suite une association omnisport comptant jusqu'à 6 associations avant que le football reprenne son indépendance en 1999.
Le préfabriqué est démonté vers 1977 et stocké chez le déménageur Bernard Lescoublet qui n’est autre que le président de US Séné Foot. En 1979, le préfabriqué est remonté sur le plateau sportif Le Derf. L’employé municipal, la maçon Garnec donne un coup de main au montage. Le préfabriqué est aménagé par les bénévoles. Eugène Le Gallic, autre dirigeant du club, se défait du comptoir de son bar qu’il avait place de l’église et l’offre à l’association sportive.
En juillet 1981, le nouveau maire, Daniel Mallet inaugure officiellement la salle qui ne porte pas encore de nom.
A l’étroit dans ce préfabriqué, la ville de Séné décide en févreier 1998 de démolir le préfabriqué et de reconstruire à la mêm eplace une nouvelle salle. Le 29 août 1998, Marcel Carteau inaugure le nouvel équipement qui est toujours présent au complexe Le Derf.

Elle prendra le nom de Roger ALLANIOUX en 198x.
Roger ALLANIOUX [16/5/1923- 1977 ] nait u village de Cadouarn. Ses parents sont pêcheurs comme beaucoup de familles du village. Après la Libération, il effectue son service militaire et s’engage dans la marine nationale. Il devient infirmier militaire. Il est envoyé en Indochine à bord de La Marseillaise, navire hopital militaire. Il revient en métropole et il est affecté à Lorient puis à la base américaine de Rochefort sur Mer.
De retour à Séné, Roger ALLANIOUX particpe à la création du premier club de football de Séné dans les années 1965. Tout naturellement, de part sa formation d’infirmier, il s’occupe de la santé des joueurs. Il devient leur soigneur à la fois coach, kiné et masseur.
"Les premiers matchs se tenaient à Cariel", se souvient Gérard, son fils. "Il y avait une équipe de sénior et une réserve des 18-20 ans."
Vers 1975, Roger ALLANIOUX arrête le bénévolat après 10 ans passés à soigner les footballeurs sinagots. Il décède d'une logue maladie en 1977.
Les dirigeants du club propose son nom à la mairie pour la nouvelle salle .
Les Légionnaires Sinagots
L'ordre national de la Légion d'honneur est l'institution qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Instituée le 19 mai 1802 par Bonaparte, alors Premier consul de la République, elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des « services éminents » à la Nation.(source: wikipedia)

Depuis sa création, wiki-sene à retrouvé le nom de 13 Sinagots décédés a qui l'ordre a décerné cette distinction. Qui étaient-ils et quels faits de gloire leur ont permis de recevoir cette décoration de la Nation?
En plus des 7 noms résencés dans la base "leonore", wiki-sene a établi une liste exhaustive des lauréats sinagots, dont certain font l'objet d'un article dédié.
Julien TREHONDARD [12/3/1816 Séné-5/2/1859 Séné], Chevalier de la Légion d'Honneur,
Jean Marie LE PEVEDIC [28/4/1844 Séné - 21/8/1913 Neuville], Chevalier de la Légion d'Honneur
Pierre Marie LE DOUARIN [24/1/1846 Séné - 13/8/1918 Rochefeort en Terre], Chevalier de la Légion d'Honneur
Jean Marie PIERRE [14/4/1864 Séné - chercher date décès], Chevalier de la Légion d'Honneur
Désiré Jean Marie BOCHE [21/9/1872 Séné - 26/2/1945 Vannes], Chevalier de la Légion d'Honneur
Mathurin Marie NOBLANC [4/4/1874 Séné - 3/4/1955 Lorient] Chevalier de la Légion d'Honneur
Emile Louis Marie LE MEUT [21/10/1874 Séné - 9/10/1949 Séné],Commandeur de la Légion d'Honneur
Vincent Marie Joseph SEVENO [22/9/1878 Séné - 21/7/1947 Séné] Chevalier de la Légion d'Honneur
Henri MENARD [19/5/1887 Cane - 20/1/1946 Villers sur Marne], maire de Séné, Chevalier de la Légion d'Honneur
François Marie LE LAN [26/1/1892 Séné - 5/6/1961], Chevalier puis Officier de la Légion d'Honneur
Auguste JANVIER [4/10/1892 Séné - 23/8/1958 Vannes], Chevalier de Légion d'Honneur
Hippolyte LAYEC [19/1/1901 Séné - 26/8/1965 Séné ], Commandeur de la Légion d'Honneur
Eugène ROBERT [6/8/1911 Nantes - 14/6/2003 Séné ], Officier de la Légion d'Honneur
Roger LE ROY [15/8/1925 Séné - 30/7/2020 Séné] Commandeur de la Légion d'Honneur
Jean Marie LE PEVEDIC [28/4/1844 - 21/8/1913 Neuville du Poitou], Chevalier de la Légion d'Honneur
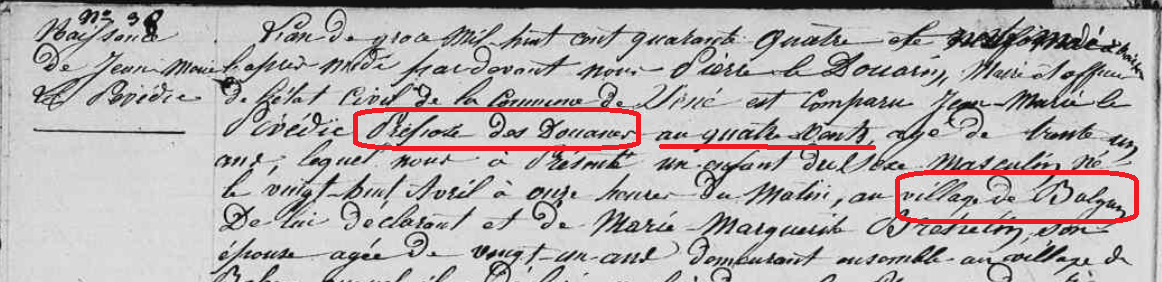
Jean Marie LE PEVEDIC nait à Balgan d'une mère ménagère et d'un père préposé des douanes en poste à la casern des Quatre-Vents. Son dossier sur la base "leonore" nous apprend que se militaire de carrière est incorporé en 8/1865 au 8° régiment de ligne. Il devient par la suite voltigeur puis caporal en 1868, sergent en 1871. Pendant la guerre contre la Pruse, il est fait prisionier. A l'issu du conflit, il se réengage et atteint le grade d'adjudant. Il occupe un poste de "portier consigne", poste de sous-officier surveillant l'entrée d'une place-forte militaire, d'abord à Rochefort sur Mer puis à Blaye. Il décède à Neuville de Poitou en 1913.
Pierre Marie LE DOUARIN [24/1/1846 Séné -13/8/1918 Rochefort en Terre], Chevalier de la Légion d'Honneur
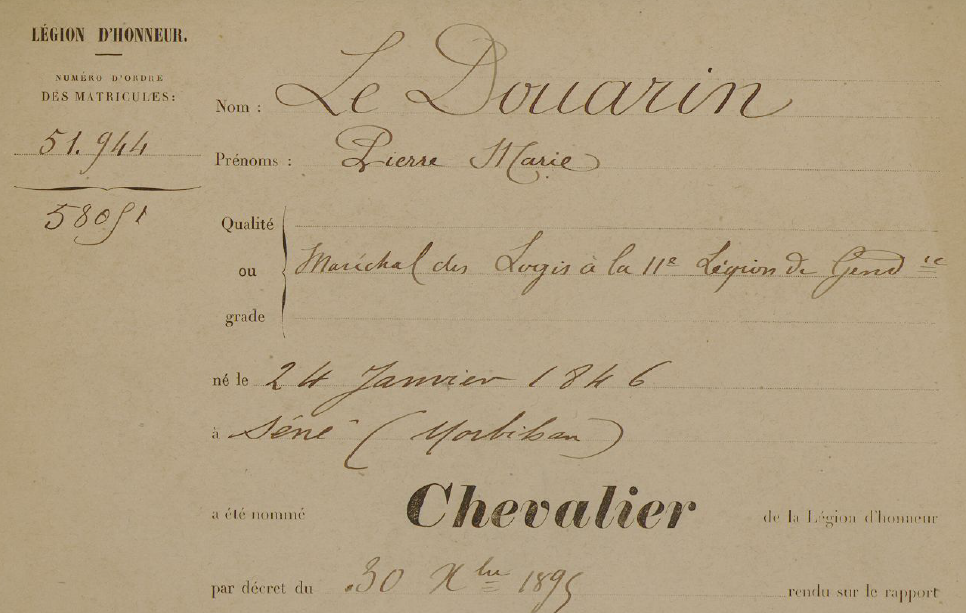
Pierre LE DOUARIN est né à Cressignan au sein d'une famille de cultivateurs. Conscrit en 1864, il est d'abord marin à Lorient sur plusieurs navires successifs. Il participe à la guerre contre la Prusse. En 1869 il est cannonier de 1ère classe. Après la conflit, il se marie le 12/10/1875 à Pluneret avec Jeanne Ribouchon. Il rejoint la gendarmerie, d'abord comme gendarme à pied, puis brigadier et en 1888 il devient maréchal des logis. Il dispose alors d'un poste dans le Finistère, notamment à Pont-Aven en 1896. Décoré de la médaille militaire en 1873, il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 décembre 1898.
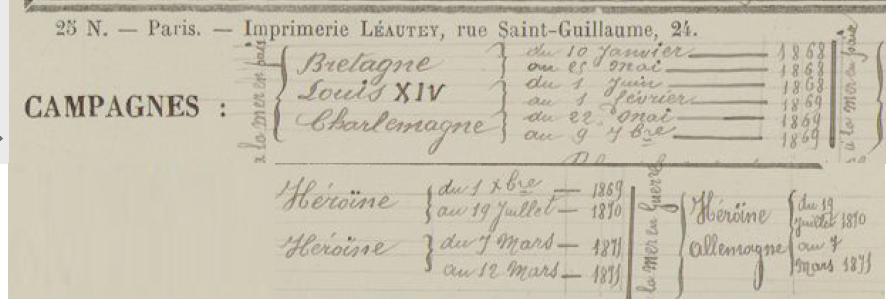
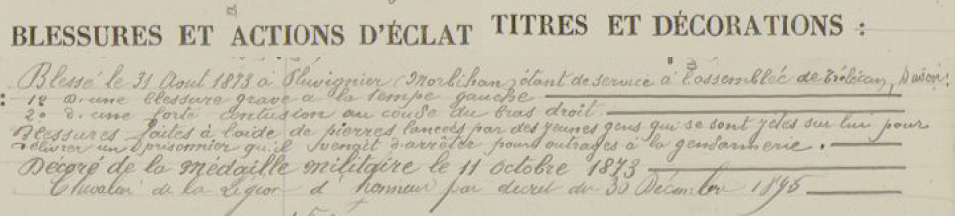
A son départ de la gendarmerie, il bénéficie d'emploi réservé aux militaires retraite. Son acte de décès le 13/8/1918 indique qu'il est alors receveur buraliste à Rochefort en Terre.
Jean Marie PIERRE [14/4/1864 - chercher date décès ].
Jean Marie PIERRE nait au sein d'une famille de pêcheur de Montsarrac en 1864. Il effectue sa conscription entre 1883 et 1886. Puis il s'engage dans la marine. en renouvelant plusieurs fois un engagement de 3 ans. Le 29/12/1910, il reçoit la médaille militaire. Il a 23 ans et 3 mois de service pour l'Etat. Entre-temps il s'est marié à Séné le 10/4/1894 avec Joséphine Marie Mathurine NOBLANC. Le 11/7/1917, il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur.
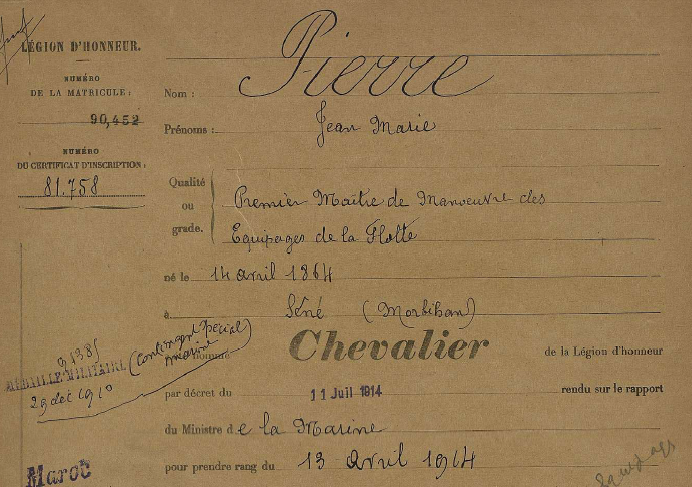
Désiré Jean Marie BOCHE [21/9/1872 Séné - 26/2/1945 Vannes]
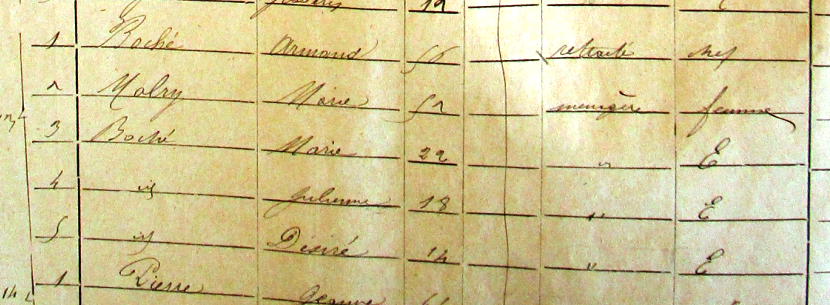
Désiré BOCHE nait au village de Cadouarn d'une mère ménagère et d'un père préposé des douanes.La famille est pointée en 1886 lors de dénombrement. Lors de son mariage à Séné avec Marie Perrine DANET, le 4/10/1898, il déclare l'activité de matelot torpilleur breveté. Il reçoit sa légion d'honneur au grade de Chevalier le 19/01/1922, il vit alors à Lorient. Il décède à Vannes le 26/2/1945.
Mathurin Marie NOBLANC [4/4/1874 Séné - 3/4/1955 Lorient]
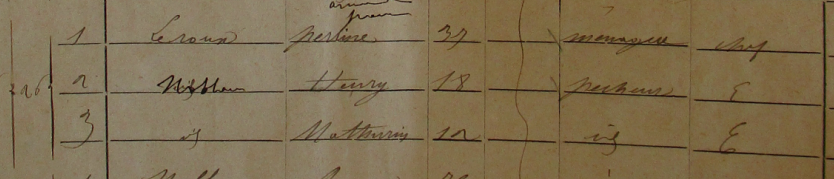
Il nait à Kérarden au sein d'une famille de pêcheur, fils posthume de son père Julien. Lors de son mariage le 16/6/1900 à Lorient avec Marie françoise GUILLEMOT, il déclare être Quartier maître de mousqueterie de la flotte. Il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 15/1/1925.
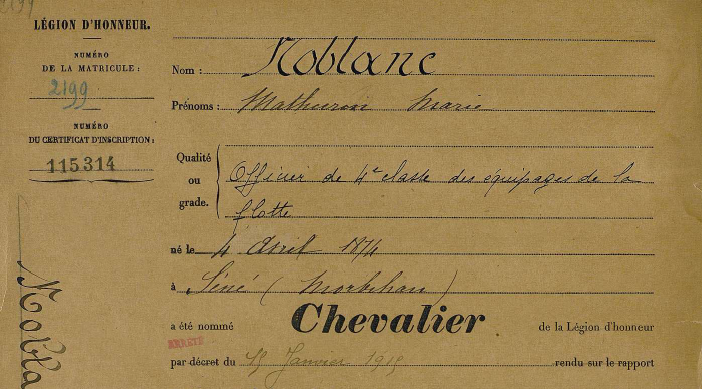
Vincent Marie Joseph SEVENO [22/9/1878 Séné - 21/7/1947 Séné]
Lors du mariage de son fils le 1er juillet 1947, l'officier d'état civil de la ville de Vannes n'oublie pas de mentionner les décorations que le vieux marin sinagot a reçues: médaille militaire, croix de guerre et légion d''honneur.
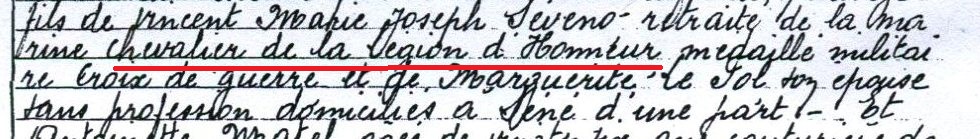
Dans l'attente de consulter son dossier d'inscrit maritime au SHD de Lorient, que sait-on de Vincent Marie Joseph SEVENO?
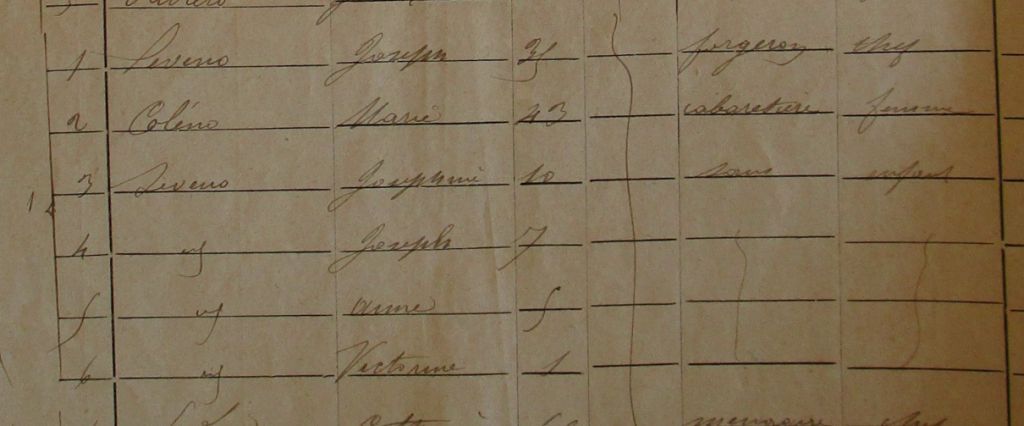
C'est le fils de forgeron de Séné dont l'épouse tient un débit de boissons au bourg. A 20 ans, il est forgeron mécanicien. La profession évolue alors vers la mécanique. Il se marie le 8/10/1913 avec Marguerite LE FOL [5/10/1891 Vannes - 5/5/1977 Trégunc], couturière à Vannes. Il s'engage dans la marine militaire où il fera carrière comme marin chargé de la manoeuvre des torpilles.
La guerre éclate et l'ancien forgeron sinagot devenu torpilleur se fera remarquer jusqu'à être décoré. Après l'Armistice, il est nommé par décret maître torpilleur en janvier 1919.
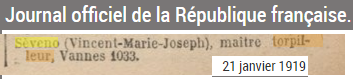
Il s'éteint à Séné, quelques jours après ce mariage, heureux sans doute de revoir son fils revenu vivant de déportation en Allemagne.
François Marie LE LAN [26/1/1892 Séné - 5/6/1961 Vannes]
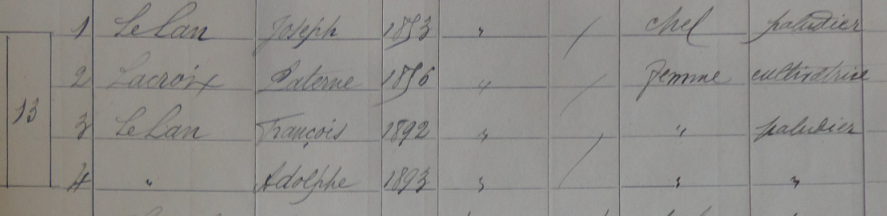
François LE LAN nait à Michot au sein d'une famille de paludiers. Il a un frère prénommé Adolphe [11/2/1893-19/3/1936], qui sera également mobilisé, blessé à deux reprises et fait prisonnier en Allemagne.
Vers 1912, avant la guerre, il déclare la profession de maçon. Il incorpore le 65° Régiment d'Infanterie le 8/10/1913. Il est se suite mobilisé lors de la déclaration de guerre contre l'Allemagne.
Lhistorique du 65° régiment nous livre le récit de son combat aux premiers jours de la guerre "Le 21, il prend contact avec les avant-gardes allemandes, à 20 kilomètres au nord de Bouillon et, le 22 août il est engagé dans la grande bataille livrée par la 4e Armée française, il reçoit le
baptême du feu à l’attaque des positions ennemies de Maissin. C’est l’époque des magnifiques charges à la baïonnette, où officiers et soldats affirment les splendides qualités de bravoure de la race. L’ennemi bat en retraite après de furieux combats corps à corps qui se prolongent fort avant dans la nuit. Mais le lendemain matin, l’ordre est donné de rompre le combat." François LE LAN est blessé par balle le 22/8/1914 Maissin, une plaie au bras droit. Le 27/10/1914, il rejoint son bataillon.
Le 4/8/1915 il est évacué pour une pleurésie.Il soigne sa maladie d'abrod à l'hôpital temporaire n°14 de Senlis. Ensuite à l'hôpital La Bucaille à Cherbourg, puis à l'hôpital n°88 de Querqueville puis l'hôpitaltemporaire La Broussais à Nantes.
Il rejoint à nouveau son corps le 5/11/1916 et passe au 91° Régiment d'Infanterie le 1/11/1916 puis au 65° le 29/12/1916. Le Régiment opère dans un secteur qui deviendra le "Chemin des Dames":
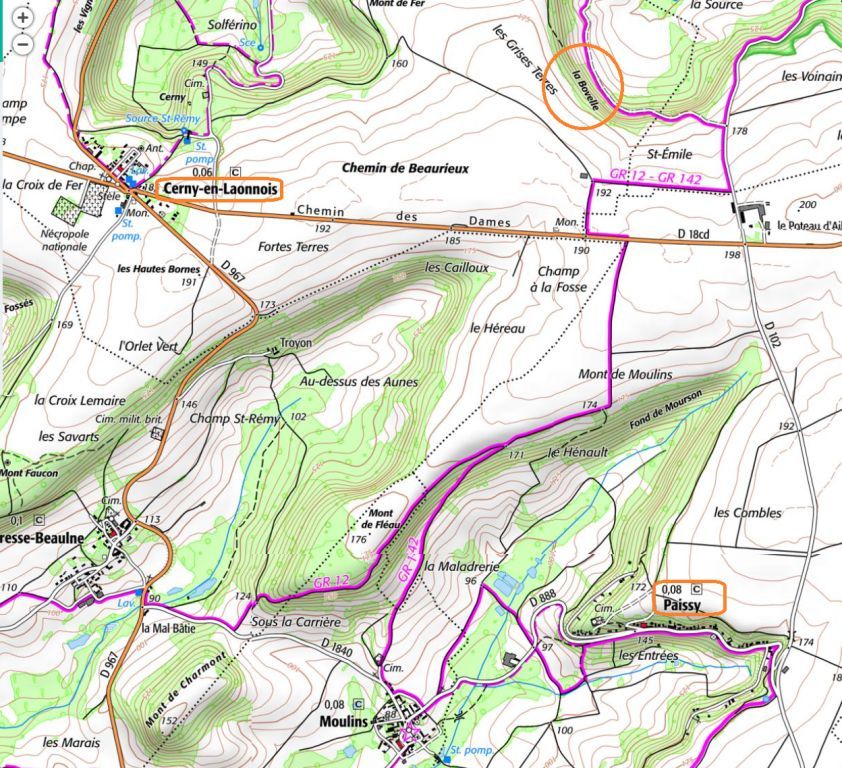
Retiré du secteur, le 65ème cantonne à Saint-Rémy Blanzy, au sud de Soissons, Aisne. Le lieutenant-colonel Prouzergue vient d’en prendre le commandement lorsque se déclenche l’offensive d’avril. Faisant partie d’une division de deuxième ligne, le régiment n’est pas directement engagé.Le 18 avril, le 65ème va prendre position au ravin de Moulins. Le 29, il relève en ligne un régiment de la division. Le 5 mai, attaque les positions allemandes dans le secteur de la Bovelle, avec mission d’atteindre les pentes nord du plateau qui domine l’Ailette.
Il est inutile de souligner la puissance des organisations ennemies en ce point du front : casemates bétonnées, tunnels profonds à entrées multiples, centres de résistance garnis de mitrailleuses et protégés par de nombreux réseaux. Tout cela occupé par des troupes d’élite
(4e régiment de la garde) qui dispose d’une artillerie formidable. A l’heure H (9 heures), le bataillon de Rochemonteix à droite et le bataillon Audran à gauche débouchent sous un feu d’enfer et, si les pertes ne diminuent pas l’ardeur de l’attaque, elles font que les objectifs ne peuvent être atteints qu’en fin de journée, après de furieux corps à corps. Des mitrailleuses et des prisonniers restent entre nos mains.
Au centre, un tunnel à trois entrées bétonnées gênait terriblement la progression. La compagnie Mercier, du bataillon de réserve, combinant son mouvement avec la compagnie Redier, réussit d’abord à faire échouer une contre-attaque, forte de deux compagnies, débouchant du tunnel ; puis, par enveloppement, à s’emparer de deux de ses entrées, faisant 60 prisonniers, prenant plusieurs mitrailleuses et un canon révolver. La nuit est tombée quand se déclenche brusquement sur le bataillon de Rochemonteix, très en flèche, une puissante concentration d’artillerie. Puis les troupes allemandes s’élancent à l’assaut. C’est, dans la nuit, une lutte épique qui s’engage, à la lueur des fusées et des
éclatements de grenades ; debout sur le parapet les hommes se battent avec une farouche énergie… A 23 heures, le calme revient, nos unités ont repoussé l’ennemi. Elles repousseront de même, à 3 h. 30, une attaque dirigée sur le même point."
Le secteur de la Bovelle est la partie orientale du saillant de Deimling, qu’il pousse encore plus loin en direction de l’Ailette : Les
soldats ont baptisé le lieu le « Museau de porc » de par sa forme. (Limité grosso modo par le tunnel de l’Yser à l’ouest et une ligne ferme de la Bovelle – Chemin des Dames à l’est. La ferme de Bovelle est aujourd’hui disparue, située à quelques hectomètres à l’est de Cerny-en-Laonnois. De septembre 1914 à avril 1917, la ferme est en zone allemande. Début mai 1917, les français arrivent à proximité de la Bovelle, les armées ennemies s’y opposant pendant de longues semaines, ce qui achève d’anéantir la ferme. Après la guerre celle-ci n’est pas reconstruite
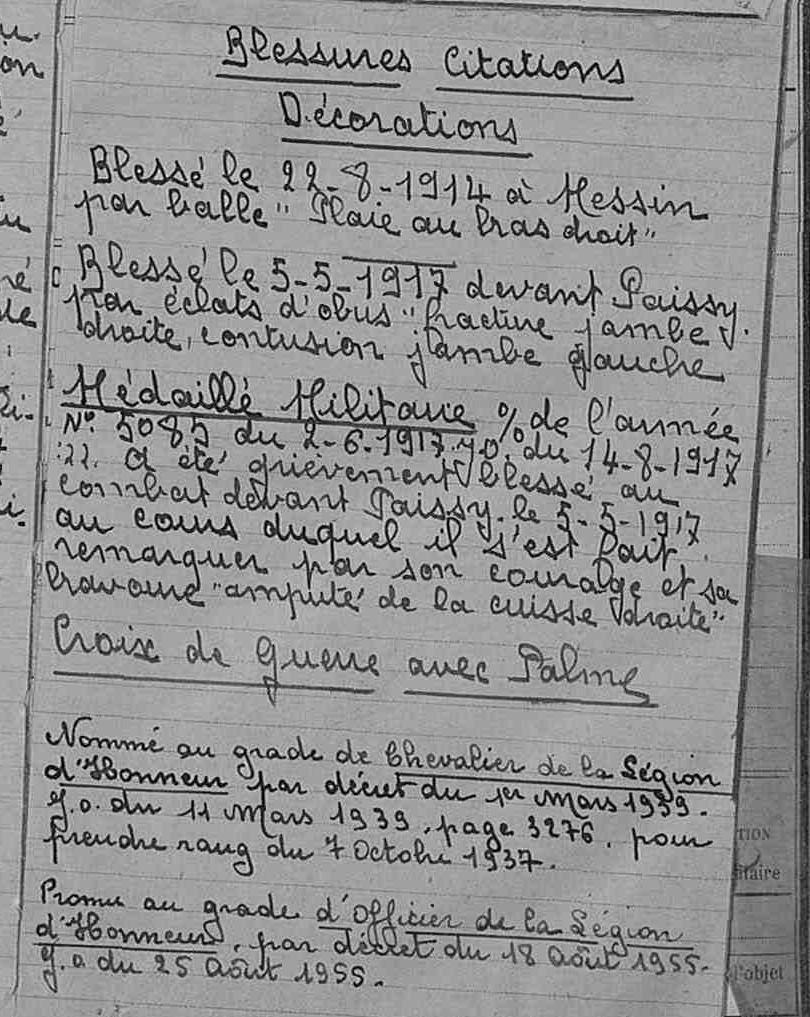
Ce jour du 5/5/1917, le soldat François LE LAN est une seconde fois blessé par un éclas d'obus devant Paissy, au combat au cours duquel il s'est fait remarquer par son courage et sa bravoure. La bombe, lui provoque la fracture de la jambe droite et une contusion sur la jambe gauche. Il est évacué à l'hôpital temporaire Broussais de Nantes, puis à l'hôpital St-Stanislas de Nantes et sur celui de Rennes. Le 1/12/1917 il est proposé pour la réforme et renvoyé dans ses foyers.. Il sera amputé de la cuisse droite.
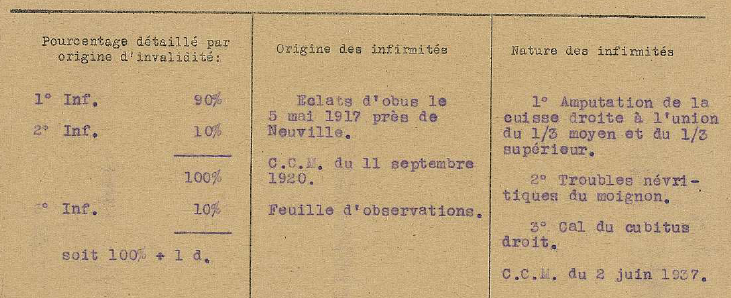
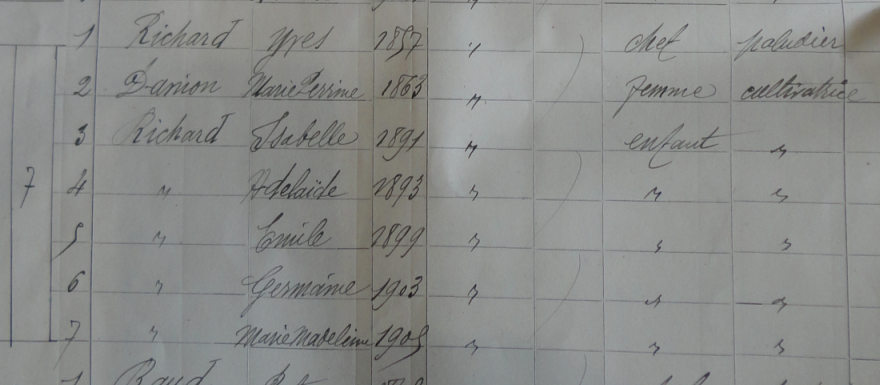
Après la démobilisation il se marie à Séné le 30/7/1919 avec Marie Isabelle RICHARD [30/1/1891-12/2/1962 Vannes], fille de paludiers à Michot, voisin des Le Lan. Son amie d'enfance s'occupera de ce soldat handicapé jusqu'à sa mort. François LE LAN s'installera avec son épouse à Vannes et sera commis administratif au Service des Pensions à Vannes.
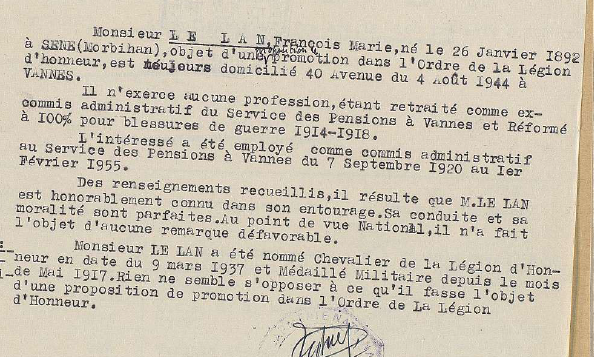
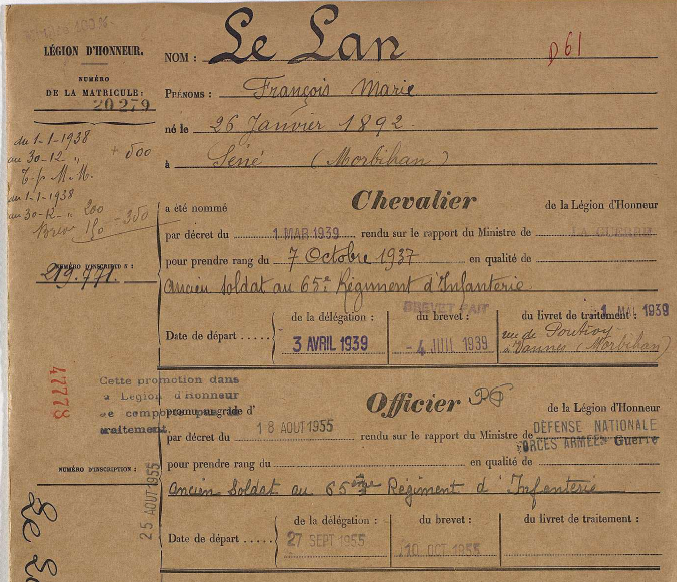
Il recevra la Médaille Militaire puis la Croix de Guerre avec Palme. Il est nommé au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur par décret le 1er mars 1939 et élevé au grade d'Officier de la Légion d'Honneur le 18/8/1955. Il décède à Vanne le 5/6/1961.
Secrétaire et Secrétaire Général de Mairie
La Révolution crée les communes qui se substituent aux paroisses. Les maires récupèrent la gestion des actes d'état civil. Les baptêmes, les mariages et les sépultures déclarés chez le recteur ou le curé sont remplacés par des actes de naissance, de mariage et de décès qu'enregistre l'Officier d'Etat Civil.
Le tout premier secrétaire de mairie.
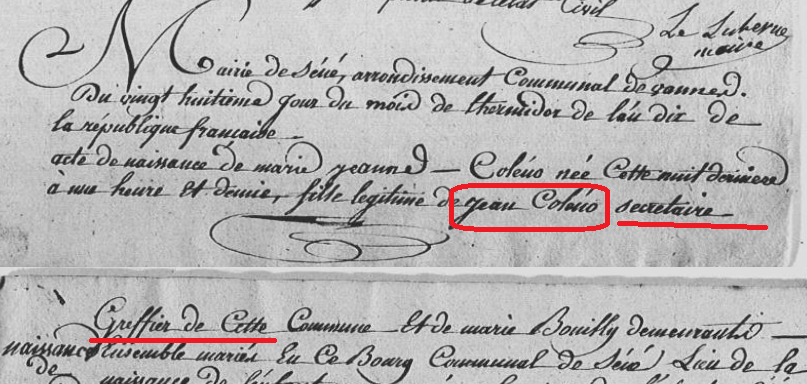
Lors de la naissance de sa fille, Jean COLENO déclare la profession de secrétaire greffier à Séné. Jean COLENO [18/10/1772 Billiers-24/2/1808 Séné] est l'époux de Marie BOUILLY, la fille du meunier de Cantizac. C'est un notable. Son oncle n'est autre que le recteur de la paroisse. Lors da la naisance de son 4° enfant, il déclare toujours être secrétaire greffier, fonction qu'il conservera jusqu'à son décès à l'âge de 36 ans. Séné compte alors 1.667 hab.
.../... poursuivre les recherches
Le dénombrement de 1841 ne mentionne pas de "secrétaire de mairie". En existe-t-il un? Vit-il sur Séné?
On retrouve la trace d'un autre secrétaire de mairie en 1855, quand Pierre Marie LOISEAU [18/8/1819 Billiers-15/05/1858 Malguénac], alors instituteur public de Séné au bourg, est nommé par le maire de l'époque, Mathurin Le Douarin. Séné compte alors 2.554 hab.
Cet article de 1905 nou sinforme que Jean Marie BOURDIC [2/11/1817 - 28/12/1904], paludier de son état fut de nombreuses années secrétaire de mairie et ensuite bedeau ou sacristain à l'église de Séné. Il assista à la destruction de la vieille église et apprécia la nouvelle église de Desperthe.
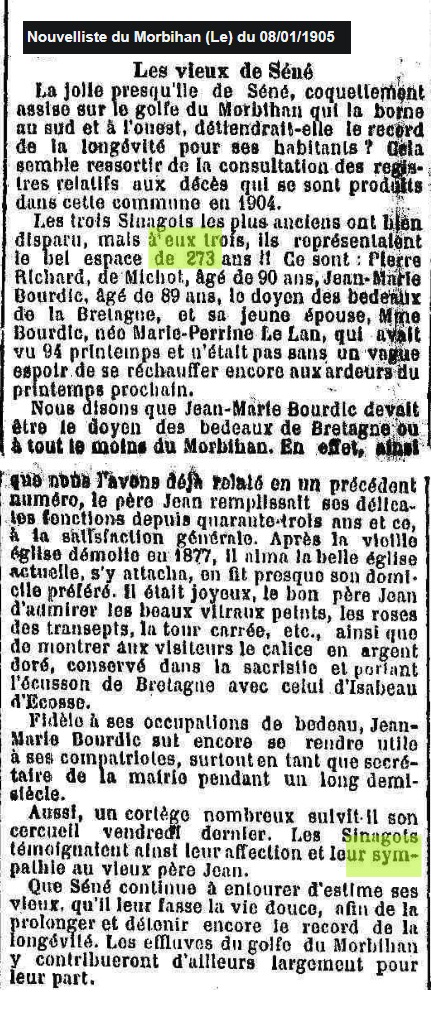
.../... poursuivre les recherches
Au dénombrement de 1886, on ne retrouve pas non plus la mention d'un secrétaire de mairie mais il manque des pages à cette archive.
Les dénombrements de 1901 à 1926, nous indiquent que Joseph Yves GIRARD [21/1/1863 Séné - 21/11/1927 Séné] est le secrétaire de mairie. Natif de Séné, il le fils d'un préposé des douanes en poste au bourg de Séné. On sait qu'il sera aussi le correspondant local de l'Ouest Républicain et qu'il mariera ces deux filles le même jour. Cette généalogie nous montre que la famille Girard est partie prenante de la vie sinagote. Le secrétaire de mairie s'est marié avec la fille d'un maître de cabotage. La famille perdra deux de ses membres pendant la 1ère guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Durant son "mandat", entre 1901 et 1926, la population de Séné décroit de 2.780 hab à 2.440 hab.
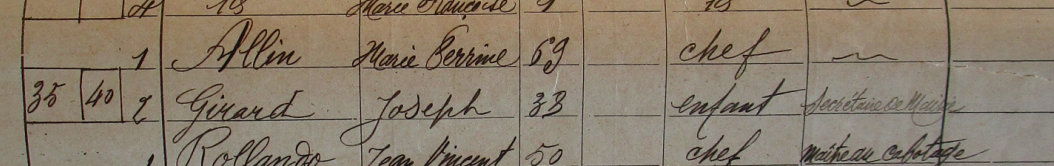
Dénombrmeent de 1901
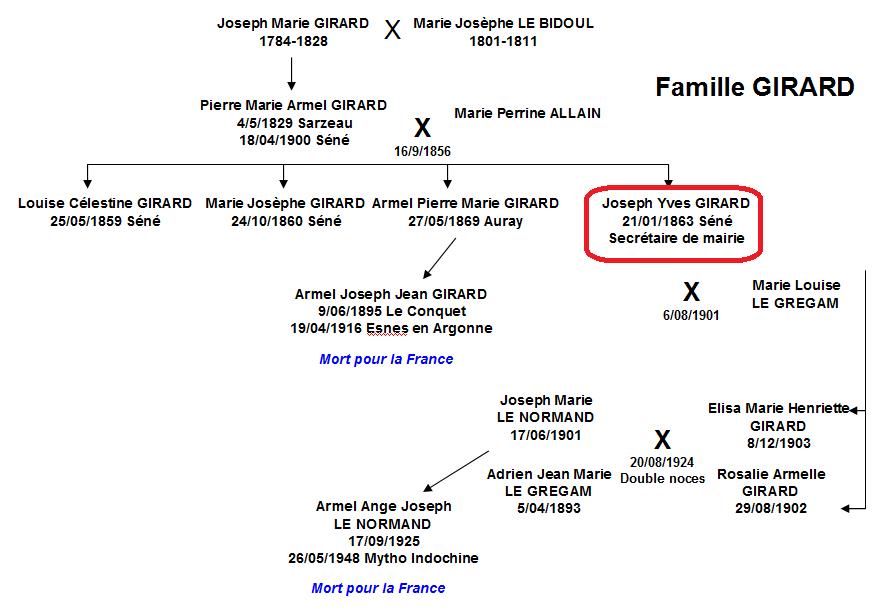
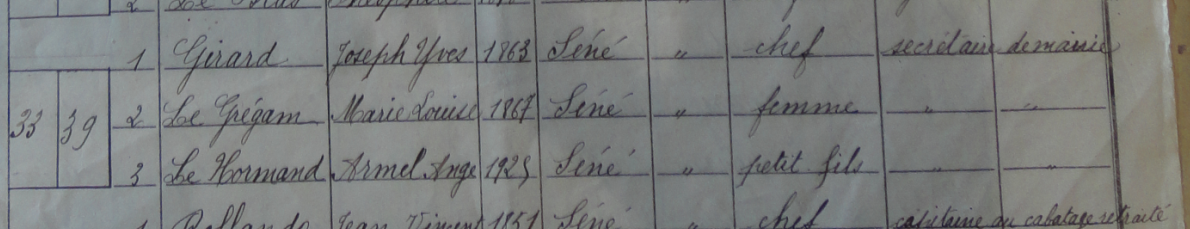
Dénombrement de 1926
A la suite du décès de Joseph Girard, Michel JOSEPH, ancien institueur, est nommé puis remercié par Patern LE CORVEC.
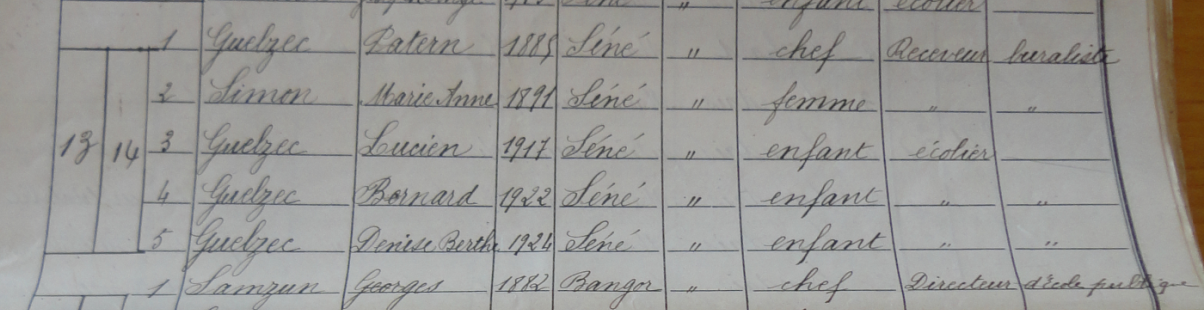
De 1928 à1936, c'est le Sinagot Patern GUELZEC [28/12/1885-27/16/1950] ancien receveur buraliste au bourg, ancien combattant de 14-18 qui assurera la fonction de secrétaire de mairie. Séné continue une décroissance démographique qui conduira la population à 2.091 hab à la veille de la 2° Guerre Mondiale.
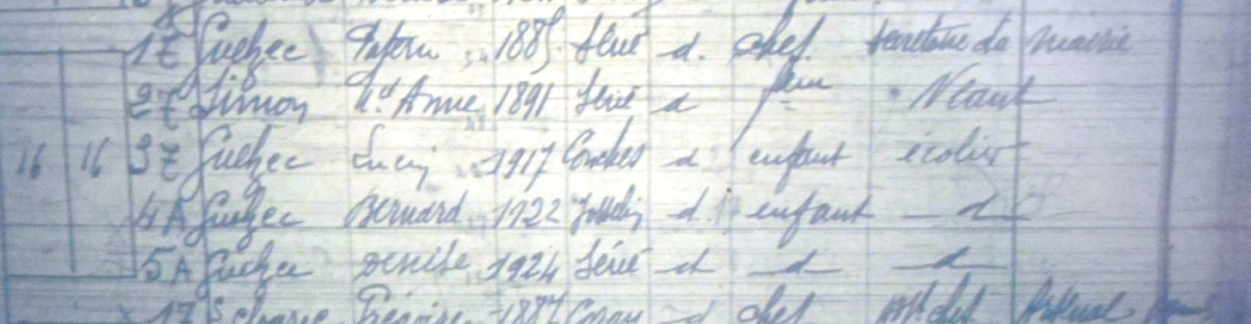
Dénombrement de 1936

Sous la mandat de Henri MENARD, la commune de Séné emploie 7 personnes réunis sur cette photo aux côté de M. le maire et son épouse, dont principalement des femmes sans doute pour le nettoyage des écoles et la cantine?
.../... poursuivre les recherches
Le recensement de 1962, nous donne le nom du secrétaire de mairie, Gaston Louis Roger GUILLOCHON [15/12/1913 Paris XIV - 3/9/2000 Ploërmel] qui finira sa carrière à Séné.
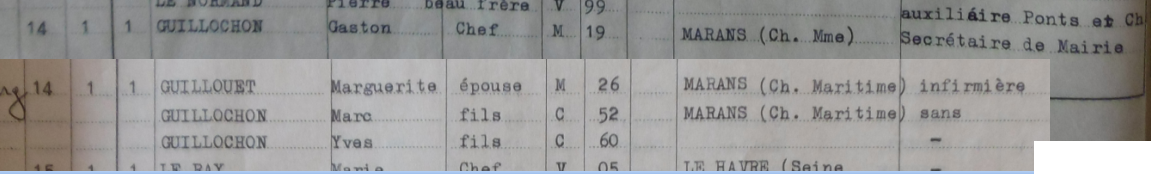
A son départ, Gilles GALLET (à confirmer) prend le poste mais ne reste que peu de temps à Séné.
En 1983, après les élections remportées par l'équipe de Francis POULIGO, Jacques MONTFORT, natif de Landivisiau, est nommé Secrétaire Général. Séné compte alors 4.599 hab et la ville emploie 33 personnes. Il restera en poste jusqu'en 1996. Marié à une Sinagote, il s'est établi dans la commune qu'il a adminsitré pendant plus de 12 ans. En 1990, le nombre total des employés municipaux s'èlève à 58 personnes.
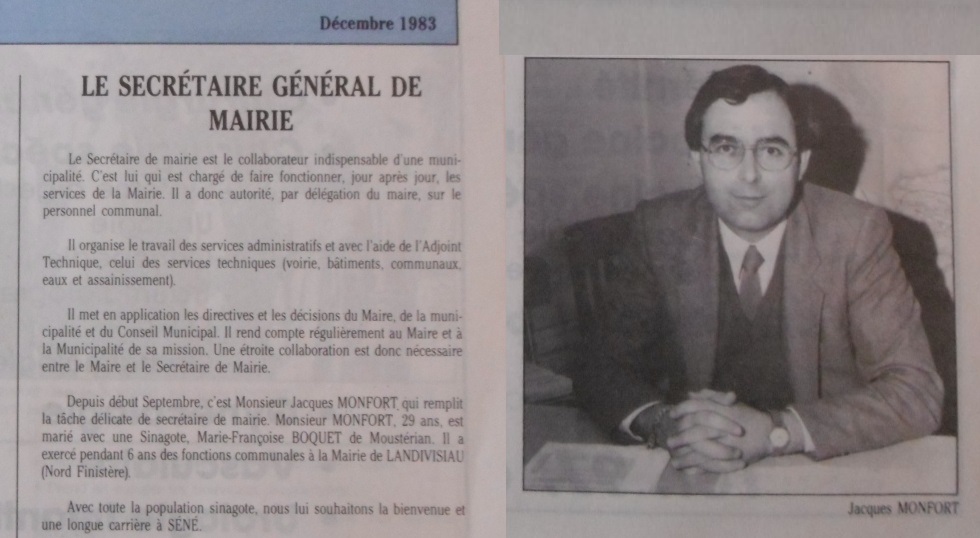
En 1996, Marcel Carteau nomme Claude SAUREL secrétaire général, poste qu'il quittera en mai 2000. La commune compte alors 7.868 hab et les services de la commune emploent env. 50 personnes.
Depuis le 1er avril, le maire procédait au recrutement d'un secrétaire général, à la suite du départ de Jacques Montort pour Ploëren. Choisi parmi pluieurs candidats, Claude Saurel a été nommé et prendra ses fonctions le 1er juillet. Agé de 33 ans et père d'un enfant, Claude Saurel a toujours exercé dans des villes supérieures à 10.000 habitants (Vitrolles, 39.000 habitants; Saint-Herblain, 434.000). Recruté par détachement (procédure complexe) il reste attaché à la commune de Vitrolles tout en exerçant et étant rémunéré par la commune de Séné. Le détachement normal est de cinq ans entre collectivités et renouvelable après accord. Se rapprocher de sa famille Il a souhaité venir à Séné pour se rapprocher de sa famille habitant sur Vannes et Grandchamp, et ainsi bénéficier des atouts du golfe du Morbihan. Titulaire d'une formation d'ingénieur et d'un DESS (certificat d'aptitude à l'administration des entreprises), Claude Saurel a effectué différents stages, notamment à EDF et à la DDE.
(Le Télégramme 23 avril 1996)
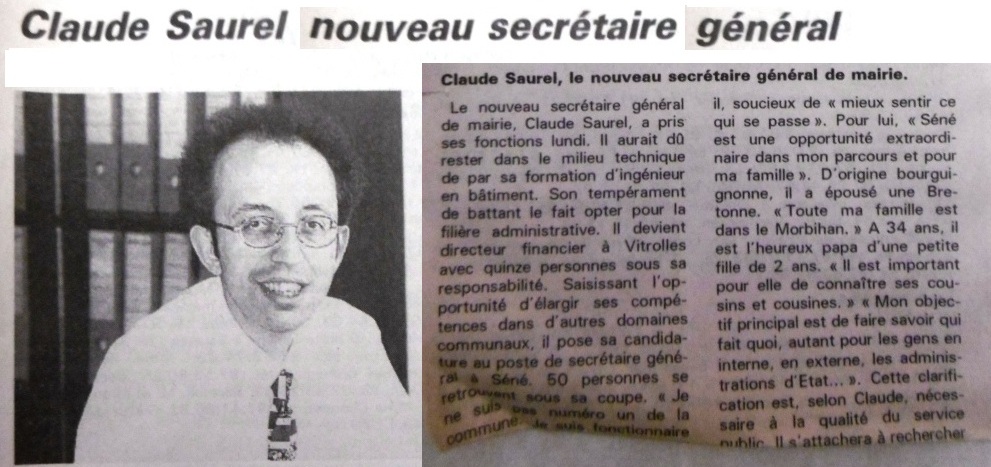
A l'été 2000, Marc CHAPIRO qui occupait la fonction de secrétaire général, est démis de ses fonctions par le maire Patrick SALLIC qui recrute en octobre Shahira JOURDAIN à ce poste. Entre temps, le Tribunal Administratif réintégrait l'ancien secrétaire dans ces fonctions. Séné comptera jusqu'à la retraite de Marc Chapiro, deux secrétaires de mairie, un en fonction et l'autre qui sera rétribué mais n'exerçera pas jusqu'à son départ en retraite.
Shahira JOURDAIN restera en poste en Séné jusqu'en mars 2005. Née à Alexandrie, où elle fait ses études au lycée français, puis à l'université avant de venir à Paris terminer ses études de Lettres. Après des débuts comme traductrice-interprète, elle prépare les concours de la fonction publique pour devenir cadre A. Nommée, en 1985, secrétaire générale de mairie à Montreuil (02), c'est en mars 1996 qu'elle se fixe en Bretagne, à Noyal-Muzillac, puis à Séné où elle occupe depuis octobre 2001 la fonction de Directrice générale des services. En mars 2005 elle part pour la ville de Cannes.
Daniel BOISSON rejoint la ville de Séné en décembre 2005 et occupera le sfocntions de secrétaire général jusqu'en 9/2012.
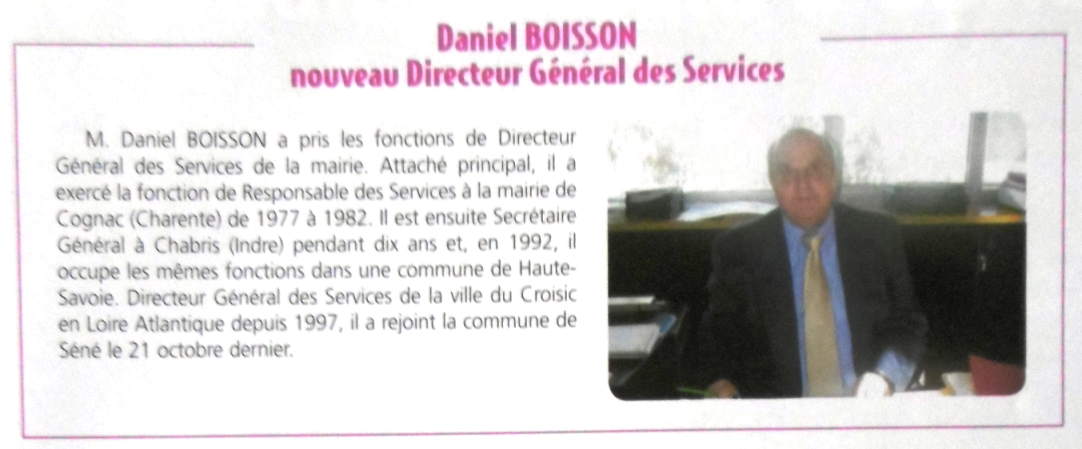
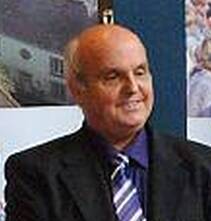
Depuis 1/2013 Céline MESSINA est la titulaire du poste de secrétaire générale de la commune de Séné
Originaire de Rouen, Céline MESSINA prend en charge la direction générale des services, à la suite du départ de Daniel Boisson. Elle a exercé les fonctions de directrice de CCAS (centre communal d'action sociale) en Haute-Garonne et de DRH (directrice des ressources humaines) à la Ville d'Evreux, 50 000 habitants et 2 000 agents municipaux. A Séné, à son arrivée elle encadrait 120 salariés pour une population de 8.821 hab. Selon le rapport social de 2022, la ville de Séné employait 137 agents pour une population de 9.155 hab (Insee) ou 9.647 hab(donnée DGF).
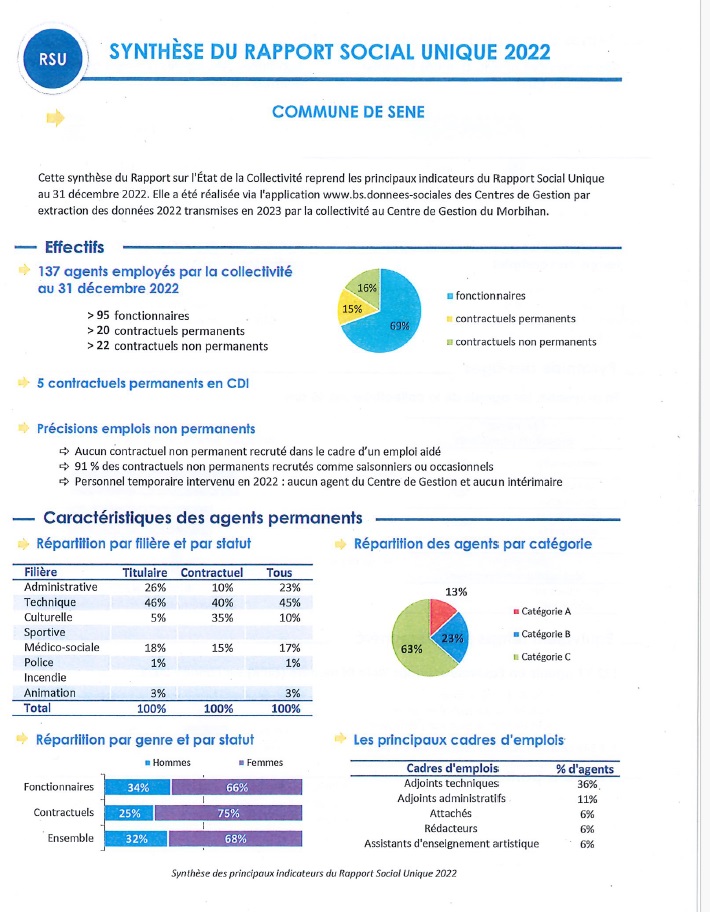
Le café rue de la Fontaine
LE BAR TABAC DU BOURG DE SENE
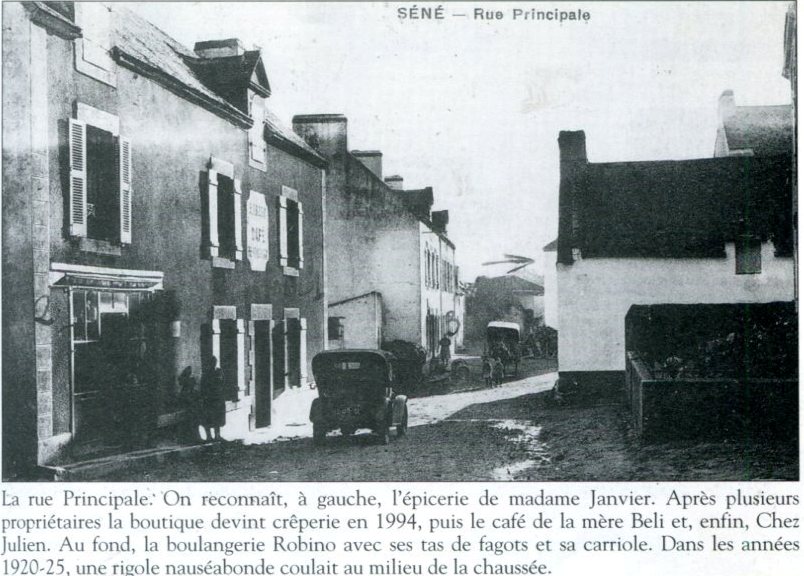
Cette photo, extraite du livre d'Emile MORIN, Le Pays de Séné, montre la rue Principale au bourg de Séné. Au second plan la boulangerie Robino avec devant une charrette prête à emporter le pain pour la tournée dans les nombreux villages de la commune. Au premier plan à gauche, à la hauteur de la voiture automobile, était situé un café-hotel-restaurant tenu par un membre de la famille Robino. Sur sa gauche, l'ancienne épicerie du bourg.
Mais à l'origine il y avait là une boulangerie...

Cet extrait du cadastre de 1810 montre le bâtiment de l'actuel bar-tabac. L'appendice arrondi signale un des deux fours à pain du bourg de Séné. Le cadastre de 1844 nous montre le même bâtiment. La boulangerie perdurera jusqu'aux années 1890 et deviednra un café. Quant à l'épicerie Janvier, elle sera construite ultérieurement.
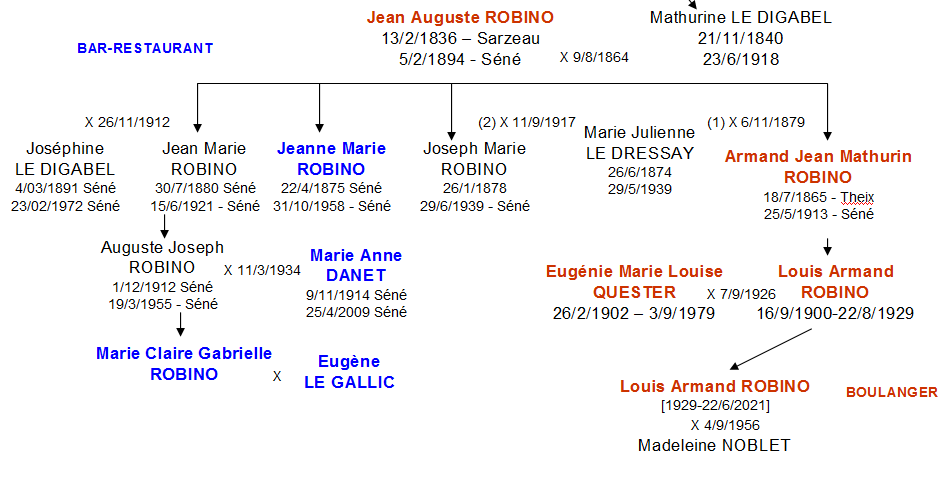
Après la première Guerre Mondiale, la famille Robino-Janvier a "tissé sa toile". Jean Marie ROBINO est boucher place de l'Eglise; sa soeur Jeanne Marie ROBINO, dite "tante Bélie", est restauratrice, épaulée par une enfant de l'asssistance, Jeanne Suzanne BAUDERO; elle a logé les peintres André Mériel-Bussy et Arthur MIDY lors de leurs venues à Séné. Son autre soeur, Anne Marie Françoise ROBINO, veuve de Guillaume JANVIER, épaulée d'une enfant de l'assistance, Madeleine LAURE, gère l'épicerie du bourg.
A quand remonte la vente de tabac dans ce café de Séné, qui en comptait une grand nombre au bourg et dans les villages?
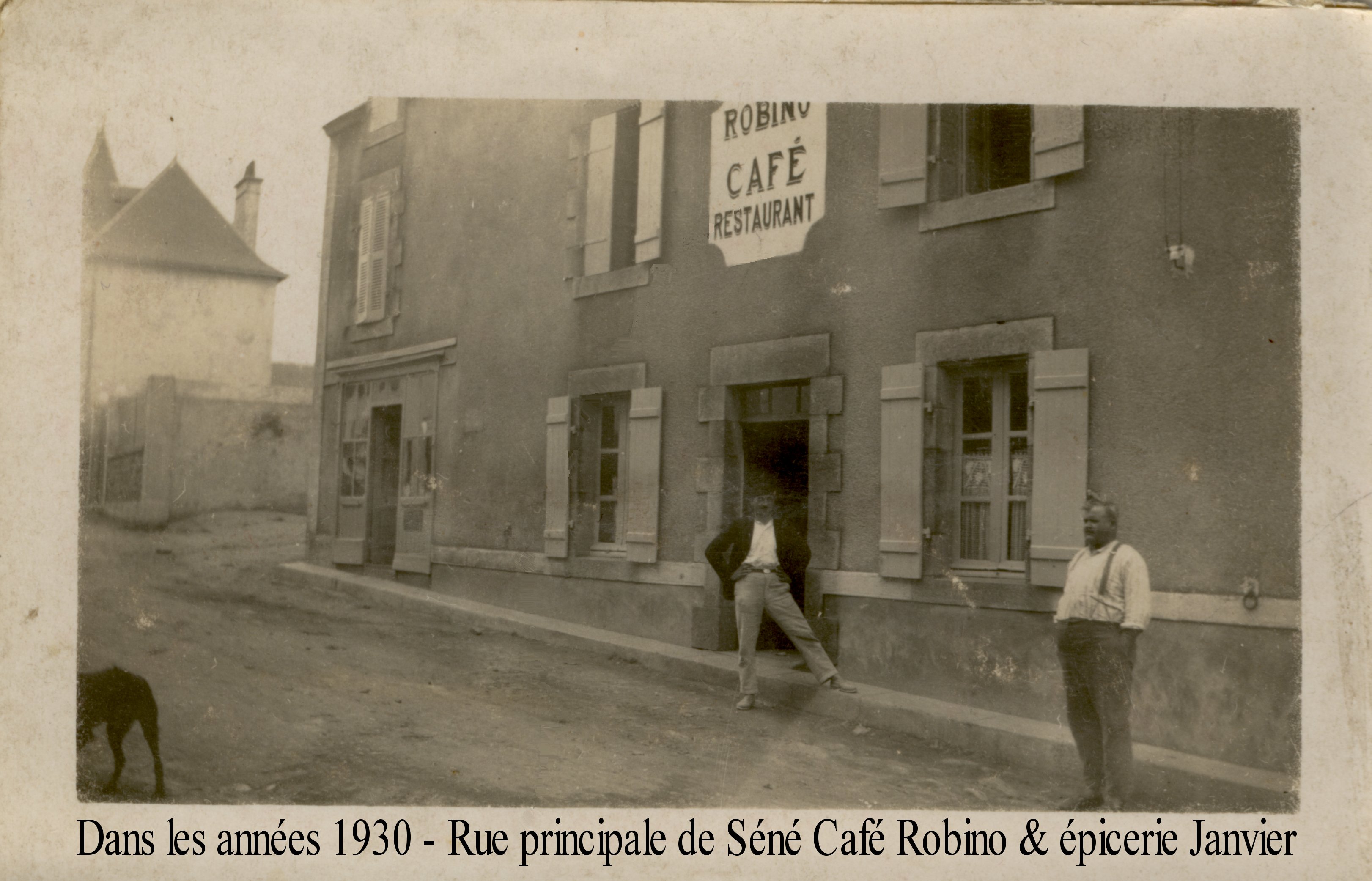
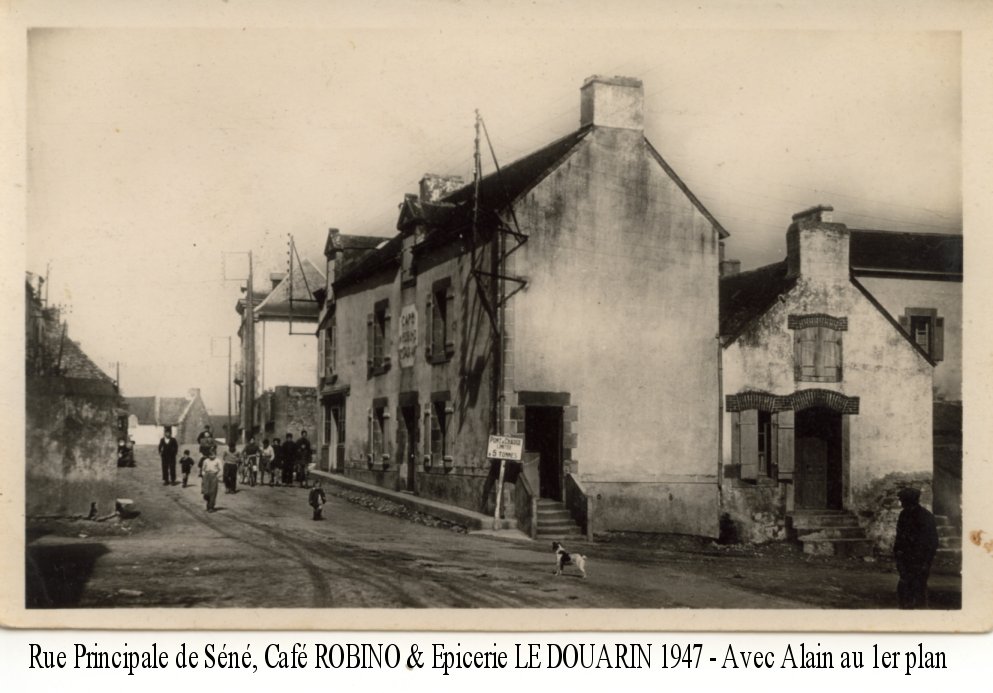
Tante Bélie (Jeanne Marie ROBINO) ne se mariera pas, si bien que la café passe à la famille de son frère Auguste Joseph ROBINO.
Marie Madelaine Maggio se souvient: "Tante Belie a tenu la bar presque jusqu'à son décès en 1958 ensuite cela devait être son neveu Auguste ROBINO, la marie de Marianne qui devait tenir le bar mais il était décédé en 1955. Alors, c'est une employée de Tante Bélie, Marie ROLLAND qui a tenu le bar jusqu'à ce que Marianne ait pu laisser la boucherie à sa fille Marie-Claire (1960). A cemoment-là, Marie ROLLAND a tenu un bar près de l'Eglise au coin de la rue des Vierges.
Marie-Claire et Eugène LE GALLIC ont tenu le bar quand ils ont vendu la boucherie vers 1978. Ils ont venu le fond de commerce à Julien Pédrono en 1988. Marie Claire m'a dit que la Tante Bélie vendait du tabac "à la coupe" et aussi du tabac à rouler. Quand elle a arrêté, la vente de tabac a été confiée à l'Hôtel Restaurant Guillonnet et ensuite Marie-Claire a récupéré la vente de tabac.

Sur cette capture d'écran, extraite du film de Bernard Moisan de 1964, on peut voir les aménagements effectués avec notamment l'entrée de l'établissement portée à l'angle de la Rue de la Fontaine et de la rue principale. Eugène LE GALLIC [3/12/1930-19/4/2016] conservera son établissement qui portait le nom LE RENDEZ VOUS DES SPORTIFS, jusqu'en 1987. A sa retraite, M. LE GALLIC deviendra Président du Football Club de Séné.
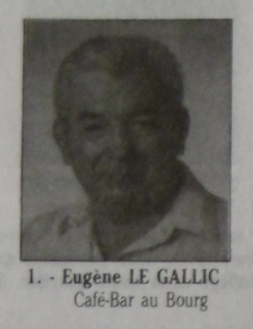

La famille Rocard dispose d'une maison familiale sur l'île de la Garenne où l'homme politique en vue sera interviewé en 1979.Michel ROCARD [1930-2016] sera présent à Séné lors de l'inauguration du collège. Lors de ses passages à Séné, il lui arrviait de fréquenter le scommerces dont le tabac-presse du bourg comme ici en mai 1988.

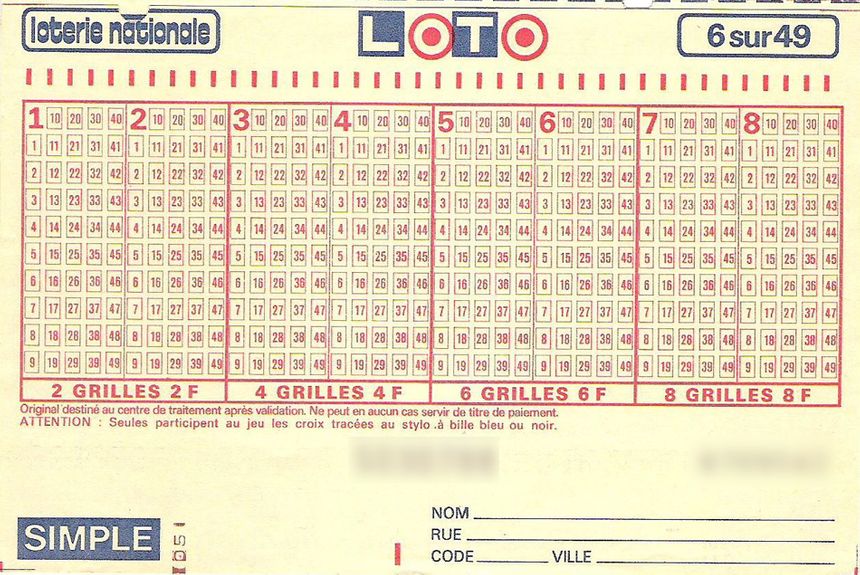
Jocelyne et Julien PEDRONO reprennent le 1er avril 1987, la café du bourg qu'il nomme le Bar des Sports. Deux ans plus tard, ils ajoutent à la représentation du Loto National, celle du PMU. Beaucoup de Sinagots qui allaient le dimanche faire leur tiercé sur Vannes, le font désormais au bourg. Cette afflux de clientèle dominicale dynamise la boulangerie de la place de l'Eglise. A la même époque, de nombreuses associations sportives peuvent organiser leurs assemblées et leurs repas dans des salles mises en place par la mairie. Le Bar des Sports est de moins en moins le lieu de rendez-vous des sportifs amateurs de la commune.
M. Pédrono se souvient d'un autre client célèbre qui a fréquenté son établissement: Léon Zitrone [25/11/1914-25/11/1995]. Le journaliste, animateur de télévision, avait acheté une maison à Montsarrac pour sa fille et son gendre convalescent.
M. Pedrono sera aussi à l'origine de la "résurrection" du bar-brasserie Le Suroît route de Nantes.
Roger et Françoise GARNIER reprennent la bar-pmu du bourg en avril 1999 et le rebaptisent LE SPORTIF

Vers 2006, Hervé et Magali BESNARD reprennent l'établissement qu'ils conserveront pendant 10 ans.

Au printemp 2016 le café est repris par Jean Pierre et Frédérique LOHEAC et adopte le nom LE SENE MARIN.


En avril 2022, le bar-tabac du bourg est repris par Christophe et Cyrielle MANÇAUX originaire d'Auray.

En janvier 2024, la SABRIVO de Ivonig GOUELLO et Sabrina GLOANIC arrivant de Campbon, reprennent le Séné Marin.
CHAPELAIN, condamné à la relégation
CHAPELAIN Yves Marie [29/10/1853-27/6/1892] nait au village du Versa dans le nord de la commune. Ses grands-parents de Chapelain sont recensés en 1841. 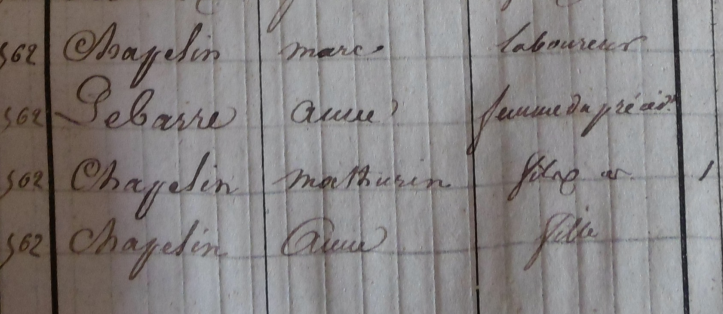
Son père, Jean Marie [10/10/1819-25/7/1859 Séné Versa], absent lors de ce recensement, il a 22 ans, doit faire son service militaire. Il sera d'abord cultivateur comme ses parents avant de devenir maçon . Au début des années 1850,, il a épousé Yvonne OLIVIERO.
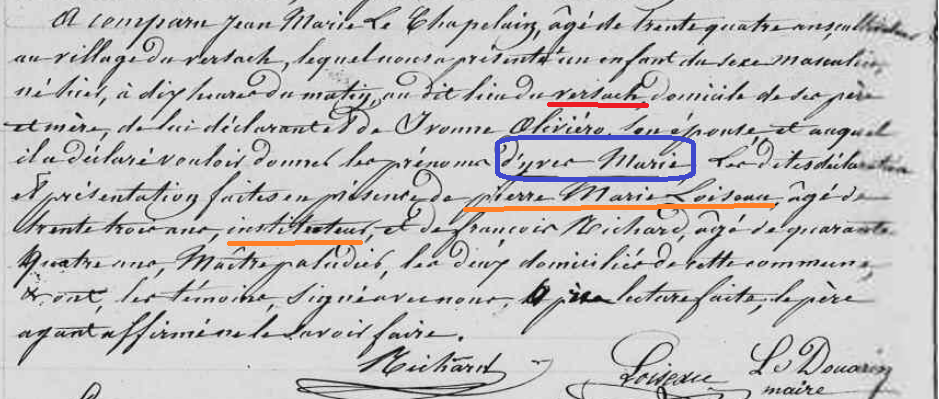
L'acte de naissance Yves Marie CHAPELAIN révèle qu'un des témoins n'est autre que l'instituteur du village Pierre Marie Loiseau. Fut-il un bon élève?
La recherche des enfants de la famille Chapelain sur les registres de l'état civil à Séné nous donne, Yves Marie né le 29/10/853 puis Marie Anne, née le 13/9/1855; deux jumelles mortes enfants, Joséphine [28/8/1857-4/9/1857] et Françoise [28/8/1857-25/4/1858]. Ces enfants étant tous nées au Versach où leur père décède le 25/7/1859.
Après la défaite de Sedan, la jeune III République à la volonté de reconstituer des forces armées nationales. Le jeune CHAPELAIN s'engage le 17/8/1872, il a alors 19 ans, dans le 93° Régiment de Ligne et en sort le 17/8/1874 soldat de 2° classe. Il se réengagera en 1881, mais ses difficultés avec la discipline militaire le conduiront à être à plusieurs reprises déclarés insousmis. C'est le début des fiches de matricule des jeunes Français qui nous permettent de retracer le parcours militaire mais également civil des appelés.
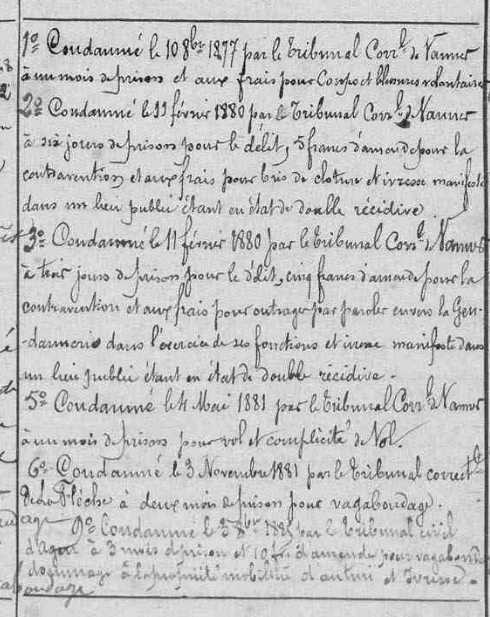
La fiche de matricule de Yves Marie CHAPELAIN mentionne également ses condamnations. Et elles sont nombreuses!
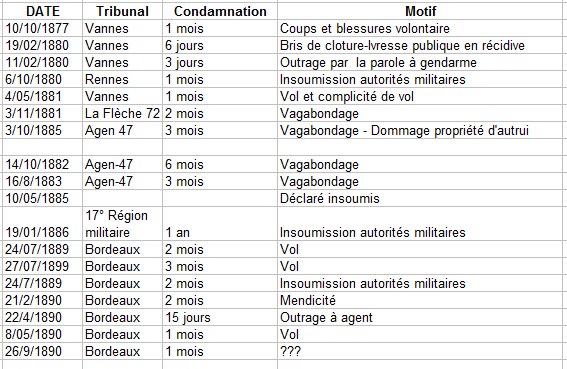
Celles établies par le tribunal correctionnel de Vannes font l'objet d'articles dans la presse locale.
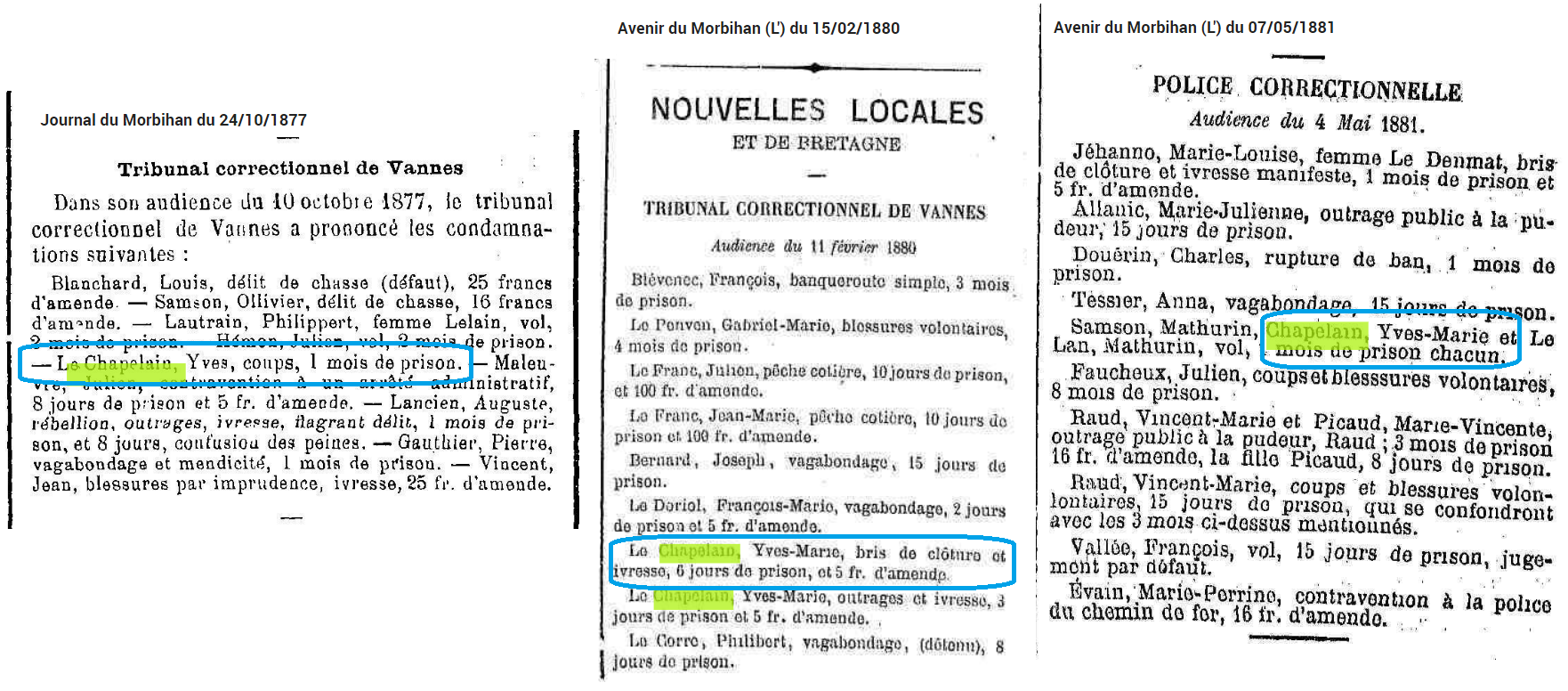
La relégation est une peine corporelle créée par une loi de 1885 et supprimée en 1970. La relégation était définie comme « l'internement perpétuel sur le territoire de colonies ou possessions françaises, des condamnés que la présente loi a pour objet d'éloigner de France » (métropolitaine).
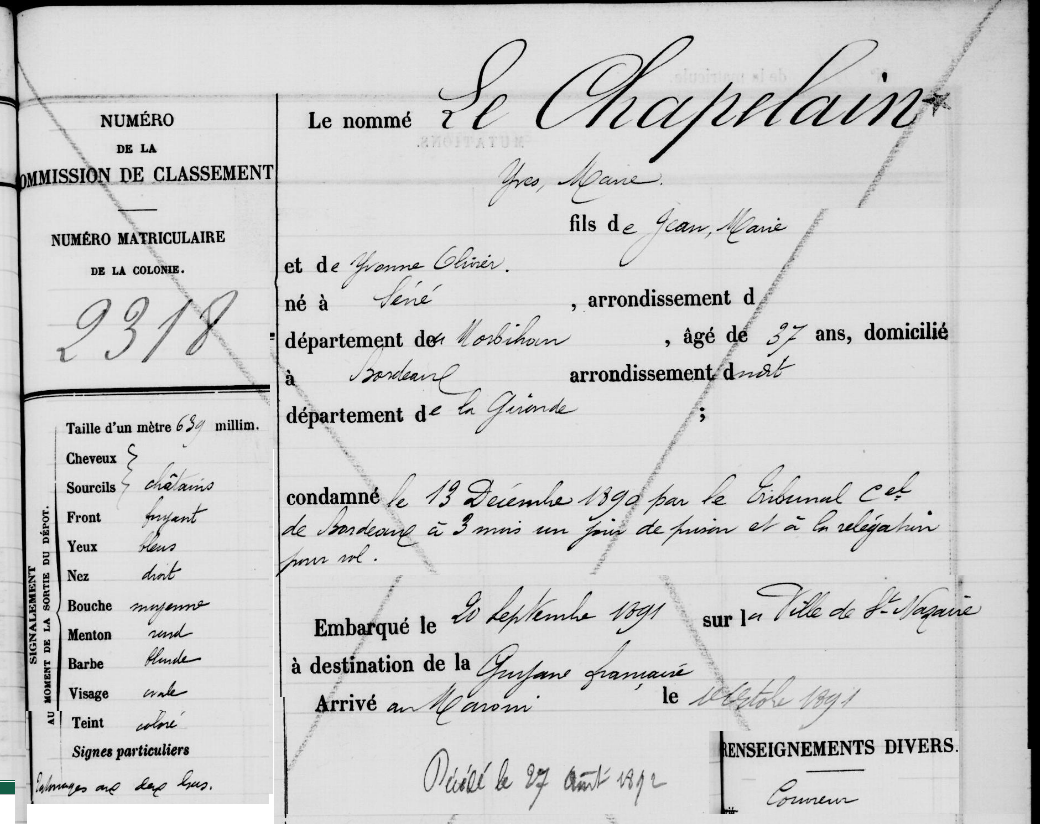
Le 13 décembre 1890 le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le condamne à 3 mois de prison un jour de prison et à la relegation pour vol. Le 20 septembre 1891, il embarque à bord du Ville de Saint-Nazaire pour la Guyane.
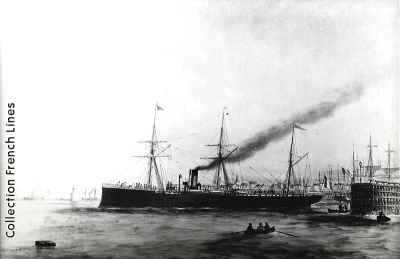
Il arrive à Saint Laurent du Maroni en octobre 1891. L'administration pénitencière indique en "Renseignements Divers" que notre Sinagot, insoumis et multirécidiviste est couvreur.
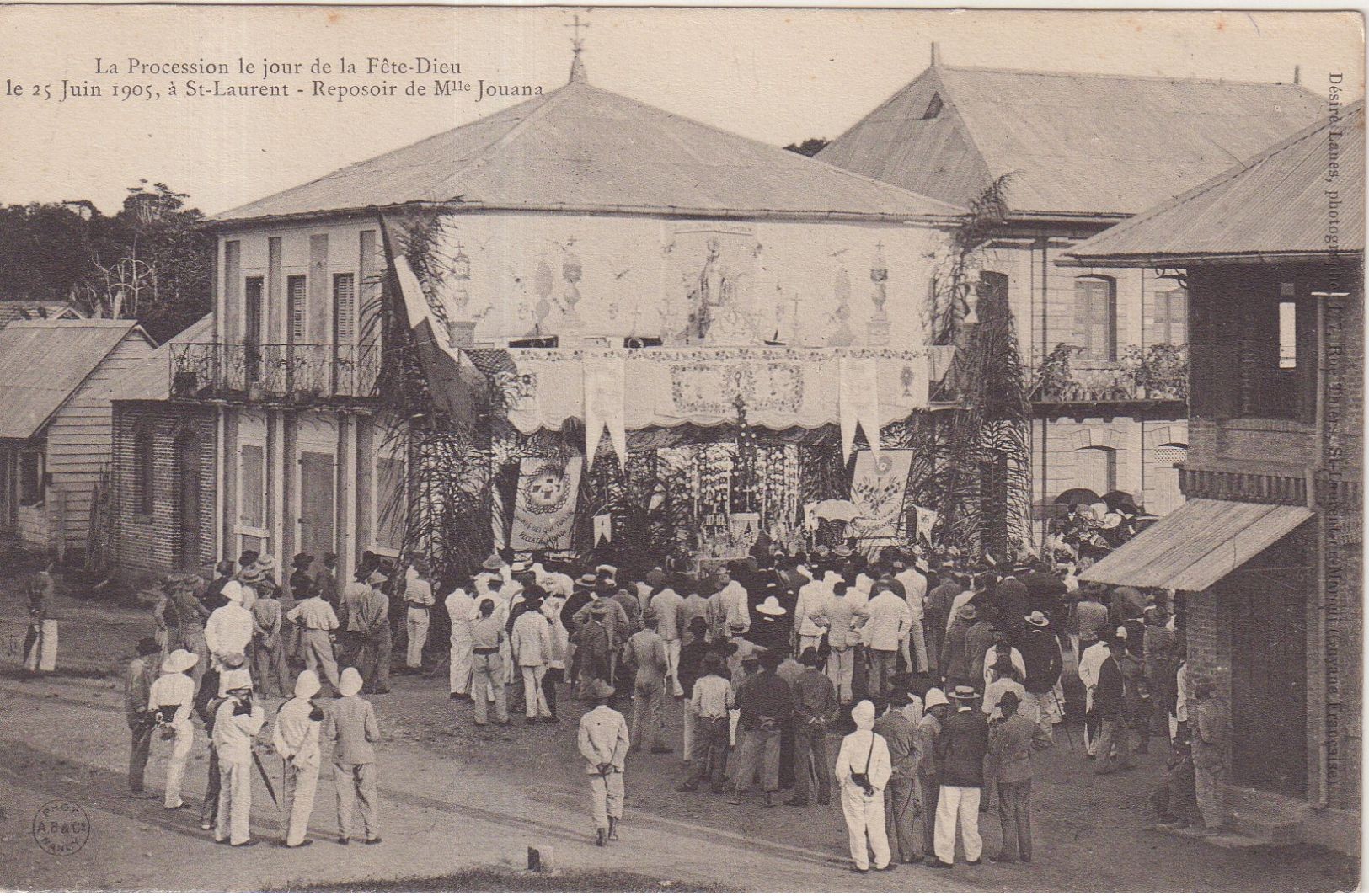
Yves Marie CHAPELAIN dont la dernière profession fut "marin", décède à Saint Jean du Maroni, en Guyane le 27/6/1892.
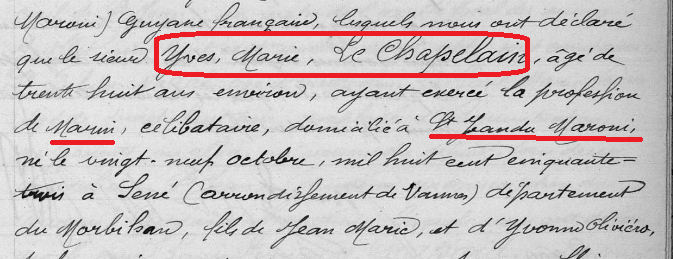
CONAN, le bagnards du Versa, 1864
Vincent CONAN [7/6/1838-7/4/1865] nait à Séné au village du Versa. Son père Yves CONAN [8/8/1807-12/9/1880 St-Avé] est natif de Saint-Avé. Son père se marie le 19/7/1830 à Séné avec Jeanne Louise LE DOUARIN [15/2/1810 Séné-13/2/1875 St-Avé], et déclare la profession de laboureur et vivre à Saint-Patern à Vannes. Sa mère quant à elle, est native de Cressignan en Séné au sein d'une famille de laboureurs.
Le lieu de naissance des 10 enfants de la famille Conan, permet de suivre son lieu de vie et de travail. Les deux premiers enfants naissent à Vannes. Marc CONAN [17/12/1835-25/8/1859] nait au Versa et mourra de fièvre typhoïde lors de la Campagne d'Italie des Armées de Napoléon III comme l'autre soldat sinagot Allano. Puis viennent Vincent, Jeanne Marie [4/9/1840-1840], Marie Louise [2/12/1841-1842] et encore Jeanne Marie [20/12/1842-??]. La famille est pointée au dénombrement de 1841 au Versa.
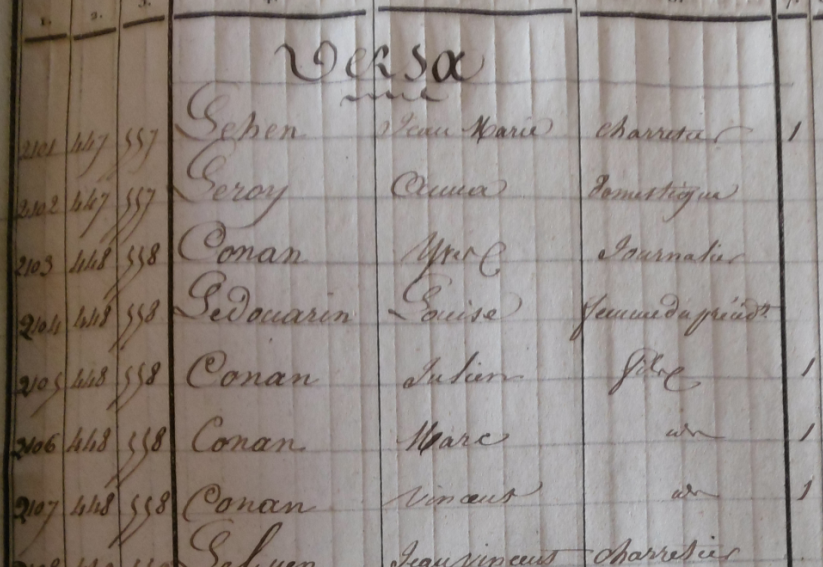
Ensuite la famille gagne Saint-Avé où naissent Jean Marie [11/1/1846-29/9/1904 qui sera carrier; Jean François [4/8/1848-19/7/1870 qui sera laboureur et Marie Anne [7/2/1851-??]. On note au passage la forte mortalité infantile qui affecte les enfants de la famille Conan.
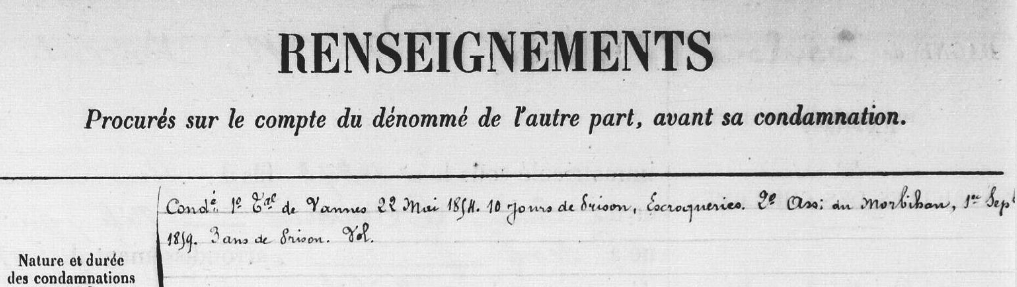
Vincent CONAN écope de sa première condanation à l'âge de 16 ans, le 22/5/1854. Il fait 10 jours de prison pour escroquerie. Lors de son procès en 1864, la profession de Vincent CONAN est ouvrier cordonnier et il demeure à Questembert. Il fait la connaissance de Marie Françoise FALHER, jeune prostituée de 23 ans à Vannes. Celle-ci approche un dénommé Guillaume MORICE, porteur d'eau de son état.
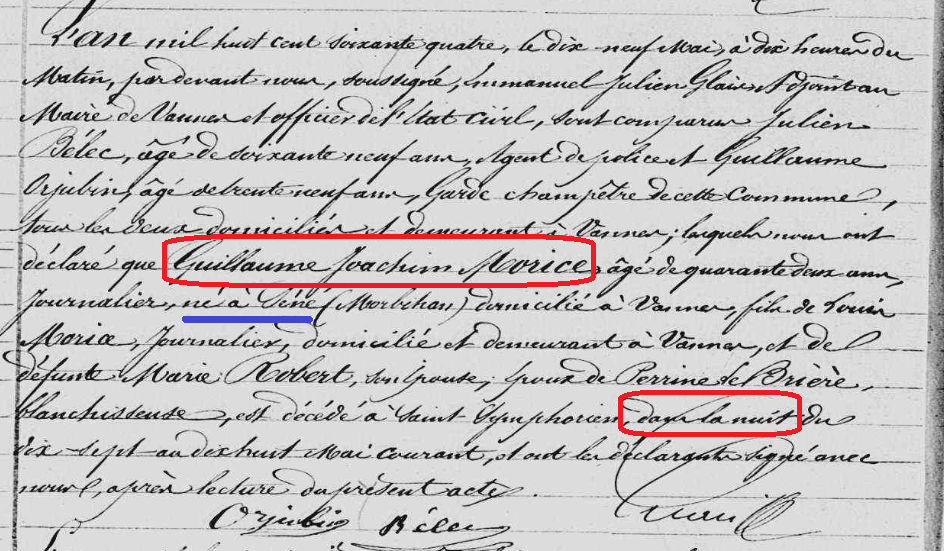
Guillaume Joachim MORICE [26/7/1822-17-18/5/1864] est natif de Séné. Sa mère Marie ROPERT [30/5/1795 Séné Versa - 24/2/1835 Vannes] a épousé à Vannes Louis MORICE [23/9/1793-2/2/1869 Vannes]. Lorsqu'il se marie à Saint Jean Brevelay le 21/11/1845, il déclare la profession de cultivateur comme son épouse, Perrine LE BRIERE [7/6/1822-??].
Selon les articles de presse d'époque, au moment des faits, il est porteur d'eau à Vannes et selon son acte de décès, sa femme est blanchisseuse. Dans la nuit du 17 au 18 mai 1864, il est détroussé et tué à l'arme blancheaux abords de la nouvelle rue Billault à Vannes.
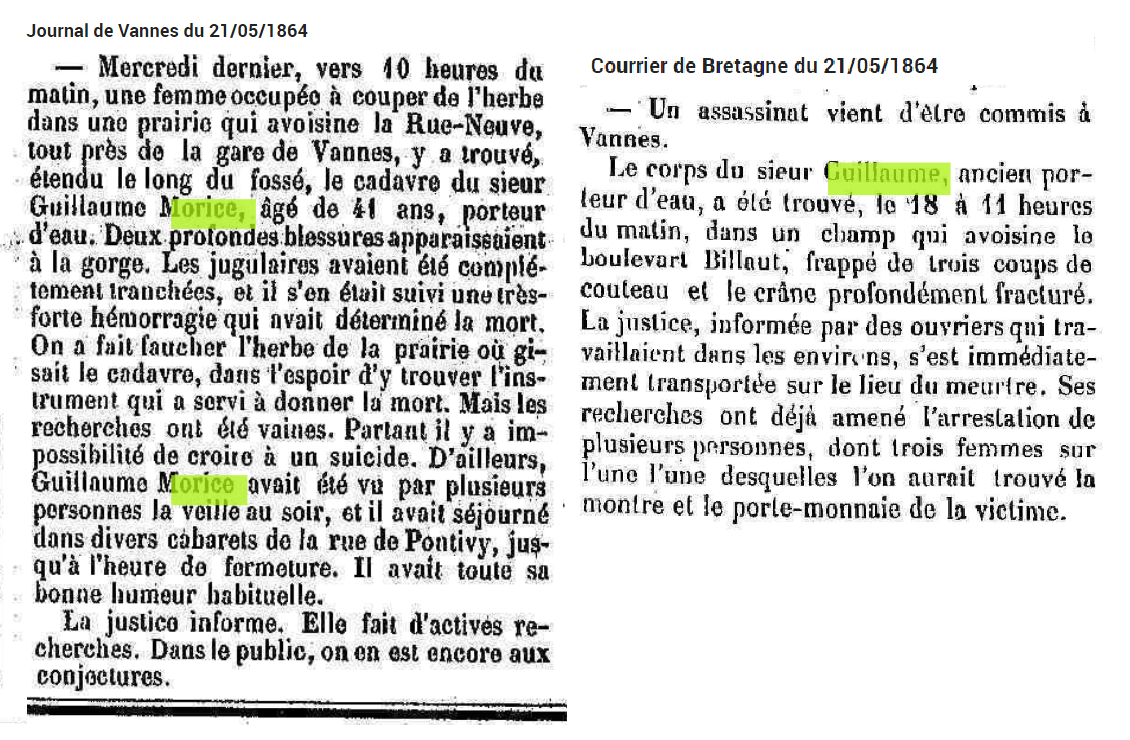
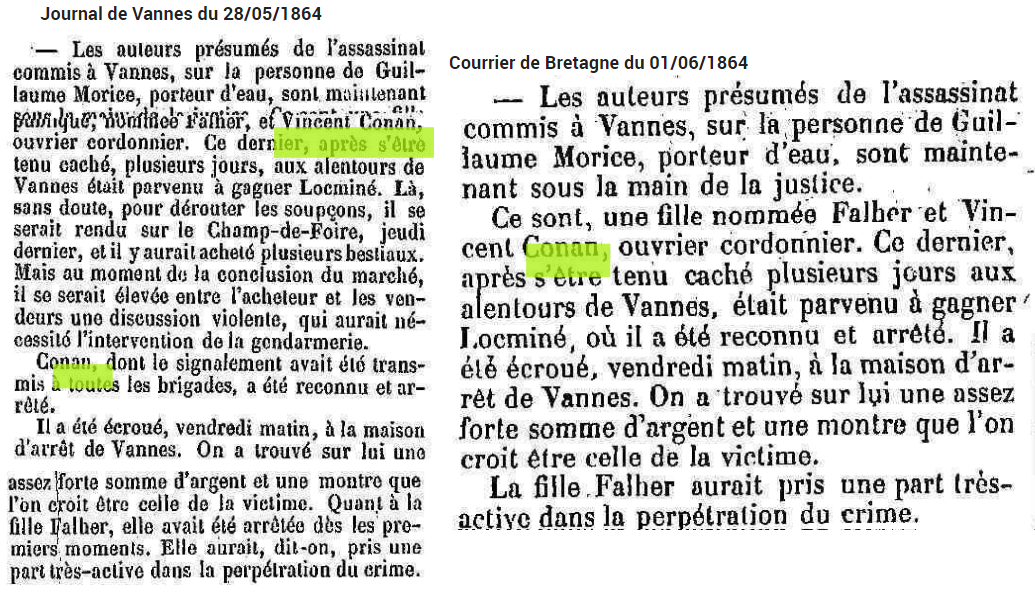
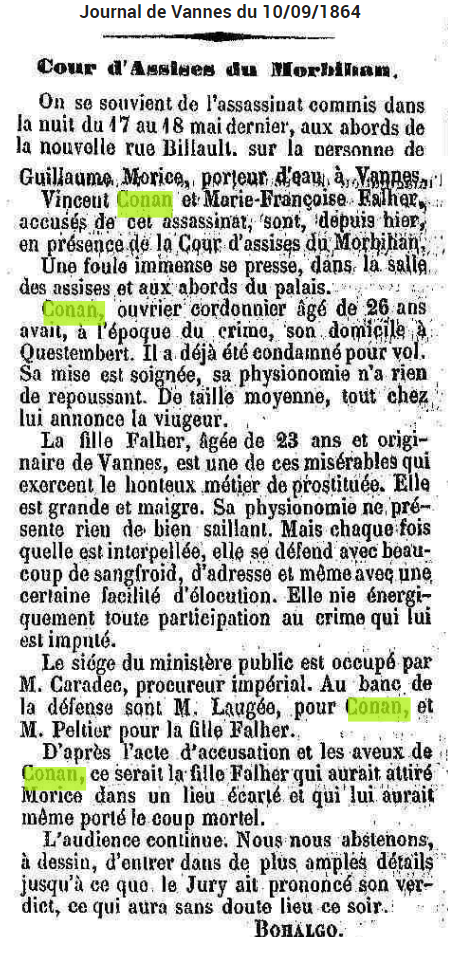
Vincent CONAN sera condamné le 10/9/1864 aux travaux forcés à perpétuité.(documents ANOM)
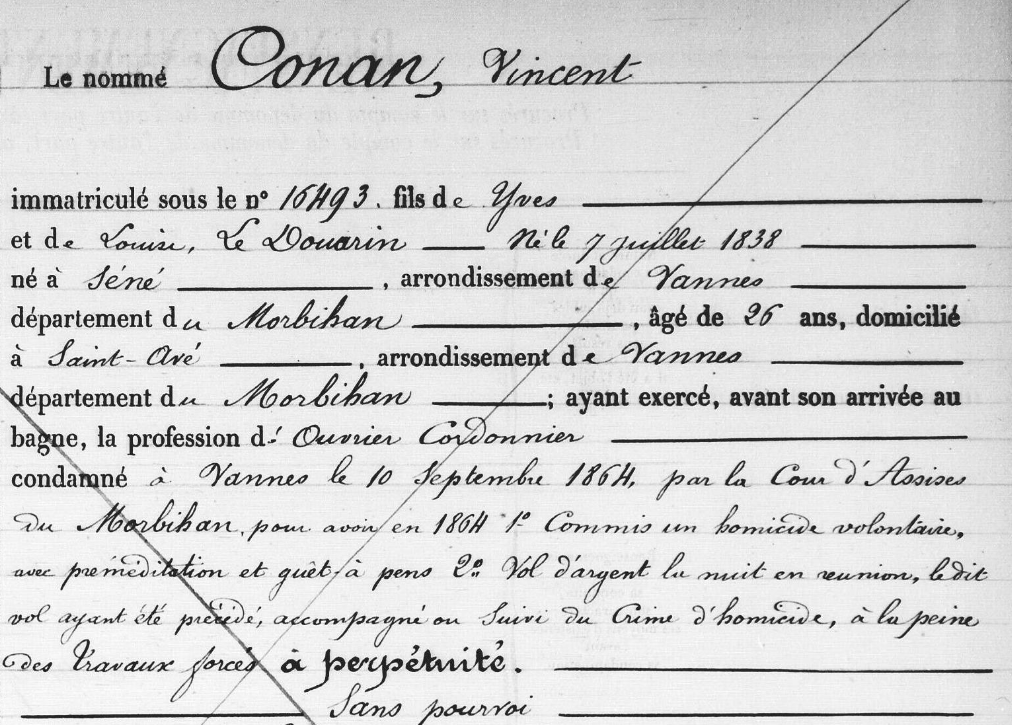
Il arrive au bagne de Toulon le 6/10/1864. Il est détaché des chaînes le 21/11/1864 et embarque sur le Céres pour la Guyane où il sera emprisonné sur l'ïle au Salut.
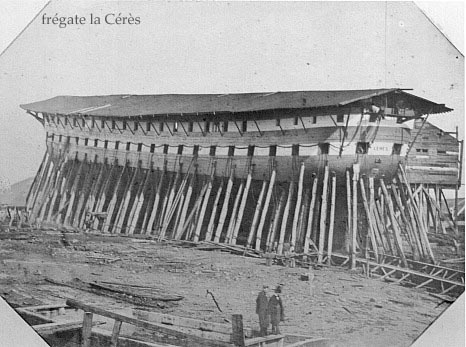
Il décède environ 4 mois après son arrivée le 7 avril 1865.
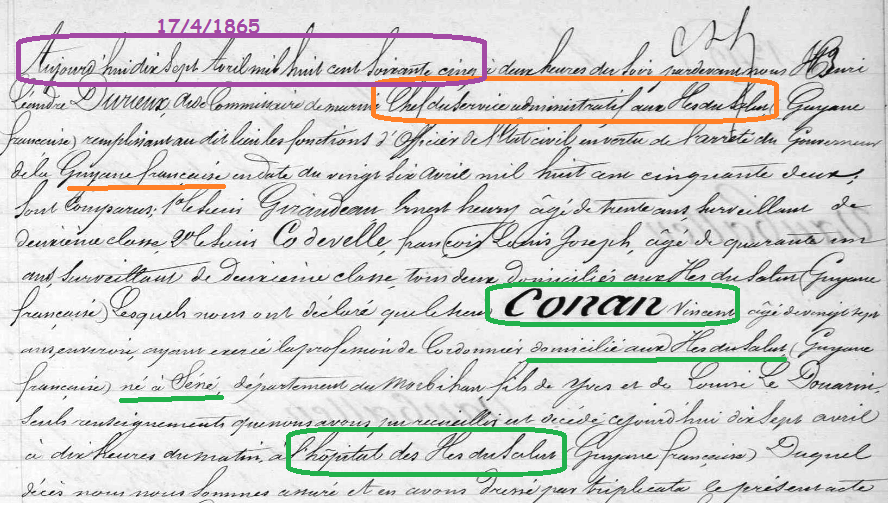

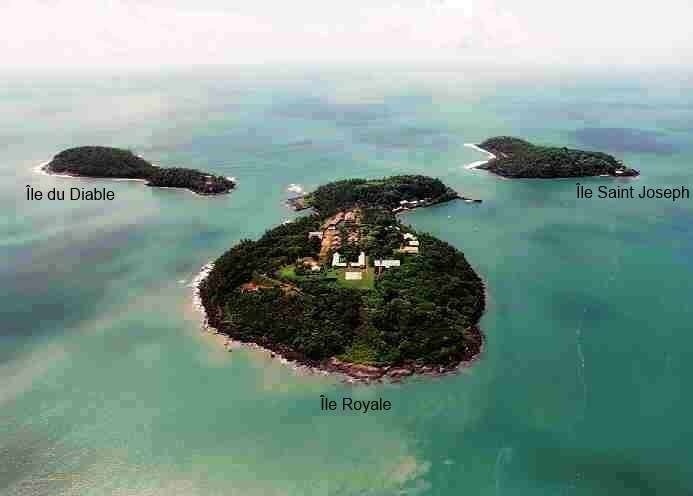
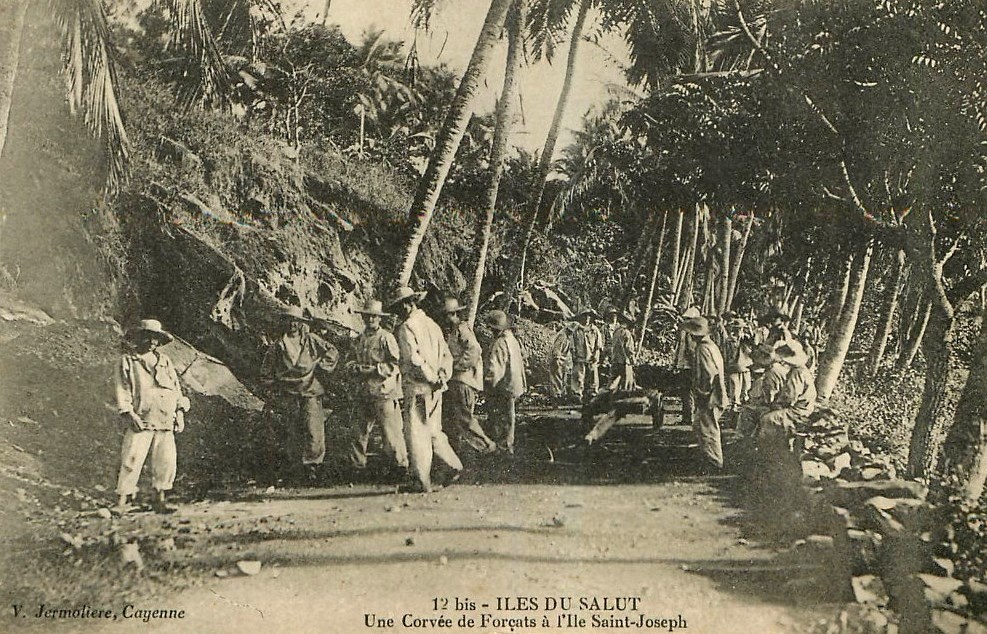
Chez les MAHE, les 3 garçons seront instituteurs
On ne remerciera jamais assez le travail de numérisation réalisé par les Archives du Morbihan. Pour le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, un grand nombre de fiches de matricule des soldats ont été ainsi mise à la disposition des historiens amateurs. Wiki-sene s'est procuré une extraction par profession. En la regardant de près, on peut voir le nom de 3 soldats ayant le même patronyme et ayant déclaré avant de partir à la guerre, la même profession d'instituteur. On a envie d'en savoir plus...et de raconter une histoire...
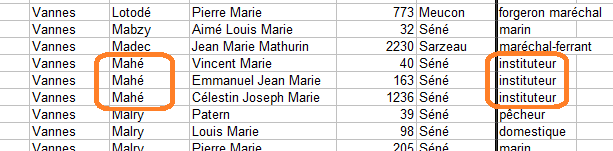
Louis MAHE, né en 1819 à Vannes, est l'enfant naturel de Marie MAHE, native de Sarzeau et domestique à Vannes. A l'age de 20 ans, il accomplit son service militaire dans la marine à Toulon d'où il sort matelot de 3° classe.
Sa future épouse, Marie Josèphe LE ROUX nait en Arradon au village du Moustoir en 1834. Sa mère et ménagère et son père Joachim LE ROUX est Préposé des Douanes.
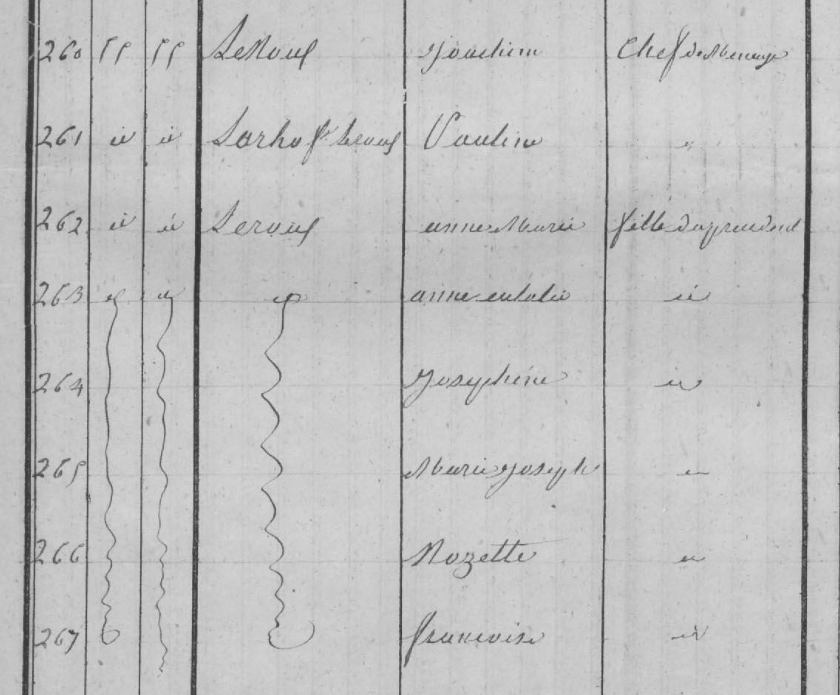
Les obligations de service amènent la famille sur l'Ïle au Moines où il décède en 1843. Le dénombrement de 1841 de cette commune montre la composition de la famille Leroux: que des filles! Notre "Marie Josèphe", quittera l'île pour aller travailler sur Séné où elle déclare l'activité de cultivatrice l'année de son mariage, en 1859 avec l'ex Matelot de la Marine, Joseph MAHE, qui fils naturel, obtient de son ancien Général de Brigade, l'autorisation de prendre épouse.
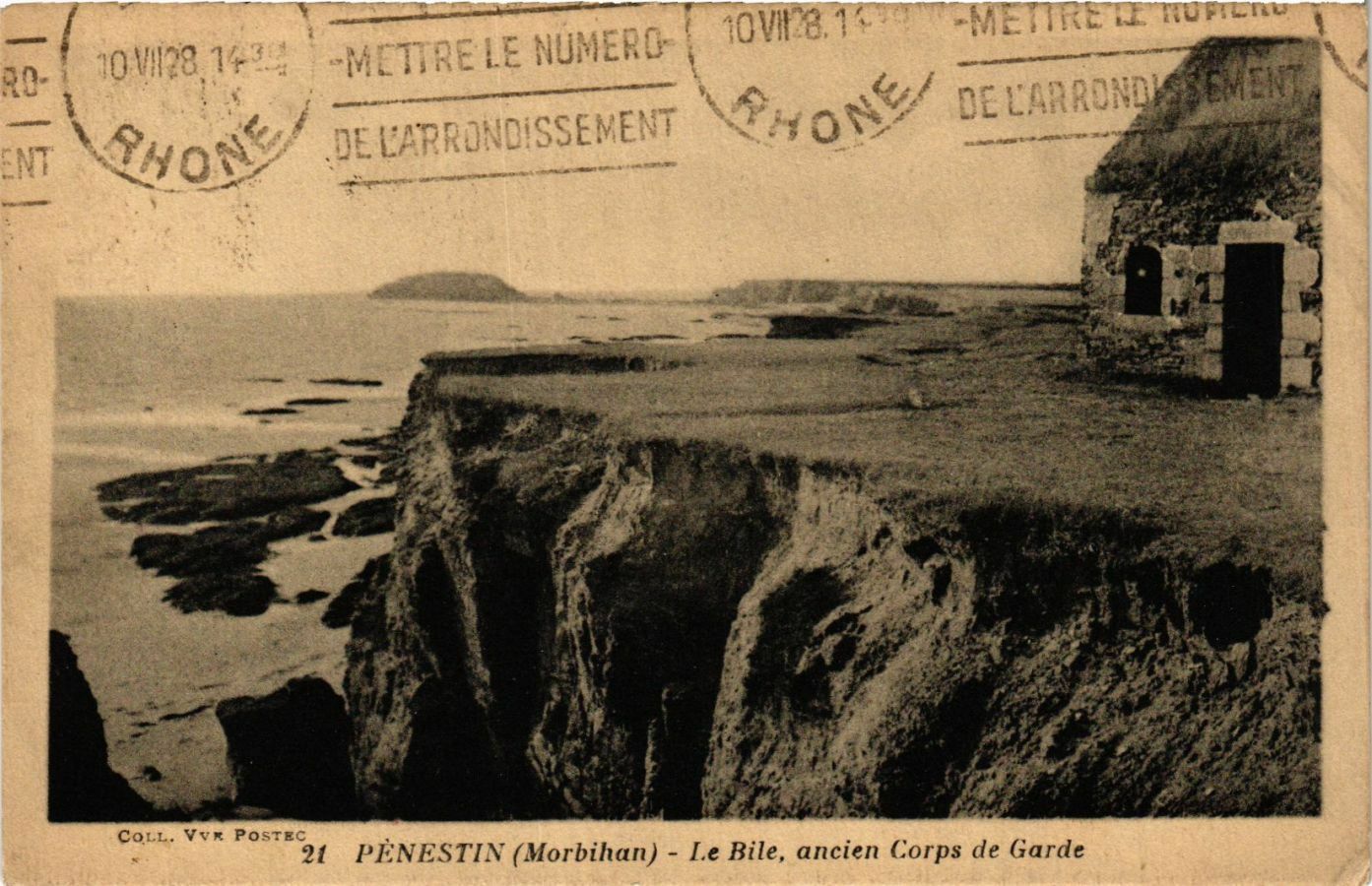
Le jeune couple s'installe à Moustérian où nait leur premier enfant Marie Louise Françoise. L'acte de naissance nous apprend que son père est préposé des douanes au port deTrehiguier commune de Pénestin. Le gendre a donc choisi la carrière de son beau-père.
Pour la naissance de Marie Rose, leur 2° enfant, en 1861, Louis MAHE est matelot des Douanes à Langle en Séné. L'acte de naissance de ses jumelles nées en 1864, dont une meurt la même année, nous précise que la famille vit à Canivarch. Deux ans plus tard, arrive le 1er garçon, Edouard alors que la famille du douanier vit à Montsarrac. Le 2° garçon, Emmanuel, vient au monde alors que la famille vit toujours à Montsarrac en 1869. Le 3° enfant mâle, Célestin, voit le jour à Moustérian en 1874. Vincent sera le 4° garçon de la famille toujours installée à Moustérian en 1876. En 1880, la famille est endeuillée, l'ainé des garçons, Edouard, décède à l'âge de14 ans.
Les enfants étaient surement scolarisés dans les Ecoles de Séné qui ont vu le jour ces dernières années.
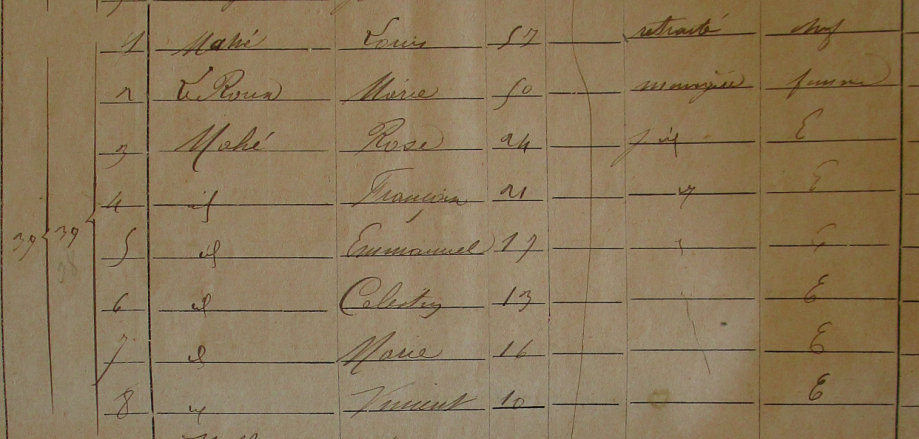
En 1886, le dénombrement à Séné indique que Louis MAHE est retraité à Moustérian.
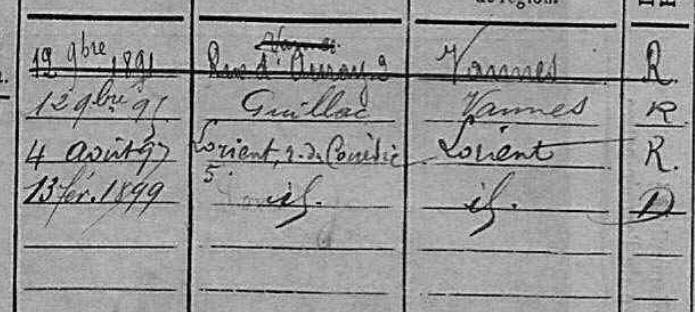
Emmanuel n'est pas pointé par l'officier du recensement, car il effectue son service militaire. Sa fiche de matricule nous indique qu'il est instituteur. Il aura un poste à Vannes, puis Guillas, Lorient..
En 1891, sur l'acte de mariage de sa fille Marie Rose on lit que la famille Mahé vit à Moustérian autour du retraité des douanes.
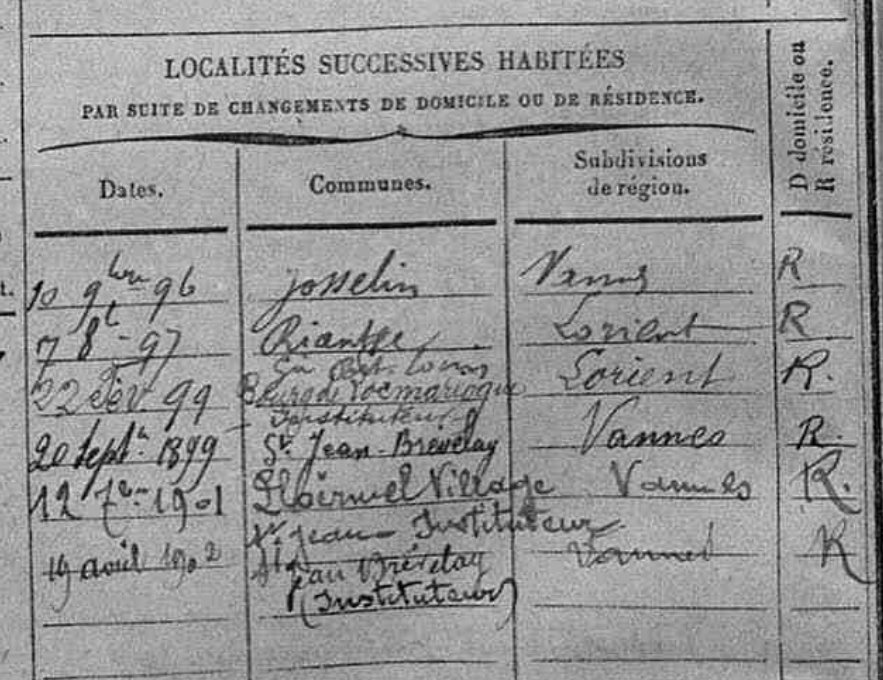
En 1894, Célestin fait son service militaire et déclare la profession d'instituteur. Il débute par un poste à Josselin, puis Riantec et Lorient. En 1899 il est en poste à Saint-Jean Brevelay où il se mariera et où, après un passage à Ploërmel il semble s'être établi avec son épouse.
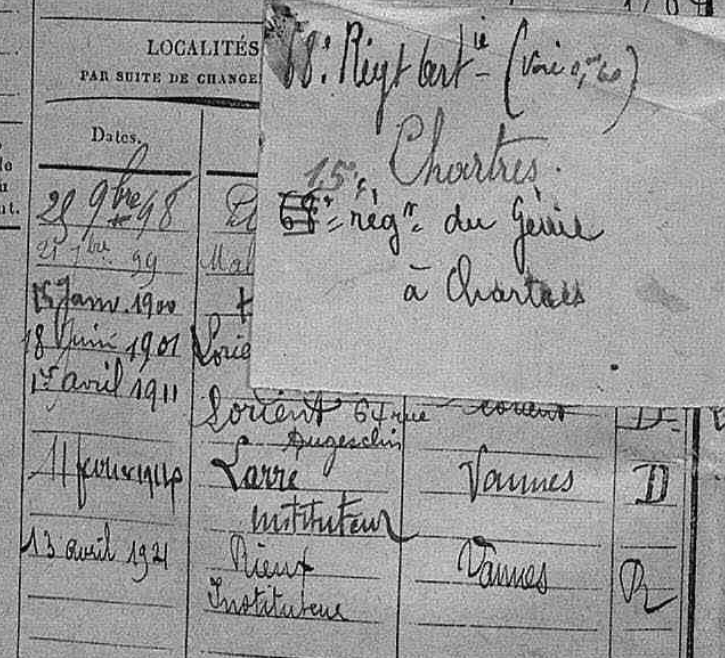
En 1896, son frère Vincent passe sous le drapeau et déclare également la profession d'instituteur. On ne lit pas bien sur sa fiche de matricule ses premières domiciliations. Après Lorient, il sera instituteur à Larré et Rieux.
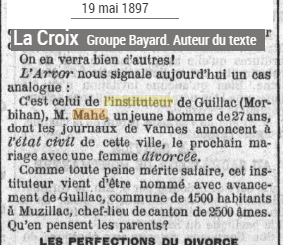
En 1897, la famille Mahé vit toujours à Moustérian quand il marit son fils Emmanuel avec une femme divorcée de 10 ans son aînée ! Et en 1899 quand il marit à son tour sa fille Marie Vincente.
En 1900, il perd sa fille Marie Rose, âgée de 39 ans et en 1905, Louis MAHE devient veuf.
Louis MAHE, l'enfant sans père, aura donné à la III° République trois garçons instituteurs qui officieront dans les écoles du Morbihan. Le douanier en retraite décède à Séné le 2/10/1909 à l'âge de 80 ans.
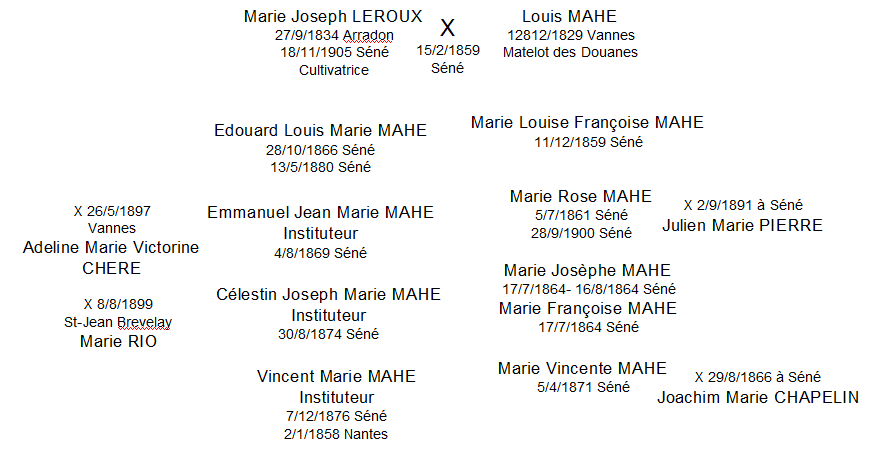
Auguste JANVIER, soldat de 14-18, Légion d'Honneur
Texte de Yannick ROME, complété et illustré.
Auguste JANVIER est né le 4 octobre 1892, à huit heures du matin, au bourg de Séné. Son père, Guillaume est quartier-maître de manœuvre dans la marine nationale [1/2/1860 Kerbors 22-17/7/1906 Vannes]. Sa mère, Anne-Marie ROBINO s’occupe des tâches ménagères durant les longues absences de son mari.
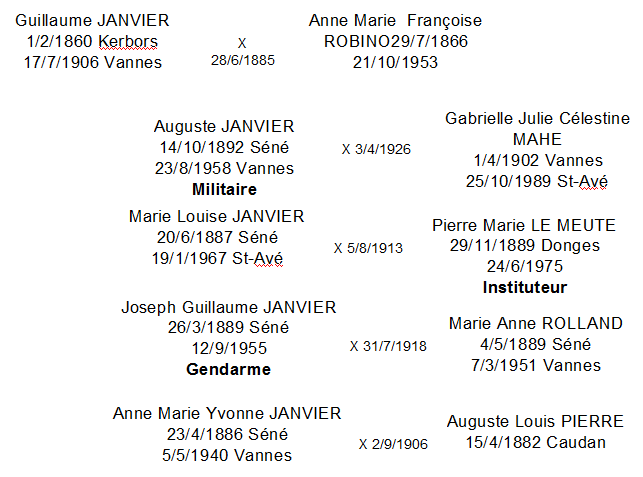
Le 4 octobre 1910, alors qu’il est étudiant, Auguste s’engage pour 4 ans dans l’armée. Il est affecté au 28e Régiment d’Artillerie basé à Vannes. Il mesure alors 1,66 m, a les cheveux châtain, le menton fuyant, les lèvres épaisses et les oreilles décollées.
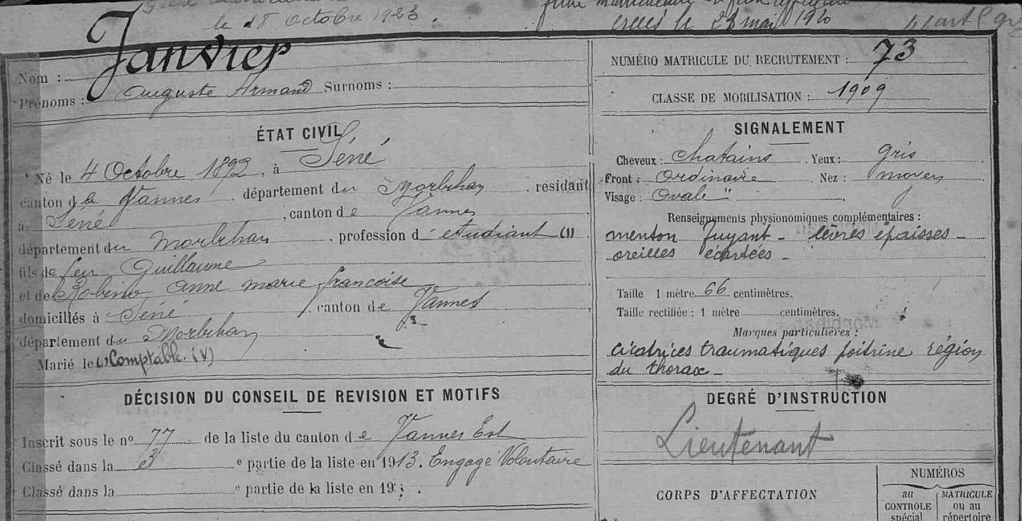
Il participe, dans l’artillerie, à toute la première Guerre mondiale. Le 11 octobre 1916, il est nommé sous-lieutenant. Il récolte 3 citations attestant de son activité :
Citation à l’ordre du régiment : « A rendu de nombreux et de très importants services comme éclaireur et comme agent de liaison avec l’infanterie. A toujours gardé le plus grand sang-froid dans les circonstances difficiles. »
Citation à l’ordre du corps d’armée, le 26 mai 1917 : « Le 11 avril 1917, par son sang-froid et son entrain au-dessus de tout éloge, a dirigé l’évacuation immédiate de tous les blessés et a commandé le tir de sa batterie un instant hésitante sous la violence du bombardement ennemi. »
Citation à l’ordre du corps d’armée le 22 août 1917 : « Brillant officier ayant le plus grand mépris du danger, a développé les plus belles qualités de courage et d’initiative. Le 19 août 1917, volontaire pour une reconnaissance dans les lignes ennemies, a rapporté des renseignements précieux sur l’état de destruction des organisations ennemies ».
Il sera blessé le 8 septembre 1917, à Verdun : « éclat d’obus à la tête ».
Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire. On le retrouve en Haute Silésie (actuellement en Pologne) du 1er février 1920 au 2 juillet 1922.
Il y reçoit une nouvelle citation : « Chargé depuis le 3 mai 1921 de diriger les convois transportant les troupes interalliées dans un pays occupé par de nombreuses bandes armées, a montré un zèle et un dévouement inlassables, a su, par sa présence, en imposer aux insurgés et a permis ainsi, sans faire usage de la force, la libre circulation de ces convois. »
Le 3 avril 1926, il se mariera, à Vannes, avec Gabrielle Mahé [1/4/1902 Vannes-25/10/1989 Grand-Champs]
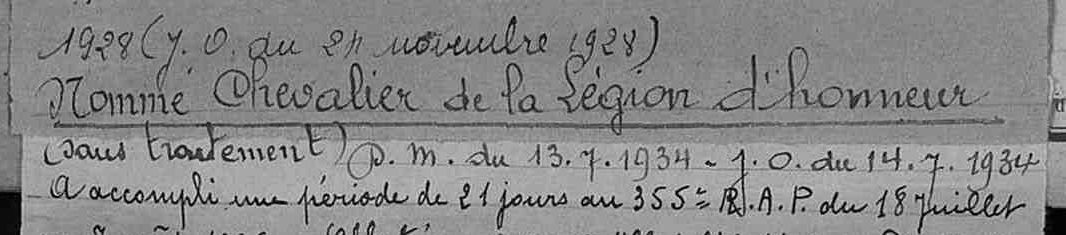
Le 13 juillet 1934, il est nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.
Il décède à Vannes le 23 août 1958.
LE MOUSSU, Communard natif de Séné
Cet article reprend celui publié sur le site maitron. Il est complété par d'autres sources
https://maitron.fr/spip.php?article64202
LE MOUSSU Benjamin, Constant
Né à Séné (Morbihan) le 14 juin 1846 ; mort le 25 mai 1907 à Paris (XIVe) ; dessinateur ; membre de l’Internationale ; communard.
Benjamin Constant LE MOUSSU (parfois orthographié par erreur Lemoussu) était petit-fils d’un retraité des douanes qui aurait été soldat volontaire de la Première République, et fils d’un capitaine des douanes. Il vint travailler à Paris et habita, 80, rue de Clignancourt, XVIIIe arr. Pendant la Commune de Paris il est "Commissaire aux Délégations Judiciaires de la Commune". Réfugié en Angleterre àprès la Commune de Paris, il s'y maria avant de revenir en France. Ingénieur, il décède en 1907 à Paris.
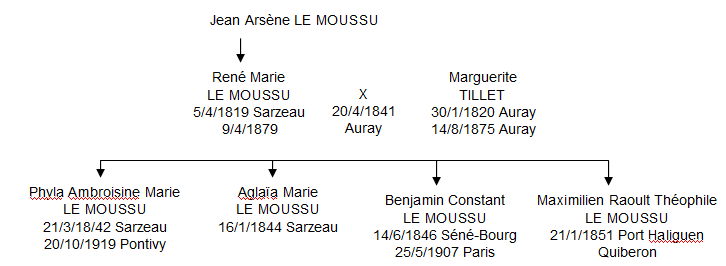
Avant le 18 mars 1871, il appartenait, avec Théodore FERRE [1846-1871], Louise MICHEL [1830-1905] et autres, au Comité de vigilance du XVIIIe arrondissement. Il servit la Commune de Paris en qualité de commissaire de police du quartier des Grandes-Carrières (XVIIIe arr.), puis, avec des pouvoirs élargis, de Commissaire aux Délégations Judiciaires.
Louise MICHEL, le mentionne dans ses souvenirs, La Commune, histoire et souvenirs, La Découverte/Poche, 1999 (1ère édition, 1898): La nuit du 17 au 18 mars 1871, Louise Michel (29 mai 1830-9 janvier 1905), membre des deux comités de vigilance, celui des femmes et celui des hommes, du XVIIIe arrondissement, où elle travaille comme institutrice, est sur la Butte au poste de la Garde nationale, au n°6 de la rue des Rosiers et voit tomber le factionnaire Turpin2.
« Je descends la butte, ma carabine sous mon manteau, en criant : Trahison ! Une colonne se formait, tout le comité de vigilance était là : Ferré, le vieux Moreau, Avronsart, Le Moussu, Burlot, Scheiner, Bourdeille. Montmartre s'éveillait, le rappel battait, je revenais en effet, mais avec les autres à l'assaut des buttes.
Investit en tant que Commissaire aux Délégations Judiciaires de la Commune, il participe à la fermeture d'églises dans la capitale.
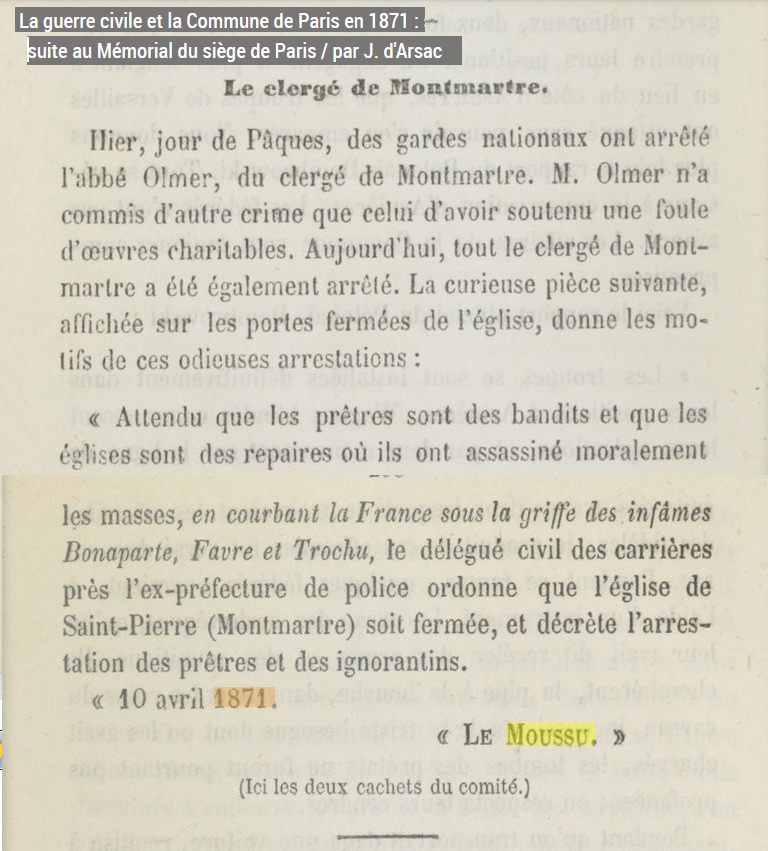
Lors de la journée di 12 mai 1871, il s'illustre dans le pillage de plusieurs églises à Paris. (Source Les Colvulsions de Paris
Maxime du Camp 1879.Tomme III) et censure la presse.
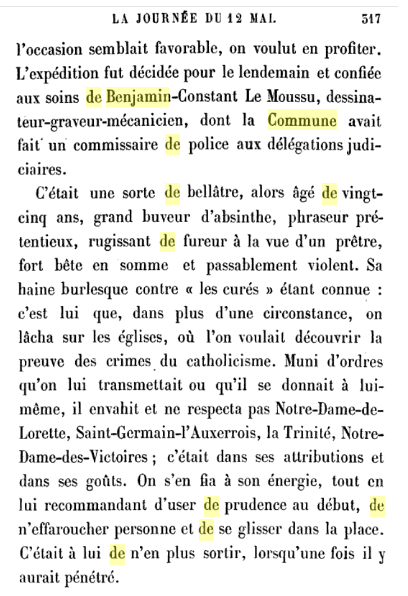
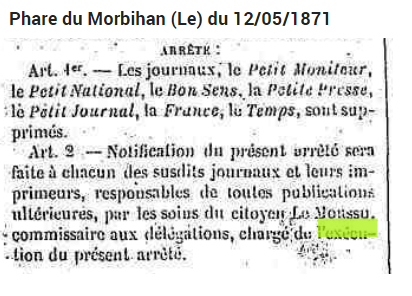
Après la défaite, on annonce sa mort comme celle de sa maitresse à Paris.
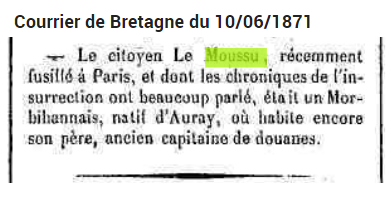
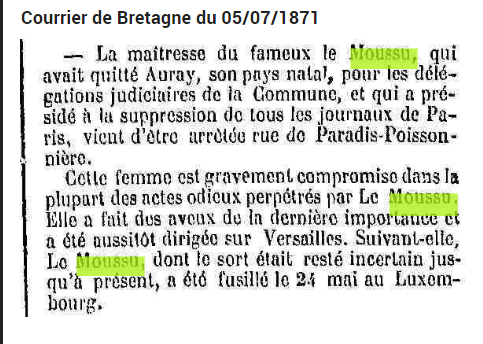
Cependant, LE MOUSSU réussit à fuir et gagna Londres. Par contumace, le 13° conseil de guerre le condamna à la peine de mort le 9 février 1872.
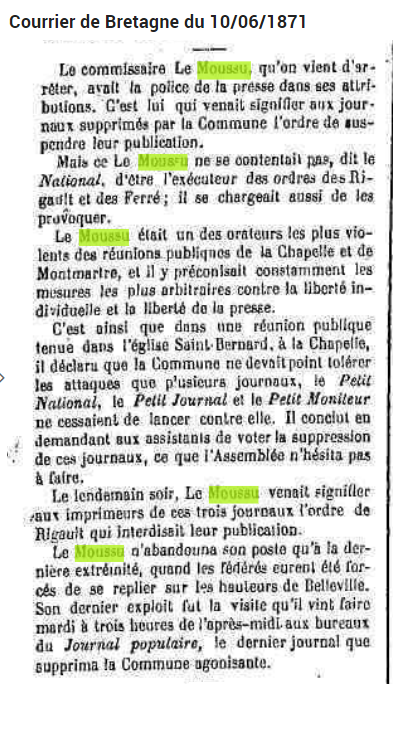 Dès son arrivée dans la capitale anglaise, LE MOUSSU entra au conseil général de l’Internationale et participa à la conférence de Londres, 17-23 septembre 1871, comme secrétaire-correspondant du Conseil pour les branches françaises des États-Unis. Marx a ainsi précisé ses fonctions dans une lettre à Bolte du 23 novembre 1871 :
Dès son arrivée dans la capitale anglaise, LE MOUSSU entra au conseil général de l’Internationale et participa à la conférence de Londres, 17-23 septembre 1871, comme secrétaire-correspondant du Conseil pour les branches françaises des États-Unis. Marx a ainsi précisé ses fonctions dans une lettre à Bolte du 23 novembre 1871 :
« Eccarius a été, sur ma demande, nommé secrétaire pour toutes les sections des États-Unis (excepté les sections françaises, pour lesquelles Le Moussu est secrétaire) ».
Un an plus tard — 27 mai 1872 — Marx, qui a rompu avec Eccarius, écrit à Sorge : « Provisoirement, Le Moussu [est secrétaire] pour toute l’Amérique. »

Benjamin LE MOUSSU fut membre de la section de langue française de l’AIT à Londres, Association Internationale des Travailleurs, la 1ère "Internationale", dont le secrétaire était Bourdeille.
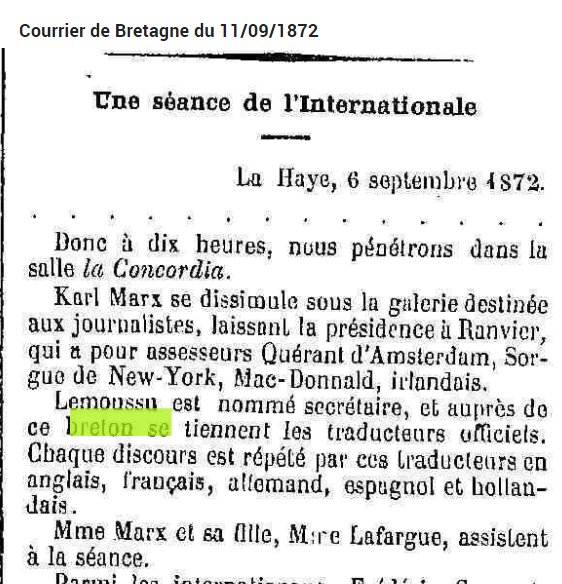
Au 5e congrès de l’Internationale tenu à la Haye en septembre 1872, LE MOUSSU représenta « une section française à Londres ». Il fut un des quatre secrétaires du congrès et, par la suite, un des membres de la commission chargée de la rédaction des procès-verbaux. Au titre de secrétaire-correspondant, il fut un des signataires des brochures Les Prétendues scissions de l’Internationale, Genève, 1872, et l’Alliance de la démocratie socialiste et l’AIT, rapports et documents publiés par ordre du congrès de La Haye, Londres, 1873. Au congrès, il vota pour l’expulsion de Bakounine, de James Guillaume et de Schwitzguébel, pour que les pleins pouvoirs soient accordés au conseil général et que celui-ci soit transféré à New-York.
Selon un rapport sans date et sans signature (Arch. PPo., B a/429), une section française d’une trentaine de membres se constitua à Londres après le congrès de La Haye, section qui comprenait entre autres les blanquistes Martin Constant et Vaillant. Étant donné ce que nous savons de l’histoire de l’Internationale et du conflit surgi entre les blanquistes et Marx vers la fin du congrès de La Haye à propos du transfert à New York du siège du Conseil général, il ne peut s’agir là que d’une section dissidente et qui ne dut pas avoir longue vie.
De toute façon, LE MOUSSU allait bientôt rompre avec Marx. Ce dernier écrivait en effet à Sorge le 4 avril 1874 :
« Les quelques Français (j’entends de ceux qui tenaient encore avec nous à La Haye) se sont pour la plupart révélés ensuite fripouilles, notamment M. LE MOUSSU, qui m’a filouté, ainsi que d’autres, pas mal d’argent et a ensuite cherché par d’infâmes calomnies à se blanchir en belle âme méconnue. »
Engels écrivait au même correspondant les 12 et 17 septembre 1874 :
« Celui qui s’est comporté le moins proprement est LE MOUSSU, qui s’est révélé escroc. »
Il convient, en cette circonstance, de faire la part des conflits habituels entre exilés, conflits avivés par les scissions et, sur le plan personnel, par la pauvreté, voire la misère. Engels nous apprend dans cette même lettre que de nombreux Français avaient fait — ou croyaient avoir fait — des inventions qu’ils cherchaient, pour vivre, à exploiter. D’où ces demandes d’argent... à fonds perdus. Ainsi s’expliquent, sans se justifier, les accusations d’escroquerie.
Deux années plus tard, Mme Marx, écrivant à Sorge, confirme (21 janvier 1877) :
« Des autres connaissances, je ne saurais vous dire que peu de chose, parce qu’il y en a quelques-uns que nous ne voyons plus, notamment plus de Français : pas de LE MOUSSU, pas de Serraillier, surtout pas de blanquistes. We had enough of them [Nous en avons eu assez d’eux]. »
D’après Paul Martinez, LE MOUSSU se maria en exil (Paris Communard refugees in Britain, 1871-1880, thèse, University of Sussex, 1981, p. 538).
Nous manquons d’informations sur la fin du séjour de LE MOUSSU en Angleterre, comme d’ailleurs sur la fin de sa vie. Aussi retiendrons-nous les quelques lignes d’un rapport de police sans date (Arch. PPo., B a/429) qui concerne le séjour en Angleterre :
« A travaillé dans des revues d’agriculture, etc., bon ouvrier demandant l’égalité des salaires, tant que la mesure n’est pas mise en pratique. Doctrines ultra-révolutionnaires ; dans l’intimité, très doux. »
Les parents de LE MOUSSU firent de nombreuses démarches pour le faire amnistier, mais comme pour les autres condamnés, surtout contumaces, ce fut en vain. Sa mère décèda en 1875 et son père mourut en 1879. Une de ses sœurs mourut aussi « qui avait puisé le germe de sa mort en allant le soigner dans une maladie grave sur la terre d’exil ». Deux sœurs demeuraient, l’une institutrice libre à Auray (Morbihan), l’autre, Ambroisine, épouse d’un professeur au lycée de Pontivy.
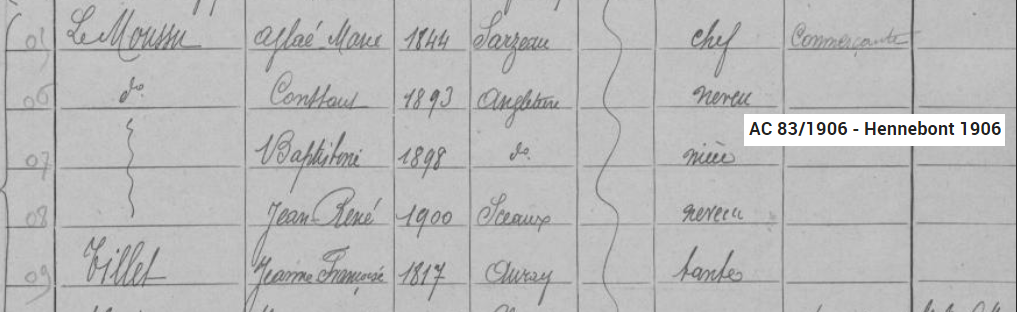
En 1906, la famille est établie à Hennebont. Les enfants de LE MOUSSU vivent chez leur tante, Aglaé Marie, commerçante célibataire qui loge également sa tante. LE MOUSSU n'est pas pointé par l'agent du recensement. On comprend que LE MOUSSU a eut 2 enfants en Angleterre avec son épouse Annie Jane ROCH et un garçon né à Sceaux.
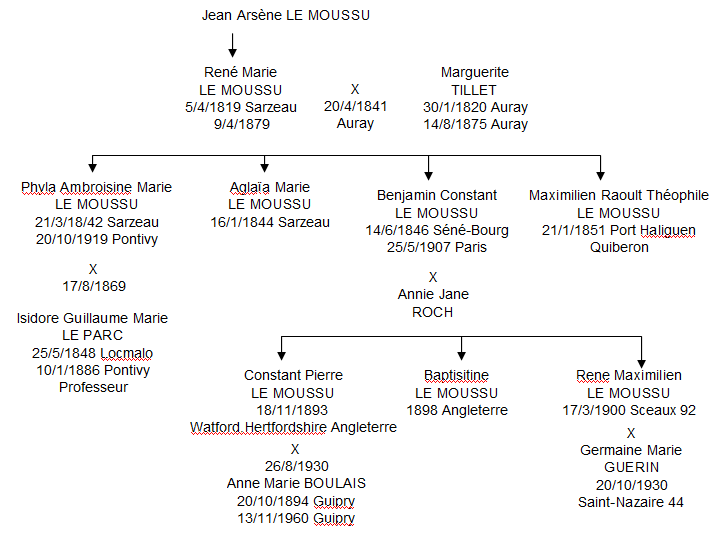
Elles poursuivirent les démarches et, le 14 février 1880, le docteur Louis Joachim Le Maguet, député du Morbihan [1879-1881] , plaidait à son tour pour LE MOUSSU. J’ai eu en main, écrivait-il, « une lettre intime du fils au père datée d’avril 1879 [le père mourut le 9 avril], admirable de patriotisme et de sentiment filial » et je considère qu’en 1871, LE MOUSSU fut « un républicain de 23 ans égaré par son patriotisme ». Témoignage intéressé certes, mais qu’il convenait néanmoins de relever, compte tenu de ce que l’on sait par ailleurs des sentiments qui animèrent souvent les Communards.
LE MOUSSU décède le 25 mai 1907 à Paris (XIVe).
La Place de l'Eglise
La Place de l'Eglise à Séné est le centre du bourg. En son sein se tient le marché BIO. A la sortie de la messe, les Sinagots peuvent aller chercher leur pain. C'est aussi un point de rencontre des patients qui vont chercher leur médicaments à la pharmacie. On y trouve le fleuriste du bourg et quelques restaurants.

La configuration de la place a bien évolué dans le temps. Le plan du cadastre de 1810 positionne la première église de Séné et autour des constructions, des habitations disposées sans réelle règle d'urbanisme.
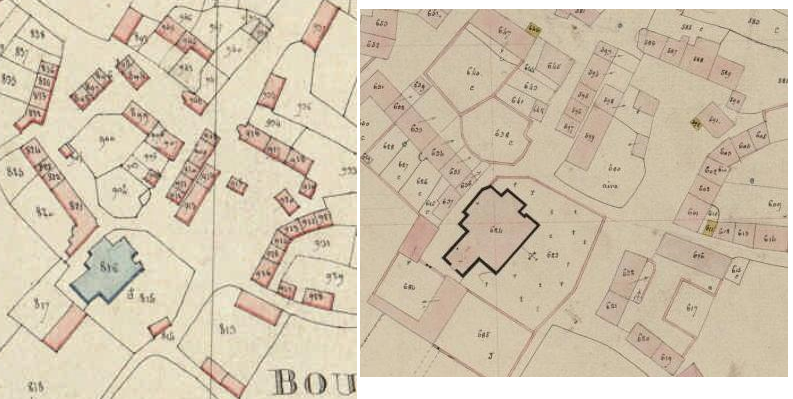
A gauche de l'église on distingue la future rue des Vierges. Au sud de l'église, le presbytère,d'abord sur un seul bâtiment, il sera agrandi d'une aile et d'un jardin clos, avant sa destrution vers 1985. Le premier cimetière a fini par ceinturer l'église paroissiale..A droite, un premier paté de maisons où l'on devine les futures rue des écoles et rue de Penhoët.
En 1810 la future place est "encombrée" par une construciton en son centre, puis deux en 1844 qui finalement seront démolies. Le transfert du cimetière rue de la Fontaine en 1887 en même temps que la construction d'une nouvelle église signent la naissance de la place de l'Eglise.
Le nord de la Place est encore emcombré en 1844 d'une maison qui bouche la sortie vers la rue de la Fontaine et la route vers Cantizac.Sa démolition permettra de créer une rue Principale qui deviendra ensuite Place de la Fraternité (Place de la Mairie).
Les derniers changements dans la configuration de la place verront la construction d'une belle demeure au sud (actuell n°1) et la percée de la place Floresti.
La configuration actuelle nous est bien illustrée par ce plan du site Geoportail qui positionne les parcelles cadastrales sur le pourtour de la place en indiquant leur numéro de boîte aux lettres.
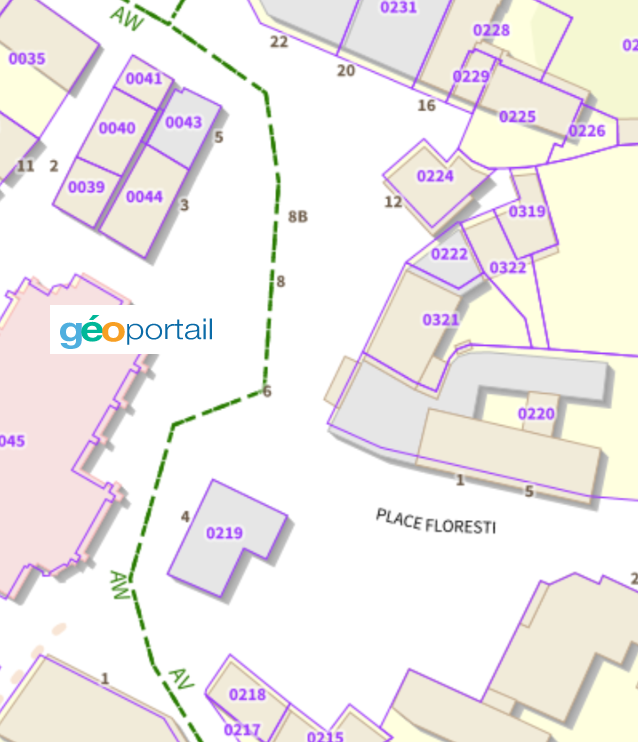
Quelques vues font le lien avec les pages Facebook de Séné d'Antan, qui oeuvre à la collecte du patrimoine photographique sinagot. https://www.facebook.com/senedantan/
Place de l'Eglise numéro IMPAIR:
1-La belle demeure derrière l'église:
Sans doute une des plus belles demeures de Séné. Avant le percement de la place de Floresti, la route principale passait au ras des habitations. Sous l'Occupation, cette maison fut réquisitionnée pour abriter la Kommandatur.
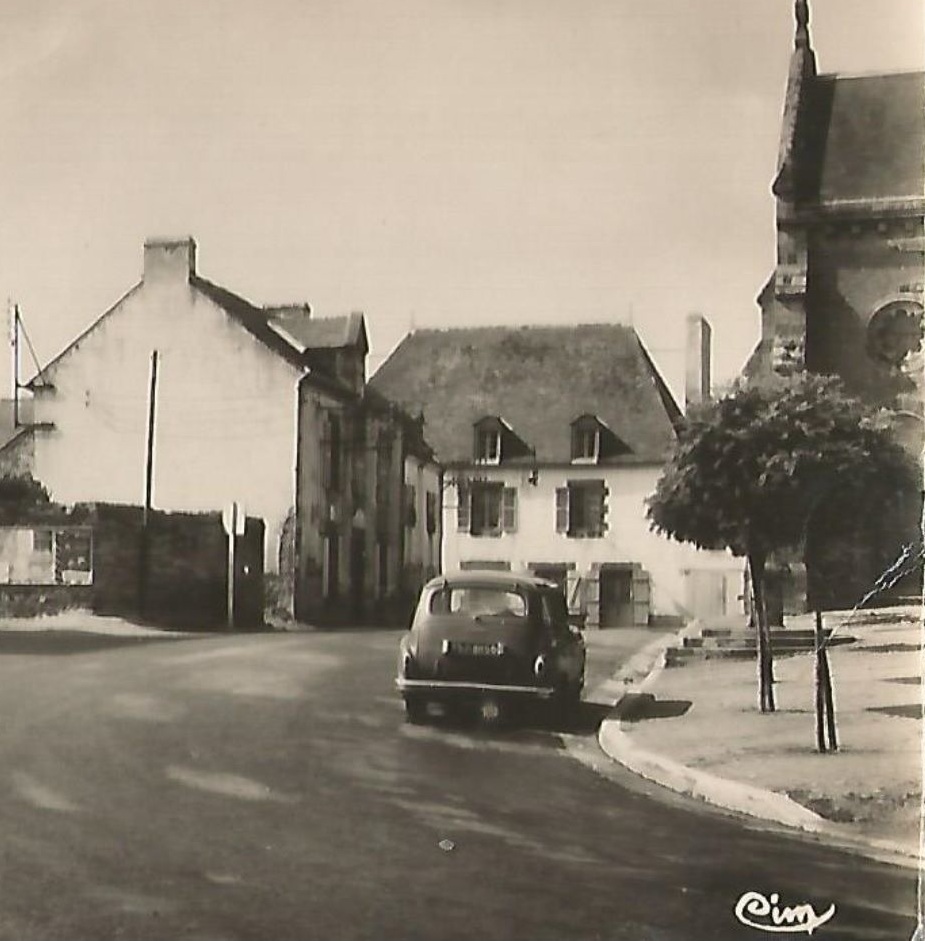
3 La maison basse devant l'église
Il y avait devant cette maison un puits qui sera bouché .



5 Boucherie-café-traiteur et crêperie:
Avant d'être acquise par la municipalité pour y installer une crêperie, cette batisse a été occupée par une boucherie, puis un traiteur. On regrettera que la crêperie n'est pas repris l'écusson disposé sur la façade entre les deux fenêtres.



Place de l'Eglise côté PAIR:
2-Ne chercher pas le numéro 2
L'ancienne maison de la famille Dauber, forgeron et conseiller rmunicipal, fut détruite pour élargir la route principale. Après la création de la place de Floresti et de l'avenue de Penhouët, on décida de soustraire à la circulation cette portion de la route qui descendait vers la rue des Ecoles.

4-Masion des soeurs - Poste - Restaurant:
L'actuel restaurant Ar Gouelen, succède à une série de restaurants. Avant de servir des plats, cette bâtisse fut le siège des PTT et de son receveur. Ce fut ensuite une maison de vacances avant de servir de logement aux Soeurs du Saint-Esprit qui s'occupaient de l'école libre et de soins infirmiers dans la commune.


6-Boucherie - Hotel restaurant - Fleuriste:
La construction actuelle date de la fin des années 1960, quand le boucher de l'époque, M. Guillonnet, rasa l'ancienne boucherie pour construire un hotel-restaurant flambant neuf. Vint ensuite le temps des fleuristes.


8-Café - café - café -Infirmière et confiserie
Cette maison typique du bourg semble avoir longtemps été le siège d'un commerce, comme l'enseigne sur sa façade, visible sur cette vieille photo du début siècle semble l'attester.
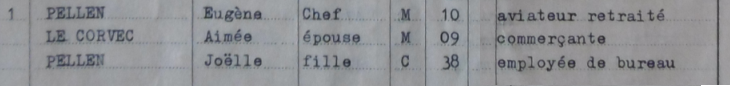
Ensuite, vint le temps du Café Le Corvec, tenu par Aimée PELLEN qui devait le tenir se son père. En ce lieu se succédèrent les cafés "Chez Jacqueline" et "Le Derby" de Bruno CORFMAT. Il est aujourdh'ui le siège de cabinet d'infirmiers, d'une confiserie-crêperie et d'appartements.

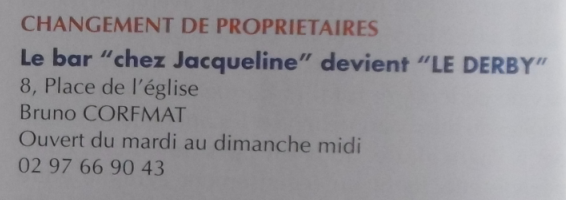

10-Annexe café - Médecin :
Actuellement occupé par le cabinet d'un médecin, cette petite habitation a été l'annexe du café situé au n°8. Au fond de la petite cours, figure le n°8bis ainsi qu'une autre petite remise inhabitée.. Dans les années 1975-78 elle a été occupée par une agence du Crdit Mutuel de Bretagne.

Source:bulletin paroissial archives Morbihan
12-Demeure d'habitation:
Cette belle maison qui a pignon sur la place a été restaurée et divisée en appartements. Elle est typique de ce qu'on purrati appeller le style sinagot. Maison avec porte principale au centre du rez de chaussée, flanque d'un chien assis sur à mi-hauteur du toit.

14-16- Maisons Layec
Lors de la rénovation de cette maison en 1947, M. Lelayec prit le soin d'orner son toit d'une pointe pour appeller celle du clocher de l'église. En 1966, il racheta le garage de Mme Eveno attenant (parcelles 0228 et 0229) qui fut intégré à la maison.
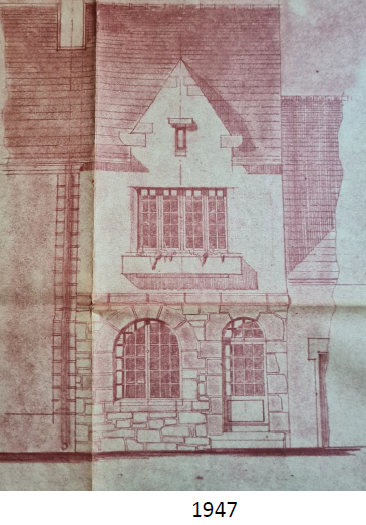
Source : document famille Le Layec

18-Où est donc passé le n°18?
L'ancienne maison Noblan, visible dans les vieilles cartes postales et photographie aérienne accuillit dans les années 1960 la toute première pharmacie à Séné, tenue par Mme GILLOT qui occupait la partie gauche de la maison, le n°20, M. Noblan gardant le n°18. La pharmacie fut agrandie en récupérant toute l'habitation. Le n°18 disparu des boites à lettres.

20- Habitation - Pharmacie
Avant d'accueillir la pharmacie du bourg, cette maison était une habitation, comme le montre cette vieille vue aérienne.


Après Mme GILOT, installée vers 1960, la pharmacie fut reprise par Mme AUFFRAY [vérfier si il y eu un autre pharmacien entre temps] qui la transmit au pharmacien Claude BRETT vers janvier 1989. En janvier 1991 elle est reprise par M. FRICQ et M. CARON et prend le nom de pharmacie "Les Sinagots". En février 2004, son nouveau gérant, Armelle CARRET adopte le nom de pharmacie "Les Voiles Rouges". A noter que le numéro de téléphone n' pas changé depuis, le 66-90-27 est devenu le 02 97 66 90 27.
Depuis mai 2021, la pharmacie a été reprise par Hélène ORAIN et Sachat BEDROSSIAN. Elel a fait peau neuve à l'automen 2024.


La deuxième pharmacie à Séné s'est installée en janvier 1989 au 8 rue du Verger. Le pharmacien était Mme. LE DEAN toujours présent en juin 1992. En décembre 2009, Pascale BOUHIER LATOUCHE reprit la pharmacie.

Une troisième pharmacie vit le jour au centre commercial du Poulfanc vers mars 1996. La publicité de l'époque évoque un certain Av. Deguilene.. Elle change de gérant en novembre 2003, reprise par Jean Marc GOBAILLE qui pris avec lui deux associés en mai 2013, Florent HAOUISE et Laurence LE BERRE.
22-Boulangerie et encore boulangerie
Depuis la révolutin et sans doute avant, en cette parcelle se tenait une boulangerie. Lire l'histoire des boulangers du bourg.

Source ci-dessus : google-street-view, ci-dessous : Collection prive Robino


Le Versa, évolution d'un quartier de Séné
Le quartier du Versa est le plus au nord de la commune de Séné, coincé entre la Route de Nantes et le Liziec, rivière qui délimite Vannes et Séné. Il est assez méconnu des habitants du bourg de Séné et de la presqu'île de Langle.

On ne s'est donner l"étymologie du mot Versa. Le lieu est déjà mentionné au temps de la carte de Cassini. Camille Rollando dans son ouvrage "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui" nous dit que le Versa ou Versach appartenait tout d'abrod à N. Rousseau et Marguerite Delahaye. En 1680, à Jean de la Landelle et en 1745, à François Louis Le Métayer. Le Versa n'était qu'une simple maison. Seul son toit d'ardoises la distinguait des autres. Mais c'était un démenbrement d'une ancienne terre noble et son propriétaire s'intitulait seigneur de Varsa.
Le plan du cadastre de Napoléon en 1810, mentionne le hameau et postionne les maisons qui nous sont presque toutes parvenues.
On reconnait sur la route d'Audierne à Nantes, le relais de poste de la Ville en Bois [actuel bar le Suroît].
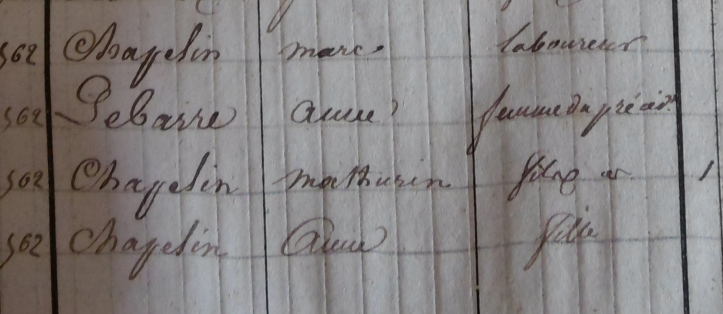
Le dénombrement de 1841 nous indique la présence de plusieurs familles de laboureurs et de cultivateurs: Langlo, Guillemot, Plunian, Adeline et Chapelain cultivent les terres et prairies sur la rive droite du Liziec. Un des petits-enfants de la famille Chapelain, délinquant multirécidiviste, sera condamné à la relégation. Il finira ses jours, à Saint-Jean de Maroni en Guyane. Le village du Grand Versa et du Petit Versa comptent aussi avec le tisserand Le Brec, la maçon Olichon et les charretiers Le Pen et Le Guen et la famille de journalier Conan. Les enfants Conan se distingueront de manière bien différente. Marc participera à la Campagne d'Italie en 1859. Son frère Vincent, sera condamné au bagne.
Sur cet extrait du cadastre de 1844, on peut positionner les batisses qui sont presque toutes parvenues jusqu'à nous. Au bout du chemin du Petit Versa, on situe la vieille ferme [au n°24 derrière le garagiste Roady]; ; on positionne aussi facilement la belle batisse restaurée au n°7 et ses dépendances en face au n°6; les anciens logements des cultivateurs s'alignent au débouché du chemin du Petit Versa. Au carrefour, on reconnait le petit hameau, avec l'ancienne maison LE RAY qui fait l'angle, la longère derrière et l'alignement de petites maisons rue Lotti. Et la dernière maison sur la parcelle opposée.
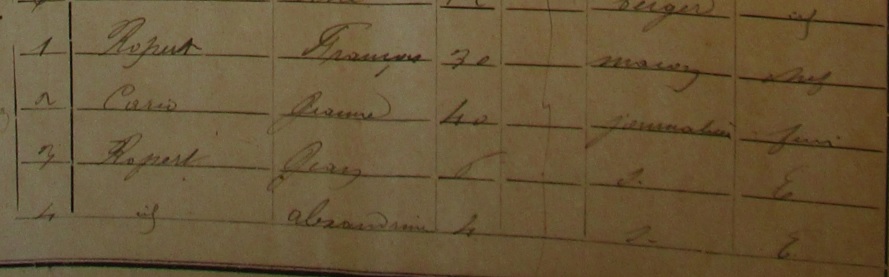
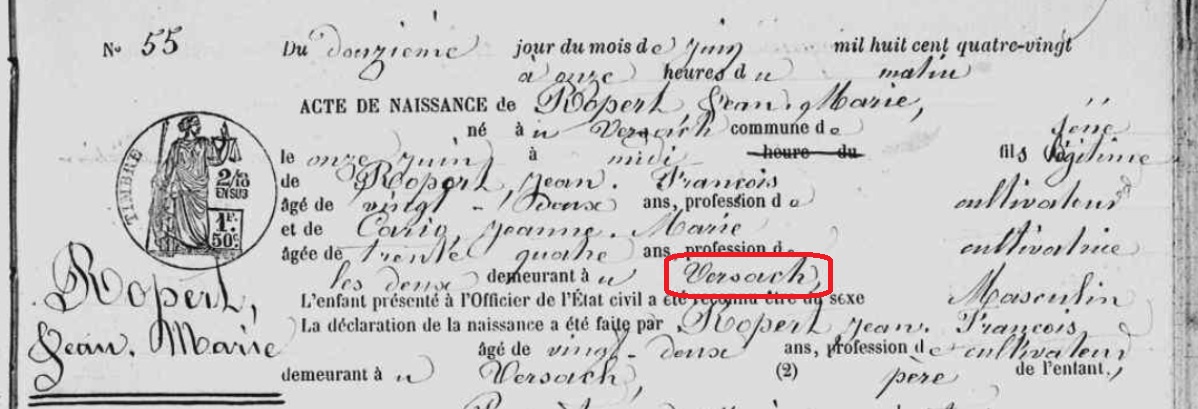
Le 11 juin 1880, Jeanne Marie CARIO, cultivatrice au Versa avec son mari Jean François ROPERT, accouche d'un garçon, Jean Marie ROPERT [11/6/1880-7/12/1914]. Ce Sinagot déclare l'activité de forgeron lors de son service militaire en 1900. Il travaille à la forge Tréhondart du Poulfanc. Mobilisé en 1914, il fait partie des premiers enfants de Séné à mourrir au début de la guerre 14-18. Il est tué à l'ennemi à Louvremont dans la Somme.
Le dénombrement de 1886 laisse apparaître l'arrivée d'une nouvelle famille au Versa, les Le Masson qui demeureront près d'un siècle sur ces terres.
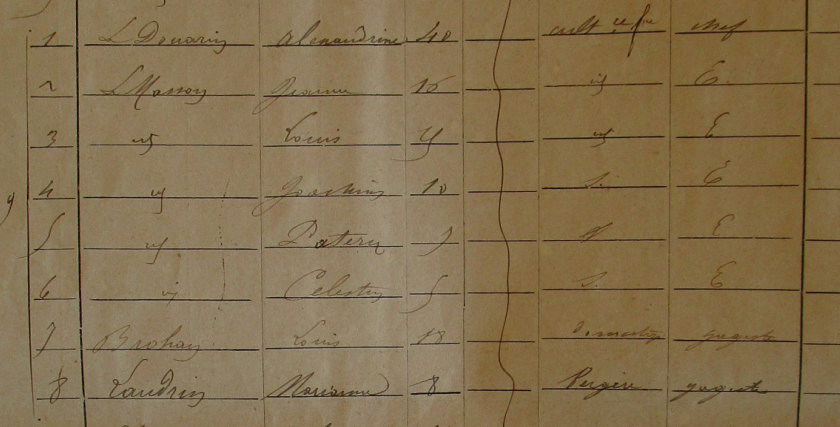
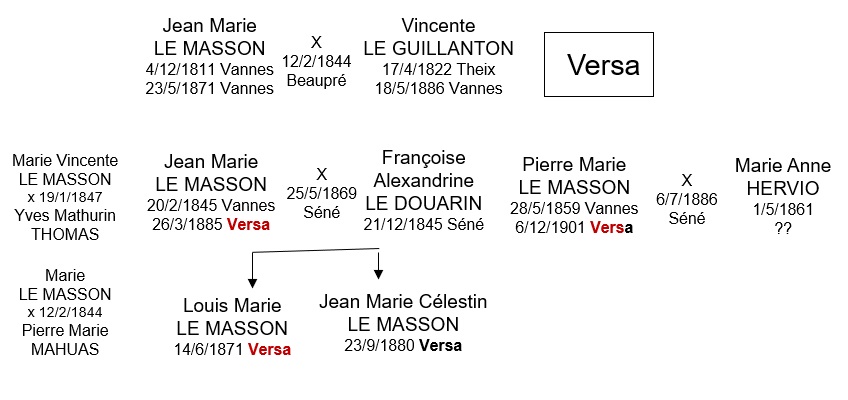
La généalogie des Le Masson permet de dater leur établissement au Versa vers 1869, année du mariage de Jean Marie LE MASSON avec Françoise LE DOUARIN, fille d'un laboureur d'Auzon, ou vers 1870, année de naissance au Versa de Jeanne, leur 1er enfant. Le ferme est grande avec plus de 14 ha de terres.
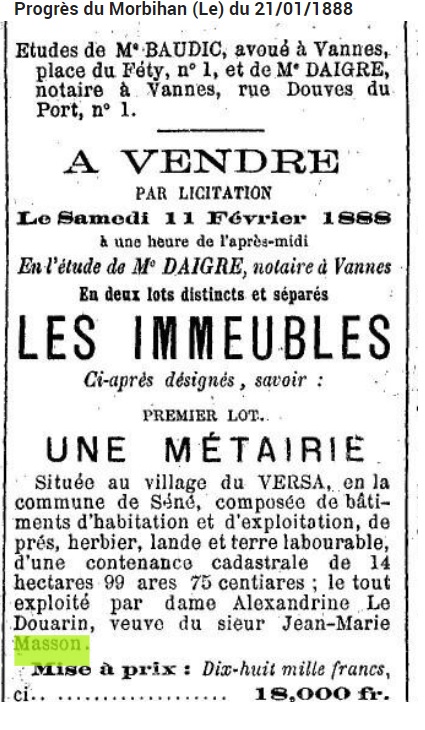
En mars 1885, Jean Marie LE MASSON décède. Son épouse, qui a perdu au moins 4 enfants en bas âge, sur les 9 qu'elle a mis au monde, est contrainte de vendre à son beau-frère. Sa fille aînée Jeanne décède au Versa en 1891. Après cette date, elle a dû suivre ses enfants établis sur Brech où Joachim puis Vincent ses garçons décèdent respectivement en 1901 et en 1903. Elle finira ses jours sur Landaul.
Pierre Marie LE MASSON a épousé également une sinagote, cultivatrice à Kernipitur, Marie Anne HERVIO. Ils sont recensées au dénombrement de 1901, traduisant une arrivée plus tardive au Versa après la vente des terres.
Cette photo aérienne datée de 1943 montre que le nombre de maisons n'a guère évolué et reflète sans doute l'état du Versa vers 1890. On note la présence de vergers de pommiers. Les Le Masson produsaient bien du cidre selon les souvenirs de leur descendante, Carole et de Louis Le Boulicaut, habitant du Versa, qui venait dès les années 1943-45 voir sa grand-mère au Versa.
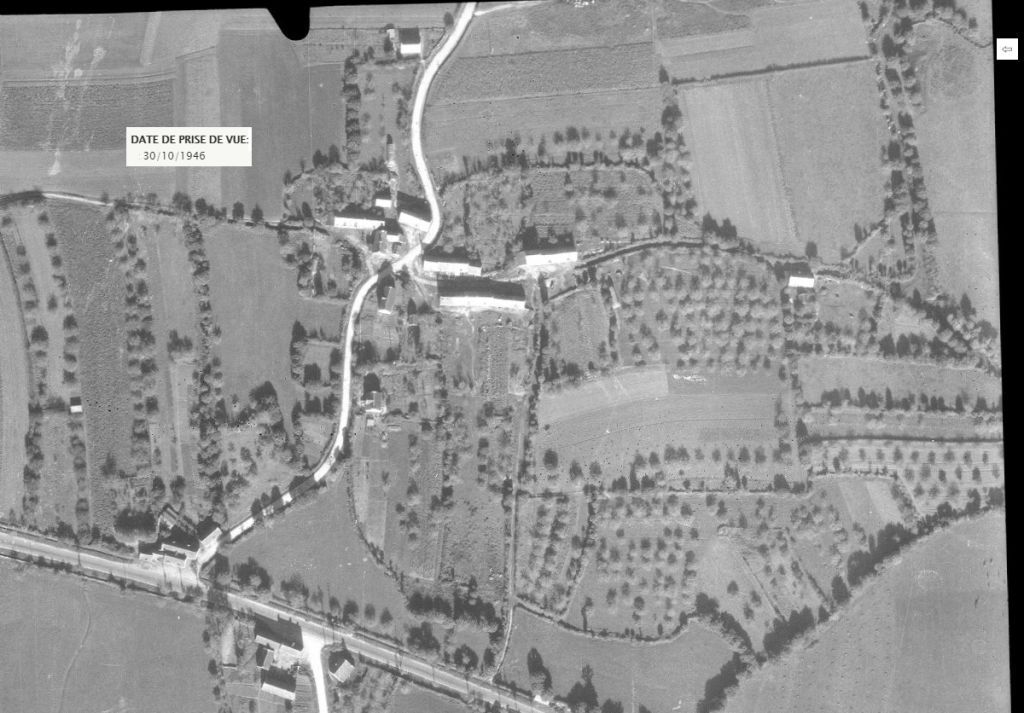
Aux côté des frères Le Masson, plusieurs familles de cultivateurs: Plunian, Olichon, Riguidel, Le Derf, Guillemot et Guillo. Le hameau du Versa abrite également une famille de journaliers et de manoeuvres et 3 familles de maçons, Chapelain, Raud, Ropert et Gachet.

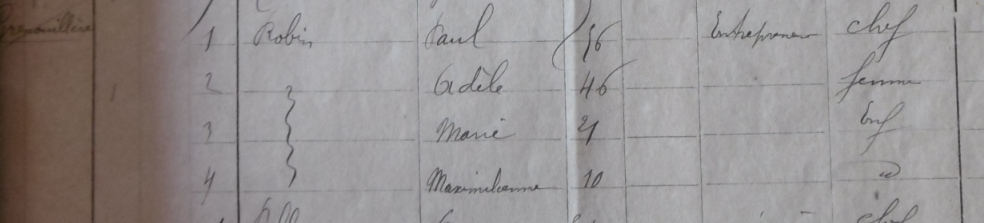
Le document ci-dessous, date peut-être la première activité artisanale qui s'est implantée dans ce qui deviendra plus tard la ZAC du Poulfanc. M. Paul ROBIN, établit un dépôt d'engrais aux portes de Vannes; non loin de la grande route de Nantes à Audierne. La famille Robin est recensée lors du dénombremetn de 1891. A ses côtés, des laboureurs et cultivateurs, un charron qui travaille sans doute à la forge Tréhondart du Poulfanc et des journaliers.
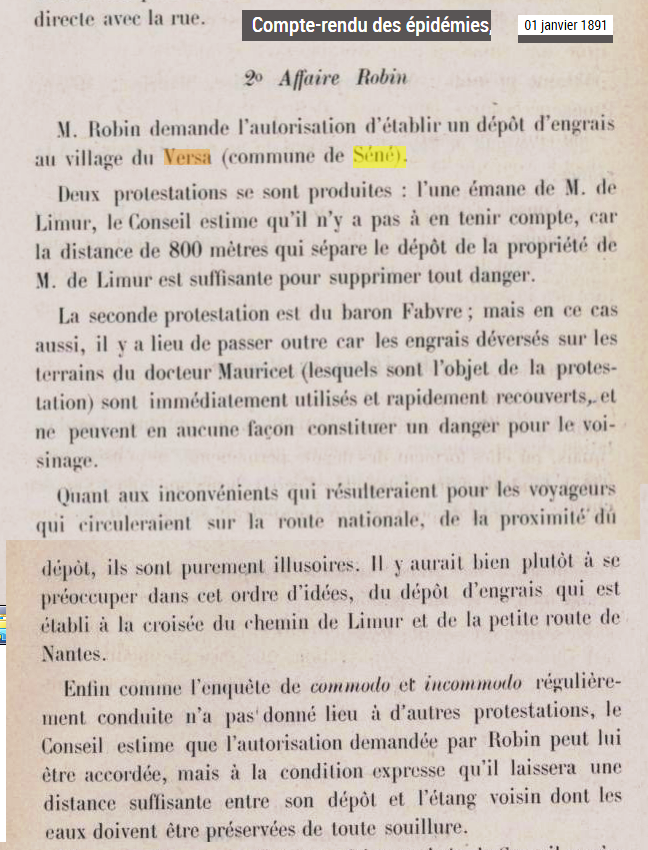
Les dénombrements de 1901 et de1906 montrent des activités identiques essentiellement agricoles complétées par des familles de journaliers. Le dénombrement de 1911 mentionne un patron chiffonnier, des ouvriers travaillant à la Fonderie de Kérino à Vannes, un botteleur employé à la fourragerie des armées, un marchand ambulant. Ces familles habitent au Versa et cotoient des familles de cultivateurs et laboureurs.
La guerre de 14-18 éclate. Les 3 garçons Le Masson seront mobilisés. Joseph Marie LE MASSON [21/1/1889 -* 8/9/1914] est tué à l'ennemi à Commantray dans la Marne pendant les premières semaines de combats. Son nom figure au Monument aux Morts de Séné.
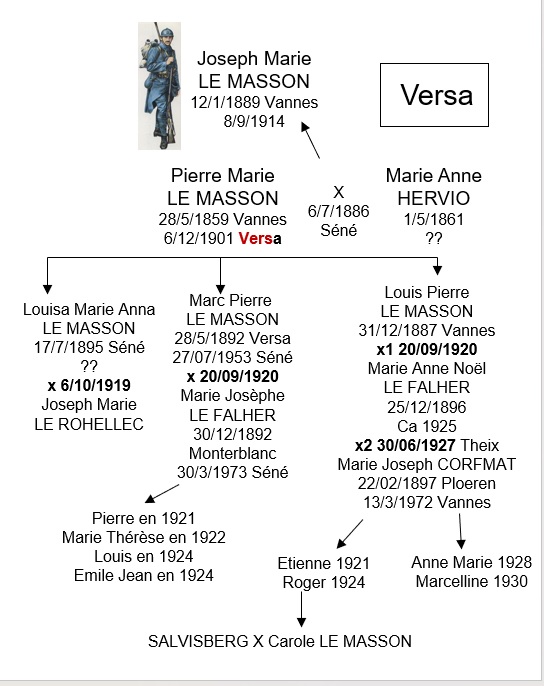

Au sortir de la Première Guerre Mondiale, si les activités au Versa demeurent toujours agricoles, les familles ont changé. Les enfants de Pierre LE MASSON ont repris la succession de la ferme qui est alors divisée. A Marc échoit la batisse principale et à Louis l'ancienne étable qui est réamnéagée en logis..

Le 29/9/1920, les deux frères Le Masson épousent à Monterblanc les deux soeurs Le Falher. Malheureusement, l'épouse de Louis décède prématurémment. Ce dernier se remarie en 1927.
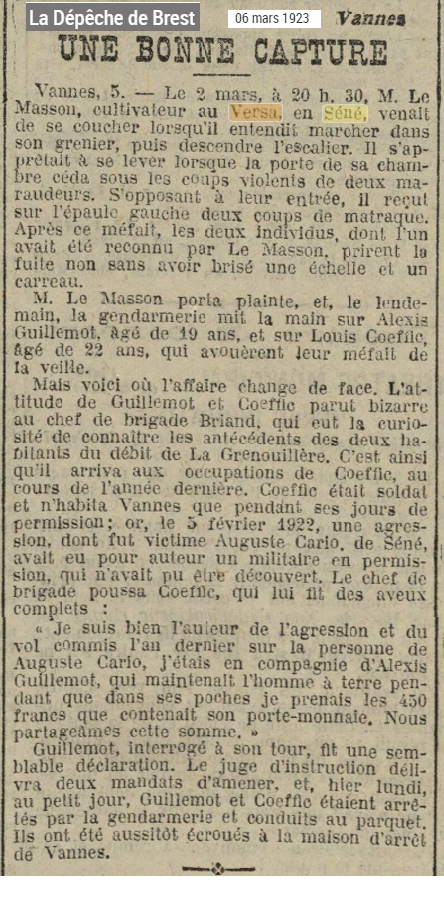 Au dénombrement de 1921, a famille LERAY s'est établi au Versa comme cultivateur. Elle loge à la maison qui fait aujourd'hui l'angle entre l'impase Pierre LOTI et la rue du Pouflanc. .
Au dénombrement de 1921, a famille LERAY s'est établi au Versa comme cultivateur. Elle loge à la maison qui fait aujourd'hui l'angle entre l'impase Pierre LOTI et la rue du Pouflanc. .
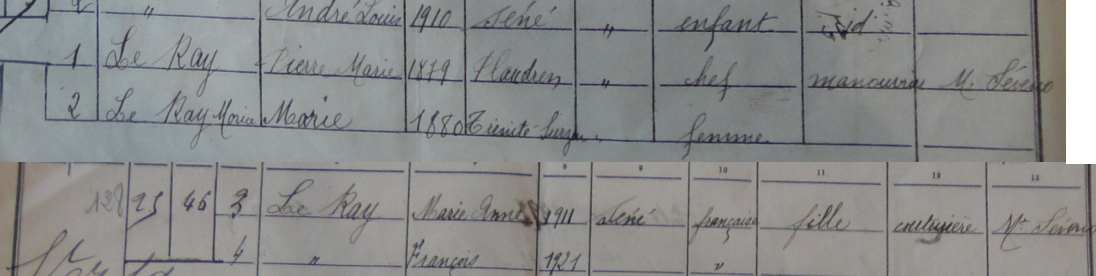

Louis Le Boulicaut, neveu de François LE RAY, connu son oncle à son retour de déportation. De ses souvenirs on a pu écrire un article qui rend hommage à François LE RAY.
Le dénombrement de 1926 indique la présence des mêmes familles de cultivateurs, les Le Masson, Guillerme. Le quartier a accueilli une plus large diversité de famille avec des activité plus vairées: manoeuvrier, journaliuer, taupier, maçon, armurier.
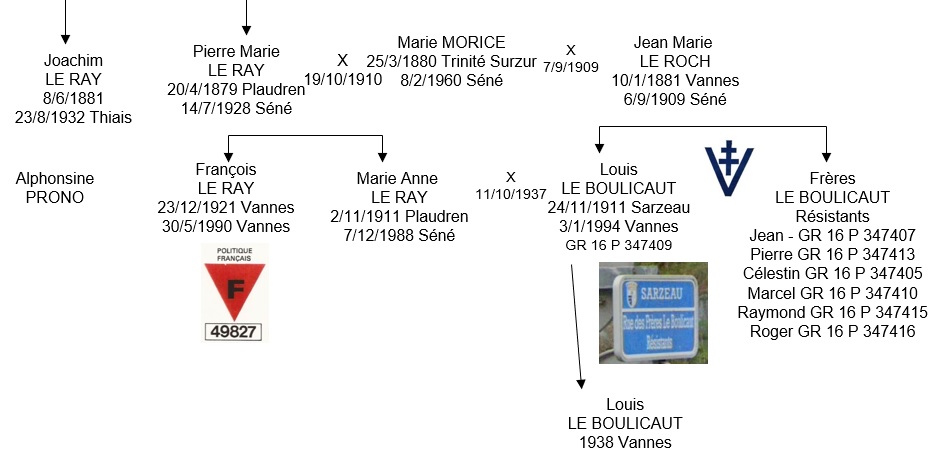
Petit garçon, Louis Le Boulicaut qui vivait dans un logis étroit rue Briand à Vannes, avait l'habitude de venir les jeudis et les dimanches voir sa grand mère (Marie MORICE) au Versa. Il se souvient qu'après guerre, il allait jouer dans le ruisseau du Liziec avec ses camarades. Les enfants en pataugeant dans l'eau soulevaient de la vase qui troublait l'eau des lavandières installées plus en aval. Ces lavandières allaient laver le linge dans un lavoir improvisé au lieu-dit Poul Mor, sur la rive du Liziec. Il y avait des moules d'eau dans le Liziec.
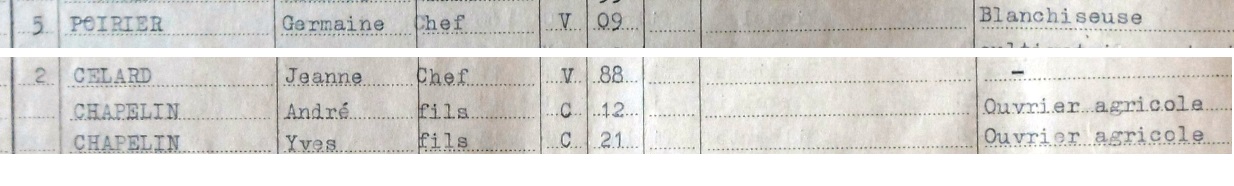
Au dénombrement de 1962, Germaine POIRIER, veuve de Alexis GUILLEMOT déclaraient la profession de blanchisseuse. Jeanne CELARD, veuve de Marc CHAPELAIN, dite Janon, était la patronne des blanchisseuses. Ces blanchisseuses, se souvient Louis Le Boulicaut avaient des lissiveuses chauffées par du bois.
Au début des années 1950, la menuiserie LEGAL s'installe au Poulfanc mais le Versa reste agricole. Pendant les années 1960-70, le Versa accueille quelques maisons de plus. Les premières activités non agricole sont le fait de Jacques DUPRE qui monte un batiment au Versa, près du Liziec en limite de Vannes pour y développer une activité de charcuterie artisanale. Le bâtiment existe toujours dans l'attente du réglement de la succession.


Cette vue aérienne de 1970 montre également un autre hangar à gauche construit par M. Houdet se souvient Louis Le Boulicaut: "C'était un négociant en produits pour l'agriculture; il vendait des semences, des engrais. Il avait auparavant un autre plus petit près de la maison de M. Caro."
Joins au télphone, le fils de Goerges HOUDET se souvient:"mon père avait repris vers 1950 l'entreprise de mon grand-père qui était porte Poterne à Vannes près des maggasin La Folly et Lmarzelle. Vers 1966-67, il s'installe au Versa d'abord dans un petit hangar sur un terrain familial. Il cultivait des semences potagères. Vers 1967-68, il construit un autre hangar bien plus grand pour le stockage de graines agricoles, de gazon pour les agriculteurs et le toutes premières jardineries. Il développe son affaire en devenant aussi grossite en produits phytosanitaires pour l'agriculture. Au cours des années 1980, il double la surface de ce hangar et travaille avec la GMS". A son départ en retaite, son fils reprendra le fond de commerce de 1993 à 2010. Les hangars seront ensuite loués à des trnasporteurs avant que ces terrains n'accueillent des logements."
La rue du Versa n'est pas encore reliée à la zone du Prat. Sur l'autre rive à Vannes, la zone du Prat est déjà bien développée. A la place de l'actuel boulanger-pâtissier Cartron, une blanchisserie existait. Louis Le Boulicaut se souvient qu'elle rejetait dans le Liziec ses eaux usées.
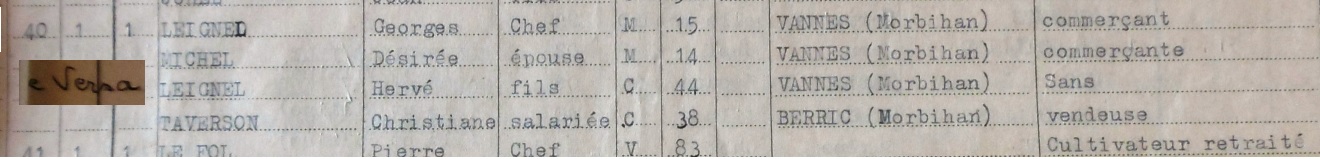
Vers 1975-77, rue du Versa, Georges et Désirée LEIGNEL installent leur entreprise de confection. Ils allaient vendre leurs pfabrication de vêtements dans les marchés de la région se souvient Louis Le Boulicaut. Leur dmeeure existe encore de nos jours.
Le Versa comptera égalmeent avce l'installation du cuisiniste Gilbert PENRU derrière l'hotel-restaurant éponyme. Il subsiste de cette époque un dernier hangar accessible par la rue Pierre Loti.
Le grand chamboulement interviendra avec l'arrivée de la grande surface Intermarché en 1982 puis celle du menuisier Lesquel en 1987. L'artisan menuisier sera rejoitn par la plomberie OLIVIER. Le hangar du plombier laissera place à des bureaux rue du Petit Versa. Le percement de l'Avenue de Gelpolsheim est ensuite réalisé, ce qui donnera au Versa sa configuration actuelle.

On connait la suite. La ZAC du Poulfanc ne cessera de se développer jusqu'à s'étendre vers l'Est jusqu'à Saint Léonard et la Grotte Jean II. Au nord de la Route de Nantes, la petite zone d'activité dite du Rohu accueillera un hotel et ses cours de tennis puis le fast-food Mac Donald's. A l'ouest de la rue du Versa, d'anciennes prairies accueillirent l'école de la Grenouillère (Guoyomard) puis des artisans tel le cuisiniste PENRU. Cette activité économique quittera le Versa pour laisser la place à des logements dans le cadre du projet de rénovation urbaine dit Coeur de Poulfanc, en phase d'achèvement sur le Versa en cette année 2022.
Un briquetier à Séné, 1881
Dans un pays de schistes, d'ardoisières et de carrières de granit, il semble peu problable de trouver une manufacture de briques. Et pourtant, cet article daté de mars 1881, nous donne le détail d'une vente d'une briqueterie à Séné. On comprend que l'atelier de production se situait rue de Séné à Vannes. A l'époque cette rue partait du port de Vannes (actuelle rue Monseigneur Tréhiou) et poursuivait vers Séné. Sur son chemin, la croix de Kernipitur, puis la ferme de Keravelo et le pont d'Argent qui enjambe le ruisseau de Cantizac.
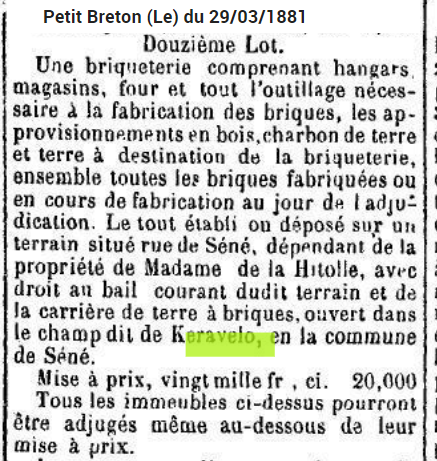
La publicité notariale indique que si la briqueterie est sur la rue de Séné, sur un terrain appartenant à Mme de la HITOLLE. Quant à la carrière de terre à brique, là ou existe un filon d''argile qui sert à confectionner des tuiles, il est située près de Keravelo sur la commune de Séné.
Il existait d'ailleurs d'autres briqueteries sur Plescop, Baden et surtout à Malgorvenec en Saint-Avé, près de Bilaire à Vannes. Le bâtiment existe toujours et fait l'objet d'uneréhabilitations au titre du patrimoine industriel.
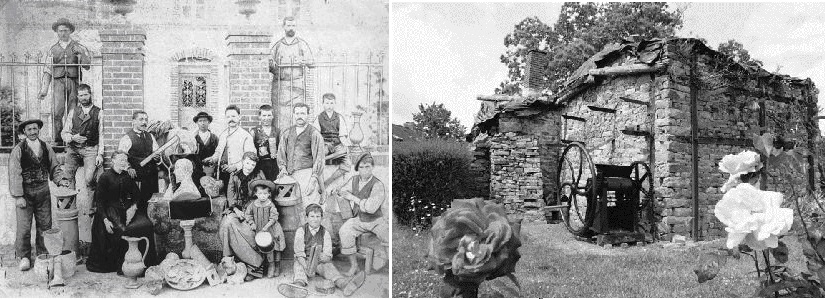
Cet autre article du Petit Breton daté de mai 1881, nous indique que la briqueterie fut acquise vraisemblablement par Olivier LEROY, qui insère une réclame dans le journal.
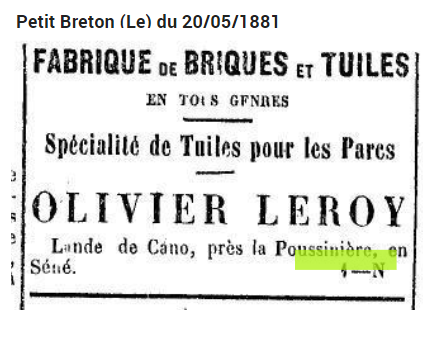
On retrouve la famille du briquetier lors du dénombrement de 1886, pointée quelque part entre le château de Limur et le village de Cano. Olivier LEROY [5/4/1841 Vannes - 9/2/1912 Ploeren] s'est marié à Vannes le 17/5/1862 avec Jeanne Marie LAMOUR [21/6/1843 Vannes - 2/2/1898 Ploeren]. Tous leur enfants sont nés rue de Séné à Vannes où la famille habitait avant de gagner Séné. On peut penser qu'il était déjà en poste à la briqueterie de Mme LAHITOLLE, rue de Séné à Vannes et qu'après l'acquisition du fond, il est venu s'installer sur Séné. Fils de journalier, journalier lui-même avec sa femme journalière, ils accèdent ainsi au statut d'artisan patron. On peut supposer qu'il ne paya pas cher cette briqueterie et son terrain de Keravelo à Séné.
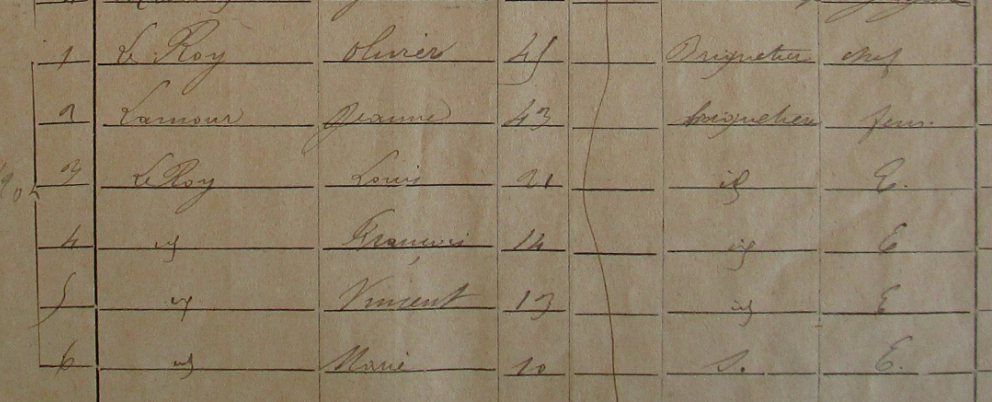
Olivier LEROY restera quelques années briquetier entre Vannes et Séné et finira par gagner Ploeren où son épouse décède en 1898. Le gisement d'argile de Séné devait sans doute arriver à sa fin pour ne plus alimenter la briqueterie de Séné. Et puis l'arrivée du chemin de fer et des matériaux de construction a sans doute changer les choses...Il finira sa vie à Vannes en 1912.
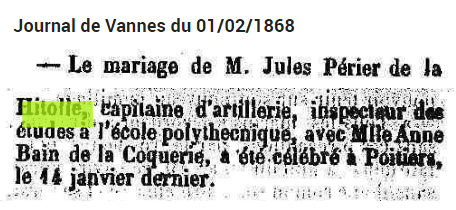
Il avait acquis la briqueterie à Mme de LAHITOLLE. On retrouve la famille PERRIER de LAHITOLLE sur les sites de généalogie. Il pourrait s'agir de Henri Jules Frédéric Antoine PERRIER DE LA HITOLLE [31/5/1832-1/9/1880], colonel d'artillerie, décédé un an aupâravent. Lors de la succession, ce bien qu'était la briqueterie, rapportant moins, il fut vendu par sa veuve Anne Henriette BAIN de la COQUERIE [1842-1912].
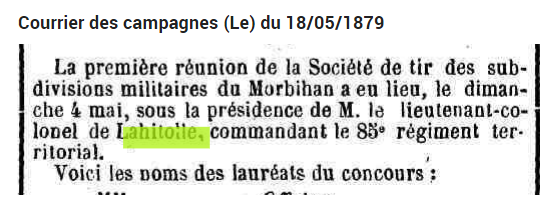
Quand à l'ancienne carrière avec son filon d'argile et le batiment même de la briqueterie, où étaient-ils situés à Séné?
LE MEUT Emile, Général sinagot 1874-1949
Il faut avoir la mémoire toujours vive de Jean RICHARD pour ce rappeller que notre commune a compté parmi ses habitants des généraux étoilés qui plus est, natifs de Séné.
Emile Louis Marie LE MEUT [21/10/1874- 1949] fait partie des sinagots ayant embrassé la carrière militaire et porté haut et loin la couleur rouge ocre de notre commune. Il nait à Cariel au printemps 1874. Son père Bertrand Marie LE MEUT [30/5/1844 - xxx ] déclare la profession de gendarme. Cet héritage paternel prédestinera Emile vers la carrière militaire. Sa mère Marie Perrine ROZO [24/3/1844 Cariel - 8/5/1898 Vannes], est la fille posthume de l'ancien maire de Séné, Vincent Marie ROZO [1796-1844], qui fut boulanger à Cariel. Elle va lui donner un enracinement sinagot. 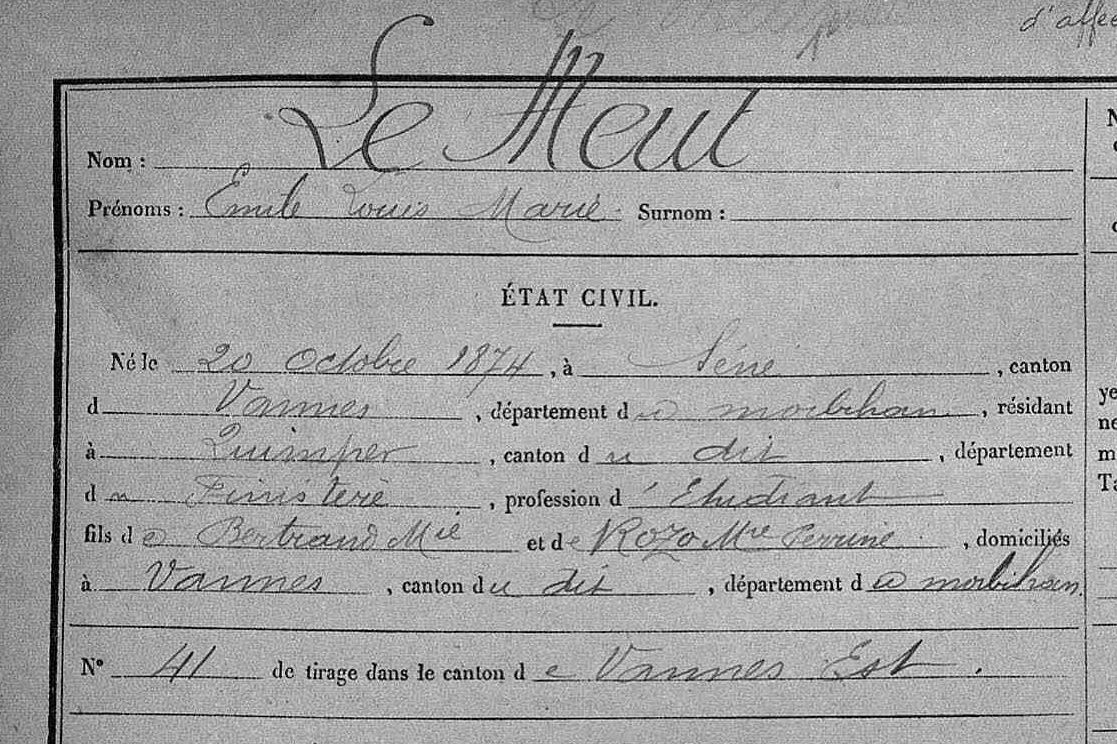
La fiche de matricule du jeune militaire LE MEUT est riche d'enseignements. En 1894, il vit à Quimper où il est étudiant. Ses parents vivent sur Vannes, et l'acte de décès de son jeune frère Ange Louis Marie LE MEUT [2/2/1876-2/6/1900] nous précise rue du Commerce.
Le parcours est un sans faute qui amène Emile LE MEUT, qui s'est engagé le 21/10/1892, à monter tous les grades dans l'Armée Française. Cannonier en 1893, Brigadier, Maréchal de Logis en 1894, Sous-Officier en 1896. Il suit alors l'Ecole Militaire de l'Artillerie et du Génie, dont il sort 30° sur 68. Il est promu Sous-Lieutenent en 1889 au sein du 7° Régiment d'Artillerie. En 1900 il passe au 2° Régiment d'Artillerie de Marin et se rend au Tonkin (1907-1909) puis en Cochinchine (1912-1914). En 1902 il est nommé Lieutenant et Capitaine en 1905. Il change de nombreuses fois de régiments. Il est mobilisé pendant Grande Guerre et en 1916, il est Chef d'Escadron. Il change pendant toute le durée du conflit plusieurs fois de régiment d'artillerie. A la fin de la guerre il prend part aux combats au Maroc.
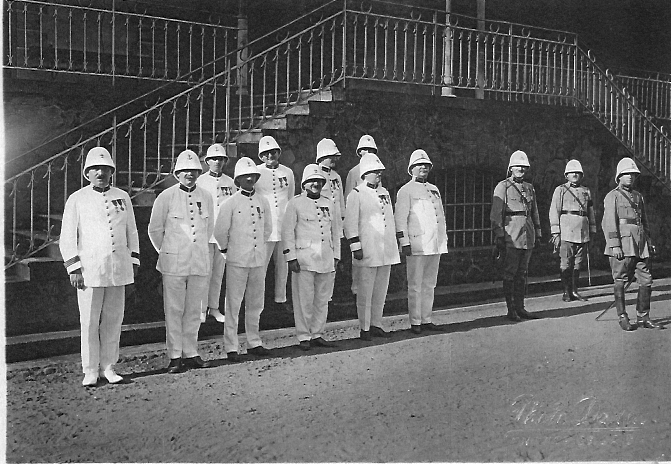
Sa fiche ne renseigne pas sur ses affectations dans l'Entre-Deux-Guerres. Il est nomé colonel.
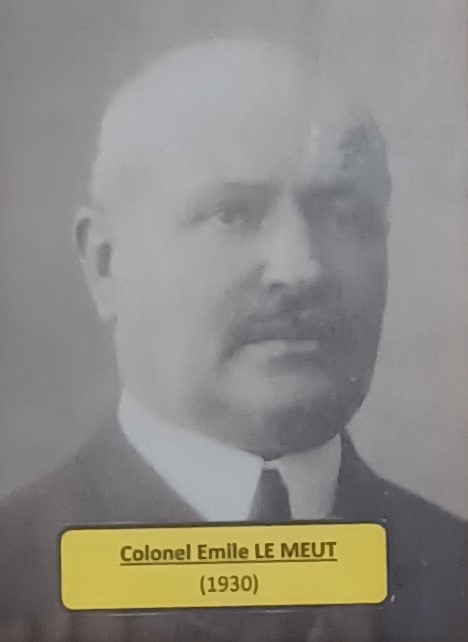

Cette photo du Minsitère de la Défense le montre alors qu'il est colonel au 11° RAC de Lorient.
Il est nommé Général de Brigade des Troupes Coloniales en 1932.

Durant toute sa carrière militaire, il recevra plusieurs décorations : Commandeur de la Légion d’Honneur, Croix de Guerre 1914-1918, Croix de Guerre des TOE, Croix du Combattant, Médaille Interalliée de la Victoire, Médaille Coloniale, Commandeur du Ouissam Alaouite, Officier de l’Ordre Royal du Cambodge, Officier du Dragon d’Annam, Médaille Commémorative de la Grande Guerre.
Il se retire à Séné, plus précisement à Cariel, là où il nacquit. Selon Jean Richars, pendant l'Occupation, sa maison à Cariel fut réquisitionnée par les Allemands pour abriter la Kommandatu de la 10° Compagnie, Unité 09987D.
Jean Richard se souvient : "je me souviens aussi très bien de l’enthousiasme collectif qu’avait entrainé la libération de Vannes ,donc de Séné. Nous étions voisins au Général Le Meut qui habitait Cariel . Des l’annonce de cette libération tous les habitants de la presqu’île se sont rassemblés pour former un défilé devant se rendre chez le Général . La petite cour qui séparait nos maisons a été envahie . Le Général a eu beaucoup de mal à calmer des Sinagots exprimant leur joie d’être enfin libres. Le calme enfin présent ,le Général a pris la parole pour exprimer lui aussi sa joie de voir la paix s’installer. Il a demandé que la Marseillaise soit chantée ´ c’était émouvant ´ Le chant terminé le Général a souhaité que tout le monde rentre tranquillement chez eux en évitant si possible de fréquenter les cafés, un souhait qui ne sera pas exaucé."

Il décède à Cariel le 1949.

Veste kaki modèle 1931 de petite tenue du Général de Brigade des Troupes Coloniales Emile Louis Marie LE MEUT
.
LE LAYEC, fils du boulanger devient Gouverneur
Notre cimetière n'est pas qu'un lieu administratif ou on inhume des personnes décédées. C'est aussi un lieu de mémoire et d'histoire quand on veut bien lui prêter un peu d'attention.

Cette plaque repérée au détour d'une allée de tombes interpelle l'historien local. Qui était ce Sinagot, Hippolyte LE LAYEC? On part en recherche avec méthode. Le registres de l'état civil permettent de confirmer son identité.
Hippolyte LE LAYEC est né à Séné le 19/1/1901 au bourg d'un père boulanger, Julien Marie LE LAYEC [27/1/1872 Theix - 17/5/1920 Lorient] et d'une mère couturière, Marie Louise LE BRAS [20/1/1875 - 9/2/1962]. On sent le bon élève qui grâce à "l'escalier social" de la République, a comme on dit, "réussit" par devenir Gouverneur de la France d'Outre-Mer. Hippolyte LE LAYEC n'aura pas oublié Séné, sa commune natale, puisqu'il choisit d'y prendre ultime demeure.
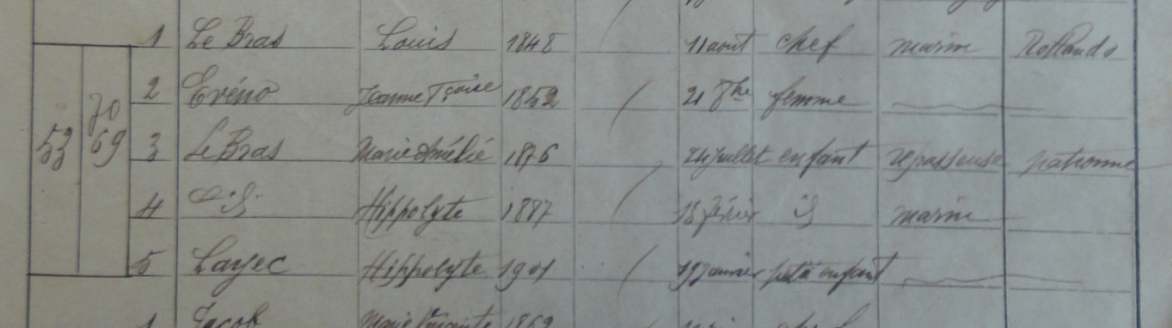
La famille Le-Bras-Le-Layec est pointée par le dénombrement de 1906. Ce jour-là les parents du jeune Hippolyte ne sont pas là. Il vit chez ces grands-parents Louis LE BRAS [11/8/1848-1922] et Jeanne Françoise EVENO [21/10/1852- xxx]. En effet, la fiche de matricule de son père Julien Marie LE LAYEC nous indique que celui-ci est toujours boulanger à Lorient. Son acte de décès au n°9 de la rue de la Corderie confirme qu'il pétrit la pâtes au sein de l'Arsenal de Lorient où sans doute son épouse vit également, l'enfant étant mieux à Séné..
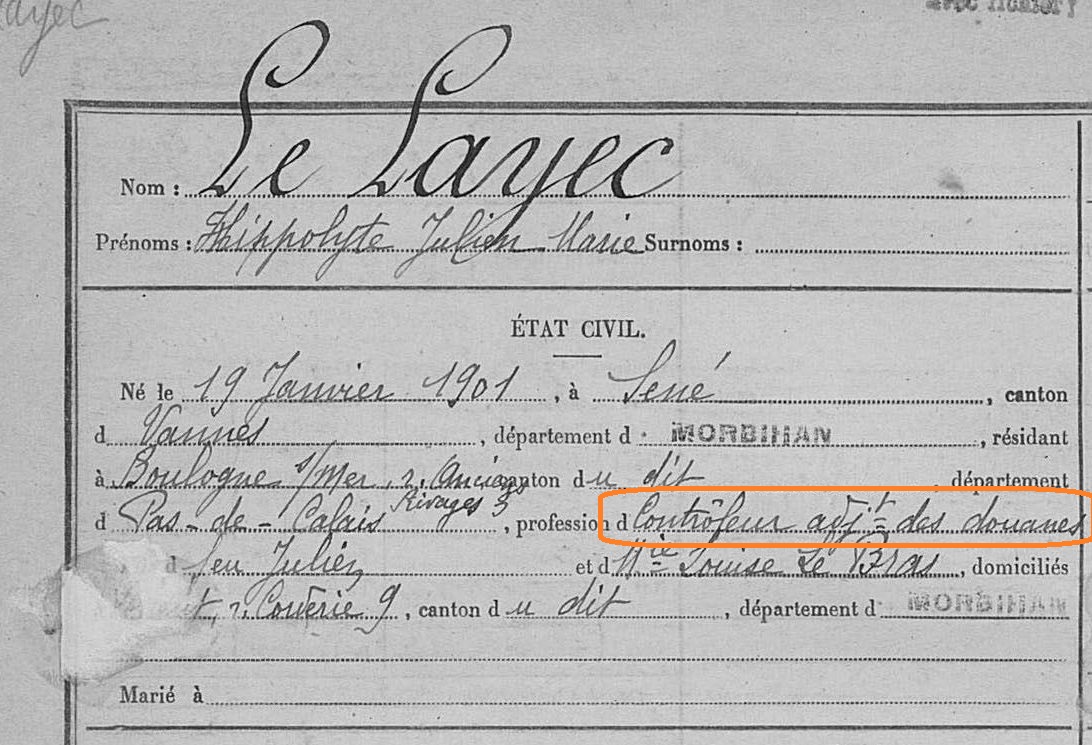
En 1920, son père décède à Lorient. En 1921, il accomplit son service national. Lors de la rédaction de sa fiche de matricule, Hippolite LE LAYEC est "déjà" contrôleur adjoint des douanes. Il est vrai que la guerre a saigné le pays. La fonction publique a recruté le jeune Sinagot qui ne va pas démériter. Il se marie au Havre en 1926 avec Andrée MARCHET [15/4/1903-27/3/1994] dont il divorcera en 1951, alors en poste à Brazzaville.
Cette même fiche nous indique qu'à l'issue de ce premier poste à Boulogne sur Mer, il est muté en 1929 à Dakar puis en 1935 à Brazzzavile. Il est mobilisé lors de la déclaration de guerre à l'Allemagne nazie du 2/9/1939 au 25/6/1940. A la Libération, il va faire carrière dans l'administration de l'Outre-Mer ce qui l'amènera à être nommé Gouverneur de la France d'Outre-Mer. Il sera décoré de la croix de Commandeur de la Légion d'Honneur. [aller aux archives nationales].
"Nul ne guérit de son enfance" a écrit un poète. Hippolyte LE LAYEC se souviendra de sa jeunesse passée à Séné, de l'odeur du bon pain chaud et choisira de s'y établir à sa retraite. En 1962, l'agent du recensement le pointe au bourg, auprès de sa mère et à quelques pas de la boulangerie Robino, comme un signe du fils du boulanger qui ne renie ni ses racines familiales, ni ses origines sinagotes.
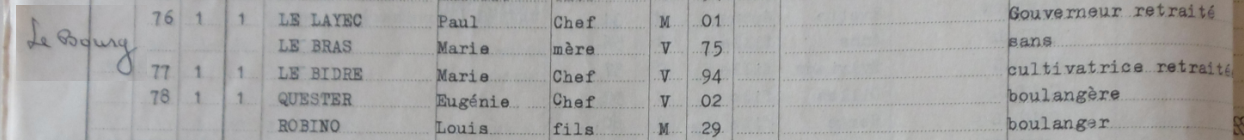
Il décède à Séné le 26/8/1965 et repose au cimetière communal.
LE ROY Roger 1925-2020
Roger LE ROY est né le 15 août 1925, à Séné, au bout de la presqu’île de Langle. Son Père Joseph LE ROY [26/7/1888-2/2/1981] est pêcheur et sa mère Marie Perrine LE MELINAIRE [26/1/1899-1/7/1988] originaire de Grand-Champs est cultivatrice. Roger Le Roy est le fils aîné d’une fratrie qui comptera 9 enfants. En 1931, la famille est pointée lors du dénombrement et vit au village de Langle.
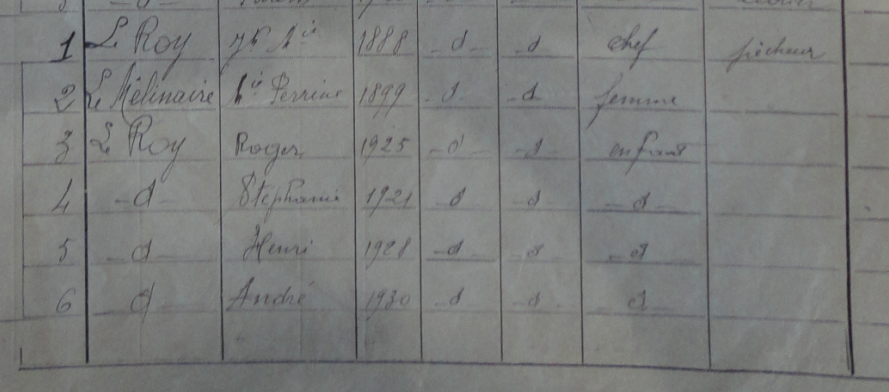
Sur la presqu'île de Lagle, depuis 1911, les enfants vont à l'école de Bellevue [lire article sur l'histoire des écoles].
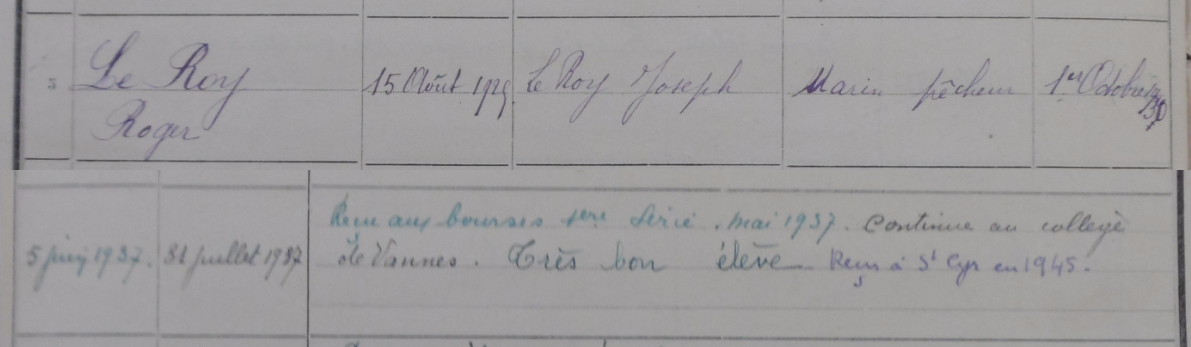
Son institutrice à l’école de Langle, Mme Jaffré, ayant détecté ses capacités, avait tout fait pour qu’il puisse poursuivre des études supérieures. Les commentaires du registre de l'école sont élogieux. C’est ainsi qu’il a obtenu son baccalauréat à la suite de sa scolarité au collège Jules-Simon, à Vannes.
Élève officier à Saint-Cyr Coëtquidan, promotion Général Leclerc en 1946-1947, il choisit de servir dans la coloniale ( troupes de marine). Parmi ses premières affectations, l’Indochine où il commande une section de tirailleurs sénégalais et de partisans vietnamiens. Gravement blessé lors d’une bataille, il est rapatrié à Séné où il passe un an de convalescence. Versé dans l’armée blindée, il poursuit sa carrière d’officier en Afrique et en Allemagne. Bilingue, il est nommé officier de liaison entre l’état-major de l’armée française et celui du Centre Europe de l’Otan.
Croix de Guerre, commandeur de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite, Roger LE ROY revient à Séné en 1982 pour y passer sa retraite. Il décède à l'âge de 94 ans le 30/7/2020.
Saint-Léonard, aux portes de Séné
Les nombreux véhicules qui empruntent la route de Nantes pour entrer ou sortir de l'agglomération de Vannes traversent le Hameau de Saint Léonard à cheval sur les communes de Séné et de Theix. Ce petit village nous présente un patrimoine tout à fait remarquable

Sur la butte au dessus de la route, un peu masquée dans l'herbe, on découvre la Croix de St-Léonard, sise en la paroisse de Theix et si familière aux Sinagots. Elle a été restaurée vers 1940, ainsi que celle de Bonervaud, située plus loin sur la même voie, avec les débris des deux croix géminées trouvées dans le fossé de la route."Source l'Abbé Le Roch). Non loin de là se tenait un moulin à vent comme l'indique le relevé cadastral de 1844.(ci-après)
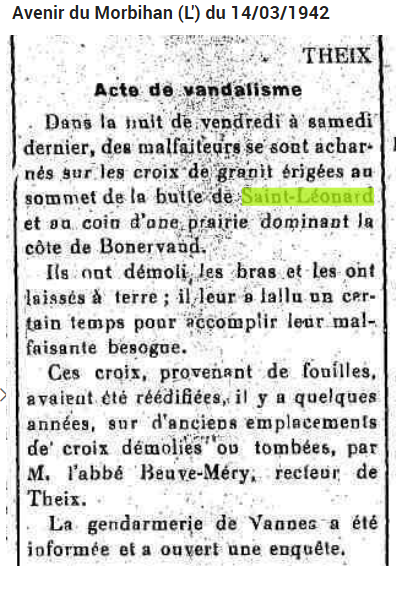
La Chapelle Saint-Léonard (XVème siècle et 1767), reconstruite en 1767, est située en contre bas de la route de Nantes. Saint-Léonard est un prieuré cité au XVème siècle et qui subsiste jusqu'à la Révolution. La chapelle porte la date de 1767 mais on sait qu'une chapelle existait très anciennement en ce lieu puisqu'en 1485 un seigneur de Lohan y fut enterré. Deux contreforts sur la façade principale semblent datés du XVème siècle.
Extrait du cahier des amis de Vannes : Citée par Dubuisson-Aubenay, dans son itinéraire de Bretagne de 1636, la chapelle de Saint-Léonard était le siège d'un petit prieuré à la présentation des soeurs de Salarun (Theix). En 1425, le duc Jean V y fit porter des présents pour l'heureuse naissance de son fils Gille. La chapelle est encore citée au procès de canonisation de Vincent Ferrier (1455) et dans un compte de la fabrique de la cathédrale de 1485 indiquant que le sieur de Lohan, puis sa femme, y furent inhumés. En 1695, ses revenus étaient affermés au secrétaire de l'evêque. La chapelle a été entièrement restaurée en 1767 (date inscrite sur la porte) et sauvée de la destruction sous la Révolution quand un voisin abtiny de la louer comme étable. Rendue au culute, elle risquait ruine quand une association se créa en 1974 pour l arestaurer et l'entretenir et rétablir son pardon annuel.
Edifice rectangulaire soutenu par des contreforts à l'ouest (restes du XV siècle), la chapelle voutée d'un lambris et enrichie d'un autel du XVIII°siècle et de plusieurs statues, Sainte Anne et la vierge (bois). Sainte Cécile (terre cuite), patonne de Theix, et Saint-Léonard qui apparait aussi dans le vitrail où il console les prisonniers. Ermite du V°siècle, Saint Léonard (466-559?) selon la tradition, aurait été baptisé avec Clovis, son cousin à Reims en 499; retiré dans la forêt de Pauvin, près de Limoges, il y meurt à l'âge de 93 ans. Fêté le 6 novembre, il est le patron des prisonniers. (D'après "Eglises et chapelles du Pays de Vannes, tome II Vannes-Est, Joseph DANIGO.
Pour passer sur la commune de Séné, on emprunte le Pont de Saint Léonard qui enjambe la rivière du Liziec à quelques mètre de son embouchure avec la Rivière de Saint Léonard et le Golfe du Morbihan. Le promeneur descendra sur la berge pour découvrir la construction. Jusqu'aux années 1946, la ligne de Chemin de Fer Secondaire du Morbihan passait sur ce pont. Lire article sur la Grotte de Jean II.
Une fois passé le pont, on ne peut le manquer. Situé dans le quartier limitrophe des communes de Séné et de Theix, le restaurant LE JARDINS DE LEONARD a ouvert en septembre 2020, à l'emplacement du BOUCHON BRETON.
Le BOUCHON BRETON, était installé au N° 130 de la route de Nantes à Séné depuis mars 2013 et géré par Michel & Marie Odile BOEFFARD.
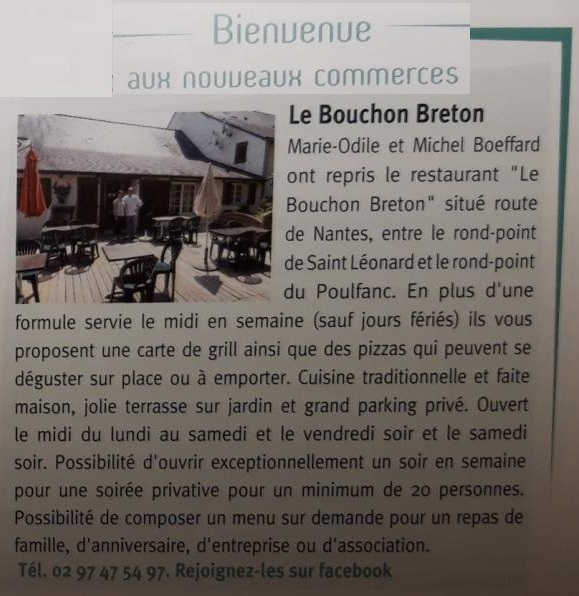

On doit le JARDIN DE SAINT LEONARD à Cécile BRETON et Frédéric FORTIN qui ont officiellement signé l'acte en avril 2020.
Ce restaurant bénéficie d'une très bonne exposition et d'un lieu imprégné d'histoire à deux pas des sentiers qui mène à la Grotte de Jean II ou de la Croix de la Brassée.
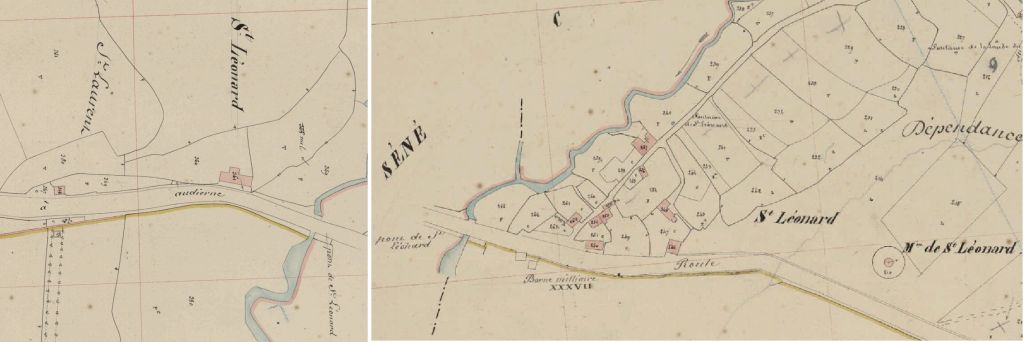
En limite entre Theix et Vannes, près de la chapelle de Saint-Léonard, sa fontaine et sa croix, un village est constitué dès 1810 sur la commune de Theix mais pas encore à Séné. Au cadastre de 1845, quelques maisons sont bâties également sur Séné. On identifie facilement ce qui deviendra au n°66 Route de Nantes, le constructeur Design & Tradition et au n°130 Route de Nantes, le restaurant et l'artiste ferronnier.

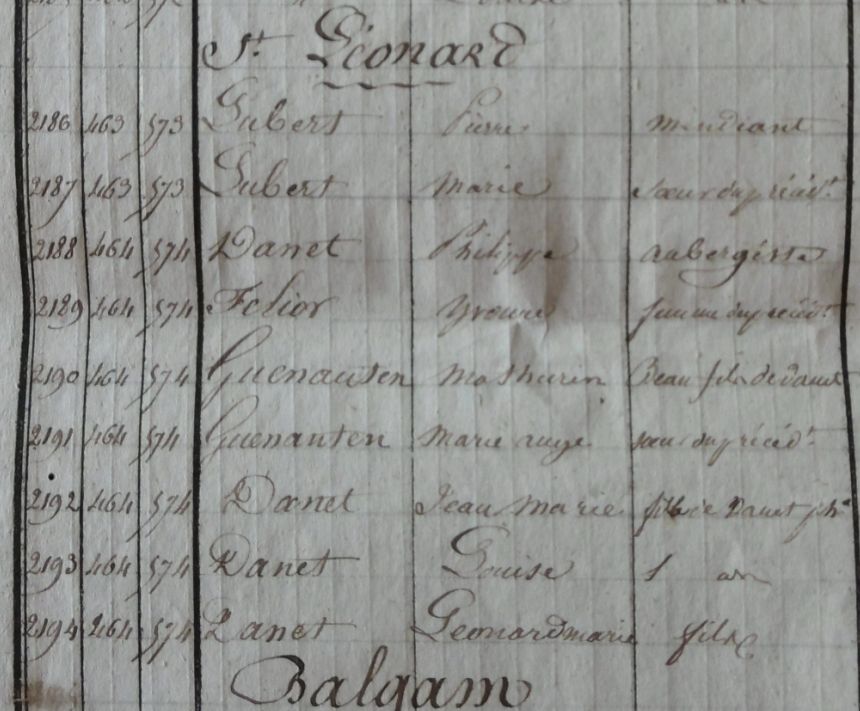
Le dénombrement de 1841 nous indique que Philippe DANET et Yvonne FILIOZ sont aubergistes. Leur auberge fait vivre au total sept membres de leur famille, dont les memebres de la famille Guénanton, apparentés aux Danet.. Charrettes, voitures hippomobiles vont et viennent sur la route royale de Nantes à Audierne.
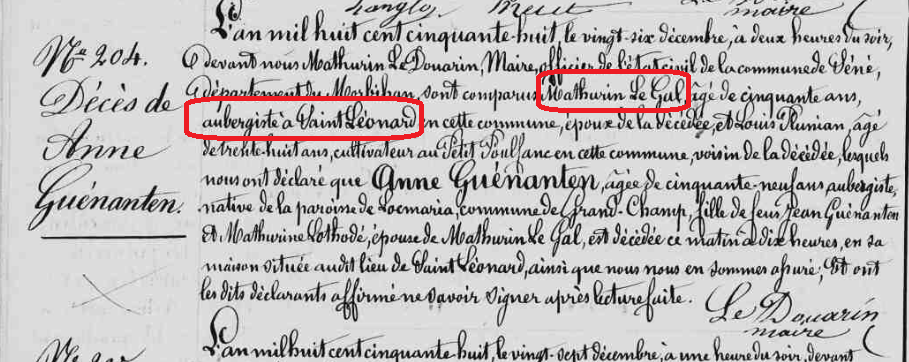
Au hasard de recherches sur les sites de généalogie et sur les registres d'état civil, on trouve cet acte de décès à Séné de Anne GUENANTON [ca 1799-26/12/1858] marié à Mathurin LE GAL né à Noyalo le 25/9/1808. qui déclare en ce jour du décès de son épouse la profession d'aubergiste à Saint-Léonard. On peut penser que le débit de boisson ou cabaret de Saint Léonard est passé de la famille Danet à la famille Guenanton. Mathurin LE GAL se marie en 1859 avec Jeanne Louise QUESTER [11/3/1817 - 3/9/1880] de Cressignan.
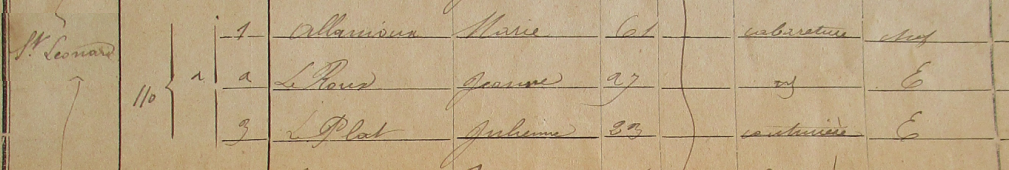
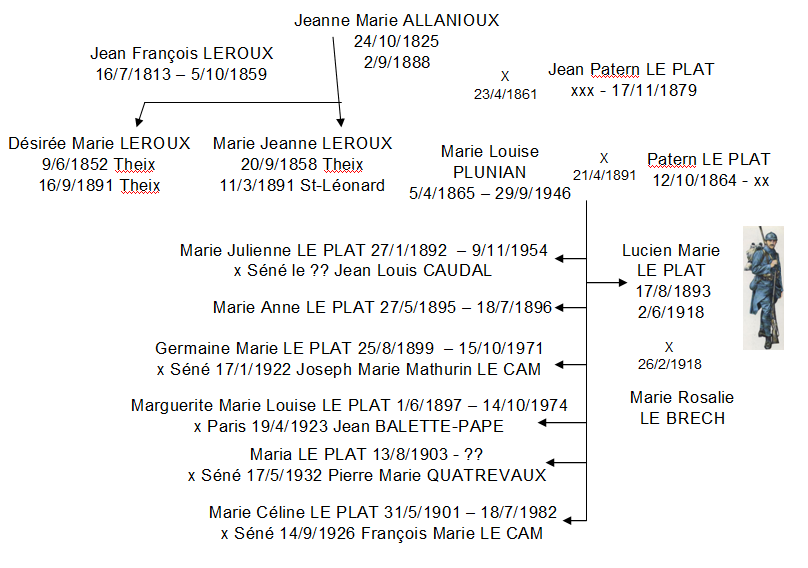
Le dénombrement de 1886, fait apparaitre le nom de Marie ALLANIOUX qui exerce l'activité de cabaretière. On peut penser à une vente de l'établissement de Mathurin LE GAL à Mme ALLANIOUX car aucun lien de parenté n'est mis en évidence. Il s'agit de Jeanne Marie ALLANIOUX, veuve alors de Jean Patern LE PLAT. Elle avait déjà eu pour mari Jean François LEROUX, dont elle eu deux filles, Désirée et Marie Jeanne LEROUX qui apparait au dénombrement de 1886. Au décès de sa mère, Marie Jeanne reprend le débit de boissons. Après son mariage en 1889, elle décède prématurément en 1891.
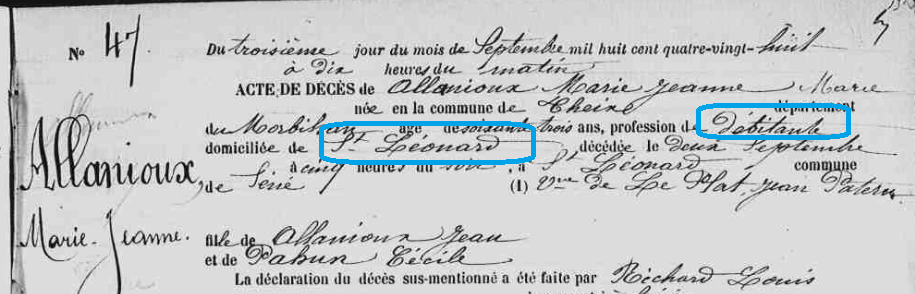
Patern Marie LE PLAT se marie la même année 1891 et reprend l'établissement avec son épouse Marie Louise PLUNIAN.
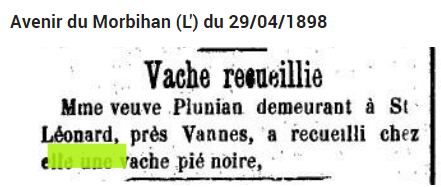
Les "Le Plat" perdront leur unique garçon, Lucien LE PLAT [17/8/1893-2/6/1918], charron chez le forgeron Tréhondat, pendant la guerre de 14-18, alors qu'il était rentré à Séné pour se marier avec Marie Rosalie LE BRECH le 26 février 1918...
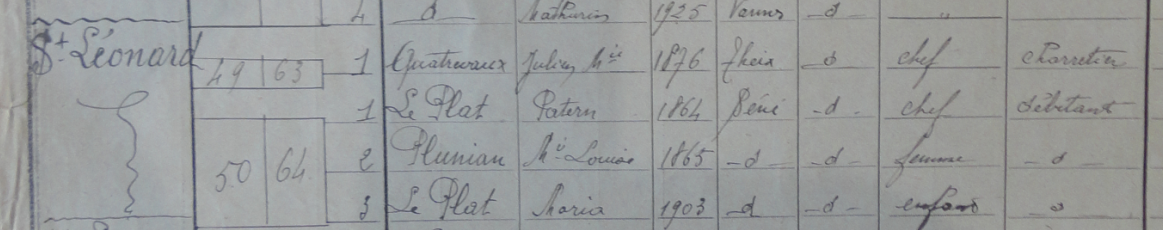
Après guerre, ils déclarent l'activité de cabaretier lors des dénombrements de 1921 et de 1926, puis celle de débitant en 1931.
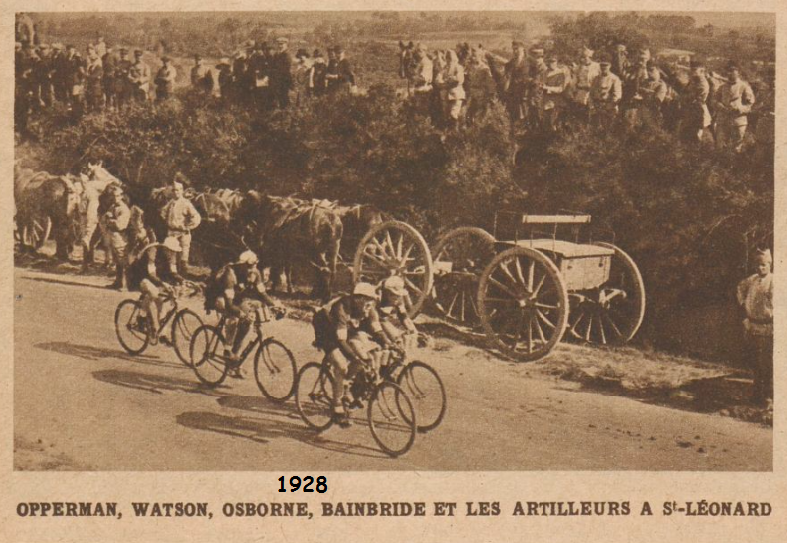
En 1928, lors de l'étapedu Tour de France arrivant à Vannes, le régiment d'infanterie se poste sur la butte de Saint-Léonard pour assister à la course.
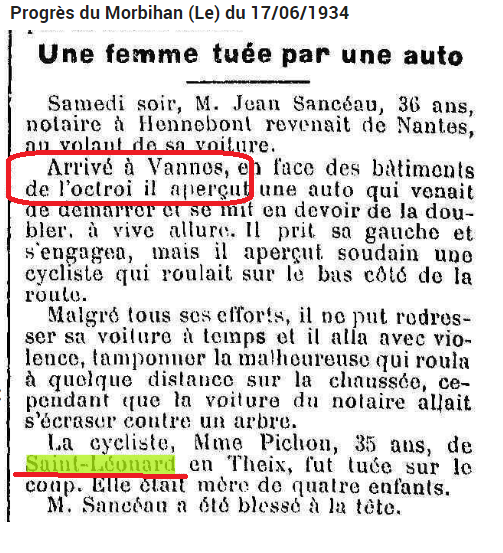
Après le décès de Mme PLUNIAN,Mathurin BIHOES et son épouse Marie Josèphe POURCHASSE [29/7/1902-6/11/1977] achètent l'établissement aux héritiers Le Plat en avril 1948. L'établissement portait alors le nom bucolique de "Rendez-vous des Chasseurs et des Pêcheurs". Les Bihoes font quelques travaux et demeureront cafetier jusqu'en 1954-55.
La café a pignon sur la route de Nantes. L'endroit est toujours dangereux. Venant de Theix il faut négocier la descente, puis passer la chicane du pont sur le Liziec, ancienne voix ferrée, pour repartir vers Vannes.


Ces deux photos illustrent un accident qui impliqua le producteur de muscadet, Donatien BAHUAUD. Au passage, on peut noter l'aspect des bâtiments dans les années 1950. Le corps principal n'a pas bougé; l'aile droite a été depuis rallongé vers Theix et du côté gauche, un hangar a été accolé à la batisse.
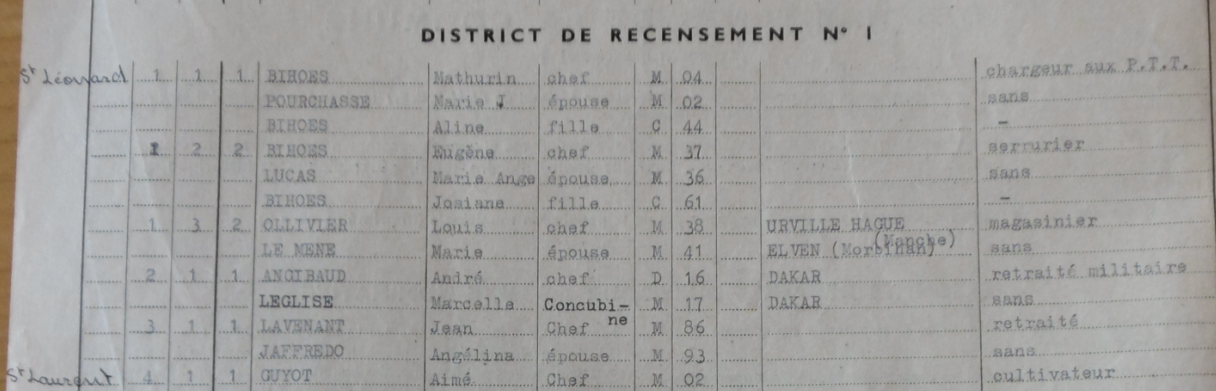
Vers 1959, la route de Nantes est rectifiée et ne passera plus au ras de l'établissement.Le dénombrement de 1962, nou smontre la présence de M. Bihoes qui demeurera dans sa maison jusqu'à son admission en maison de retraite.
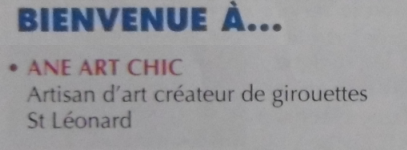
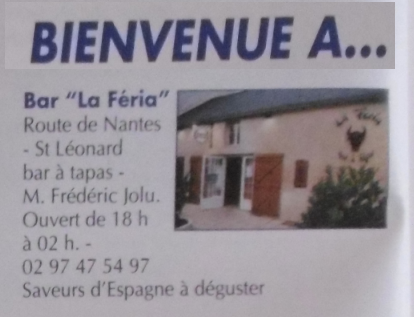
Le bien sera vendu le 3/10/1996 à la SCI Kerleo. La Girouette (Ane Art Chic) , atelier de ferronnerie d'art verra le jour ainsi que le restaurant LA FERIA qui laissera place vers 2005 au restaurant Le Bouchon Breton.
En 2020, le bien est revendu à a societé de Nantes FCMB qui revend le bien en 3 lots dans la foulée: le restaurant, l'atelier et la maison d'habitation. Depuis l'automne 2021, L'Atelier de Saint Léonard propose la dégustation et la vente d'un large choix de café, torréfiés sur place par Isabelle BAZIN, artisane torréfacteur.
L'espace de "Bien-être" PARACELSE est venu compléter l'activité de cette entrepreneuse en 2023.

Mini-club, toute une époque!
Qui se souvient de la maison des jeunes? Sur le terrain où sera construit le la médiathèque et la salle de spectacle, GRAIN DE SEL, existait un parking spacieux utilisé par les parents pour aller chercher leur enfants aux écoles et pour déposer leur adolescents à la MAISON DES JEUNES.

Capture d'écran Mappy
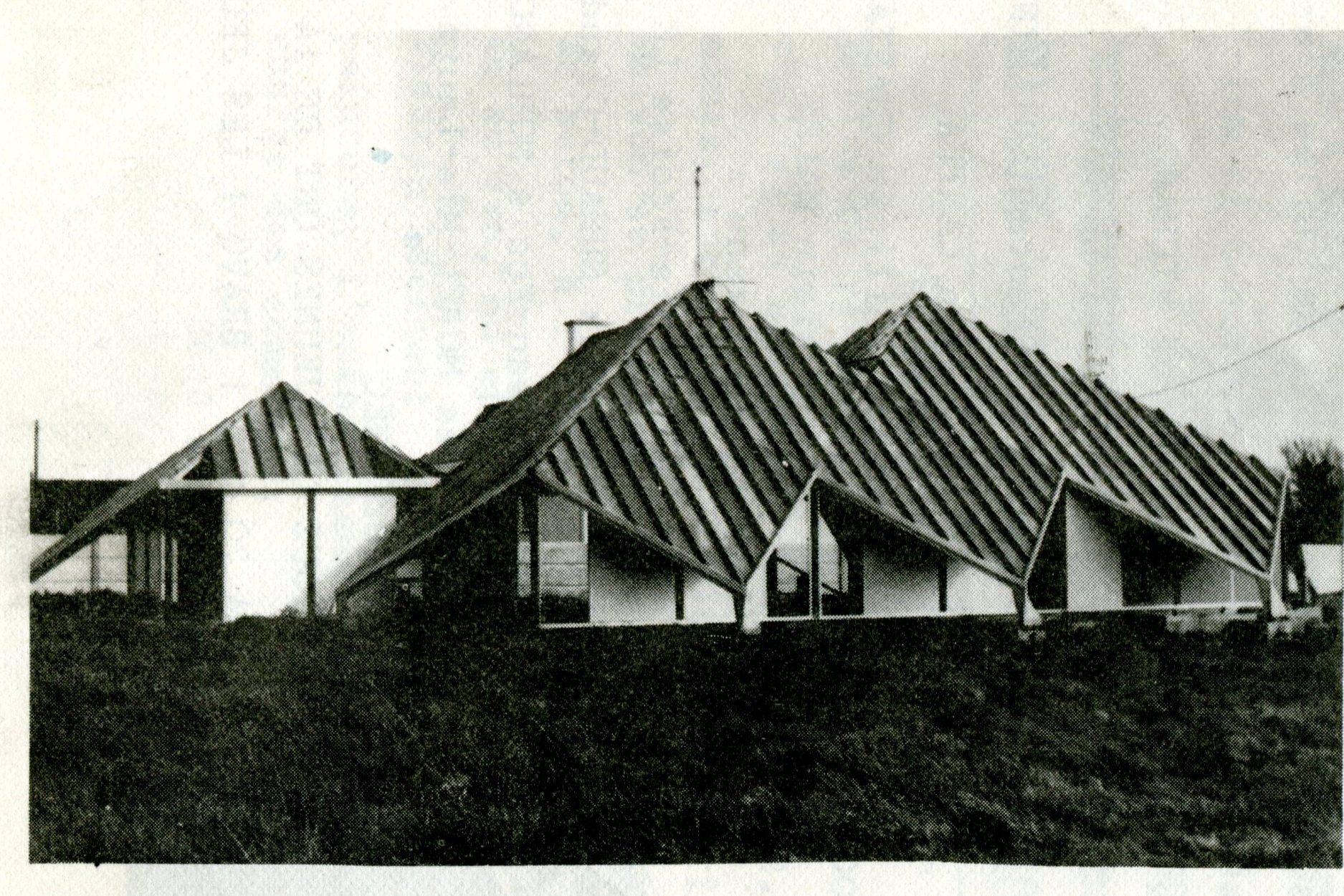
Cette maison des jeunes, était logée, comme le montre cette photo, dans un batiment en plusieurs volumes, métallique et aux toits en pente raide. Sa construction s'inscrivait dans un grand plan national d'édification de maisons des jeunes....
[texte ci-après extrait d'un document de la Région Bourgogne qui a décidé de classer certains de ces batiments au titre du Patrimoine du XX°siècle]
Le contexte national
En 1966, le Ministère de la Jeunesse et des Sports lance un concours pour un prototype d'équipement socio-éducatif afin d'équiper la France de « Mille-Clubs de jeunes ». L'objectif des Mille-Clubs est de produire des modèles de série économiques selon des processus de préfabrication légère. Les exemplaires doivent être identiques quelle que soit la région ou la taille de la commune (urbaine ou rurale) et doivent assurer une diffusion et un accès aux animations socio-culturelles, égalitaires sur tout le territoire. Leur implantation a lieu en deux phases, à partir de 1967 puis de 1972. Chaque phase débute avec un cahier des charges à destination d'une entreprise de construction et d'un ou plusieurs architectes. Deux ou trois équipes sont retenues pour concourir. Le programme précise que le montage doit être aisé et rapide, sans l'intervention de professionnels et sans que les éléments constructifs ne pèsent plus de 60 kg chacun. Les locaux doivent comprendre un foyer avec bar et sanitaires sur 150 m2 environ. Les exemplaires, envoyés en kits aux communes sélectionnées, sont montés par les jeunes sous la direction d'un agent technique. Le choix du terrain, sa viabilisation et la réalisation des fondations du club sont à la charge des municipalités.

Les mille-clubs au niveau national
Le concours de la première série de Mille-Clubs lancé en 1967 distingue deux modèles lauréats qui sont ensuite diffusés: le modèle BSM des architectes Godderis et Deleu (photo à gauche) et le module SEAL des architectes Béchu, Bidault et Guillaume [photo à droite -il sera retenu à Séné]. Le second concours de 1972 retient également les modèles améliorés de ces deux équipes plus un troisième lauréat : le modèle SCAC conçu par l'agence Environnement Design. Chaque prototype fait appel à des modules préfabriqués qui trament leur plan et leur composition de façade. Des matériaux aussi divers que l'aluminium, le plastique, le polyester ou le bois sont employés par les différents modèles et montrent les nombreuses possibilités en matière de préfabrication légère. Alors que le modèle BSM met en valeur la performance technique avec sa structure-parapluie unique, les modèles SEAL et SCAC misent sur la répétitivité de modules pour créer des clubs composés de plusieurs volumes avec des toitures à pentes multiples. Au total, près de 2500 de ces clubs ont été construits en France entre 1967 et 1982.
Et à Séné ? Cet extrait du bulletin paroissial de mars 1978, nous raconte quels furent les jeunes de Séné à construire leur "mini-club".
DU COTE DE L'OPERATION MILLE CLUB A KERANNA
L'Opération "MILLE CLUBS" remonte à 1967. La "Jeunesse et les Sports" décide de réaliser une "Opération 1000 Clubs" de Jeunes dans toute la France, club réalisé en usine par la "maison S.E.A.L." et devant être monté par les jeunes eux¬mêmes, sur place, à l'aide d'un outillage simple, suivant un plan détaillé. Cette maison se présente comme un véritable chapiteau sans mât, monté sur une plate-forme de béton, à l'aide de profils d'alumînium . L'ensemble offre une une grande résistance au feu, un entretien facile, le chauffage est à air pulsé par un générateur extérieurau bâtiment. La plate-forme, le sol, la mise en électricité , le chauffage, la peinture, l'aménagements des abords ainsi que l'équipement intérieur restent à la charge des connnunes.
Séné décida en 1975 [sous le mandat du maire Albert GUYOMAR] de se doter, à la demande des jeunes, d'un "mille club", Puymorens de 160 m², de 15m x 24,5m, comprenant une grande salle et une autre plus petite. Après bien des difficultés relatives au choix et à l'achat du terrain qui ont retardé le démarrage de l'opéraiton, nous avons pu commencer en septembre dernier la réalisation de la plate-forme. Puis après avoir vainement cherché à contacter l'ancien bureau, nous a-vons organisé, en octobre, une réunion qui a . Un bureau fut élu..Il fut décidé de travailler le mercredi après-midi et le samedt après-midi, ainsi que pendant les congés scolaires .. Le montage par les jeunes se fait en 1000 heures .. Le temps, dans l'ensemble ne nous a pas gâtés, mais malgré ce handicap vous pouvez voir actuellement le résultat du travail de ce groupe de jeunes, dynamiques et dêvouês , le sous-toit ayant été posé durant les vacances de Pâques, ainsi que les côtés .. Il rest donc le toit de tuiles d 'aluminium et les finitions sol, chauffage, électricit"... Nous sommes environ à la moitié de la réalisation.
Voici le nouveau bureau élu : Président : Hervé RICHARD, Vice-President : Joël LE RAY; Secrétaire: Chantal GUILMIN Secr.Adjoint: Jean CARTEAU; Trésorier: Philippe CHARTAUD Trésorier adjoint: Alain MALRY. Membres du bureau: Eric CADERO-Marie-Fçoise LE LAIDIER-Régis SUHAUD-Claude DORIDOR-Jean-François NOBLANC¬Jean-Yves MOREL-Marie-Laure PLOUZENNEC.
TOUS CES JEUNES ONT DE 14 A 20 ANS ! BRAVO ! LES JEUNES !
Nous sommes en mars 1978, le premier bureau de l'Association des Jeunes Singots signe le montage de la "Maison des Jeunes". D'autres adolescents se succèderont pour animer leur association comme en témoignent ces extraits de bulletins municipaux.
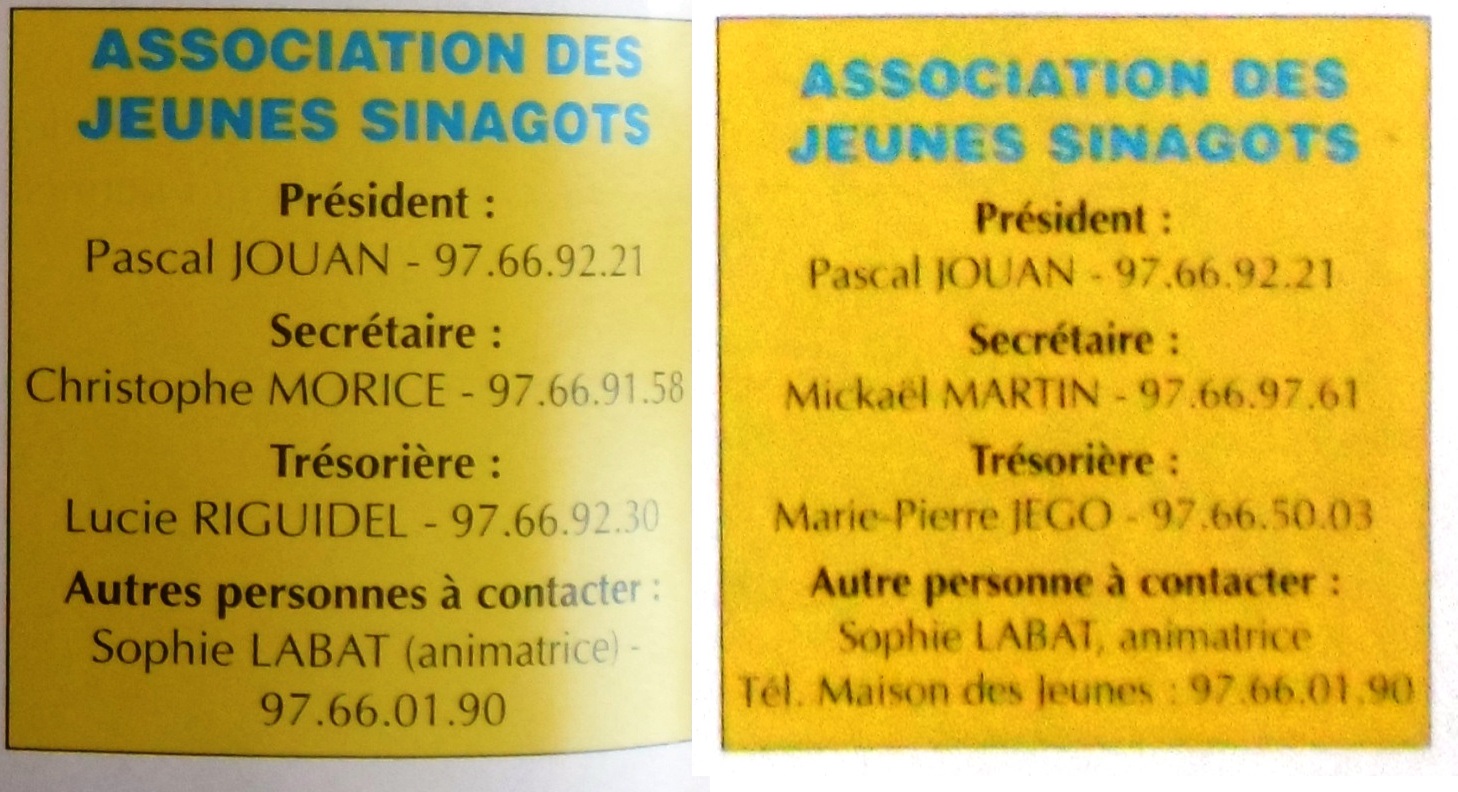
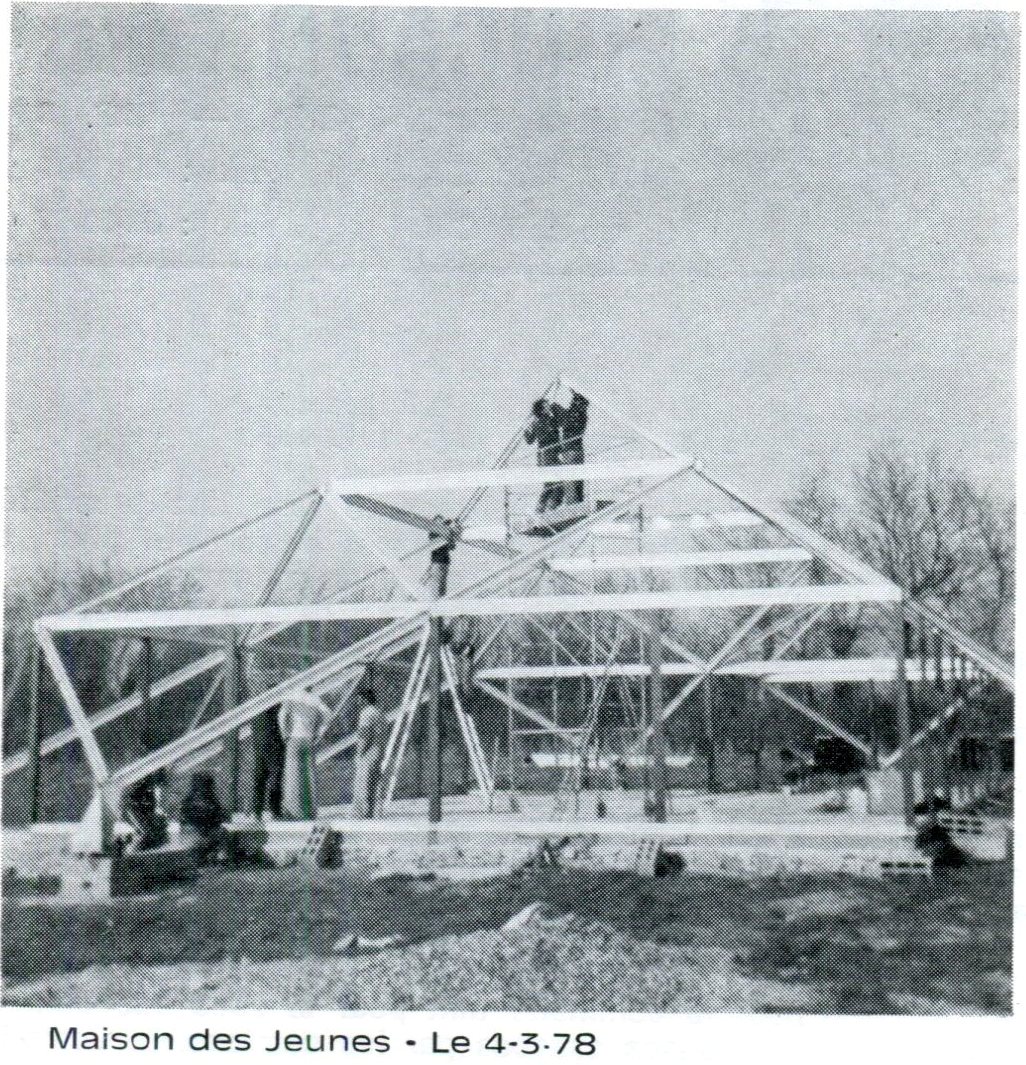
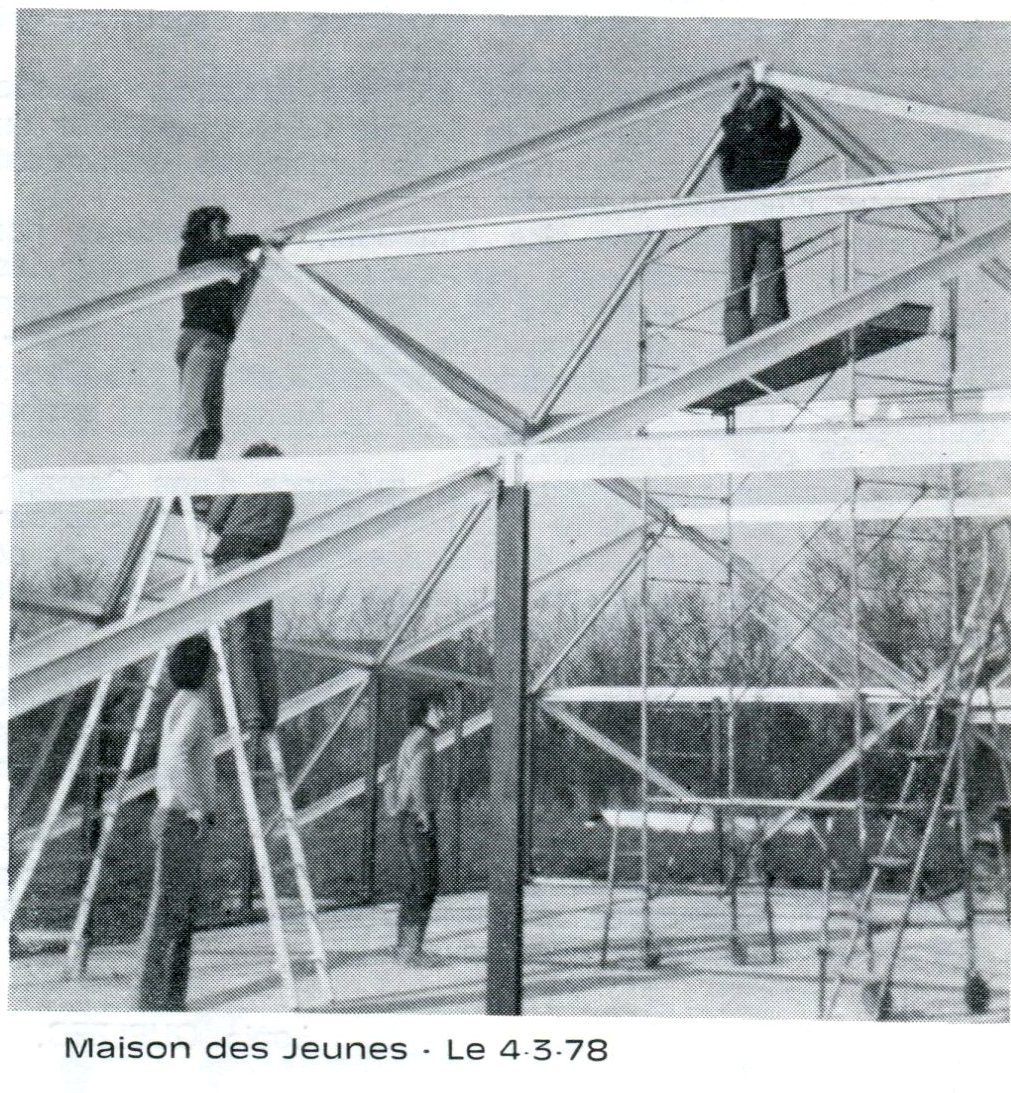
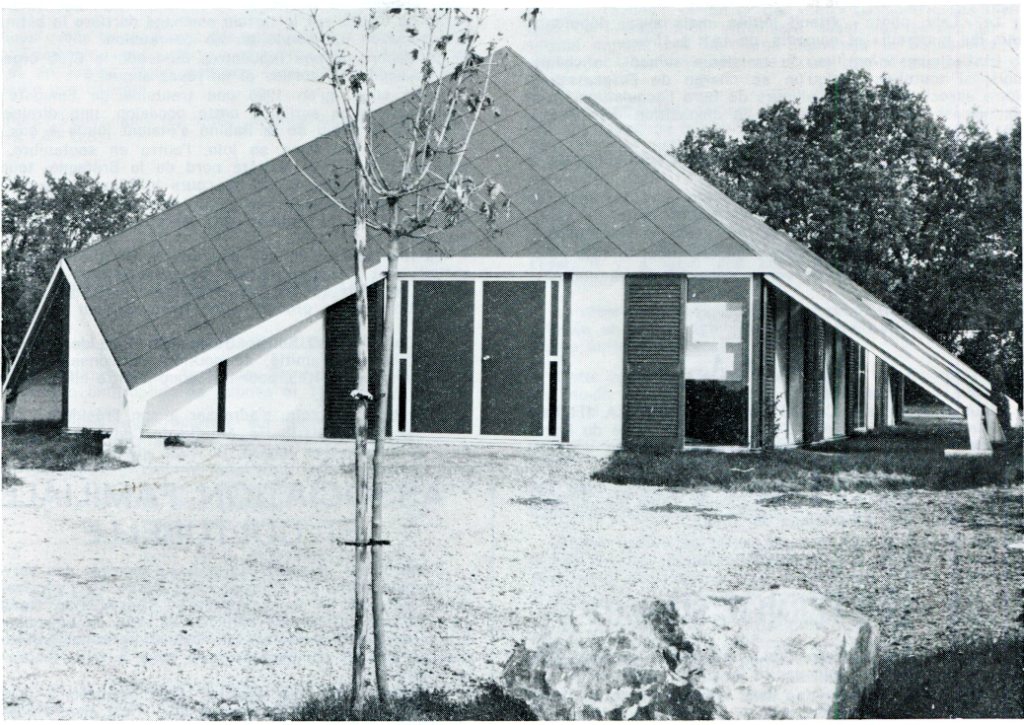
La foire de Saint-Laurent, par l'Abbé LE ROCH
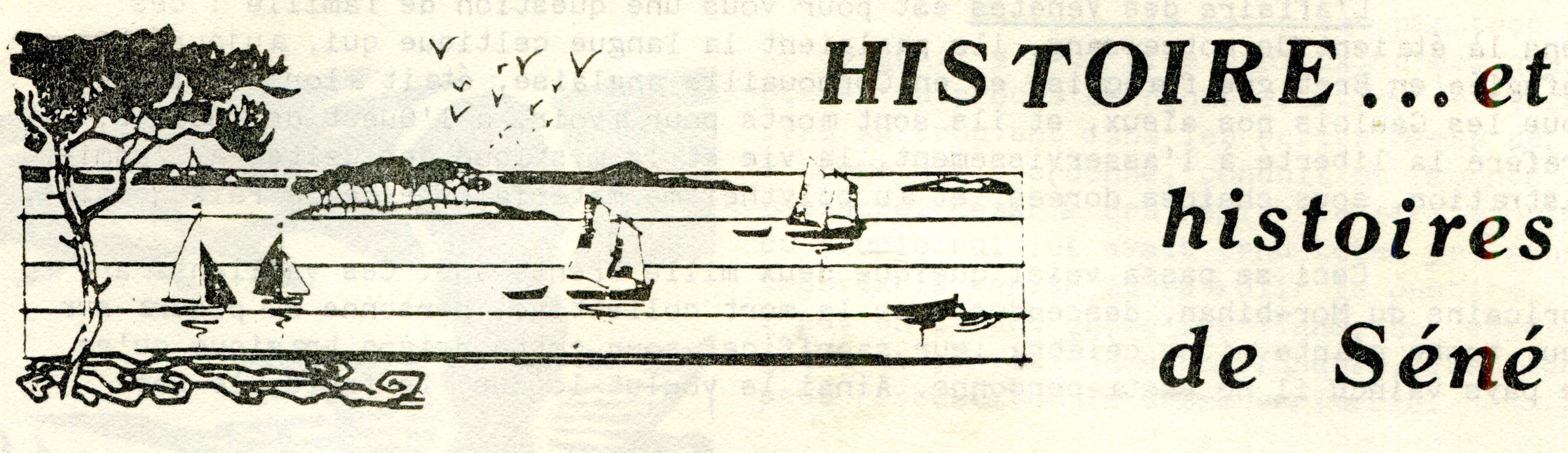
LA FOIRE DE SAINT-LAURENT
Elle se tenait dans le voisinage de la chapelle le 22 Septembre ou le lendemain quand cette date tombait un dimanche. C'était une des plus importantes de la région et l'on s'y rendait d'assez loin. Elle s'est perpétuée jusqu'à la dernière guerre de 39-45 qui a vu définitivement son déclin et sa disparition.
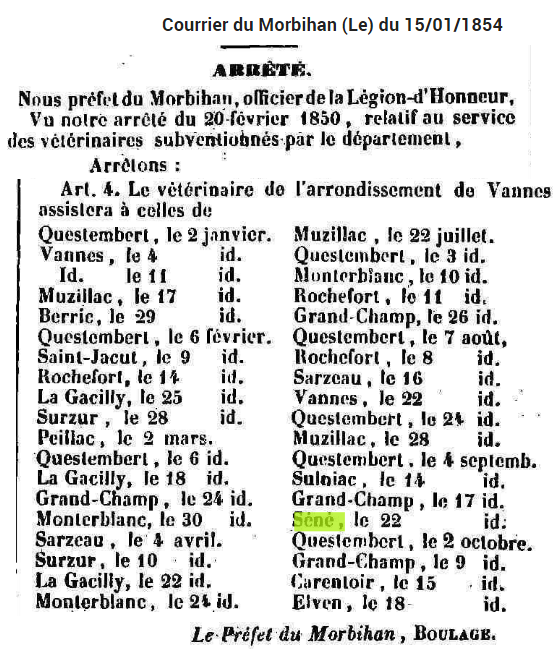
On y présentait toutes sortes d'animaux, bon an mal an, une cinquantaine de vaches, autant de cochons, une centaine de chevaux et encore des boeufs. Chaque catégorie avait son foirail traditionnellement réservé. Les vaches étaient surtout de vieilles bêtes que l''on vendait pour la boucherie en fin de saison. Les boeufs venaient de la région de Questembert. Un maquignon de Ruffiac arrivait régulièrement dès la veille avec une quinzaine de chevaux que les fermiers du village accueillaient dans leurs écuries. Les marchands de Locminé se reconnais¬saient à la longue blouse bleue qui leur tombait presque sur les sabots, à leur chapeau de velours et à leur cravache.
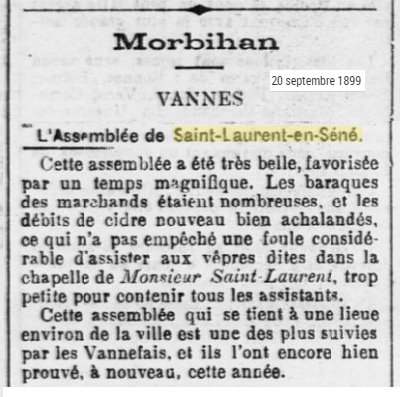
Une foule nombreuse se pressait à la foire, paysans des campagnes et bourgeois de la ville. On y accourait à pieds, à cheval ou en chars-à-bancs, qu'une capote parfois abritait du soleil ou de la pluie. Cette assemblée attirait les marchands qui étalaient leurs éventaires en bordure du chemin ou dans les prairies. On vendait de tout : de la soupe, du ragoût, du pain, des charcuteries, des sardines grillées et naturellement toutes sortes de friandises du far, des fruits, des berlingots et des cacahuètes ... Comme il cied en Bretagne, les débitants de café et de boissons ne demeuraient pas en reste. On y exposait même du matériel agricole paniers, brouettes, instruments aratoires et jusqu'à des charrues et des brabants.
La foire se doublait d'une fête foraine avec son cortège de baraques, de manèges et de balançoires et son accompagnement de flonflons. Au son d'un orgue de Barbarie et à la grande joie des enfants, les chevaux de bois tournaient, entraînés par un cheval, celui-ci en chair et en os.
Pour s'en retourner, bêtes et gens étaient parés d'éventails et de mir li tons multicolores, et au collier des chevaux les grelots tintaient joyeusement. Avec la foire de Saint-Laurent, c'était la belle saison qui tirait vers sa fin, et la Joie de la fête qui cédait le pas au recueillement d'un long hiver sans radio ni télévision.
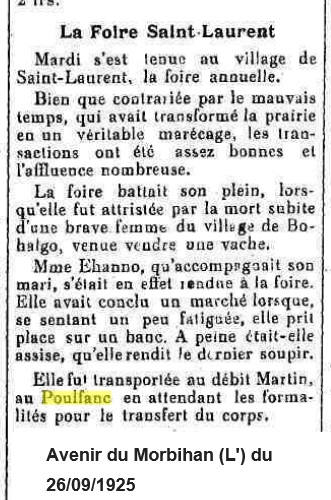
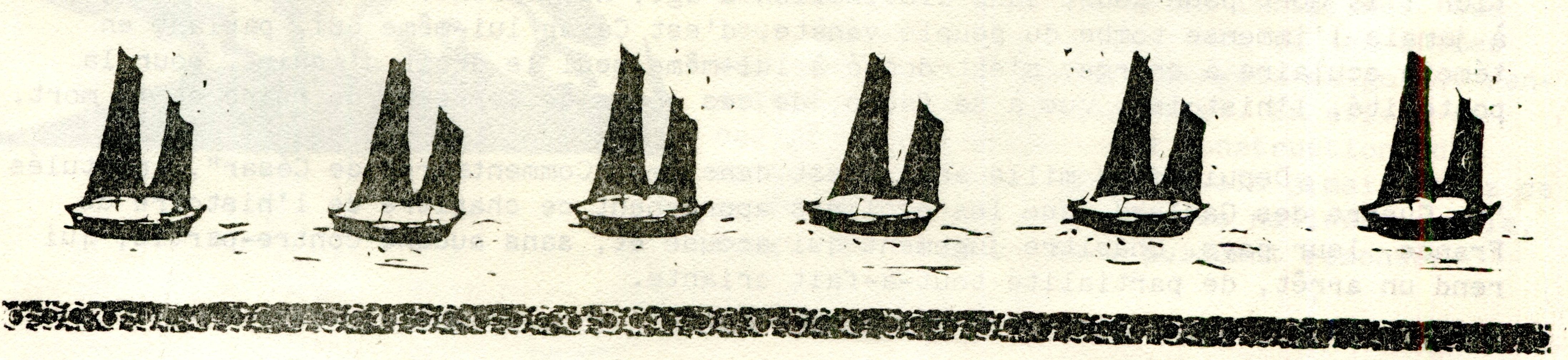
Jospeh LE ROCH, recteur médiatique de Séné
Joseph LE ROCH
30/06/1923 Baud - 18/01/1988 Vannes
Recteur de Séné 1968-1980

Joseph Albert LE ROCH était natif de Baud. Il fut ordonné prêtre le 30 juin 1947 à Vannes par Monseigneur Le Bellec. Il était titulaire d'un baccalauréat Lettres & Philisophie. Il débute sa vie d'écclésiastique comme vicaire instituteur à Plescop où il est nommé dès le 18/10/1947. Il devient recteur de l'ïle d'Arz, le 28 août 1966, avant de de prendre la tête de la paroisse de Séné le 20 septembre 1968.
En 1976, sous son magistère, fut entrepris la restauration des vitraux de l'église Saint-Patern (lire article). Le 25 juillet 1980, après 12 ans passés à Séné, il est muté à Le Tour du Parc. Il décède à Vannes le 18 janvier 1988, à l'âge de 65 ans.
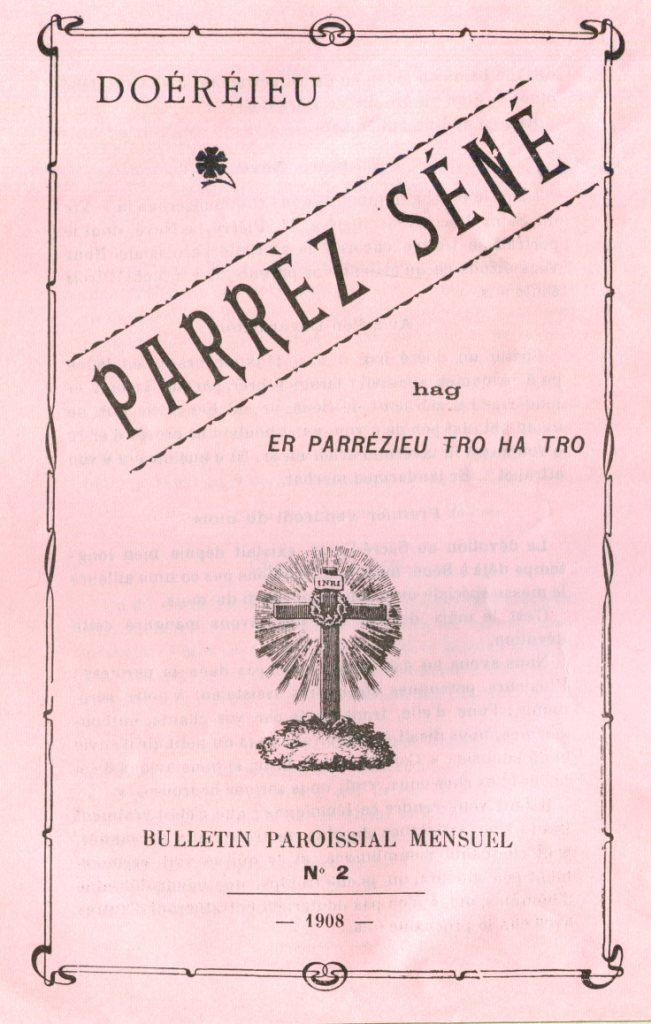
Joseph LE ROCH a laissé un fort souvenir dans notre parroisse. La commune disposait d'un bulletin paroissial dont le tout premier exemplaire date de de janvier 1908.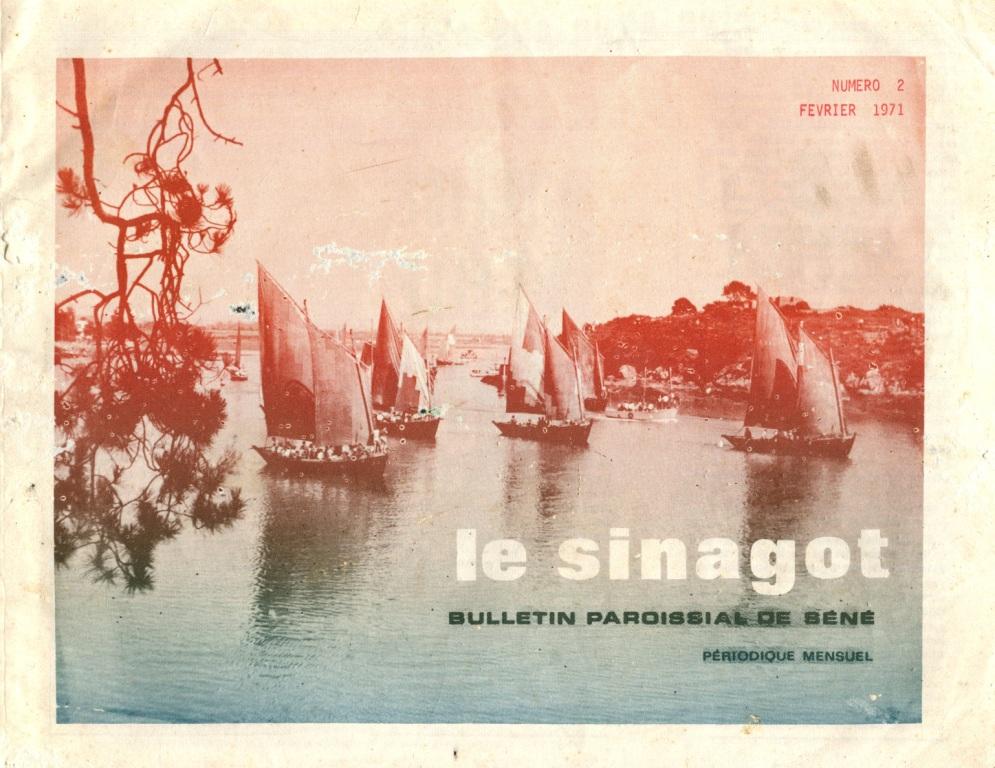
Dès sa prise de foncion il relance le bulletin paroissial. En janvier 1971, il refait une nouvelle maquette, d'abord au format A4 paysage puis sous un format portrait. Chaque année, il prenait soin de changer la couverture du mensuel. Fort d'un atelier de photocopies au sein même du presbytère, il était devenu, en marge de son activité de prêtre, "imprimeur, rédacteur, gérant" un 'auto-entrepreneur', rédacteur en chef du mensuel "Le Sinagot", véritable "organe de presse local".
Fort d'un atelier de photocopies au sein même du presbytère, il était devenu, en marge de son activité de prêtre, "imprimeur, rédacteur, gérant" un 'auto-entrepreneur', rédacteur en chef du mensuel "Le Sinagot", véritable "organe de presse local".
A côté de pages consacrées à la vie religieuse de la paroisse, il faisait vivre le carnet paroissial avec de belles photos de baptêmes et de mariages et ne manquait pas d'insérer des pages consacrées aux activités sportives à Séné, aux associations, AVLEJ de Mousérian, Club Vermeil et aux multiples pélérinages ou excursions de ses paroissiens. Il "couvrait" les événement locaux tels les kermesses ou les courses à Cano. Il voulait toucher, tel un bon pasteur, un grand nombre des habitants de Séné au travers de sa publication. Il savait aussi écrire des "petites nouvelles brèves de chez nous", petites anecdotes sur la vie sinagotes. "Page rétro", mots-croisées et dessins humoristiques "à la Jacques Faisant" agrémentaient son bulletin. A l'écoute de la population, il savait réaliser des articles sur des personnalités locales, sur la sociologie des Sinagots, notamment les marins qu'il affectionnait et pour lesquels il "baptisait"' leur bateau. Il réalisa un très beau portrait de Jean Marie LE GUIL, dit P'tit Jean ou de l'institutrice Mlle Marguerite. L'abbé Le Roch mettait à la porté de tous, la richesse de l'histoire de notre commune. Ces articles sur la "Bataille des Vénètes" et sur l'histoire de Séné furent réunis dans un seul polycopié. Wiki-sene reproduit dans ces pages leur contenu.
En introduction à ce polycopié voilà ce qu'écrivait Joseph LE ROCH " Sous le titre, "LE SINAGOT" va reprendre durant toute cette année et les années suivantes, l'étude du Pays Sinagot parue dans les bulletins paroissiaux à partir du mois de novembre 1968...en tenant compte autant que possible des modifications survenues depuis ces 8 dernières années...Cela permettra aux 720 abonnées (410 en 1968) de connaître Séné - son Histoire et ses histoires, sa population, sa vie...Merci à tous ceux qui pourraient nous fournir documents et photos (même anciennes) sur notre pays sinagot !"

Quelques mois avant sa mutation pour la paroisse de Le Tour du Parc, il réussit l'exploit de convier la télévision régionale en juin 1980, à l'époque FR3 et Antenne 2 pour un reportage en couleur, et en version originale breton, - qu'il parlait parfaitement - sur les derniers pêcheurs sinagots.
Ethnologue, journaliste, prêtre, il avait gardé de ses études de lettres et de philosphie une "bonne plume", utile à la rédaction de ses homélies et de ses articles de presse. Il était le premier historien local de Séné, une référence et une source d'inspiration pour les suivants.
Les marins sinagots à la TV, 1980
Au printemps de 1980, le dynamique abbé Joseph LE ROCH réussit à faire venir la télévision à Séné pour réaliser un reportage sur les derniers sinagos. Le film de 23 mn, intitulé, SINAGO BOTEU PLAD E LAK E VERH DE RUANNAD", réalisé par Franco Calafuri et Alain Bienvenu, fut diffusé deux fois sur les chaines nationales Antenne2 et FR3 e, juin 1980. Il annonça l'événement dans le bulletins paroissial et fit après sa diffusion un débreiffing de cet diffusion. Le reportage comportait des prises de vues extérieures sur la Golfe du Morbihan et des interviews au café de Bellevue de vieux marins de Séné auxquels s'était jointe Ernestine MORICE.

 SENE au petit écran
SENE au petit écran 
Dans le dernier Bulletin, nous vous annoncions une prochaine émission, sur FR3, devant relater en 23 minutes un aperçu sur la vie des marins sinagots ... Les prises de vue sont terminées. A vous, chers lecteurs, d'être à vos postes un de ces samedis sur FR3, à 13 H 30 ... Titre de l'émission : "BREIZ O VEVA" ... Cette même émission sera retransmise sur ANTENNE 2 , mais à une date que nous ne pouvons vous donner aujourd'hui. Consultez donc les programmes sur les journaux de fin Avril ou début Mai ... Voici le texte que vous entendrez (nous y avons mis en regard sa traduction).

Ni zo aman è Siné, anuèt Sénac én amzer goh; chetu perag é vé groeit "Sinagiz" ag en dud e chom énni; hag er gir-se en des reit "Sinagots" è galleg er hornad.
Nous sommes ici à Séné, qui s'appelait autrefois Sénac. Les habitants se sont donc appelés les "Sénageu", mot qui a donné les "Sinagots".
A viskoah, Sinagiz e zo bet "tud¬er mor" , én arbenn ag o hornad douar boud gozig gronnet ged en deur é penn pellan er Mor Bihan étré stér Gwéned hag hani Noaleù. Boud int bet a viskoah MORAERION ha PESKETERION, rag aveid biùein ha desaù liéz mat ur famill stank, é vezé red grons kavouid àr en tachad er bouéd rekiz. Ha mor Gwéned ( anùet breman er Mor Bihan) e oé sanset tad magér en dud-man. Betaf nandeg kant daou ha hanterkant (1952), Sinagiz o doé bageu-pesketa dishanval braz doh ré ar mor braz, hag e vezé anùet "sinagot" é galleg. Ur bamm o gwélet ken plomm àr en deur ! Groeit e oent ged koed derù, liùet liésan ged goultron du ; ha ged bihan deur édanté, é hellent heb riskl erbed douarein mem àr er lizeù. O gouélieù e oé karré a getan; met goudé, éh es bet chanjet er blein anehé, hag er stumm kaèr-sé on-es ni anaùet. Gwéharall, éh oé groeid er gouélieu ged krohen-loned tenaù, hag arlerh ged liénkrenn tiù, a liù ru. Hag er besketerion en-em anaué étrézé a ziabell àr èr mor doh liù en daboneù gouriet arnehé.
Les Sinagots, de tous temps, se sont tournés vers la mer : le découpage des côtes, la situation de Séné au fond du Golfe, entre la Rivière de Vannes et celle de Noyalo l'y prédestinaient. Toujours, les Sinagots ont été un peuple de marins, de pêcheurs. Pour vivre, bien souvent pour survivre, pour nourrir une famille nombreuse, il fallait bien tirer sa nourriture de ce que l'on trouvait sur place. Et ici, c'est la mer, la petite mer, c'est-à- dire le Mor Bihan, le Golfe. Pour pêcher, on utilisait jusqu'en 1952 un bateau typique le "Sinagot". C'était un bateau qui tenait admirablement la mer. Sa coque en chêne, construite autour d'un solide carénage et peinte généralement au col tar noir, exigeait peu de profondeur dans les eaux du Golfe, et lui permettait même de s'échouer sur les vasières sans aucun risque. Leurs voiles, carrées pendant longemps ont vu leur forme modifiée au sommet, et ont pris la belle allure que nous avons connue. D'abord en peau souple, elles furent ensuite taillées dans une toile solide, teintée en rouge,...et la plupart du temps, les pêcheurs se reconnaissaient sur le Golfe aux pièces rapportées et cousues, mais de couleurs plus ou moins foncées.
Boud e oé é nandeg kant seih ha daou uigent (1947) naù bag "sinagot" ha daouuigent. Ni bé chonj anehé er "Vas-Y-Petit Mousse", er "Sans-Gêne", er "Brér¬Bras". En tri ré devéhan : "Vers le Destin", "Mon Idée", "Rouget de l'Isle" e zo bet disarmet è nan dek kant tri ha tri uigent (1963). En devéhan é labourat e zo bet er "Pauvre de nous". Ne chom mui hiniù nameit tri, gloestret d'er plaisans, ha gellein e hrér ou guélet é porh Gwened.
En 1947, on comptait 49 sinagots, et leurs noms sont encore dans nos mémoires le"Vas-y-Petit¬Mousse", le "Sans-Gêne", le "Bér¬Bras". Les trois derniers sinagots: "Vers le Destin", "Mon Idée", "Rouget de l'Isle" ont été désarmés en 1963...et le dernier armé a été le"Pauvre de nous". Actuellement, il n'en reste plus que trois, armés "en plaisance"...On peut les voir au port de Vannes.
Ha boud éma bageu sort-sé e zo bet distrujet dré en tan ged Jul Cézar ér blé huéh ha hantér kant (56) éraok Jézuz¬Krist, dirag gouriniz er Ruiz??? Perchans ya, mar krédam ataù er péh en-des éan skriuet dem a zivoud en emgann-sé én é lèvr "De bello gallico". Bageu Siné e oé bageu dré lién, a pe gerhé ré er Romaned ged ruâneu Ha chetu ma arsavas en avél én un taol. Ne oé ket bet diéz d'er Romaned dispenn ha trohein ged felhiér hir fardaj bageù gwénédiz.
Est-ce que ces bateaux sinagots ont fait partie de la flotte que les trirèmes de Jules César a exterminée par le feu en 56 avant J.C, au large de la presqu'île de Rhuys?? Sans doute que oui, si l'on en croit Jules César lui-même qui a relaté son forfait dans son livre "Commentaires sur la Guerre des Gaules". Le vent était indispensable aux bateaux sinagots pour manoeuvrer...Mais le vent tomba, et les bateaux à rames des Romains n'eurent pas beaucoup de peine à couper, à l'aide de longues faux, le gréement de nos bateaux à voiles.
En avél .... Henneh e zo bet berped en dra rekisan de vageu Siné. Met arlerh er brezel devéhan, chetu deit er rnoteurieu. Achiù geté er bageu dré lién. Ar o lerh érna deit "pinassenneu", de lared é pikol tignoleù é sturnm ur V, seih-naù metr a hirded dehé. E nandeg kant daoù ha hantér kant (1952) é en des er bag "Ca me suffit" kernéret léh er "sinagot" dré lién "Ca me va" ... Ha houdé uigent vlé, ur hant pinassen bennag e zo bet lakeit é servij àr mor bihan Gwéned ; ha mé me-unan, a houdé daouzeg vlé, m'em es benniget ur pemzeg bennag anehé.
Le vent...Il a été toujours l'élément essentiel pour le bateau à pêche sinagot. Mais quand le moteur est apparu vers les années d'après guerre, le bateau à voile a été remplacé par des "pinasses": grosses plates en V de 7 à 9 mètres de long...C'est en 1952 que le bateau à moteur "Ça me suffit" a pris la relève du sinagot à voile "Ça me va". Depuis 20 ans, une centaine de bateaux-plates, en V ont été mis en service dans le Golfe du Morbihan, et moi-même, depuis 1968, j'en ai bien "baptisé" une quinzaine.
D'er prantad-sé, ur hart ag en dud e viùé diar er pesketereh pé en istr, ha kernentrall e labouré àr er lestri-komers pé er lestri-pétrol. Bihanneit mad endes breman en nivér anehé, ha nen des mui nameid tri-huéh tri uigent (78) a dud enskrivet àr roll en "dud a vor". Memès tra aveid er besketerion: deit int ur lodenn vihan ag er barrez. Ne faot ket bout souéhet a gement-sé, pe huélam tud ag en Argoed é toned de chorn ér gumun a gandeù. Pesketerion Siné e ya dré rah er Mor bihan ha betag iniz Houad, er Gerveur, Kiberén, de dapoud er pesked ged ur roued braz anùet "chalut" e stleijant àr o lerh. Lakat e hrant hoah kavelleù a gandeù eit tap morgad d'en nevé-han, ha de gourseù zo éh ant tré betag fardell Arzal de besketa silied bihan anùet "civelle". Lod kaer hoah e cherr en istr ged ravanelleù, eid o desaù arlerh én o farkeù-istr.
A ce moment, le quart de l apopulation vivait de la pêche et de l'ostréiculture, tandis que la même proportiuon naviguait sur les bateaux de commerce et les pétroliers. Maintenant, ce pourcentage est très inférieur, et on compte 78 inscrits maritimes. Lès pêcheurs sinagots sont devenus minoritaires dans la commune, d'autant plus qu'il y a eu un très grand apport de morbihannais de l'intérieur du département. Les marins-pêcheurs parcourent tout le Golfe et vont jusqu'à Houat, Belle-Ile, Quiberon. Ils utilisent le filet droit", c'est-à-dire le chalut. Ils posent également leurs casiers par centaines pour les "morgates" au printemps. Certains mois, de nuit, ils se rendent à Arzal, à l'embouchure de la Vilaine pour pêcher la "civelle". Un grand nombre enfin font la drague de l'huître et pratiquent l'ostréiculture.

Rag é Siné, gwazd ha mouézi, rah en dud e labour. Laret e vé
"Sinago boteù plad"
"e lak é verh de ruanad".
Gwir é. Ar lehidégi, er lennvor, étré Bouéd ha Bouédig, é Billerbon, é Monsarrag, hui o gwél, mouézi Siné é toug ur ré boteù iskiz: diw blankenn staget doh o zreid ged lérenneù, chetu "boteù-planch". Grés dehé, é hellant mont ha dont a dreuz er fang-mor de cherrér bélured ha kregad a ben sort, trawalh d' ober ur pred a féson. Ha bét sur: na Jorjet, na Poled pé Mari, pe za ur benérad geté, hâni ne ankouéha ou ferson. Epad en amzér-sé, er wazed e vé àr vor ...
Car tout le monde, hommes et femmes travailent à Séné et il y a un dicton qui dit : "Le Sinaqot à sabots plats" "Met sa fille aux avirons".
Oui, sur l'immense vasière du Golfe, entre Boëde et Boëdic, à Billerbon, à Montsarrac, les femmes de Séné portent une curieuse paire de chaussures deux planchettes avec des lanières de cuir, ce sont les "boteu-planches" qui leur permettent de parcourir les vasières à la recherche des palourdes, et de faire souvent ainsi de bonnes "godailles", et aucune d'elles, ni Paulette, ni Georgette, ni Marie n'oublie leur recteur, quand elle a fait une bonne pêche. Pendant ce temps, les hommes vont au large.

Boud e oé kant peder (104) bag é nandek kant dek ha tri-uigent (1970). E nandek kant tri-huéh ha tri-uigent (1978) ne chomé mui meid hanter kant (50) . Kalz a besketerion e zo bet red dehé, ged ké, klask ur labour bennag arall é uzinieù Gwéned pé ér Prad. Ur rézon e zo de gement-sé: priz er pesked ne des ket heuliet priz er vuhé, hag er pesketour n'hell ket mui biùein ken éz él agent. 0hpenn, en artizanted¬mor o devé poén braz é kaoud ur blank bennag a berh er Stad ; henne e zisko boud berped pih eid dakor presteù argand dehé a p' o des dobér. Er lézenneù a vrenan zo groeit kentoh eid rein harp à' er vistri-pesketerion, er ré e bieù bageu brasoh eid deuzek mètr. Met chetu: ne vé ket mui kavet hâni kin a ré sort-sé é Siné ... ! ! !
Anaù e hret breman bro Siné ... ,buhé en dud a Siné. Dèit d'on gwélet pe gareet ... N'ho-po ket ké ... Un dégemér ag er gwelan e vo groeit deoh ...
En 1970, il y avait 104 bateaux de pêche à Séné... En 1978, it n'y en avait plus que 50. Vous voyez que, si dans les années 65/70 on a construit beaucoup de pinasses, leur nombre a bien baissé, et nombre de pêcheurs, à contre-coeur, ont dû prendre un travail dans les usines de Vannes ou au Prat. Ceci vient du fait que le prix du poisson n'a pas suivi la hausse du coût de la vie, ce qui a entraîné une baisse du pouvoir d'achat du Pêcheur. De plus, les pouvoirs publics ne viennent pas, ou peu, en aide aux petits pêcheurs et n'accordent des crédits qu'aux patrons-pêcheurs, propriétaires de bateaux de plus de 12mètres, que l'on ne trouve pratiquement pas à Séné. Voilà Séné...Voilà la vie des Sinagots...Venez nous voir...Vous ne le regretterez pas!!
Voici la liste des 49 sinagots qui naviguaient à Séné en 1947
"Vengeur du Trépas" - "Jeune Chanto"- Petit Vincent" - "Les Trois Frères"¬-"Ca me regarde" - "Le Coq du Village"- -"Gracieuse" - "Patrie" - "Soyons amis" - "Vas-Y-P'tit Mousse" - "Jeune Alice" - "Coureur des Côtes" - "Aviateur Le Brix" - "Jean et Janine" --"La Déesse des Flots - "Voe Victis"- -"Ca me va" - "J.M.J.P." - "Méfie-Toi" - " Sans-Gène" - "Joseph et Thérèse" - " Vainqueur des Jaloux"¬-"Fleur de Printemps" - " Renée-Marguerite" - "Saint-Jacques" - "Avenir du Pêcheur" - " Vers Le Destin" -"L'Yser" - " Léonie Ma Chère" "Jeune Odette" - "Ma Préférée" - "Marguerite" -"On les aura" -" Capricieuse" -" Léonor et Marianne" -"Jouet des Flots" -" Brér bras" -"L'Idée de mon Père" - "Souviens-Toi" -" Aventure" -" Souvenir de Jeunesse" - "Mon idée" -"Cours Après"-"Va de Bon Coeur"- "Célestin et Louis"-"Pierre et Marie"-Le Drapeau de la Mer"--"Pauvre de Nous (le dernier armé) Pierre et Louis"-- ...
Une suggestion à l 'intention de nos édiles qui réclament des propositions lorsqu'il s'agit de donner des noms aux nouvelles rues du quartier marin de Séné : Pourquoi ne pas donner à ces rues les noms de ces ancien sinagots .. Cela serait sûrement préférable à ces noms passe-partout que l 'on constate atuellement ici où là ? ?
Dernière heure : Cette émission de FR3 passera sur l'antenne début JUIN (sous toutes réserves). Nous vous tiendrons au courant
Après la diffusion de ce reportage, l'abbé Le Roch publie dans le bulletin paroissial ce texte agrémenté de capture d'écran ici reproduite avec autant de fidélité que possible et en couleur.
APRES LE PASSAGE DES SINAGOTS à L'ANTENNE
C'est le samedi 21 Juin sur FR3 à 13 Hres et le mercredi 25 Juin sur Anbtenne 2 à 11Hres30 que nous avons pu regarder l'émission "SINAGO BOTEU PLAD E LAK E VERH DE RUANNAD", émission de Franco Calafuri et d'Alain Bienvenu.

Pierre Louis CADERO
Ce passage au petit écran a plu d'emblée à tous, aux "acteurs" comme aux spectateurs. Le montage
des séquences a peut-être surpris, mais avouons que c'était parfait comme réalisation, d'autant plus que les couleurs du film (le rouge et le noir des bateaux sinagots, le bleu du ciel, l'aspect verdâtre dé l'eau, du Golfe, le jaune des cirés de nos marins, les lumineuses couleurs des vitraux de l'église, .. Etc .. ) étaient bien rendues, et que le tout était projeté sur fond musical "envoûtant" ( Eh oui ! près de 25 personnes nous ont demandé le disque il s'agit de l'Opéra Sauvage" de Frédéric Rossif, disque que l'on trouve à Vannes ).
Après un exposé fait par un marin du Bono, exposé qui nous a permis de mieux saisir les différences ( barre, tirant d'eau, roof, voiles ) entre le "forban" (bateau du Bono) et le Sinagot (bateau de Séné), nous avons pu suivre les conversations, au Café René JACOB de Bellevue, savoureusement locales entre Pierre MIRAN, René JACOB [13/8/1924-12/5/2016] , Pierre-Louis CADERO [23/05/1904-30/03/1980], Louis LE FRANC, dit"MOUSSE" (tous les deux décédés depuis ( hèlas!) Jean Marie LE GUIL [16/2/1903-20/8/1983] dit P'tit JEAN, Jean DANET, Patern GREGAM et Ernestine MORICE [9/11/1909-24/10/1999] { me garikel ! hiniù en dé !).

Joseph LE FRANC
Nous avons été les témoins des évolutions du "VAINQUEUR DES JALOUX" au large de Lerne, avec, à la barre, Henri LE FRANC, et comme matelots, Théo RIO, Emile NOBLANC, M.Georges RIDEAU des Scouts Marins. (N.B.= Le "Vainqueur des Jaloux" était gréé ce jour-là avec les voiles du Nicolas-Benoit).
Nous avons apprécié la beauté, la poésie de la complainte de ' "ER VORAERION" (LES MARINS) de Jean-
Pierre CALLOC 'H, chantée et accompagnée à la harpe celtique ( nous reproduisons plus loin cette complainte en compagnie de nos pêcheuses de palourdes déjà citèes ici en Mai, par Dominique GICQUEL, de Bézidel...

Jean-Marie-LE GUIL, dit P'tit Jean, passeur en retraite et René JACOB, patron du café La Bellevue
Puis ç'a été la scène de NINI, avec sa carte postale près de l'église, celle de Mr. le Recteur dans son "Vatican", ... tout ce monde voulant nous faire revivre les merveilleuses années de vie (ou mieux ... de"survie") des marins-pêcheurs des années - 30-40 à Séné. L'émission finissait par quelques séquences tirées du film relatant, en couleurs, les dernières régates des Sinagots en 1952 (Ah, "LI K" !, Ah, 27 Bateaux !) ... Une des photos de ce film est reproduite par la couverture de ce Bulletin ... BRAVO! Chacun a pris un grand plaisir à voir son pays ... Evidemment, on y parlait breton .. Mais ! ... mais, .. cela prouve qu'on parle encore (trop peu !) ce breton chez nous, la preuve ... ! .... cela prouve que, sur le plan culturel, nous avons un atout supplémentaire (qui voudrait nous le reprocher?)...ignoré des autres! (tant mieux pour nous! dommage pour les autres ! )... cela prouve que si la Télé, bien souvent, trop souvent! ... ,nous propose des émissions où l'on entend parler ou chanter uniquement dans une langue étrangère, ( et cela ... pendants des heures d'affilée cette Télé est aussi capable de faire du bon travail, et du TRAVAIL INTERESSANT (= c'est-à-dire qui nous intéresse ) .. et que pendant une petite demi-heure (c'est notre reproche que faisons aux responsables...Hélas .. ils n'y sont pour rien!)le "petit écran" est capable de nous redonner un moment de fierté à voir LE PAYS SINAGOT et les SINAGOTS !

Pierre MIRAN
NOUS VOULONS AJOUTER QUE:
-1-Les Eclaireurs de France de Vannes, dans le cadre de l'année du Patrimoine, ont été retenus pour reconstruire un sinagot .. La construction de ce bateau est commencée au chantier du GUIR à l'Ile-aux-Moines. Sa mise à l'eau est prévue pour fin Octobre.
-2-L' émission a été magnétoscopée ainsi, les personnes qui le désirent peuvent la revoir ... S'adresser
à M. le Recteur (2 conditions avoir un poste-télé couleurs et un appareil émetteur (qu'on peut louer) s'appelant magnétoscope.
-3-Cette émission passe oendant tout l'été dans le cadre de l'exposition sur le Golfe à la Cohue à Vannes(face à la Cathédrale
-4-Des copies du film des Régates de 1952 se trouvent au Presbytère (films en couleurs 16 m/m muet).
Marguerite LAYEC, institutrice dévouée
Cet article reproduit mot pour mot la nécrologie de Marguerite LAYEC [ 7/2/1907 St Gildas - 2/9/1977 Vannes], parue dans le bulletin paroissial de Séné, à l'initiative de l'Abbé Jospeh LE ROCH.
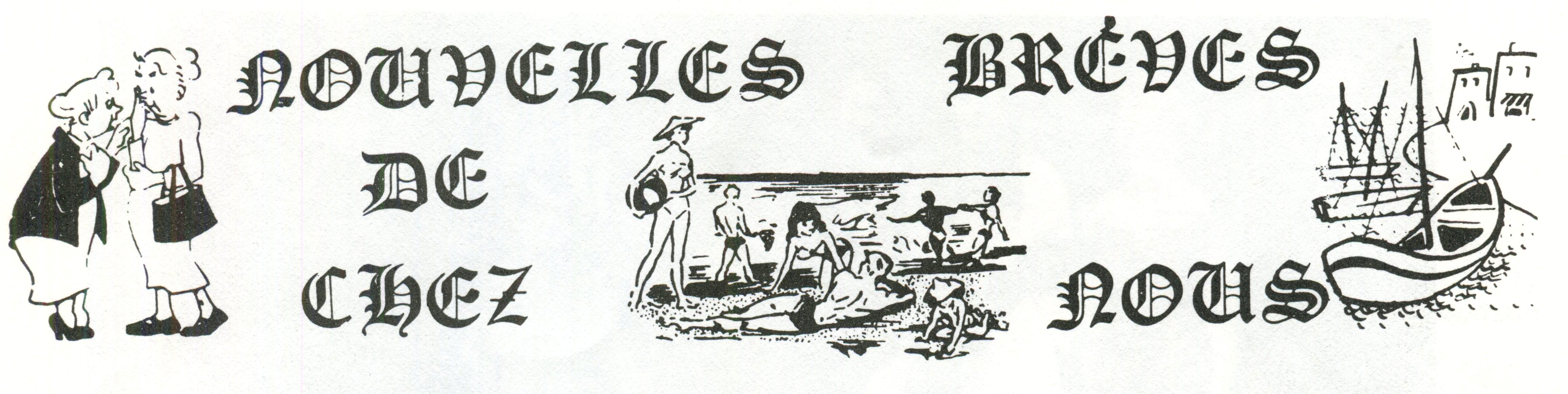
2 SEPTEMBRE : DÉCÈS DE MLLE MARGUERITE LAYEC, ENSEIGNANTE A KERANNA, CATÉCHISTE ET ORGANISTE DANS LA PAROISSE DE SENE DEPUIS 1930.
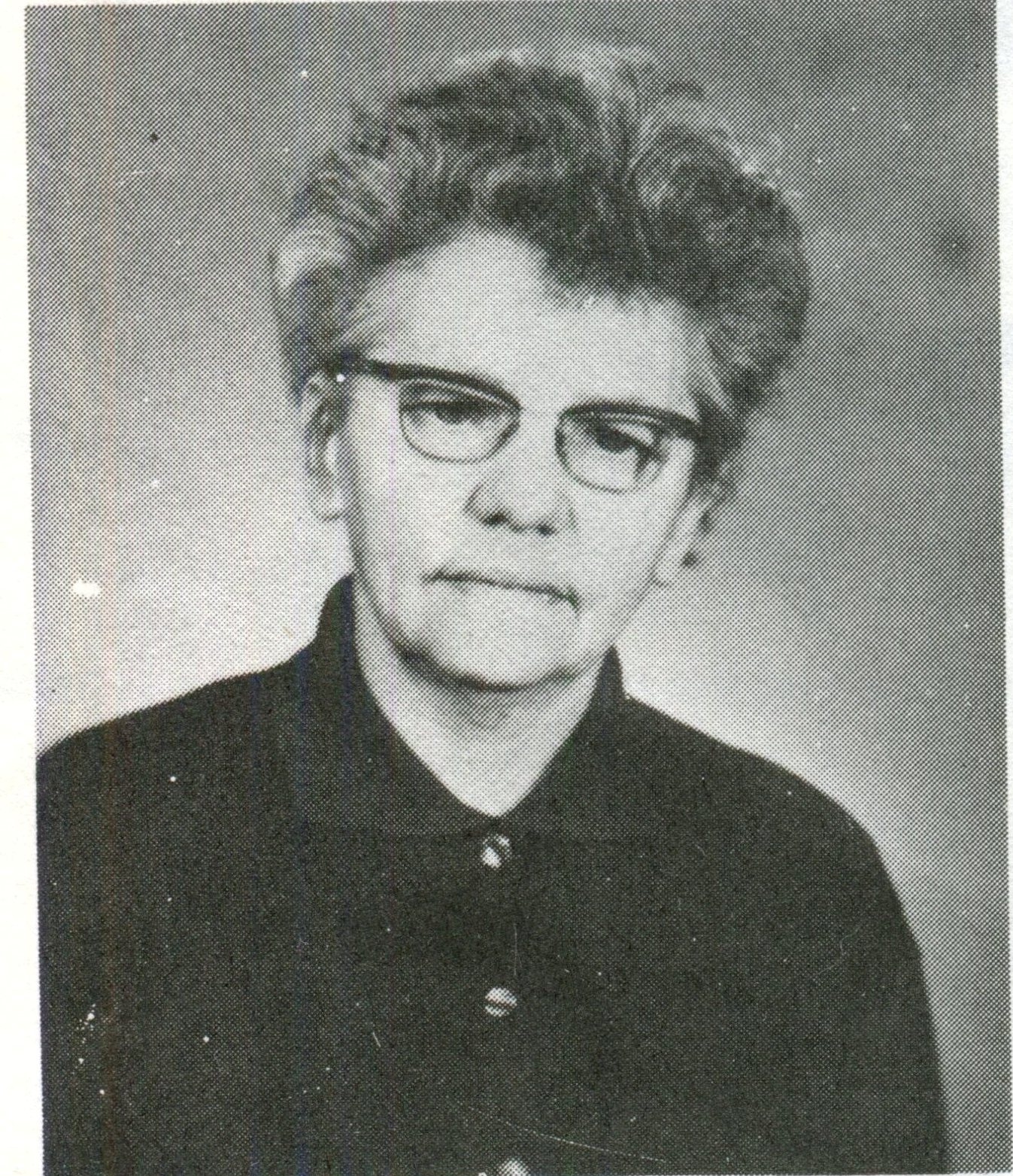
Après un mois seulement de maladie, s'éteignait une figure bien chère à toutes les familles de SÉNÉ: Mlle MARGUERITE LAYEC, enseignante à l'école de KERANNA de septembre 1930 à juillet 1973, catéchiste en 1974 et 1975, organiste à l'église jusqu'au 30 juillet dernier. Très nombreux, les Sinagots, jeunes et anciens (3 générations) se sont relayés pendant près de 3 jours à l'oratoire près du presbytère, pour veiller sur celle qui les éduqua pendant de si longues années. Une foule, celle que l'on retrouve au jour de la Toussaint, a voulu l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, au cimetière même de SÉNÉ. Dans son homélie, Monsieur le Recteur s'est essayé de retracer la vie si remplie de Melle MARGUERITE.
Pierre disait à JESUS : "Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre"; JESUS lui répondit : "En vérité, je vous le dis : personne n'aura quitté, à cause de moi et de l'Evangile une maison, une famille sans qu'il reçoive déjà le centuple en sa vie et, dans le monde à venir, la vie éternelle. " Mes Frères, à voir votre très nombreuse assistance autour du corps de Melle MARGUERITE, n'est-ce pas cette parole du CHRIST réalisée aujourd'hui à SÉNÉ? C'est en effet la très grande famille de ses amis, de ses anciens et anciennes élèves, réunis autour de sa famille propre, une très grande famille qui continue aujourd'hui à l'entourer, comme elle l'a toujours fait depuis tant et tant d'années, et qui est là pour demander au SEIGNEUR, que Melle MARGUERITE reçoive cette récompense, assurément méritée par tous les vrais disciples qui ont mis leur vie au service du CHRIST dans leurs frères. Cette récompense ici-bas, de vivre longtemps, ensemble, et , un jour, la Vie Eternelle.
Vous les parents de Mlle MARGUERITE, et vous, chers paroissiens de SÉNÉ, ses nombreux amis et ses anciennes élèves de l'école de Kéranna, oui c'est bien l'affection, la sympathie, la reconnaissance qui vous réunit cet après-midi comme les frères et soeurs d'une grande famille, à l'occasion des oèques d'une amie de famille.
Née en février 1907 à Saint-Gildas de Rhuys, Mlle Marguerite a passé toute sa vie au service de l'enseignement chrétien. Tout d'abord institutrice à l'école de Sérent, où elle resta 5 années, c'est ici, à Séné, qu'elle consacra pour ainsi dire toute sa vie. Arrivée à Keranna en Septembre 1930 elle ne devait quitter notre école, pour prendre une retraite bien méritée, qu'en Juillet 1973.
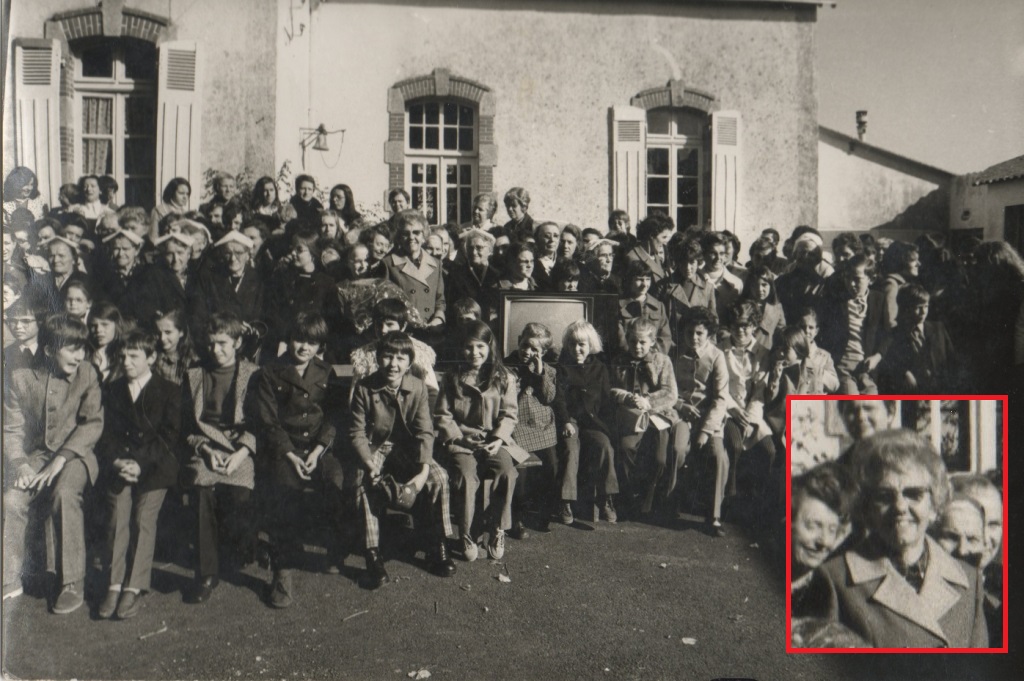
Le 21 octobre de cette année 1973, beaucoup d'entre vous étaient réunis autour d'elle dans cette église pour une messe d'actions de grâces, à l'occasion de ce dépàrt en retraite.

Et le Directeur de l'Enseignement Catholique, Mr. l'abbé MOULLAC,disait ceci :
" ...Malgré tous vos mérites, je ne vais pas, Mlle MARGUERITE, prononcer votre panégyrique [discours à la luange de quelqu'un] , votre simplicité naturelle, votre modestie seraient blessées si je m'attardais à vanter le bel exemple de fidélité de travail et de dévouement que vous donnez. La présence nombreuse de vos anciennes et anciens élèves, celle de leurs familles et de tous vos amis, leurs prières ferventes, adressées au Seigneur à toutes vos plus chères intentions, attestent suffisamment combien ils ont conscience de vous être redevables de leur éducation, et comment ils entendent vous en garder une profonde reconnaissance" .
Et après une réunion dans la joie, à l'école, Mlle MARGUERITE vous remerciait de votre reconnaissance, et elle terminait oar ces mots "A Séné j'ai vécu, à Séné je mourrai. .. "
Nous ne pensions pas que, quatre ans après, son souhait devait se réaliser : revenir parmi ses sinagots ... les rejoindre, mais à travers la mort ... et dans la prière ... et reposer enfin au milieu d'eux, au cimetière de Séné, près des prêtres, des religieux, des enseignants, (ici, je pense à quelqu'un qui, comme elle, donna le meilleur de sa vie à Séné, Mr. Aimé CAPPÉE).
A mon tour, je ne ferai pas le panégyrique de Melle MARGUERITE. Il y aurait tant à dire, non seulement pour ses 47 années données à l'enseignement chrétien, mais aussi pour tout son dévouement à la cause des jeunes, les Bruyères d'Arvor, du théâtre, du chant, de l'orgue (elle était encore à son poste, ici, le 30 juillet dernier), son dévouement à visiter les familles, les malades aussi bien chez eux qu'à l'hôpital ou dans les cliniques. Chacun de vos coeurs se remémore ce que Mlle Marguerite a fait pour son éducation chrétienne ... et cela durant trois générations. Restée fidèle à sa foi, à l'enthousiasme, à l'esprit de service de ses débuts, Melle Marguerite a eu le mérite non seulement d'avoir duré, mais aussi de n'avoir jamais dévié.

En hommage à Mlle. MARGUERITE, voici deux photos qui la rappelleront combien sa vie a été intimement mélée à celle des Sinagots. Ci-dessus à Lourdes en 1952, entourant: M. l'Abbé PERON, alors vicaire de Séné, et Mlle Marguerite :
Ier rang en haut, à partir de la gauche : Mme Lucienne PENRU, Mme LODEHO, Mme DORIDOUR, Mme Vve DORIDOUR, Mlle LE FRANC, Jean LE MEITOUR, Emile NOBLANC du Goanvert
2ème rang: Mme Pascaline DOUARIN, Mme LE RAY, Mlle Alphonsine NOBLANC, Mlle Philomène SAVARY, Mlle LAYEC, Mme Emile NOBLANC, Mme Léon GREGAM de Montsarrac
3ème rang : Soeur Sophie BARO, Mme PIERRE, Mlle MIRAN, Clothilde BOCHE, L'abbé PERON, Mme PIERRE, Mlle DORIDOUR, Mlle MIRAN, Soeur PIERRE.
Et c'est ensemble que nous prierons à cette messe pour elle ... que nous demanderons au Seigneur, par l'intermédiaire de Notre Dame, Saint Patern, Sainte Anne de nous guider comme elle, aux sentiers de vie, et de nous ouvrir un jour sa maison .
Un an plus tard, paraissait dans le bulletin paroissial cet autre article en souvenir de Mlle Marguerite :
|
SOUVENONS-NOUS ! Voici un an déjà déjà. que nous a quitté Mademoiselle LAYEC , mieux connue sous le prénon de Mlle MARGUERITE.. Parmi nous elle a vécu, connaissant et aimanttous. Son don d'elle-même aux autres dans l'enseignement, ses multiples services, ses visites aux familles sinagotes, sa présence dans le domaine musical à la paroisse lui ont valu l'estime de tous. Elle a désiré rester parmi ses Sinagots en partageant leur champ de repos éternel. Ayons parfois pour elle une pensée, une prière ou une fleur. Car, savez-vous qu'elle a dédié à tous ses amis dans les années 50, surl'air de "La Paimpolaise" ce chant, dont nous sommes les heureux héritiers, et que voici : |
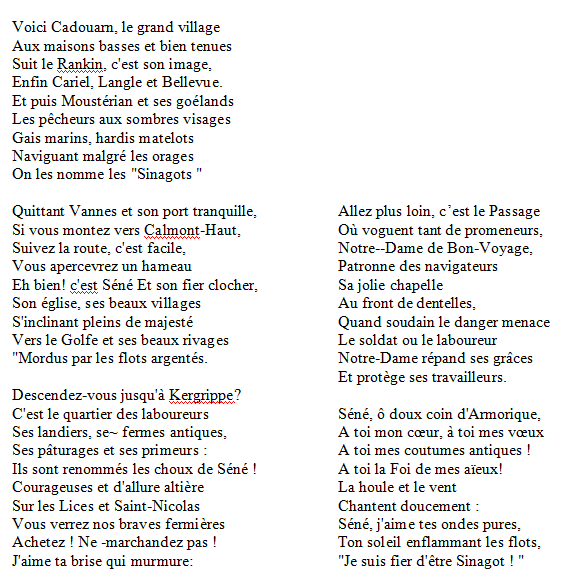
Un autre article parut à son sujet :
Marguerite Layec est née en février 1907 à Saint-Gildas de Rhuys et est morte à Vannes le 2 septembre 1977. Elle est enterrée dans le cimetière de Séné.
D'abord institutrice à Sérent pendant cinq ans, elle vint ensuite à l'école Sainte-Anne en septembre 1930 où emme restera jusqu'à sa retraite en 12/9/73 soit 43 ans. Tout en étant enseignante et catéchiste à l'école, elle assumait la fonction d'organiste de la paroisse et s'occupait des loisirs des jeunes filles. En classe où elle enseignait avec tout son savoir de pédagogue, elle apprenait aussi à ses élèves à mieux connaître Dieu, le Seigneur. Elle préparait les filles à la 1ère communion, aux processions de Fête-Dieu ou l'on jonchait le sol de pétales de fleurs. Elle apprenait également le chant aux enfants et avait formé une chorale qu'elle accompagnait à l'harmonium. Avec ses anciennes élèves devenues grandes, elle préparait des séances récréatives : rondes de petits, danses rhytmiques des moyennes, ballets et pièces de théâtre pour les autres. Le dimanche, avec les jeunes filles, elle organisait des visites pour mieux connaître la Bretagne. Les jeunes filles ont formé les Bruyères d'Arvor puis la Jeunesse Agricole Chrétienne Féminine, JACF, toujours sous la conduite de Mlle Marguerite, aidée alors par l'abbé Poëzivara. Elle rendait visite aux familles sinagotes et accueillait les nouveaux arrivants. Elle a composé "la chanson de Séné" sur l'air de la Paimpolaise et a laissé un excellent souvenir dans le coeur de plusieurs générations de Sinagots.
Le complément de wiki-sene : "Nul ne guérit de son enfance" Jean Ferrat.
L'examen de son acte de naissance recèle peut-être le "secret" de Marguerite Pauline LAYEC. Lorsqu'elle nait le 7 février 1907 à Saint-Gildas de Rhuys, elle est la fille de Marie Ernestine LAYEC, sa mère et de son père, Jean Marie Eugène QUATREVAUX [5/71877-10/11/1915], capitaine au long cours.
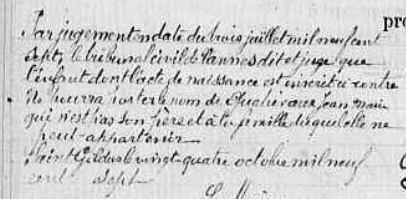
Cependant, une mention marginale indique que par un jugement du 3 juillet 1907, le Tribunal Civil de Vannes, reconnait à M. Quatrevaux, sa non-paternité sur cet enfant, né d'un adultère, sans doute était-il en mer...
Marguerite Pauline QUATREVAUX, prend dès le nom de jeune fille de sa mère, et devient Marguerite Pauline LAYEC. Sa mère divorcera et se remariera le 21/2/1911 avec Jean Louis LE TEXIER [1880-1976] dont elle aura un fils, Jean [1912-2014]. M. Jean Marie QUATREVAUX se remariera avec Jeanne Angèle DURAND le 25/8/1913 avant de disparaitre en mer en novembre 1915. Il étati à bord du vapeur Boileau au départ de Swansea avec une cargasion de charbon et à destination de Nantes. Aucun sous-marin n'a revendiqué avoir coulé le Boileau. Jean Marie Quatrevaux ne fus pas déclaré mort poour la France.
Cette identité tourmentée est sans doute à l'origine du célibat de Mlle Marguerite et de son dévouement pour les autres.
Boëdic, l'île aux jardiniers
A contrario de sa grande soeur, l'île de Boëdic n'a révelé aucun vestige de mégalithes après des fouilles.

La carte de Cassini témoigne de la présence sur Boëdic d'une chapelle.
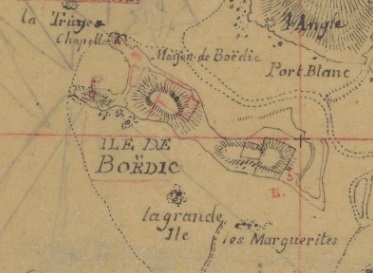
Cette vieille carte datée de 1771-1785, confirme la présence d'une chapelle à l'extrémité nord-ouest de l'île comme une "Maisson de Boëdic".
Rollando (Séné d'Hier et d'Aujourd'hui) nous dit qu'en 1655-1656, un procès est enregistré par le Présidial de Vannes [retrouver le document aux AD] pour un différent entre le sieur de Boëdic, le noble homme Rolland BONNEFOY sieur de Couedic et de Kergoual, Substitut du Procureur du Roi au siège des eaux et forêts de Vannes, et Guillaume Yhanno, au sujet de dégradations commises en la chapelle et principale maison de Boëdic, ainsi qu'au jardin de la maison. Plus tard, les terres de Boëdic appartennaient à l'abbé Ragat de Vannes (1723) puis au chevalier de Moncant (1723-1742).
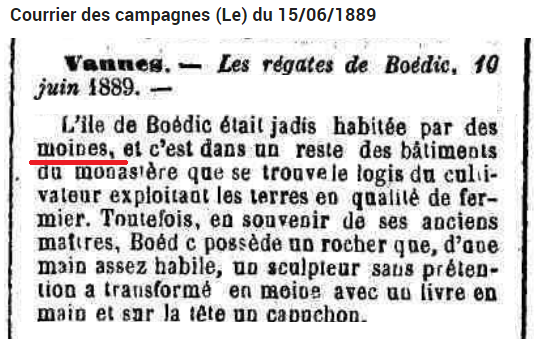
Cet article de presse, certes daté de 1889, laisse entendre au lecteur que l'île aurait abrité des moines et une petit "monastère". La présence de moines à Boëdic est donc plus que certaine avant la Révolution.
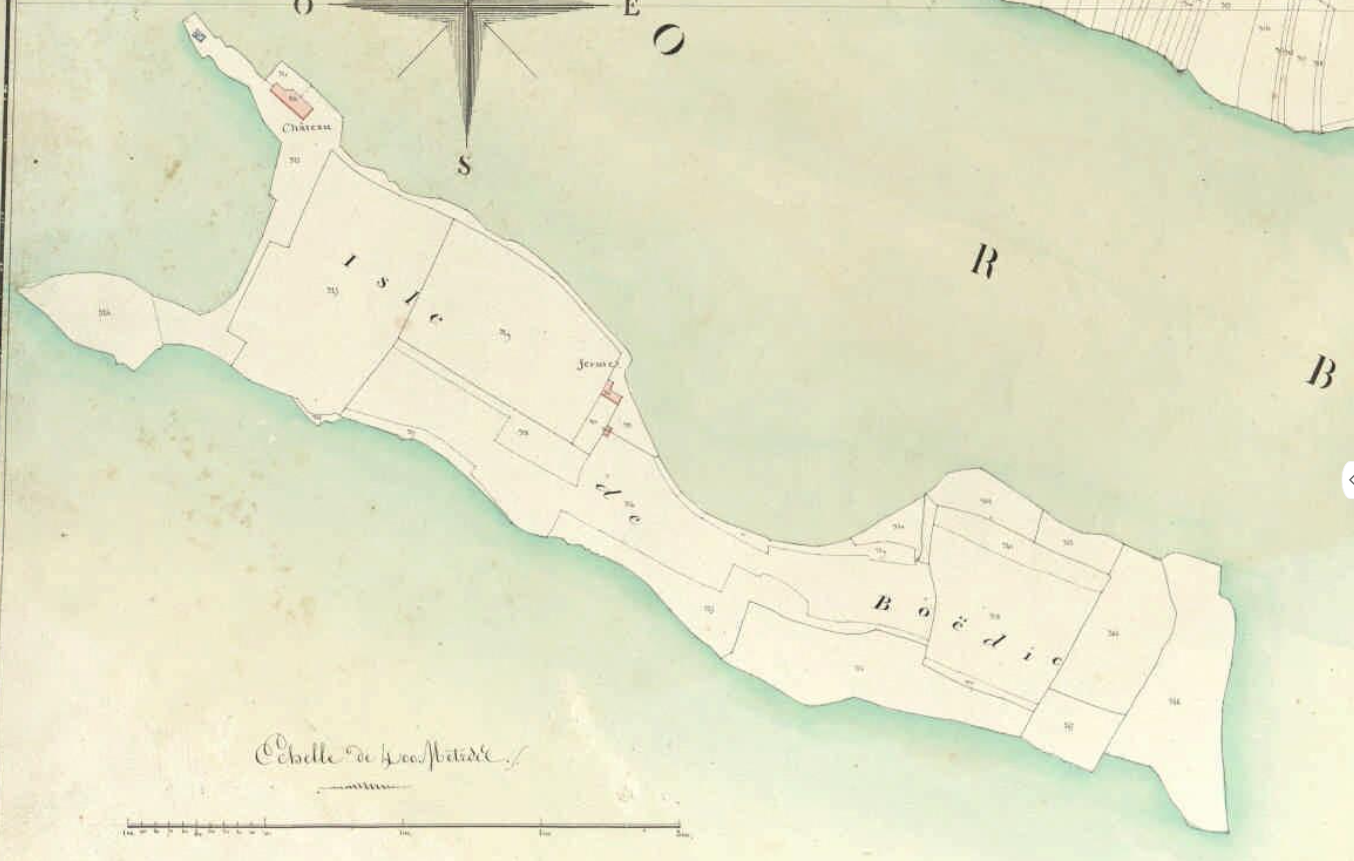
Le cadastre de 1810 ne mentionne plus la chapelle. Il semble qu'après le départ des moines, le batiment fut transformé en poste de garde des douaniers, à l'entré du goulet de Conleau, point stratégique pour guetter les bateaux allant vers le port de Vannes. Cette vieille chapelle sera dotée d'un four à pain avec une cheminée. (Lire article dédié "Petit Patrimoine). L'île compte également une belle demeure, surmontée d'une tourelle qui lui vaut le nom de château. Plus à l'est, la maison du fermier qui aurait abrité les moines.
En repassant patiemment les actes sur les registres de l'état civil, on finit par trouver une certaine Mathurine LE PORT décédée sur l'île de Boedic, le 7/06/1803. Avec l'aide de site de généalogie, on arrive à raccrocher cet enfant mort en bas âge à la famille de François LE PORT [26/9/1769 Grand Champ - 6/02/1863 Vannes] marié à Séné le 15/10/1796 avec Mathurine TATIBOUET [11/4/1777 Arradon - ??], tous deux cultivateurs sans que l'on sache si ils sont déjà établis à Boëdic. Toujours les registres, nous indiquent qu'ils auront plusieurs enfants tous nés à Boëdic : Jacques (11/5/1797), François (7/4/1799), Louise (12/4/1800) Mathurine (25/8/1802), Mathurine (7/06/1803) indiquant que sa soeur est morte en bas âge et Julien Jean (29/09/1809).
La famille LE PORTxTatibouët laisse place aux cultivateur Mathurin LE BIHAN [9/4/1781 Arradon - 11/2/1849 Arradon] et son épouse Françoise LE CALO [21/6/1781-5/03/1859 Moréac] qui met au monde un enfant, Vincent Marie [25/10/1812 Boëdic -22/02/1884 Kerguen Arradon] puis son frère Mathruin Joseph (21/1/1819) à Boëdic. Les Le Bihan restèrent sur Boëdic entre 1812 et 1820.
Le cadastre de 1844 montre tout près de la métairie un grand jardin cloisonné de 8 parcelles de terres. La douceur du climat à Boëdic explique sans doute la permance d'un jardin (potager) sur ces terres insulaires à quelques encablures du port de Vannes, attesté dès 1655 (voir c-dessus) et qui perdurera jusqu'au jardinier ROPERT (dénombrement de 1926).
Le dénombrement de 1841 nous donne le nom du jardinier, en fait une jardinière, en la personne de Mme Perrine LE CORF [20/1/1794-28/5/1876 Vannes], veuve de Jean Baptiste JEFFRO ou JEFFRAU [1803-29/7/1840 Boëdic]. Mme veuve JEFFRO, entretient le grand jardin de Mme Marie Louise Joséphine QUIFISTRE DE BAVALAN [1836-26/10/1886 Berric], (dont le père fut maire de Vannes entre 1830-32), propriétaire de l'île avec son mari oseph de GOUELLO du Timat [Bath, 22/9/1811- oct/1881 Vannes] (Source Camille Rollando). La famille JEFFRO est installée à Boëdic depuis au moins la naissance de leur fille Marie Josèphe JEFFRO [30/11/1831 Boëdic -12/11/1867 Vannes_H].(Louise le 14/2/1835).
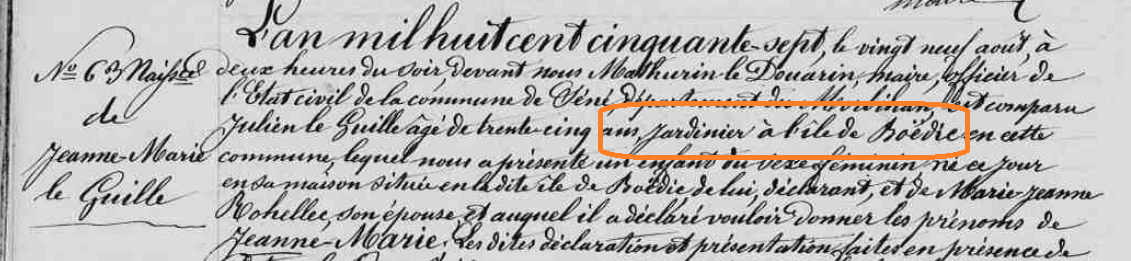
Cet acte de naissance de de Jeanne Marie LE GUILLE [21/8/1857] indique que son père Julien LE GUILL [1822-1904] et son épouse Marie Jeanne LE ROHELLEC, sont les jardieniers à Boëdic. Un autre LE GUIL, Jean Pierre était le grand-père de P'tit Jean, le passeur de Conleau [lire histoire des passeurs]
En 1863, une bande de copains érige la statue du moine Saint-Antoine. [Lire article Chronique-Petites Histoire) rappellant le passé monacal de l'île.
En 1873, la Société des Régates de Vannes organise pour la première fois une petite course autour de l'île de Boëdic le 2 juin, lundi de Pentecôte. Le programme est annoncé dans le Journal de Vannes du 24/5/1873 :
"Les canotiers vannetais remercient les souscripteurs qui se sont intéressés à leur oeuvre. Leur bienveillant concours permettra de distribuer bon nombre de prix aux vainqueurs. Des musiciens amateurs se sont gracieusement joints aux canotiers pour égayer la fête. Au programme : départ de Vannes à neuf heures, annoncé par l'artillerie des régates. Les mucisiens, placés à bord d'un des bateaux de plaisance, exécuteront à deux heures. Le retour aura lieu vers sept heures du soir. Les bateaux se formeront en ordre au Pont-Vert pour faire leur rentrée dans le port. La musique jouera. Les personnes désireuses de se rendre à Boëdic trouveront, dès neuf heures, au quai, de nombreux bateaux pour les y transporter. Les canotiers prendront à la chaussée de Roguédas, les amateurs qui voudriaent passer à Boëdic."
Les régates dites de Boëdic perdureront jusqu'aux années 1890 avant de se fondre avec celles de Conleau. (Lire articles sur l'histoire des Régates de Vannes").
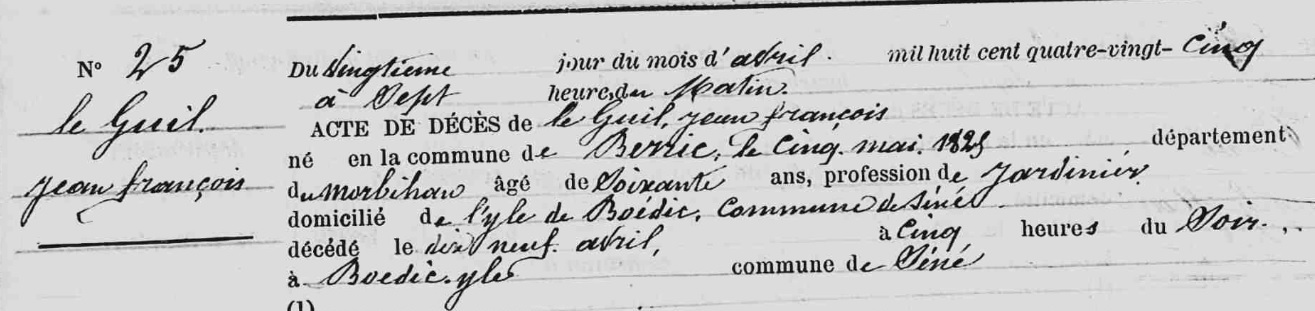
Cet extrait d'acte de décès nous indique qu'en 1885, Jean-François LE GUIL, natif de Berric est jardinier à Boëdic aux côtés de son frère Julien LE GUIL. C'est leur père François LE GUIL [1792-1865] qui est veur prendre la succession des Jeffreau comme jardinier à Boëdic.
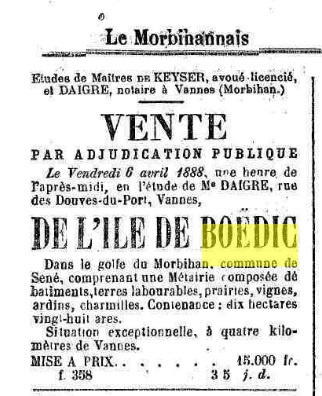
Lors de la succession des Quifistre de Bavalan, l'île de Boëdic est mise en vente en mars 1888 et sera achetée par Louis PANCKOUKE. Louis Fleury Arthur PANCKOUCKE [6/8/1831 Meudon - 23/2/1893 Paris], est éditeur de presse, dont le Journal de Vannes, petit-fils de l'éditeur de l'Encyclopédie de Didérot,. Il est aussi propriétaire du manoir de Roguédas qu'il a racheté en 1867 à la famille Avrouin-Foulon qui a fait faillite.(Lire article Faille Avrouin-Foulon). A sa mort, son fils Charles PANCKOUKE en hérite.

Cette photographie NB a l'avantage de réunir sur une seule vue, à gauche le "chateau" près de la cale de Boëdic, au centre le manoir et à droite l'ancienen chapelle, flanquée de son four à pain sur son aile nord.
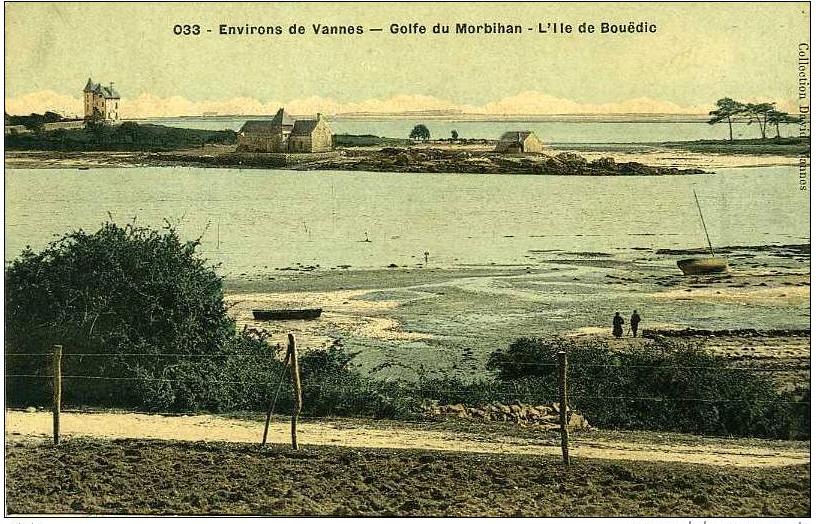
Vue de l'île de Boëdic depuis Roguedas en Arradon. Carte postale David-Vannes
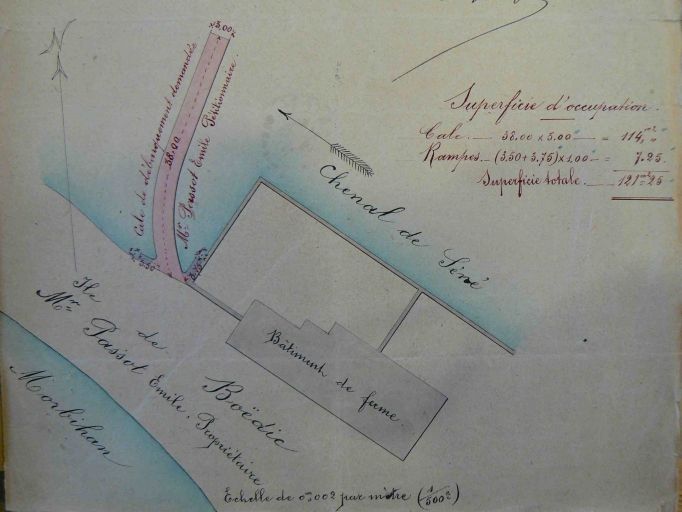
Vers 1897, la cale de Boëdic est rallongée de 2.6 m sans que l'on sache dater sa première construction. M. Passot, plus tard, y fera d'autres travaux.

La famille PANCKOUKE est à l'origine du joli manoir de Boëdic, construit avant la fin du XIX°siècle.
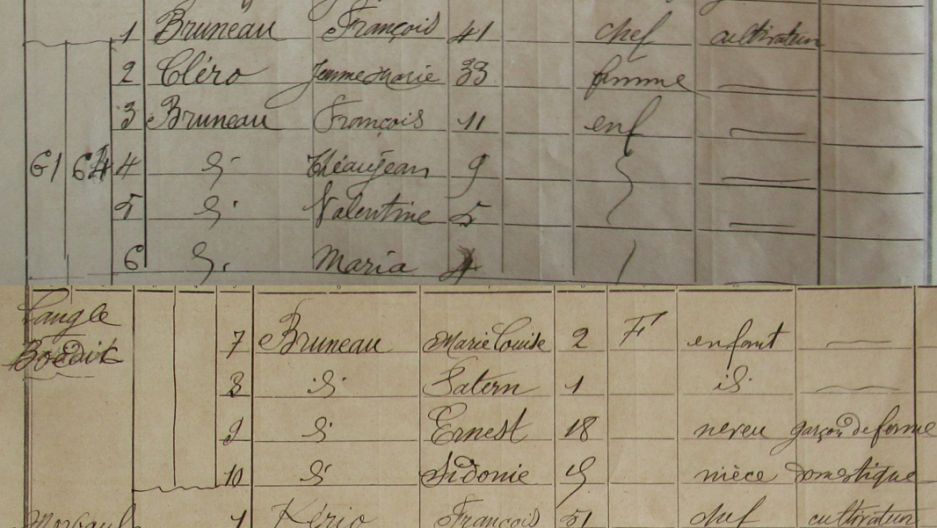
Au dénombrement de 1901 et à celui de 1906, la famille BRUNEAU est installée comme cultivateur à Boëdic.
En 1911, c'est la famille BENVEL qui cultive les terres de Boëdic. En janvier 1919, les frères PASSOT, industriels parisiens achètent l'île .
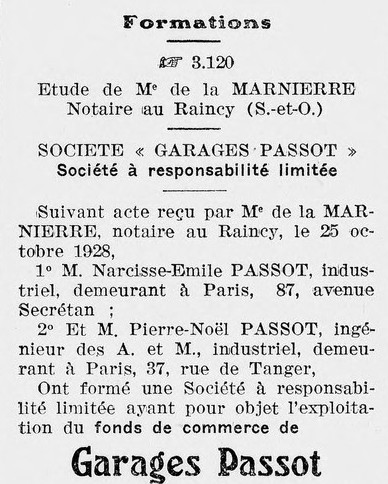
Narcisse Emile PASSOT et son frère Pierre Emile PASSOT dirigent un garage à Paris. Il réhabilitent la chapelle en 1923-24, (Lire article dédié aux chapelles de Séné). Leur autre frère, Narcisse Marie PASSOT, abbé y célèbre quelques messes, comme en témoigne cette vieille carte postale. Les passeurs de Conleau assurent le transport des fidèles.
Au dénombrement de 1921, la famille LE GAL est établie sur Boëdic. Elle est encore présente en 1926 aux côtés de la famille ROPERT qui est jardinier sur l'île. Leur fils, Pierre ROPERT se distinguera durant l'été1944 dans la résistance.
Courant des années 1930, la famille LE VAILLANT qui cultive des terres à Boëd, travaille également une propriété à Boëdic, comme nous l'indique le dénombrement de 1936.
Camille Rollando nous donne les propriétaires successif de l'île :
5/1936 Marc BOYER
10/1940 : LE HIR et MARCHAL
5/1941 J.M. LE GUILLOU
En 1947 ou 1949 Bernard et Paul Claude GOUPY, originaires de la Mayenne, achètent l'île et s'installent comme ostréiculteurs. Paul-Claude est pointé par le resencement de 1962. Bernard, vit sur Conleau. Très bricoleur, il avait construit une petite centrale électrique avec une éolienne qui alimentait une série de batteries. En récoltant l’eau de pluie, les Goupy pouvaient ainsi vivre en autarcie.

Bernard GOUPY derrière la statue de Saint-Antoine.
Le cinéma débarque à Boëdic...

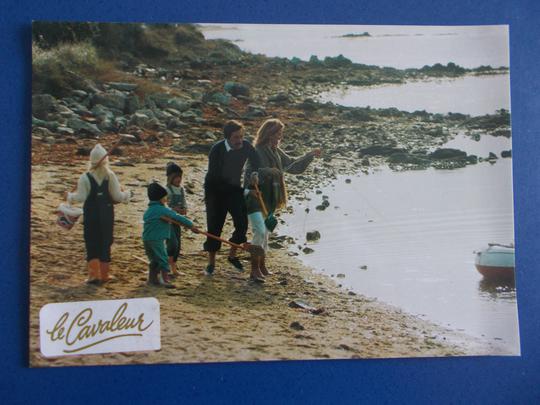

En 1979, le réalisateur Philippe DU BROCA tourne quelques scènes du film "Le Cavaleur" avec Jean Rochefort.

En 2011, les héritiers de Beranrd GOUPY décédé en 2007, vendent l'île de Boëdic à Olivier METZNER [1949-2013-Séné). L'avocat entreprend une large rénovation des différents batiments de l'île. En mars 2013, maître METZNER décide de mettre fin à ses jours. Il est retrouvé noyé au bord de l'île.

Longère dites "le château" avant et après sa restauration
Manoir de Boëdic
Métairie de Boëdic

Depuis 2015, l'île appartient à Christian LATOUCHE, homme d'affaires français à la tête du groupe FIDUCIAL.

Le cabanon de l'artiste BOISECQ à Barrarach
Il faut avoir le sens de l'observation pour le repérer sur les vieilles cartes postales montrant la butte de Bellevue à Séné. 
Il apparait sur la plage de Barrarach, non loin de la cale du passeur.


Vous le voyez? Oui, il s'agit d'une construction, d'un cabanon à un étage établi sur la plage de Barrarach !
Mais diable comment cette construction a-t-elle pu être édifiée à même le rivage?
Jean RICHARD se souvient : "M.Boisecq est arrivé d’Algerie en 1952 , un artiste peintre et sculpteur ,c’est lui qui a fabriqué la statue de Saint-Pierre qui orne la Chapelle de Bellevue. Il a construit lui même son cabanon , où il demeurait . Les enfants de la presqu’île l’ont aidé à confectionner les parpaings,qu’il posait lui même , à l’estime! Cela amena les gamins à appeler le cabanon, "le fil à plomb". Le cabanon fut démoli vers 1962 quand il fut décidé de construire la zone de Barrarach !"

Jean-Paul PIERRE faisait partie des gamins de la presqu'île qui "aidèrent" l'artiste dans son projet : "Nous étions Lulu MOREL (Lucien Morel), Jean-Jacques MORICE, (le fils d'Ernestine), Chantal MORIO, la fille de la patronne du café de la Pointe, à l'aider à faire les parpaing."
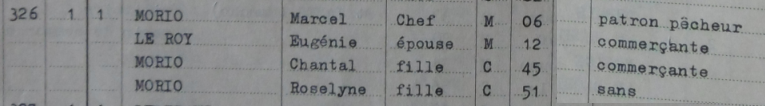

En effet, le peintre sculpteur fut logé un certain temps au café de la Pointe, aujourd'hui disparu, avant "d'aménager" son logis sur la plage. Sur cette photo, au premier plan, on le voit assis devant le café.
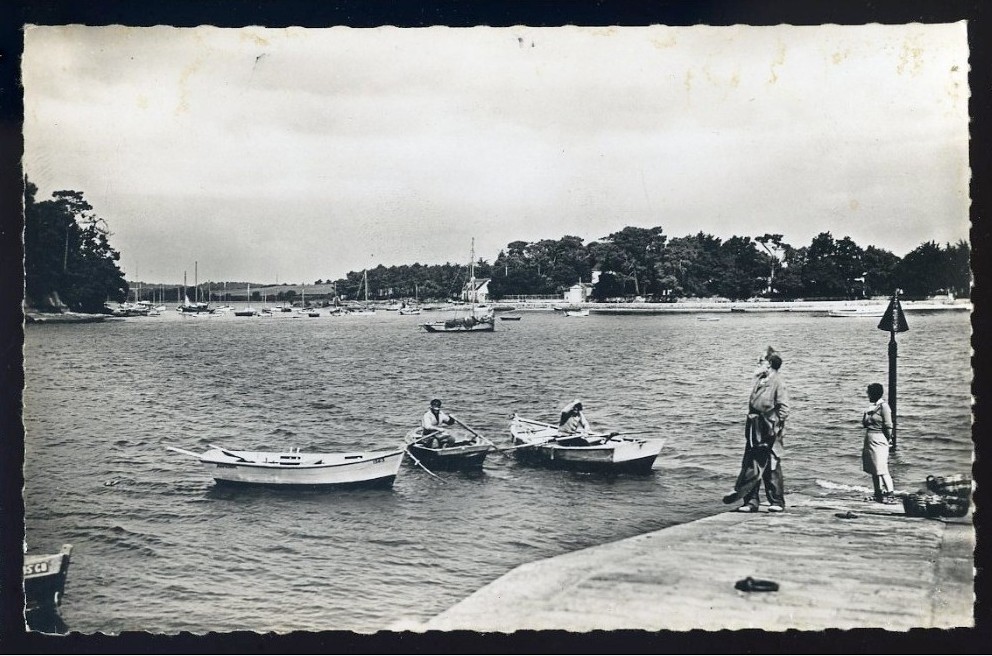
Sur cette autre cliché, il vient de débarquer sur la cale de P'tit Jean à Barrarach.
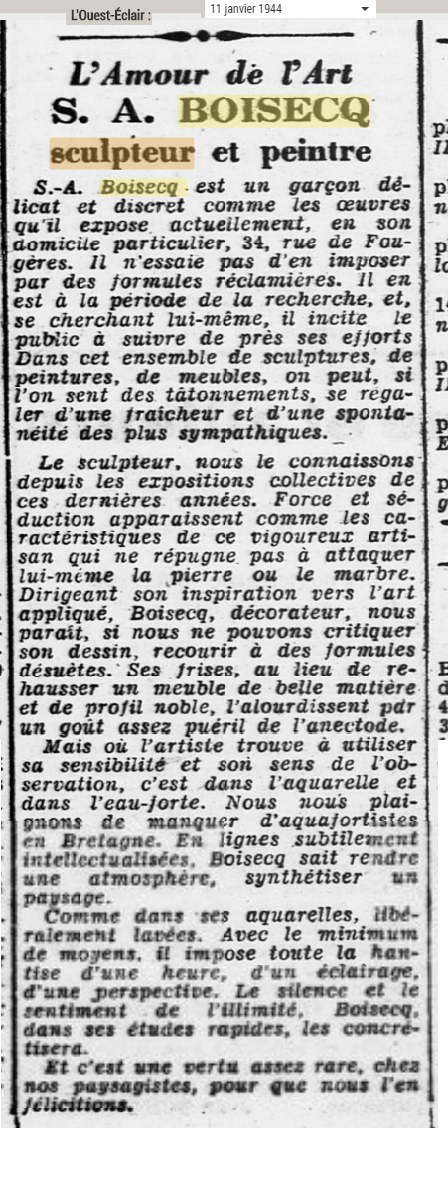
Fils du minotier Boisecq à Vannes, Salomon Alfred Jospeh Marie BOISECQ [17/4/1911 - 31/5/2002], il est le cousin de la sculptrice Simone BOISECQ [1922-2012].
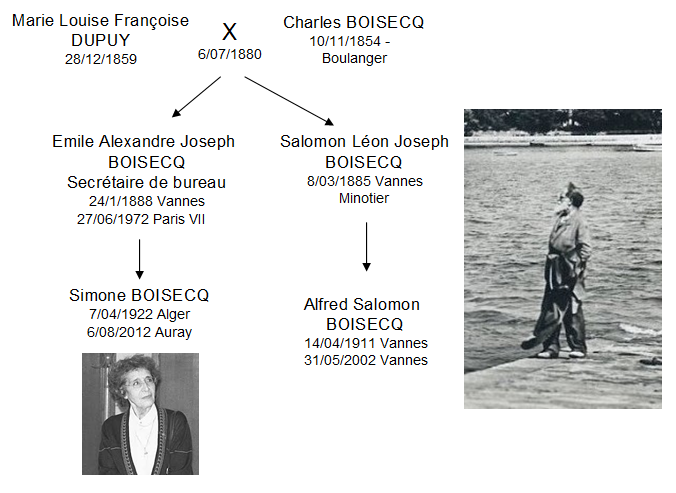

Après des études au lycée Saint-François-Xavier à Vannes, il embarque sur le trois-mats Général de Sonis entre 1927-1929. Attiré par la mer, il suit des cours à l'Ecole d'Hydrographie en vue de devenir lieutenant au long cours. En 1931-1933, il est au Levant (Syrie-Liban).
De retour en France, il épouse Madeleine ANDRE en 1933. Il aura 6 enfants. Il se lance dans la peinture, l'aquarelle et la sculture. Il se définisait qomme Statuaire, Artiste Peintre.
Pendant la 2° guerre mondiale, il est engagé volontaire lors de la Campagne de France. En juin 1940 il a le grade d'aspirant puis de sergent. Il sera cité pendant la Campagne de France. Après l'armistice, il participe à la création du réseau de résistance HECTOR. Il sera reconnu actif dans ce réseau des FFC, Forces Françaises Combattantes du 1/2/1941 au 31/7/1944. Il sera lieutenant en décembre 1943 au sein du groupe Heurtaux, faisant du renseignements et des relevés topographiques, tantôt, basé en Morbihan, en Île et Vilaine et Côtes du Nord. Ensuite il est membre des l'ORAF, Organisation des la Résistance des Armées Françaises. Dans le civil, ilest de 1940 à 1943, Contrôleur des Réfugiés à la Préfecture du Morbihan puis de mars 1942 à aout 1944, il se déclare Artisite Peintre Sculteur et vit à Renes. Le 28 août 1944, il s'engage dans le Transport Militaire Automobile pour les Populations Civiles , les TMAPC. Après le débarquement, il rejoint l'armée française et aux côtés des Américains, il combat jusqu'en Allemagne et participe à la libération du camp de Dachau.
Après guerre, on le retrouve à Vannes, au n°3 Place de la république; , puis à Paramé. Il devient Secrétaire de la Société Nouvelle des Beaux-Arts vers 1955. Puis il reviendra en Morbihan et s'établira quelques temps à Séné. Ses différentes aquarelles, eux-fortes et peintures montrent qu'il a voyagé en France et à l'étranger avant de revenir s'établir sur Vannes, où il décède en 2002.

Parmi ses oeuvres locale, notons une statue à la cathédrale de Vannes et différentes oeuvre avec pour inspiration le Golfe du Morbihan et Séné.
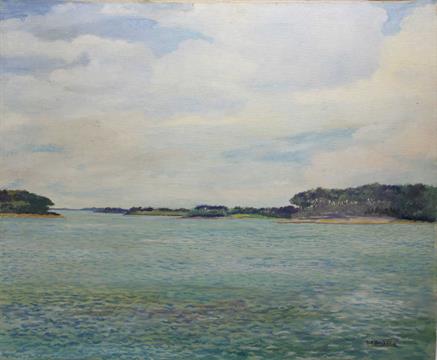
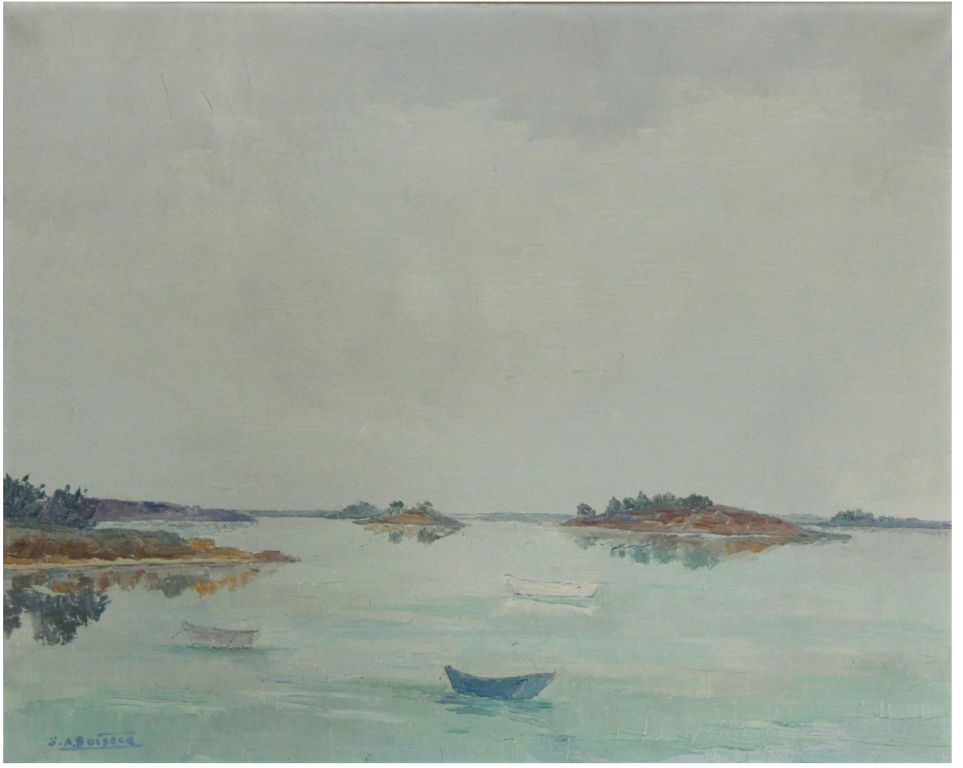


Au Domaine de la Rochevillaine, on peut voir un très grand tableau représentant la bataille des Cardinaux qui eut lieu non loin de l'Île Dumet le 20 novembre 1759. L'industriel Henri DRESCH, qui acquis l'île et constuisit le domaine à Billiers, était incollable sur cette épisode de la Guerre des Sept-Ans [1756-1763]. A sa demande, Salomon Alfred Boisecq peignit en 1966, cette représentation de la bataille navale qui est désormais exposé dans le manoir des Cardinaux.
 .
.
La faillite d'AVROUIN-FOULON, 1858
Depuis l'Ancien Régine, les receveurs généraux des finances étaient de véritables banquiers qui faisaient des avances considérables au Trésor à l'aide de fonds qu'ils empruntaient au public, ou qu'ils se procuraient par des opérations ou des spéculations plus ou moins hasardeuses. [source : infobretagne]
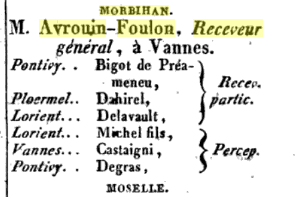
Cet extrait de l'Almanach de 1819 montre que le receveur général chapotait l'administration financière du département qui comprend des receveurs et des percepteurs.
Charles Gratien AVROUIN FOULON [2/05/1790 Beaumont lès Tours - Nantes 22/8/1860] succède en 1816 au poste à Jospeh François DANET, qui fut révoqué à la Restauration de la monarchie. En effet, on constata alors un déficit énorme dans ses caisses. Deux arrêts de 1816 de la Cour des Comptes le constituèrent en débit pour les exercices 1811 et 1812 d'une somme globale de 126.883 fr. Puis, le 24 juin 1817, le ministre des finances établissait le dit Joseph François DANET débiteur de 1.263.553 fr, dans son compte courant avec le Trésor arrêté, en capitaux et intérêts, au 31 décembre 1816.
Contrainte fut décernée contre lui, et, à la requête de l'agent judiciaire du Trésor, on procède en juillet et août 1818 à la saisie immobilière de ses immeubles. Antérieurement, un arrêt de la cour d'assises du 15 juillet 1818 l'avait déclaré contumax et condamné à une peine afflictive et infamante. Il ne purgea pas cette contumace, et le directeur des Domaines fut chargé de le représenter en qualité d'administrateur légal de ses biens.[source : infobretagne]
Charles Gratien AVROUIN FOULON, durant sa carrière de plus de 40 ans en Morbihan, fut également un grand acheteur de biens, comme le montrera la liquidation de son patrimoine.
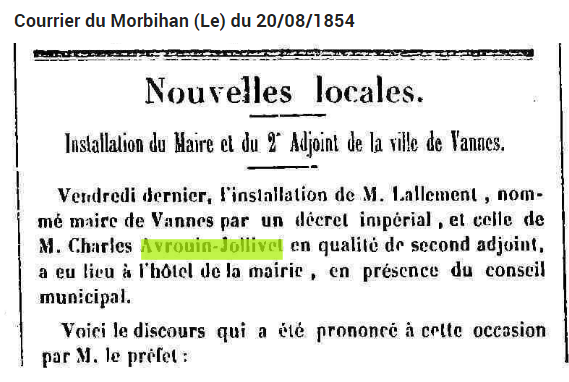
En août 1854, le conseiller municipal de Vannes devient conseiller général du Morbihan à Saint-Jean Brevelay. A la mort du maire de Vannes, il est nommé second adjoint du nouveau maire Lallement. La ville de Vannes organise les premières régates. Son fils Jules AVROUIN-FOULON [5/2/1829-5/1/1908] est le trésorier secrétaire parmi les commissaires des régates.
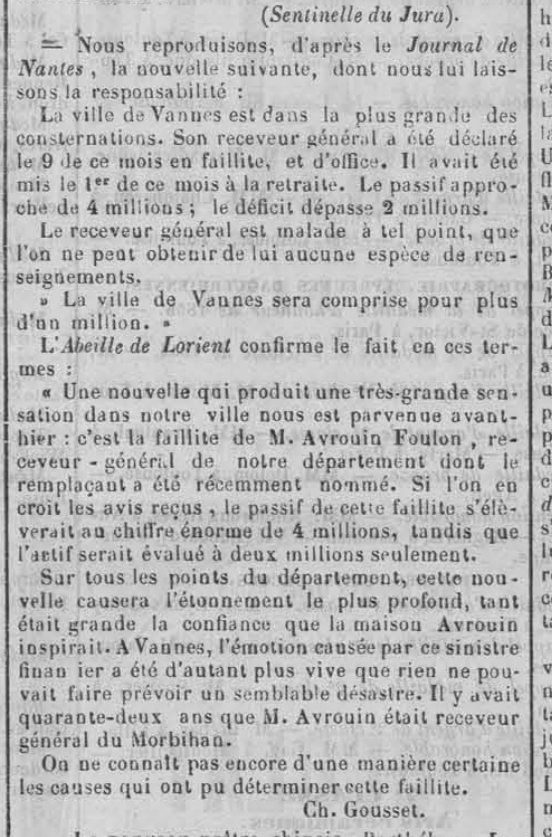
La crise financière de 1857 (sourdce Jean Marc Daniel)
Déroulement de la crise mondiale de 1857.
24 août 1857, début de la crise: faillite de l'Ohio Life Insurance and Trust Company.
4 octobre: les actions des compagnies de chemin de fer ont perdu depuis le début de l'année 30% de leur valeur à Wall Street; début d'un "bank run" aux Etats-Unis; fermeture des banques jusqu'au 11 décembre.
12 novembre 1857: la banque d'Angleterre suspend la convertibilité de la livre.
La crise de 1857 résulte de la conjonction de ces deux principaux phénomènes:
1-la baisse soudaine de rentabilité des mines d'or californiennes;
2-la baisse du rendement financier des actions des compagnies de chemin de fer, laquelle ne tardera pas à affecter lourdement l'industrie sidérurgique.
Répercussions en France :
Les actions du crédit mobilier passent de 1.487 Fr. en mars à 670 Fr. en décembre.
Les taux d'escompte variable d'ajustement grimpent.Le taux de référence à 4%; loi du 3 mars 1852; loi du 9 juin 1857; le taux culmine à 10% en novembre 1857; il redescend à 5% fin 1857. Il descend à 3.5% en 1863.
10 juin 1857 : Charles de Germiny devient Gouverneur de la Banque de France.
14 janvier 1858: attenta d'Orsini contre Napoléon III.
Ce rare article de presse, daté de décembre 1858, évoque la fin de carrière d'AVROUIN FOULON, sans doute victime de la crise financière.
"Nous reproduisons, d'après le Journal de Nantes, la nouvelle suivante, dont nous lui laissons la responsabilité : La ville de Vannes est dans la plus grande des consternations. Son receveur général a été déclaré le 9 de ce mois [décembre 1858] en faillite, et d'office. Il avait été mis le 1er de ce mois en retraite. La passif approche de 4 millions; le déficit dépasse 2 millions. Le receveur général est malade à tel point, que l'on ne peut obtenir de lui aucune espèce de renseignements. "La ville de Vannes sera compromise pour plus d'un million".
L'Abeille de Lorient confirme le fait en ces termes : Une nouvelle qui produit une très grande sensation dans notre ville nous est parvenue avant-hier : c'est la faillite de M. Avrouin Fouilon, receveur-général de notre département dont le remplaçant a été nommé. Si l'on en croit les avis reçus, le passif de cette faillite s'élèverait au chiffre énorme de 4 millions, tandis que l'actif serait évalué à deux millions seulement. Sur tous les points du département, cette nouvelle causera l'étonnement le plus profond, tant était grande la confiance que la maison Avrouin inspirait. A Vannes, l'émotion causée par ce sinistre financier a été d'autant plus vive que rien ne pouvait laisser prévoir un semblable désastre. Il y avait quarante-deux ans que Avrouin était receveur général du Morbihan.
On ne connait pas encore d'une manière certaine les causes qui ont pu déterminer cette faillite. Ch. Gousset.
La consultation de la cote U3686 aux Archives Départementales montre plusieurs centaines de requerants, essentiellement de Vannes, floués par cette faillite et qui déclare des sommes variables. Quelques Sinagots seront victimes de cette fiallite à l'image du douanier Josset.
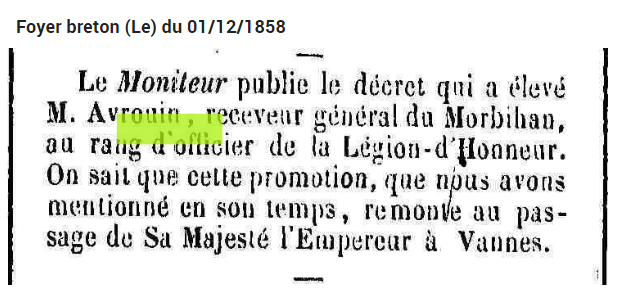
Effectivement, le receveur, qui faisait partie des notables de Vannes qui avaient accueillis l'Empereur le 15 août lors de sa visite à Vannes, compte parmi les promus de la Légion d'Honneur.
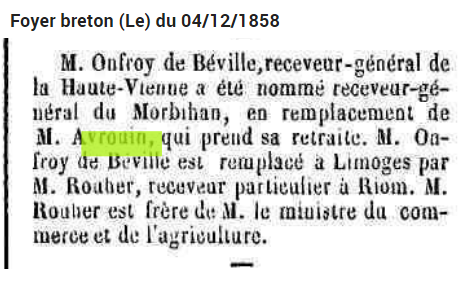
Avant la promulgation de sa faillite qui parait sans doute évidente, les autorités mettent en retraite le vieux receveur et nomme son successeur. Début janvier 1859, le Préfet prend les chose en main afin de limiter les conséquences de la faillite sur la population, comme le décrit cet article du Journal de Toulouse.
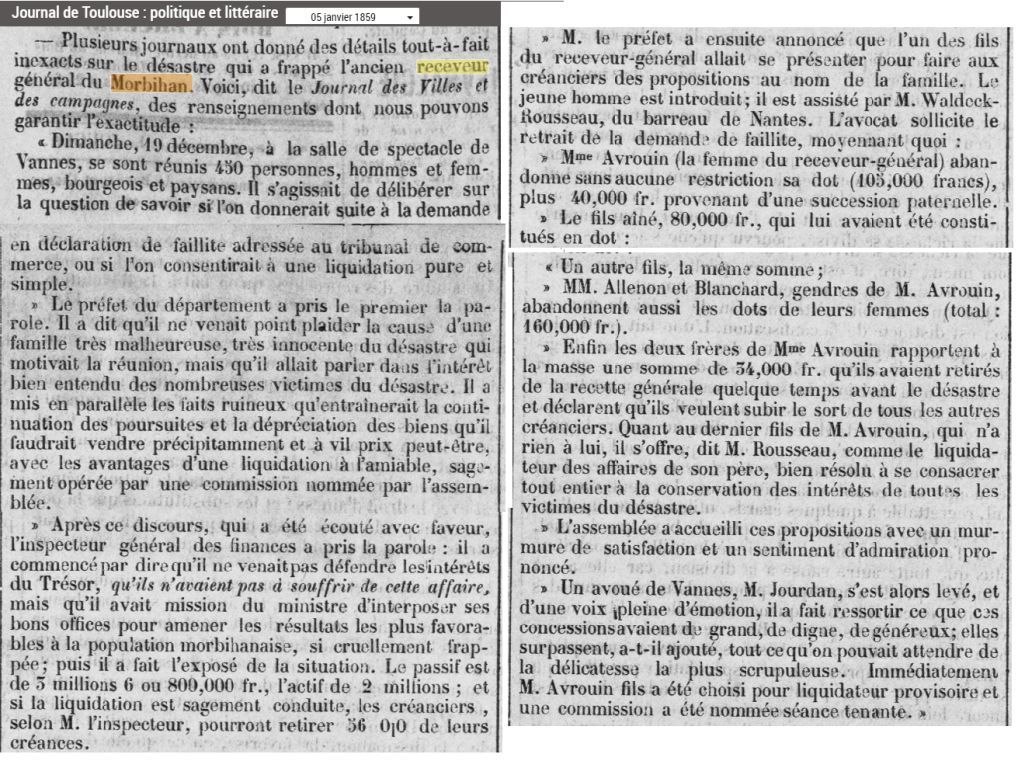
La première annonce de vente aux enchères retrouvée sur le sites des Archvies du Morbihan, porte sur des chevaux le 19 janvier 1859 : un cheval de selle, deux chevaux de voiture, quatre chevaux de trait, Amazone, petit cheval de selle, montrant que l'ancien receveur s'adonnait aux courses en voque déjà à l'hippodrome de Cano à Séné.
Le lundi 21 février 1859, c'est au tour du mobilier d'être vendu aux enchères dont des voitures et calèches. tableaux et gravures. Un autre lot comporte des embarcations, dont les bateaux La Perle et l'Hirondelle, qui participaient aux Régates de Vannes. La chute de la maison Avrouin entrainera la suspension des régates de Vannes pendant 8 ans.
Le 22 mars 1859, est mis en vente le château de Roguédas en Arradon où la famille Avrouin Foulon recevait les officiels lors des Régates de Vannes. Le château sera acquis par l'imprimeur Panckoucke."Batterie de cuisine, cristaux et porcelaines, rideaux, tentures et tapis; meubles en acajou, anitques et modernes, ameublement Louis XV, tableaux, glaces, pendules et candélabres; lits garnis et quantité de linge de lit et de table.
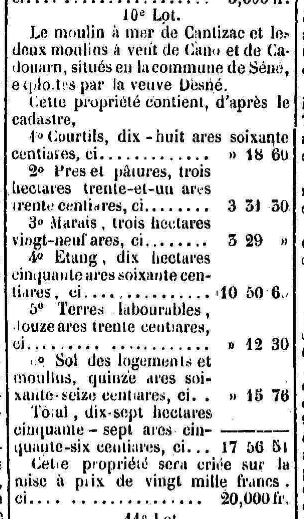
Les Avrouin détenaient également les moulins du Hezo, de Campen et le petit moulin à vent de Cano à Séné. Le moulin de Cantizac et de Cano furent rachetés par le meunier Joseph GACHET qui les exploitait.
A ces biens, s'ajoutait les terres à Séné à Cantizac, 17 ha, la maison du meunier et les terres jouxtantes pour 36 ha, des propriétés à Kerhuilhieu, 72 ha, Keravelo, 56 ha, la Poussinière, 20 ha.
AVROUIN FOULON mettait aussi en fermage des terres à La Chenaie, Keroyer et Keravelo en Arradon comme d'autres parcelles de terres au Hézo.
Charles Gratien AVROUIN FOULON détenait également des salines sur Séné : saline grande de Michote, 50 oeillets, saline petite de Michotes, 104 oeillets, saline de Misentrets, 60 oeillets, saline de Misentrets-Michot, 29 oeillets, salien de Misentrets 100 oeillets et saline de Grand Brouel 111 oeillets pour un total d'environ 45 ha. La vente des ses salines permis à des Sinagot d'en devenir les propriétaires [à investiguer - article à venir sur les paludiers].
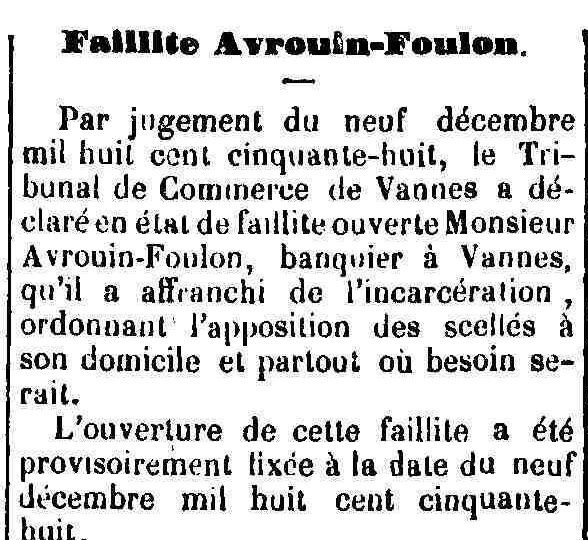
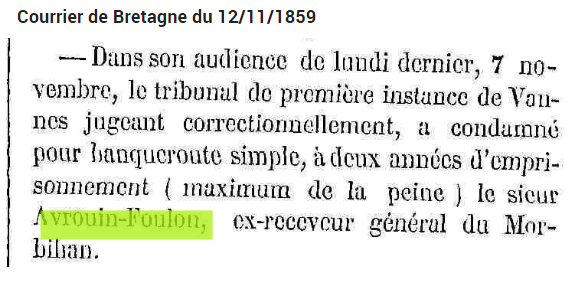
Charles Gratien AVROUIN FOULON sera condamné pour banqueroute à deux ans de prison. Vu son grand âge et son état de santé, on lui permettra de quitter la ville. Il décède à Nantes le 22 août 1860.
Le saltimbanque diffuse la variole, 1869
Avant la généralisation de la vaccination, la découverte des antibiotiques et les progrès de la médecine en général, les maladies infectieuses étaient un fléau. A Séné, ces maladies ont fait des ravages au sein des militaires et des jeunes conscrits, que cela soit le choléra pendant la guerre de Crimée, lle "vomito negro" ou fièvre jaune pendant la Campagne au Mexique ou bien la tuberculose pendant la 1ère Guerre Mondiale.
Avant la construction d'un réseau d'adduction d'eau, après guerre, il était encore fréquent de voir des épidemies de typhoïde dans notre commune.[lire article sur les Fontaines et Puits à Séné]
La population de marins qui parcourraient les mers du monde, était aussi propice à ramener dans la paroisse des maladies infectieuses comme la paludisme qui étaient encore endémique à Séné dans l'entre deux guerres.[lire article dédié].
Au cours du XIX° siècle avec l'essor de la marine marchande, les guerres, l'accroissement des échanges grâce au chemin de fer, les épidemies étaient fréquentes et les autorités soucieuses de leur population, oeuvraient au déploiement de mesures prophylactiques.
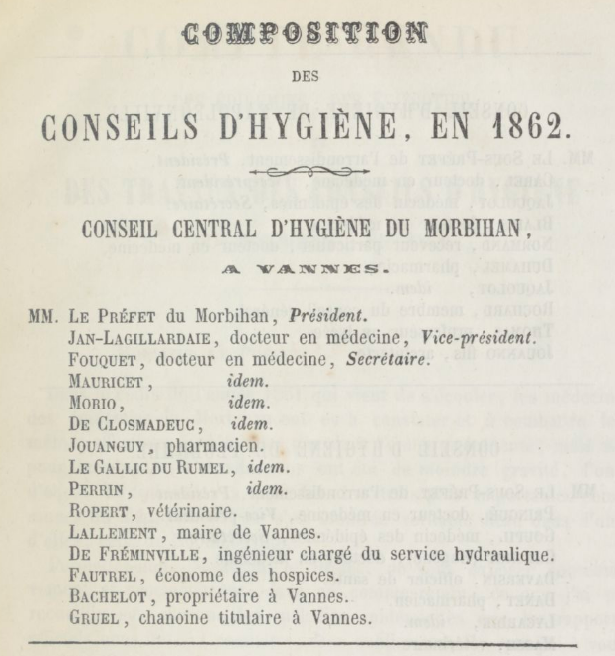
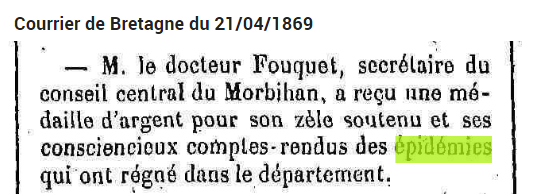
Dans le Morbihan, il existait un Conseil d'Hygiène, dont le secrétaire, Le docteur Alfred FOUQUET [Redon 2/10/1807- 24/06/1875 Vannes], rédigeait chaque année un "Compte-Rendu des Epidémies et Epizooties".
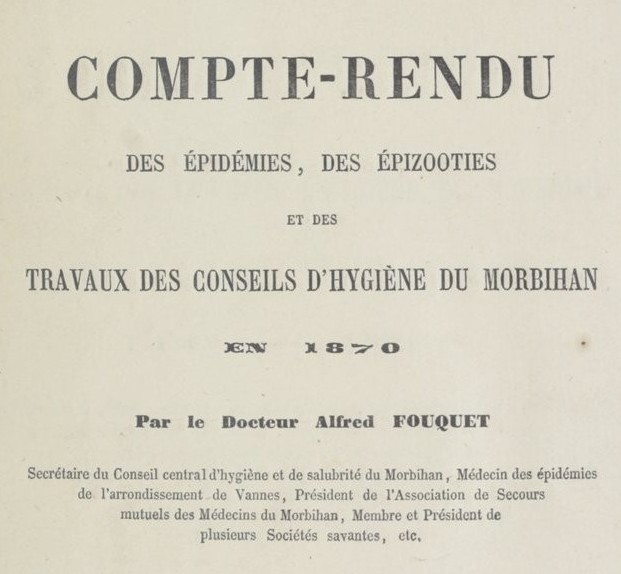
On retrouve sur le site Gallica BnF, ces rapports pour les années de 1861 à 1870. Ils nous renseignent notamment sur l'épidémie de variole qui sévit en 1870 à Vannes, à Séné et dans le Morbihan.
Les maladies infectieuses étaient fréquentes et variées : la variole [due au virus poxvirus, la diphtérie due au bacille de Löffler-Klebs],, la fièvre typhoïde (dotinentherie [due à une bactérie, Salmonella enterica ou bacille d'Eberth], la rougeole [due à un morbilivirus], la coqueluche [due à une bacterie du genre Bordetella], la scarlatine [due à une bactérie Strerptococcus pyogenes], les dysenteries [dues à une batérie Shigella ou une amide protozoaire] comme le rapporte ce tableau qui donne pour 1868 et 1869 le nombre de communes atteintes par les maladies infectieuses et le nombre de décès constatés en Morbihan.
Fort heureusement, ces maladies ont été aujourd'hui éradiquées grâce notamment au progrès dans la vaccination.
A la fin du 18ème siècle, un médecin de campagne anglais, Edward Jenner, fait une découverte importante : une maladie bénigne des vaches, la « vaccine », ressemble à la variole. Les fermières, en contact régulier avec le virus de la vaccine en raison de leur métier, ne contractent pas la variole lors des épidémies.
Jenner contamine une personne avec la vaccine via de petites incisions dans la peau. Puis s’efforce d’infecter son « cobaye » avec la variole, sans succès : celui-ci ne développe pas la maladie.
Le nom de « vaccination » est donné à cette opération. Elle connaît un succès retentissant en Europe et donne lieu à l’organisation de grandes campagnes antivarioliques. Le patient ayant reçu la vaccine après incubation produit ses propres anti-corps. On va lui prélever sur son bras quelques goutes de son sang et l'injecter par incision sur le bras d'un individu à vacciner. Ainsi "de bras en bras" les populations étaient protégées de la variole. Cependant, ces vaccins nécessitaient des rappels d'injection plus fréquent que de nos jours...

Vaccination aout 1905
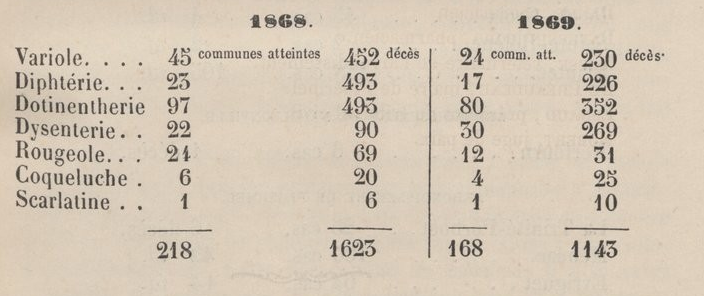
Si durant les premières années de la décade, la variole était peu fréquente sur la canton de Vannes, comme nous l'indique cet historique établi par le Docteur FOUQUET, il y eut une forte épidemie de variole en 1870.
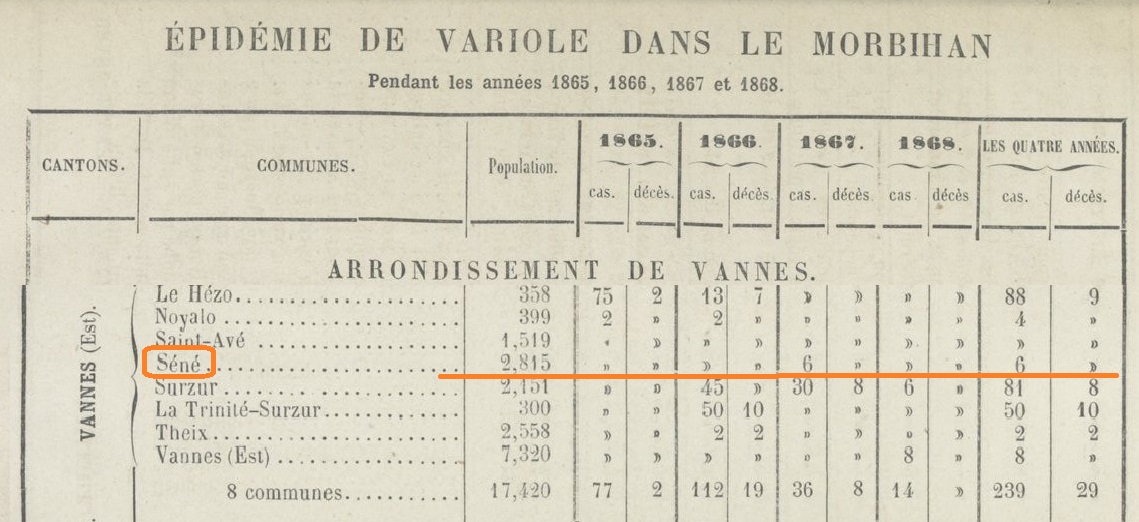
Le docteur FOUQUET écrit dans son rapport pour l'année 1869, que la variole causa 4 morts à Séné pour 52 cas répertoriés dans la commune. 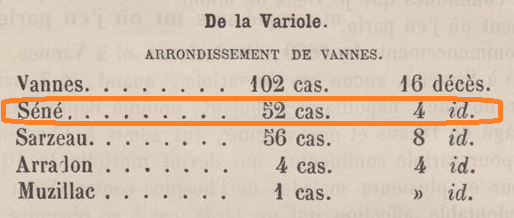
Il donne l'origine un peu singulière à ce début d'épidémie :
"Au commencement de 1869, il n'existait ni à Vannes, ni à Séné, ni à Sarzeau, aucun cas de variole, quand, le 7 mai, un chanteur de rue, napolitain ambulant, nommé Baptiste Grand-Pietro, âgé de 16 ans et non vacciné, fut admis à l'hospice de Vannes pour variole confluente, qui devint mortelle le 16 mai.
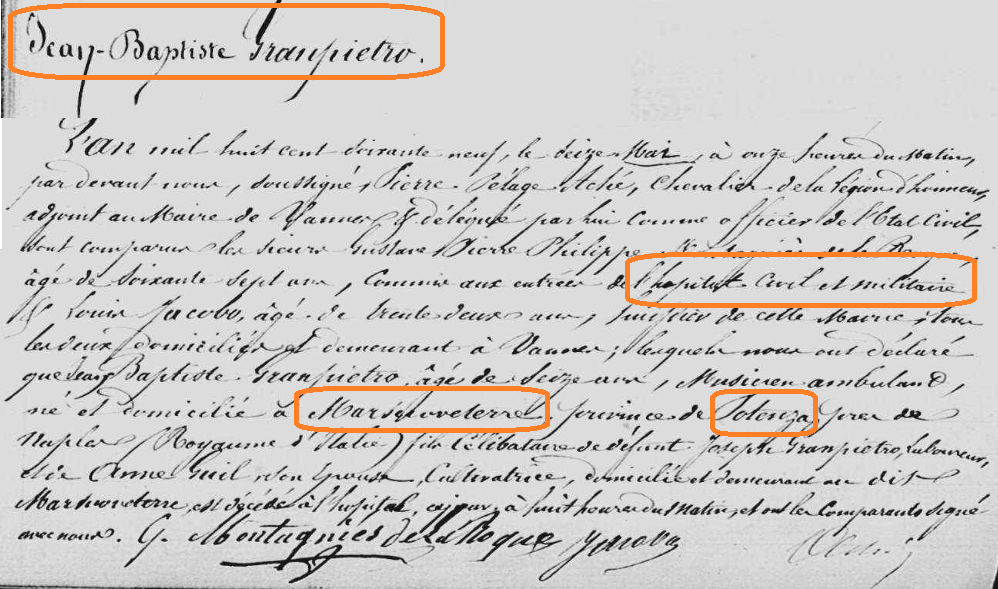
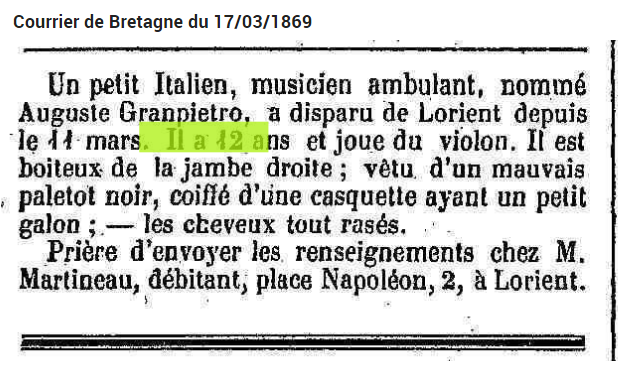
[On retrouve son acte de dcès enregistré à Vannes, le jeune italien, natif de Marsicotevere, province de Potenza, sud de l'Italie, est âgé de 16 ans quand il est admis à l'Hôpital Civil et Militaire rue de la Loi, derrière la mairie, où il succombe de variole. Cet article de presse permet d'avancer qu'il était en France avec son jeune frère et sans doute ses parents, dont le snoms apparaissent sur l'acte de décès.]
Une soeur et plusieurs malades de l'hospice contractèrent alors cette redoutable affection qui ne tarda pas à se répandre dans toute la ville.
Les rapports incessants qui existent entre les habitants de Vannes et ceux de Séné, eurent bientôt créé entre eux une solidarité épidémique, funeste aux uns comme aux autres; car, si d'abord l'épidémie a passé de Vannes à Séné, cette même épidémie est revenue de Séné à Vannes, dans les derniers mois de l'année. Cette recridescence varioleuse, concentée d'abord dnas la rue de Séné à Vannes
[actuelle rue Monseigneur Tréhiou, qui était le voie principale pour aller à Séné en passant par la croix de Kernipitur, le Pont d'Argent pour franchir le ruisseau de Cantizac avant d'rriver en Séné],
a parcouru, au commencement de 1870, non seulement les divers quartiers de la ville, mais encore plusieurs villages de la commune où, en deux mois, elle a fait 30 victimes."
Dans le Compte-Rendu édité en 1871, portant sur l'année 1870, le docteur Alfred FOUQUET, fait le décompte des victimes de la variole dont la famille de saltimbanques napolitains aura été un maillon dans sa diffusion.
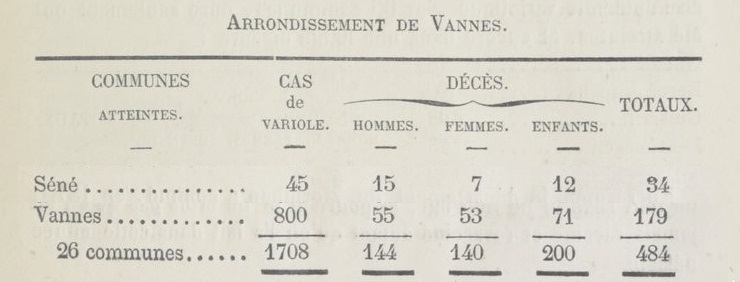
Sur Vannes, lors de la semaine pascale, on sortit les reliques de Saint Vincent Ferrier pour demander la fin de l'épidémie, comme nous le relate cet article de la "Semaine Religieuse", se souvenant ainsi de tous les mirales atrtibués au saint lors de la peste de 1453. [lire article dédié].
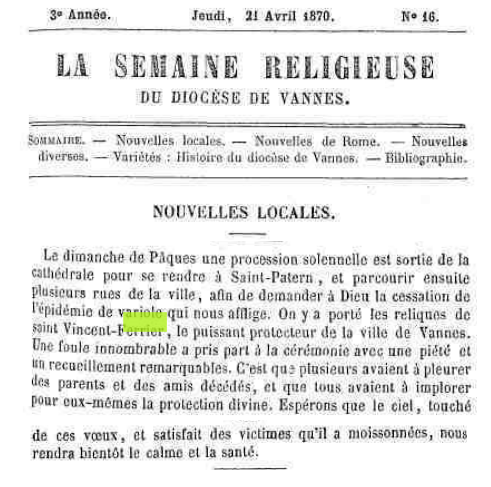
A Séné, on compta 45 cas dont 34 décès parmi lesquels, 15 hommes, 7 femmes et 12 enfants!
Dans ce même rapport, le docteur FOUQUET site le cas d'un Sinagt âgé de 22 ans qui succomba de la variole.
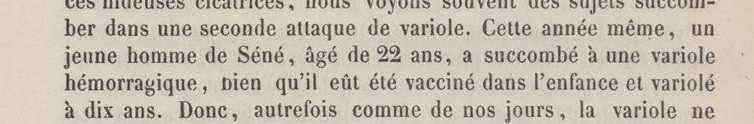
Ces précisions permettent d'identifier une victime parmi les 34 décès, en la personne de Pierre PIERRE [101/1850 Moustérian - 28/8/1870 Moustérian].
Mais pourquoi tant de décès alors que la vaccination était possible?
Cet article de presse signé du Docteur Alfred FOUQUET en donne la raison : les difficultés pour la population à se faire vacciner.et surtout à faire un rappel de vaccination.
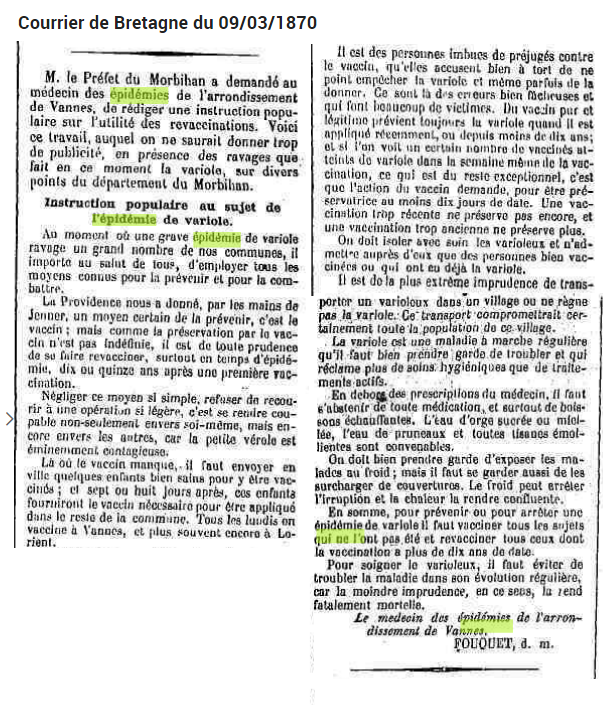
Avec le début guerre franco-prussienne de juillet 1870, la défaite de Sedan le 1er septembre, la fin du Second Empire, Le Docteur FOUQUET a dû arrêter de rédiger ces Comptes-Rendus. Il décèdera en 1875.

Plus près de nous, en 1955, survint la dernière une épidémie de variole apparue en France qui fit 15 morts pour 74 cas répertoriés dans le département. A l'origine de cete épidémie, un militaire, porteur sain, qui revint d'Indochine. Le première victime ne fut autre que son enfant...Les anciens Sinagots se rapellent de longues files d'attentes pour aller se faire vacciner à Vannes. 5souvenir de Jean Richard).
Saint-Vincent fait des miracles à Séné
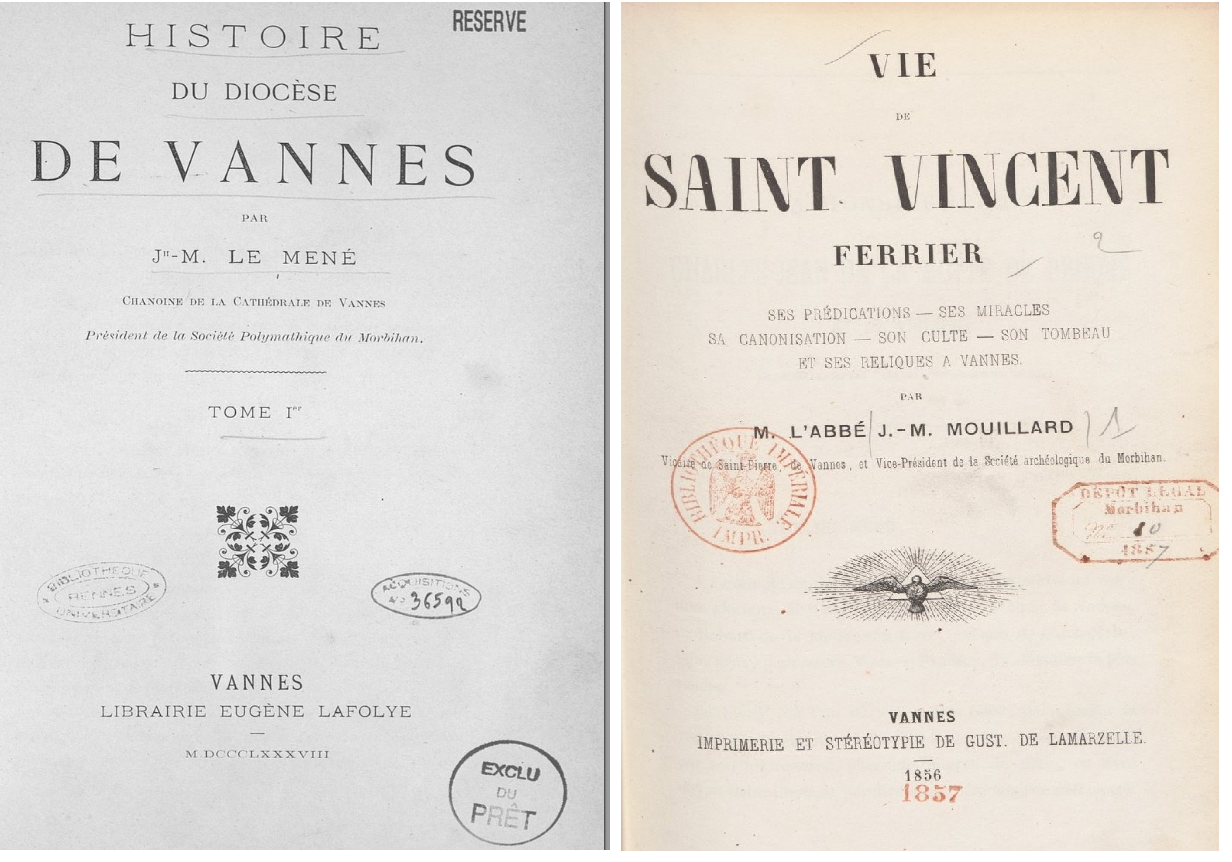
Tout commence par une recherche sur le site de l'Université de Rennes II qui a numérisé des vieux ouvrages et permet une recherche avec des mots clef. En tapant "Séné", je tombe sur un livre de J.M. Le Mené, Histoire du Diocèse de Vannes, dans lequel il est rapporté que la peste sévit dans plusieurs paroisses du diocèce, dont Séné, du 29 juin 1452 jusqu'au 1er novembre 1453...
Un autre hasard dans mes recherches me fait repérer sur Gallica BnF un autre livre intitulé "Vie de Saint Vincent Ferrier", écrit par l'abbé J.M. MOUILLARD. Une recherche avec le mot clef "Séné" me fait découvrir plusieurs témoignages recueillis entre 1542-1453 par les autorités écclésiastiques en vue du procès en canonisation du prédicateur dominicain Vincent FERRIER [Valence 23/1/1350 - Vannes 5/4/1419].
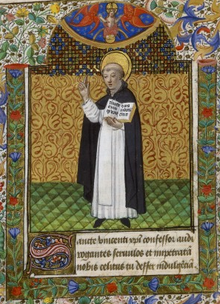
L'affaire se déroule à Vannes en l'an de grâce 1453. Depuis le 29 juin 1452, la peste sévit dans le diocèse de Vannes et durera jusqu'au 1er novembre 1453, Plusieurs paroisses sont touchées par l'épidémie sans que l'on sache précisement si il s'agit véritablement de la peste bubonique ou d'une autre maladie infectieuse.
Pour préparer le procès en béatification, les autorités écclésiastiques décident de recueillir des témoignages sur les intercessions de Vincent Ferrier. Plus de 300 témoignages sont recueillis entre novembre 1453 et mars 1454 à Plumaugat, Dinan, Redon, Nantes, Fégréac, Questembert et Guérande.
Parmi les récits du Pays de Vannes, nombreux sont ceux qui relatent la présence de la peste, et parmi ces récits figurent ceux de deux familles de Séné. L'abbé MOUILLARD a fait un ecellent travail de traduction car les témoignages ont été rédigés à l'origine en latin! Heureusement, ils sont indexés et on peut retrouver rapidement sur le site des Archives du Morbihan, le vieux texte en latin.
On ne remerciera pas assez les travail de numérisation entrepris par les Départements, Minitères et autres institutions en France, qui permettent à l'historien de mener rapidement des recherches...
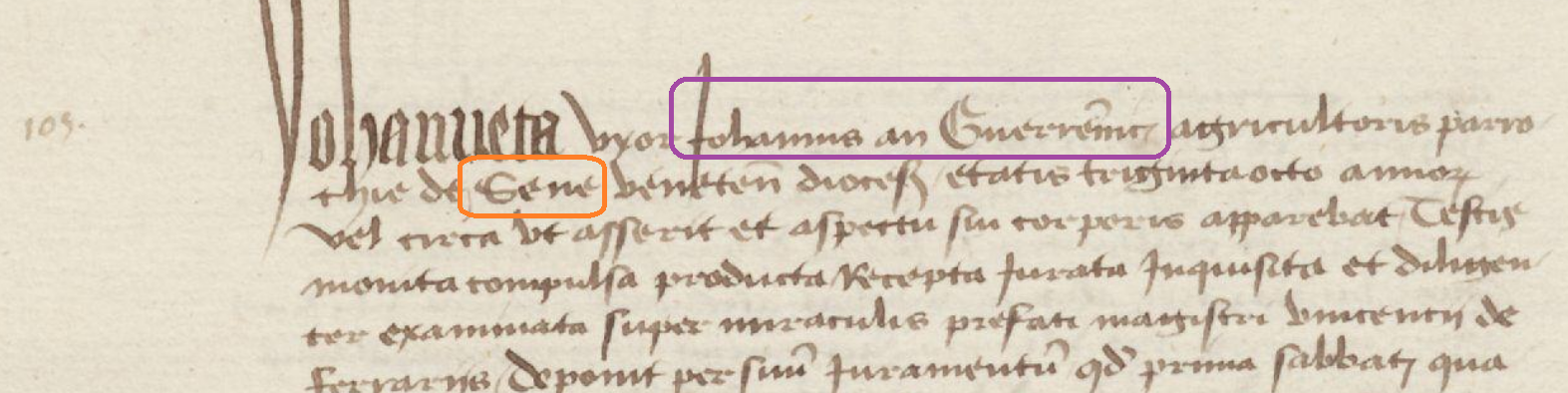
105°-106° et 107° témoins
Jeannette, épouse de Jean an GUERENNIC, cultivateur de la paroisse de Séné, âgée de trente-huit ans, rapporte que son maru fut, le premier samedi du carême dernier, atteint de la peste pendant quelques jours. Il reçut les sacrements de l'Eucharistie et de l'Extrême-Onction : on désespérait de sa guérison. Un voeu qu'elle fit à Me Vincent lui procura la santé, bien qu'il ait conservé une grande faiblesse pendant sept semaines. Elle ajoute que, il y aura trois ans au mois de mai, elle mit au monde un enfant mort. Tout affligée, elle voue cet enfant à Me Vincent. L'enfant revenant à la vie, fut baptisé, reçut le nom de Guillaume, et vivait encore au moment où elle faisait sa déposition.
Jean Guérennic, laboureur, de ladite paroisse, âgé de vingt-huit ans, confirme les deux faits qui précèdent.
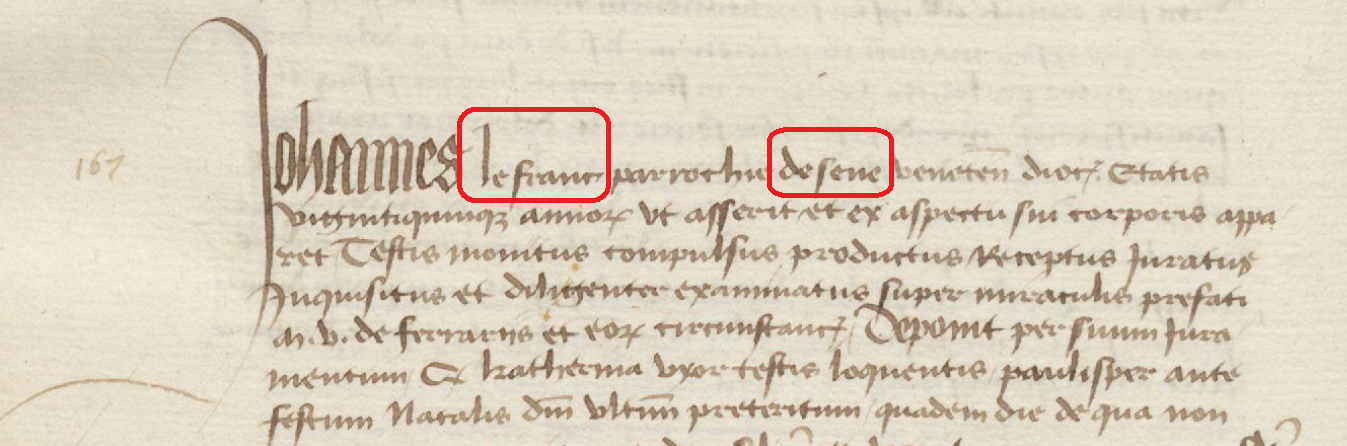
167°, 168° et 169° témoins
Jean LE FRANC, de la paroisse de Séné, au diocèse de Vannes, âgé de vingt-cinq ans, assure que sa femme, Catherine, à la suite de ses couches, devint épileptique, avec chutes réitérées par jour, écume à la bouche et perte de la parole. Il fait le voeu ded présenter au tombeau de Me Vincent un voeu en cire à la ressemblance de la malade, et aussitôt elle fut guérie; ce qui lui parait tenir du miracle.
Catherine, femme de Jean Le Franc, témoin précédent, âgée de vingt ans, confirme les faits exposés par son mari. Elle ajoute qu'après chaque crise qu'elle éprouvait, elle ignorait ce qui s'était passé en elle.
Nicolas Le franc, père de Jean Le franc, de la paroisse de Séné, âgé de soixante ans, a vu Me Vicnent; il l'a entendu prêcher, et il l'a toujours regardé comme un saint personnage. Il confirme les faits précédents : la maladie de sa belle-fille Catherine, le voeux fait à Me Vincent, et la guérison complète de la malade.
Ainsi, deux familles de Séné, les Le Franc et les Guerennic furent miraculées et lors de l'enquête, elle ont apporté leur témoignages sur les heureuses intercessions de Vincent FERRIER pour guerrir leur proches.
A la cathédrale Saint-Pierre de Vannes, une tapisserie nous raconte quelques passages de la vie de Saint Vincent Ferrier et des miracles dont il est à l'origine. Cette longue tapisserie fut commandée en 1615 par l’évêque Jacques Martin. L'artiste tapissier a dû être "brieffé" dirait-on aujourd'hui, sur les différents témoignages des miracles de Saint-Vincent. La tapisserie qu'il dessina relate entre autre le miracle de la guérison d'un enfant atteint de la peste. Ce type de témoignages fut recueilli de nombreuses fois comme l'atteste le livre de l'abbé MOUILLARD qui en donne de nombreux exemples.
Comme le fils Guérennic de Séné, d'autres enfants furent guéris par l'intercession de Saint Vincent Ferrier.
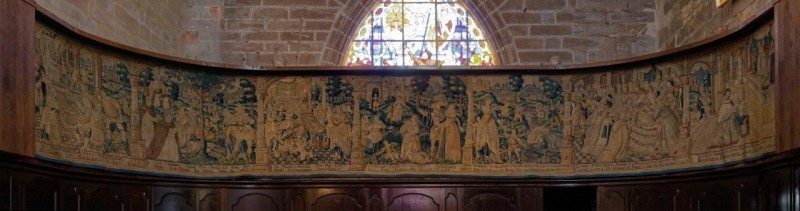
Le quatrième tableau a pour légende :
VN ENFANT FRAPÉ DE LA PESTE, RECOMMANDÉ
PAR SES PARENS AV SAINCT, EST GVÉRY.
La scène présente un enfant couché sur le sol, et une femme à genoux, qui le voue à saint Vincent ; à droite on voit un seigneur et une dame en costume de la fin du XVIème siècle, et à gauche, au fond, les murs et une porte de la ville de Vannes. Il serait difficile de donner des noms propres à ces personnages, car les guérisons de la peste, dues à l'intercession du Saint, furent nombreuses, surtout en 1452 et 1453.
http://www.infobretagne.com/vannes-tapisserie-vincent-ferrier.htm

Place de Cofornic
Le site de généalogie Filae propose l'étymologie suivante pour le nom COFORNIC: Coffornic est un nom de famille breton d'origine toponymique, representant un nom de lieu-dit morbihan , forme contractée de coh-fournic, compose de l'adjectif vannetais koz qui signifie vieux, et le diminutif fournic qui signifie four, c'est-a-dire le vieux petit four autour duquel s'est forme le lieu-dit .
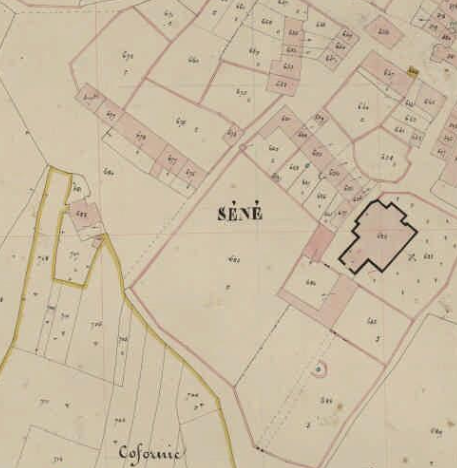
Le nom Cofornic est présent sur le cadastre de 1845 où il nomme des parcelles de terrain entre l'église du bourg et les rivages du golfe. Si le relevé cadastral indique un puits dans le jardin du presbytère, toujours visible aujourd'hui, il ne figure pas de four.

A cette époque, ce qui deviendra la Place de Cofornic est occupée en partie par l'enclos du prebsbytère et le corps d'une ferme toujours présente au n°7 actuel. Cet enclos ménage un passage étroit, une ruelle bordée de muret qui permet de faire communiquer la ferme avec le reste du bourg, dont la rue des Vierges. La mémoire orale raconte qu'afin de laisser passer les charrettes, l'angle de la maison sise aujourd'hui au n°7 de la place de la mairie (librairie Marée Pages) fut "rabotté".
On devine l'alignement des maisons qui portent les numéros 4 à 12 aujourd'hui. On en déduit que les maison 8-10 ont été scindées alors que la maison au n°12, d'un seul tenant est issue du regroupement de deux parcelles. On remarque surtout qu'une maison existait au bout de la rue des Vierges entre ce qui allait devenir les places de Cofornic et de la Mairie.
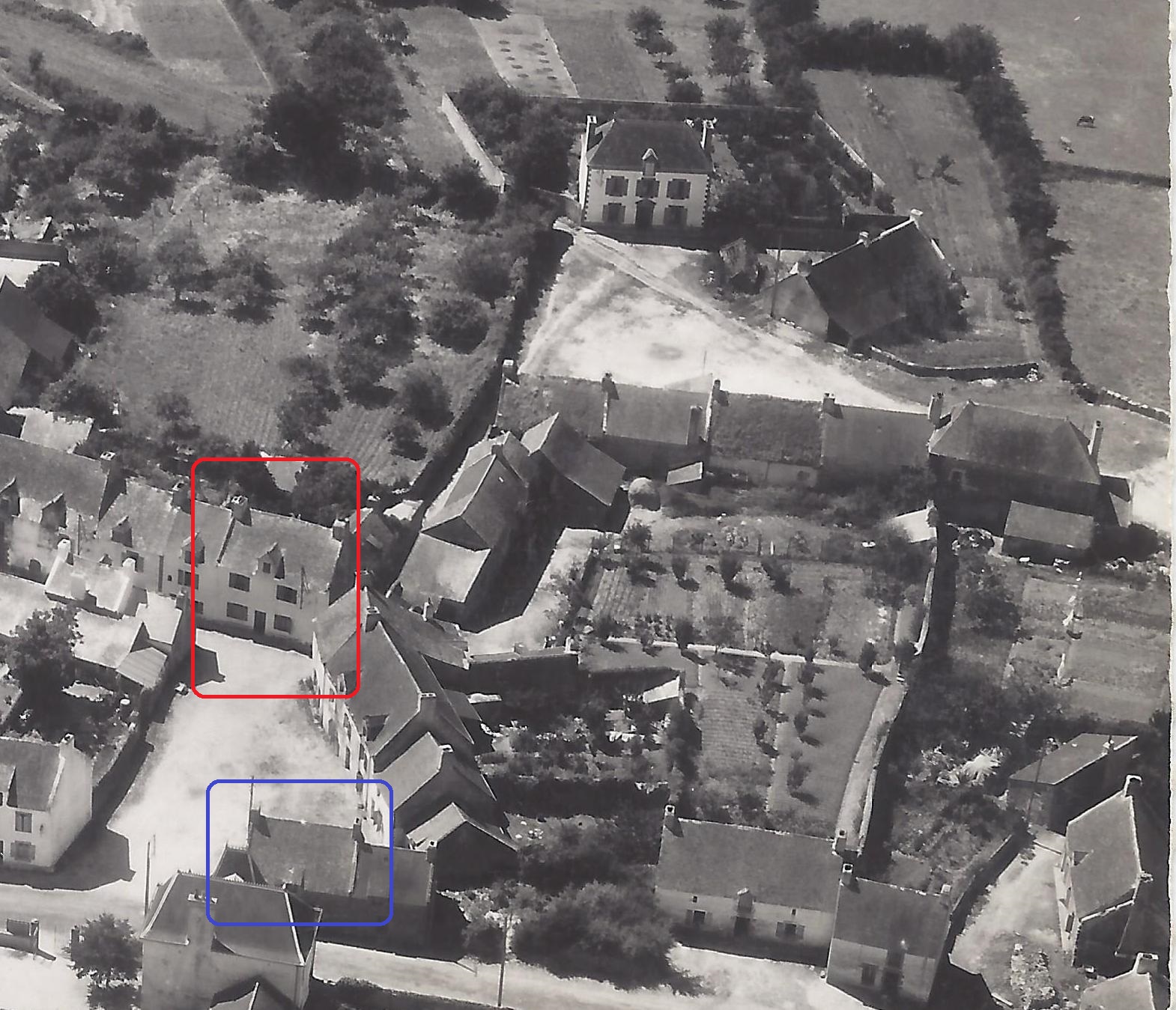
Cette vue aérienne des années 1960, nous montre l'enclos du prebsbytère, encore intact, la longère de la ferme agricole et la maison du meunier Gachet,, construite autour de 1885. qui fut également maire de Séné.
On devine l'alignement des maisons des numéros 4 à 12 alors bâties en style sinagot. La dernière, au numéro 12 conserve quelques traits architecturaux originels. Les autres ont été fortement remodelées.
Par rapport au relevé de 1845, on note qu'une maison a été construite, l'actuel n°2 de la place.
On peut voir sur cette photographie l'ancienne maison qui "obstruait" la communication entre les deux places. Elle est encore présente sur cette photographie aérienne de 1970.

Cette autre photographie aérienne prise du sud, montre l'ancienne école publique avec sa cours délimitant les habitations des instituteurs et les classes. Au milieu la toute première mairie dont il subsiste encore la porte principale. La maison au n°12 était alors flanquée d'un petit garage.

Sur cette vue aérienne de1970, les jardins du presbytère ont été rognés pour laisser la place à une série de garages qui perdurèrent longtemps, comme nous le montre ce document extrait du bulletin municipal de juin 1990.
Cette photographie aérienne Setap, reproduite par l'abbé Jospeh LE ROCH dans son bulletin paroissial montre l'ancienne salle des fêtes issue du remodelage des batiments de l'ancienne école et de la toute première mairie; .
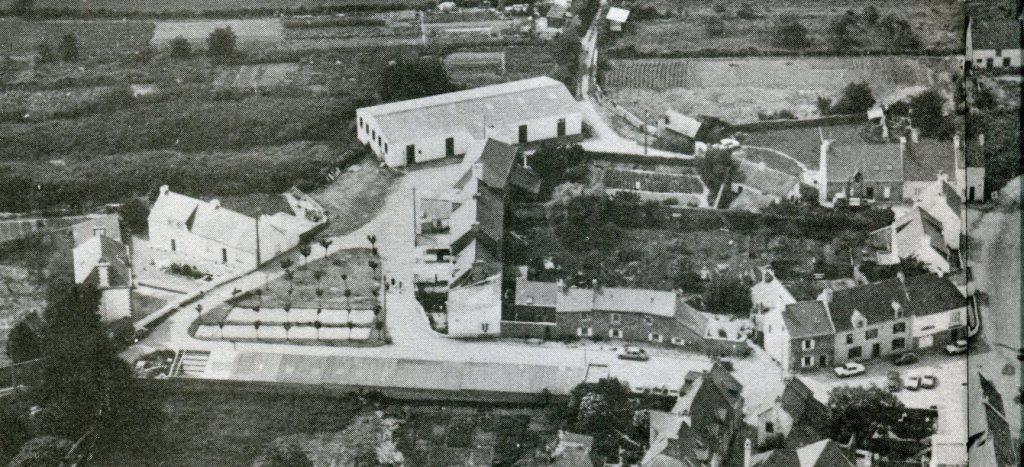
En 1990, l'équipe Carteau avait prévu la construction de logements sur des surfaces allant du jardin du presbytère à la place Cofornic. Ce projet ne verra pas le jour.
Cette vue aérienne de la place Cofornic prise en 2020 montre les deux habitations les plus récentes construites près du Golfe (n°1 et n°3), la façade sud de la maison Gachet, la longère du n°7. Dans leur porlongement, la salle des fêtes. De l'autre côté, les maisons alignées cotée pair et la futur espace qui va faire l'objet d'un aménagement par la municipalité en 2021.

En avril 2021, la municipalité invitait la population a donner son avis sur le projet de réaménagement de la Place de Cofornic. En novembre 2023, le sénateur Uzenat, récemment élu, était convié à l'inauguration de la place Coffornic, redessinée par l'équipe Sculo.

Soeur Felix-Marie, soigne le choléra, 1893
Cet article reprend la nécrologie parue dans le bulletin des Filles du Saint-Esprit après le décès de Paterne KERGAL, en religion Soeur Félix-Marie. Il est complété par des documents relatifs à l'épidémie de choléra qui frappa Séné au printemps 1893.
Déjà, dans les pages de ce Bulletin, nous avons rendu hommage aux grandes vertus de cette respectable Soeur, l'aînée de notre Famille Religieuse. Nous avons souligné en particulier la promptitude et la générosité de son obéissance lors de son rappel à la Maions Principale, la simplicité parfaite avec laquelle elle prit rang parmi les Soeurs de l'Infirmerie.
Ne trouvait-elle pas à la tête du service des malades Soeur Euphrosine-Joseph dont elle avait été la Mère dans la chère Fondation de Séné en deuil depuis son départ?
Nous l'avons vue menant la vie commune comme une simple Novice, pleine de cordialité, affable avec toutes, assidue à la chapelle parce qu'elle y trouvait "le Dieu se son coeur et le Coeur de son Dieu"; asistant à la sainte Messe et s'unissant à Notre-Seigneur au moment de la Communion avec une piété toute séraphqiue.
Laissons à une plume filiale la consolation de résumer sa belle et très féconde carrière.
"Soeur Félix-Marie était née à Theix, le 27 février 1832, dans une famille aisée, très honorable et surtout foncièrement chrétienne. Cet heureux foyer vit naître douze enfants dont six se consacrèrent à Dieu dans la vie religieuse.
"Deux filles entrèrent dans la Congrégation des Filles du Saint-Esprit; deux autres prirent rang dans la Congrégation du Père de Montfort; la cinquième entra au Couvent des Filles de Jésus. à Kermaria, et un fils dans la Société des Frères de Saint-Gabriel, à Saint-Laurent sur Sèvre. Soeur Félix-Marie était l'aînée de la famille; les petits frères réclamant des soins continuels, elle fut initiée de bonne heure au soin du ménage et aux travaux de la ferme. Elle conserva toute sa vie cet esprit d'ordre et d'organisation qui la distingauit déjà dans la maison paternelle.
Dès l'âge tendre, ses parents, lui inspirèrent le goût de la piété. Vers l'époque de la première Communion, elle fut envoyée en pension, chez les Soeurs, au bourg de Theix où elle ne tarda pas à obtenir l'estime de ses maîtresses et de ses compagnes par sa sagesse, son obligence, son application à l'étude au au travail.
Dès lors, la voix du bon Maître se fit entendre à son âme. Rentrée pour quelques temsp dans sa famille, elle ne songea plus qu'à quitter le monde et à se consacrer à Dieu, à l'exemple de ses deux cousines, Soeur Saint-Felix et Soeur Sainte-Isabelle.
Après avoir obtenu le consentement de ses pieux parents, elle dirigea ses pas vers le Noviciat des Filles du Saint-Esprit. Là, au comble de ses désirs, elle travailla courageusement à se former à la vie religieuse. Après quelque smoins d'épreuves, elle fut envoyée à Plérin, pour la visite des malades, sous la direction d'une Soeur.
Elle se plaisait à parler de sa première Fondation qui fut le berceau de notre chère Congrégation.
En 1853 [le 6/9/1853], elle prononça ses Voeux et fut nommée à Groix où elle passa 14 ans, s'occupant des enfants de la salle d'asile. Elle aimait beaucoup ses petis bambins, et dans un âge très avancé,elle se plaisait encore à chanter les cantiques qu'elle leur avait appris dans sa jeunesse, car jusqu'à ses derniersq jours, elle conserva intacte sa mémoire aussi bien que sa lucidité d'esprit.
Ni le travail de l amaison, ni sa classe ne l'empêchaient de voir les malades. Pendant une épidémie de choléra qui fit tant de victimes dans l'île, [ de Groix], elle se rendait d'un village à l'autre. Epuisée de fatique, et n'en pouvant plus, elle tomba évanouie un jour en rentrant à la maison. Elle se crût elle-même atteinte par le terrible fléau. Mais le bon Dieu veillait sur elle et la réservait pour d'autres travaux.
Jeune encore, elle fut nommée Supérieure à Erdeven où elle commença la Maison. Les débuts d'une Fondation sont souvent pénibles. Cependant, sous sa direction, la classe devint prospère, avec le concours de deux Maîtres ses zélées et capables, dont l'une vit encore, c'est Soeur Gabrielle, Supérieure à la Communauté de Douarnenez. Ici comme ailleurs, son dévouement pour les malades fut sans bornes, et les gens qui l'ont vue à l'oeuvre en parlent encore avec admiration.
C'est surtout à Séné où elle passa un demi-siècle qu'elle exerça son zème et son activité.
A son arrivée dans cette localité [ le 1er janvier 1872] , la situation de l'Ecole laissait beaucoup à désirer; les locaux n'étant pas suffisant, deux Soeurs se voyaient obligées d'aller faire une classe à la campagne, dans les villages distants du bourg d'au moins quatre kilomètres. Cet état de choses la peina; aussi se mit-elle en devoir de construire de nouvelles classes afin d'y réunir toutes les petites filles de la paroisse.
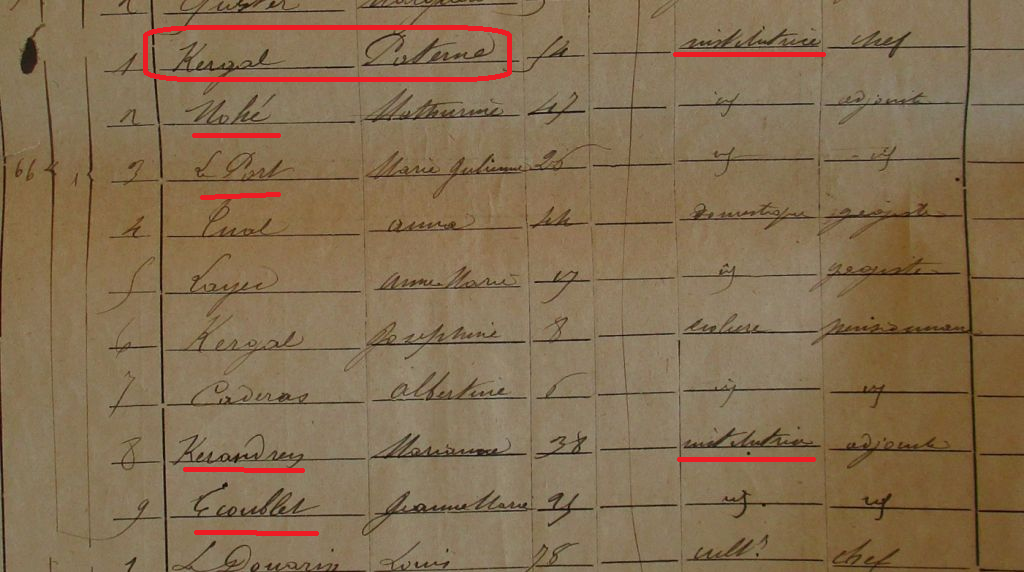
Extrait du dénombrement de Sén en 1886
Elle se fit elle-même architecte, dirigeant les travaux, ne craignant pas ni peine, ni fatigue pour aller jusqu'aux carrières de Saint-Nolf recommander les pierres de taille et les matériaux nécéessaires à la bâtisse.
Bientôt trois belles classes, reçurent toute la population scolaire, et les Religieuses eurent la direction de l'Ecole communale, - qui fut très prospère , - jusqu'à l'application de la loi néfaste interdisant l'enseignement aux Congrégations.
Un arrêté ministériel, daté du 13 juillet 1902 intimait l'ordre de quitter une maions indûment occupée. Huit jours seulement étaient accordés pour évacuer les locaux.
Que de peines, que de soucis incombèrent à la chère Supérieure pour tout réorganiser ! En septembre 1902, les classes s'ouvrirent sous la direction d'une personne dévouée qui prodigua pendant plusieurs années ses ressources et son dévouement pour le maintien de l'Ecole chrétienne.
[Le texte parle de Marie Louise GACHET [21/5/1880-10//1958] lire article sur l'Histoire des Ecoles]
En prévision d'une confiscation prochaine du Couvent, M. Le recteur obtint d'une personne du bourg, très généreuse et très dévouée aux bonnes oeuvres, un grand et beau terrain pour construire une nouvelle Ecole libre.
Chassée de cette maison qu'elle avait bâtie, où elle avait tant prié, travaillé et souffert, Soeur Felix-Marie ne cessait pas pour cela de se livrer à la visite des malades qui devenaient de plus en plus l'objet de ses soins charitalbes.
Que de viellards n'a-telle as conduits à Vannes, soit à l'hôpital, soit chez les Petites Soeurs des pauvres ! Elle sollicitait les aumônes des riches pour l'admission de ses protgés dans ces asiles charitables où ces bons vieux terminaient leur jours dans la paix et la tranquilité.
Combien de pauvres aussi n'a-t-elle pas secourus discrètement, leur procurant des couvertures pour l'hiver, des vêtements ou autres soulagements dans leurs maladies! Rien ne lui coûtait quand il s'agissait de secourrir un malheureux.
Un généreux bienfaiteur la faisait la distributrice de ses aumônes, et c'était pour elle un bonheur que de donner des "Bons de pain" aux indigents qui usaient de son influence pour solliciter des secours pour eux et pour leurs familles.
En mars 1893, éclata une terrible épidémie de choléra; plusieurs malades furent enlevés en vingtèquatre heures; et une trentaine de personnes sucommbèrent en quelques jours. La chère Supérieure donna toute sa peine, tout son temps, n'épargna rien pour soigner, visite, consoler ces pauvres victimes.
Mais ses forces ne suffisant pas à la tâche, l'Administration préfectorale ne tarda pas à lui envoyer, tous les matins, une voiture d'ambulance, pour la conduire dansles villages les plus éprouvés par le fléau.
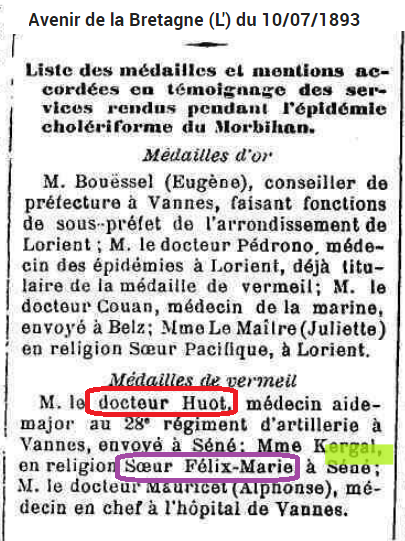
D'après les ordonnances d'un Major [le Docteur HUOT, major au 28° RA], elle distribuait aux malades les médicaments délivrés par la Préfecture. En reconnaissance de tout son dévouement, le Ministère lui décerna une Médaille de Vermeil, et la population applaudit à cette distinction. Quant à la vaillante Soeur, elle n'en fut pas émue; on la vit seulement par la suite plus modeste encore dans l'exercice de la charité.
Tandis que ces forces le lui permirent, elle travailla courageusement au bien de la Communauté.
Depuis plusieurs années, une infirmité, qui n'ôtait rien à son activité, la gênait beaucoup dans ses mouvements. "J'ai de sottes mains encore aujourdh'ui". disait-elle. Jamais une palinte dans les malaises inhérents à la vieillesse. Son aspiration favorite était alors : "Mon Jésus, ayez pitié de moi".
Elle vait une grande dévotion pour le saint Sacrifice de la Messe, mais la distance de l'église la privait souvent du bonheur d'y assister; [les soeurs vivent loin du bourg]. Aussi se trouvait-elle heureuse à la Maison-Mère de communier tous le sjours, et de visiter Jésus dans son divin Sacrfement. Que de prières ardentes se sontélevées de son coeur, là, près du Tabernacle pour la sainte Eglise, pour notre Congrégation, pour tous ceux qu'elle aimait!
Quelques jours avant son départ pour Saint-Brieuc, la population de Séné se préparait à fêter ses "Noces de rubis". C'était une occasion merveilleuse de lui témoigner son estime et sa reconnaissance, pour tout le bien qu'elle avait fait dans la paroisse. Soudain une lettre de notre bonne Mère la rapelle à la Maison Principale.
Aussitôt, avec le plus grand calme, elle fit ses préparatifs de départ, comme s'il agissait de se rendre à la retraite annuelle. Elle voyait la volonté de Dieu dans celle de ses Supérieures.
C'est dans la paix et le repos de la Maison-Mère, où elle a passé seulement quinze mois, que le bon Maître est venu prendre sa fidèle Epouse pour la conduire au Ciel. Elle y prie certainement pour nous qui l'avons tant aimée et vénérée.
Elle décède à la maison Mère à Saint-Brieux, le 12 décembre 1924.
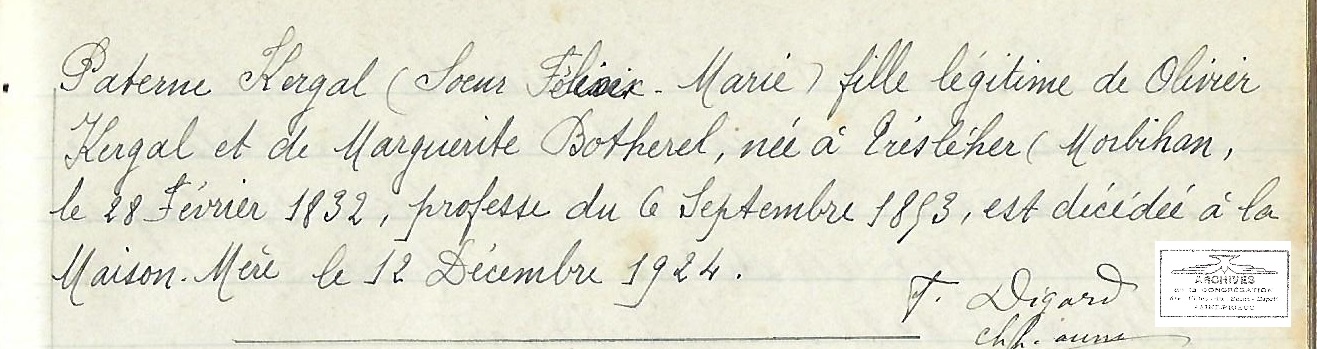
L'épidémie choleriforme à Séné en 1893
A plusieurs reprises cette réclame apparait dans les numéros des journeaux du Morbihan en avril et mai 1893.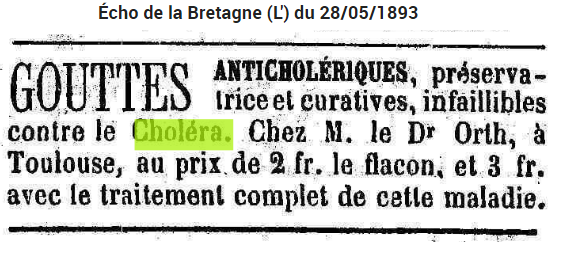
Cet article de la Liberté Morbihannaise est daté du 11 avril 1893 et montre que l'épidémie est sérieuse et mobilise jusqu'au Prefet du Morbihan, Henri POIRSON.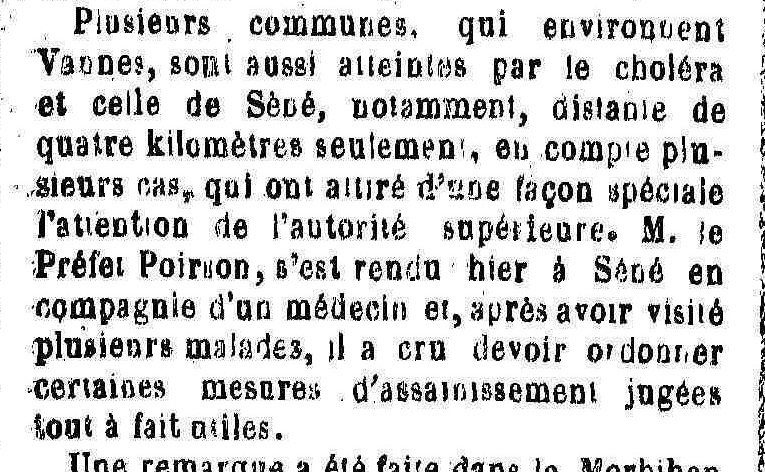
Malheureusement, les archives du Morbihan ne conservent pas tous les numéros des journaux de cette époque. On peut penser que dans un souci de transparence et afin d'éviter la panique, les autorités publient un état sanitaire de l'épidémie, comme le 29 avril et ce 9 mai 1893. Plusieurs cas sont déclarés à Séné dont un mortel le 20 avril 1893.
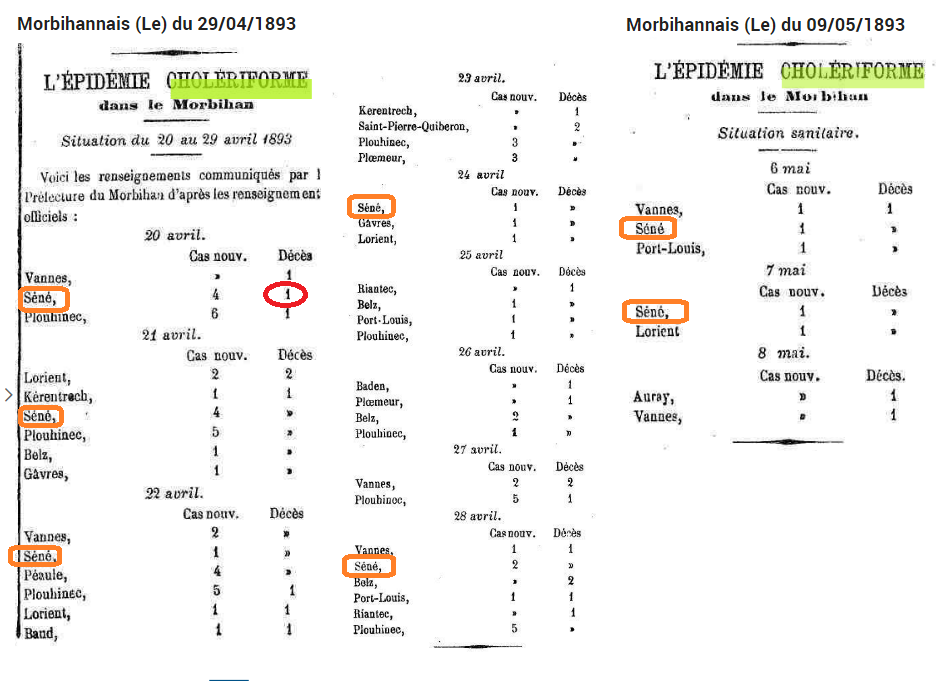
La consultation des actes de décès à Séné montre 8 décès en janvier 1893, 8 décès en février, 5 décès en mars et 17 décès en avril 1893 puis 14 décès en mai. Une quinzaine de décès supplémentaires imputables à l'épidémie de choléra ?
Les actes de décès à Séné n'indiquent pas la cause du décès. Il se peut également que des décès aient eu lieu à l'Hôpital de Vannes. Cependant aucun Sinagot n'est pointé dans les registres de décès de Vannes mais il se peut que l'Hôpital Civil & Militaire, rue de la Loi à Vannes n'ait pas retranscrit tous les décès pendant l'épidémie. [Consulter aux Archives les registres de l'hopital].
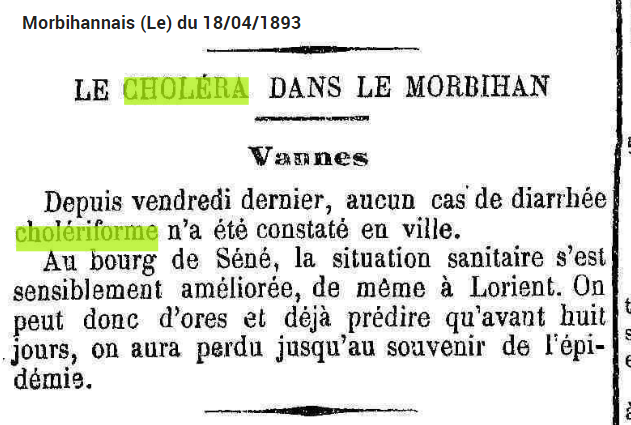
L'épidémie à Séné est suffisamment sérieuse pour que l'Hôpital de Vannes décide d'envoyer sur place le medecin aide-major Huot du 28° régiment d'Artillerie à Vannes. Des dépenses importantes auront été engagées pendant l'épdiémie comme nousl'indique cet article de presse.
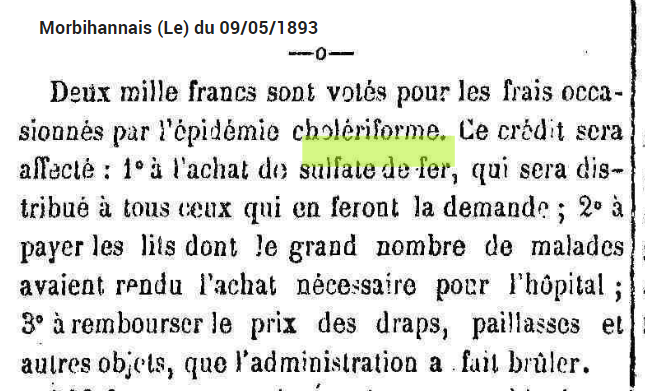
Finalement, les cas de choléra finissent par se raréfier. Le 20 mai la Croix du Morbihan rassure le public attendu aux prochaines régates de Conleau et Séné.
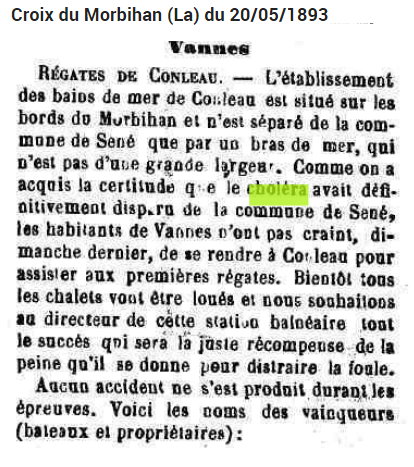
Les mairies de Séné
Ces deux vues de l'ancienne mairie de Séné datent respectivement de 1928 et 1941. Entre ces 2 dates, l'édifice a été doté d'une horloge et d'un beau balcon en fer forgé. Dans le bulletin municipal de décembre 1990, avant l'agrandissement de la mairie, tel que nous la connaissons aujourd'hui, un historique avait été dressé par Vincent Le Franc, conseiller municipal qui resta en poste de 1947 à 1997.
Il nous apprend que la décision de principe de construire cette mairie fut prise le 17 février 1924, sous le mandat de Ferdinand ROBERT. Le 15 juin 1924, les plans de l'architecte Germain de Vannes et le devis de 53.900 Frs furent approuvés.
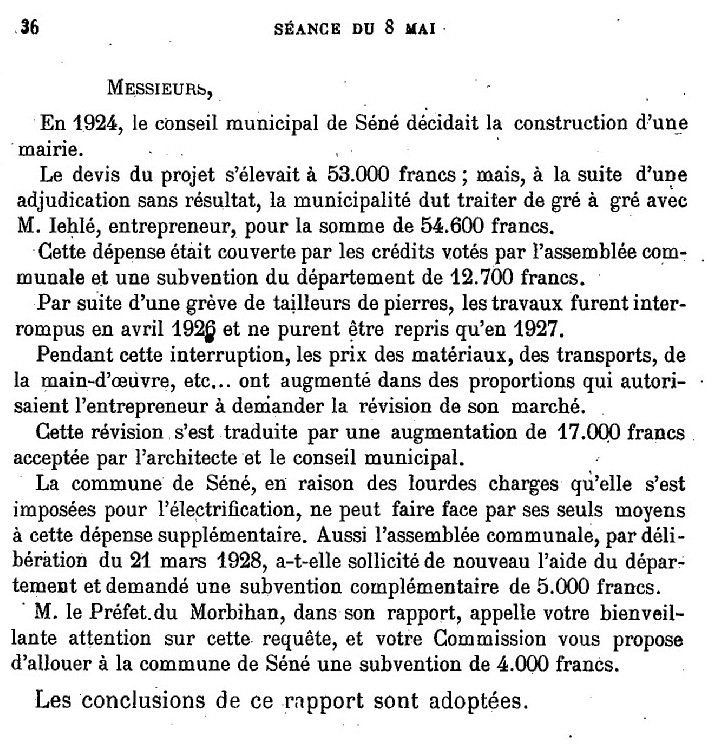
Le 2 août 1925, les travaux furent confiés à une entreprise JEHLE de Soissons. Le 22 janvier 1928, une rallonge de 17.000 Frs fut votée afin de finir le toit de l'édifice. La mairie fut officiellement inaugurée le 31 juillet 1930, Henri MENARD étant alors le maire de Séné.
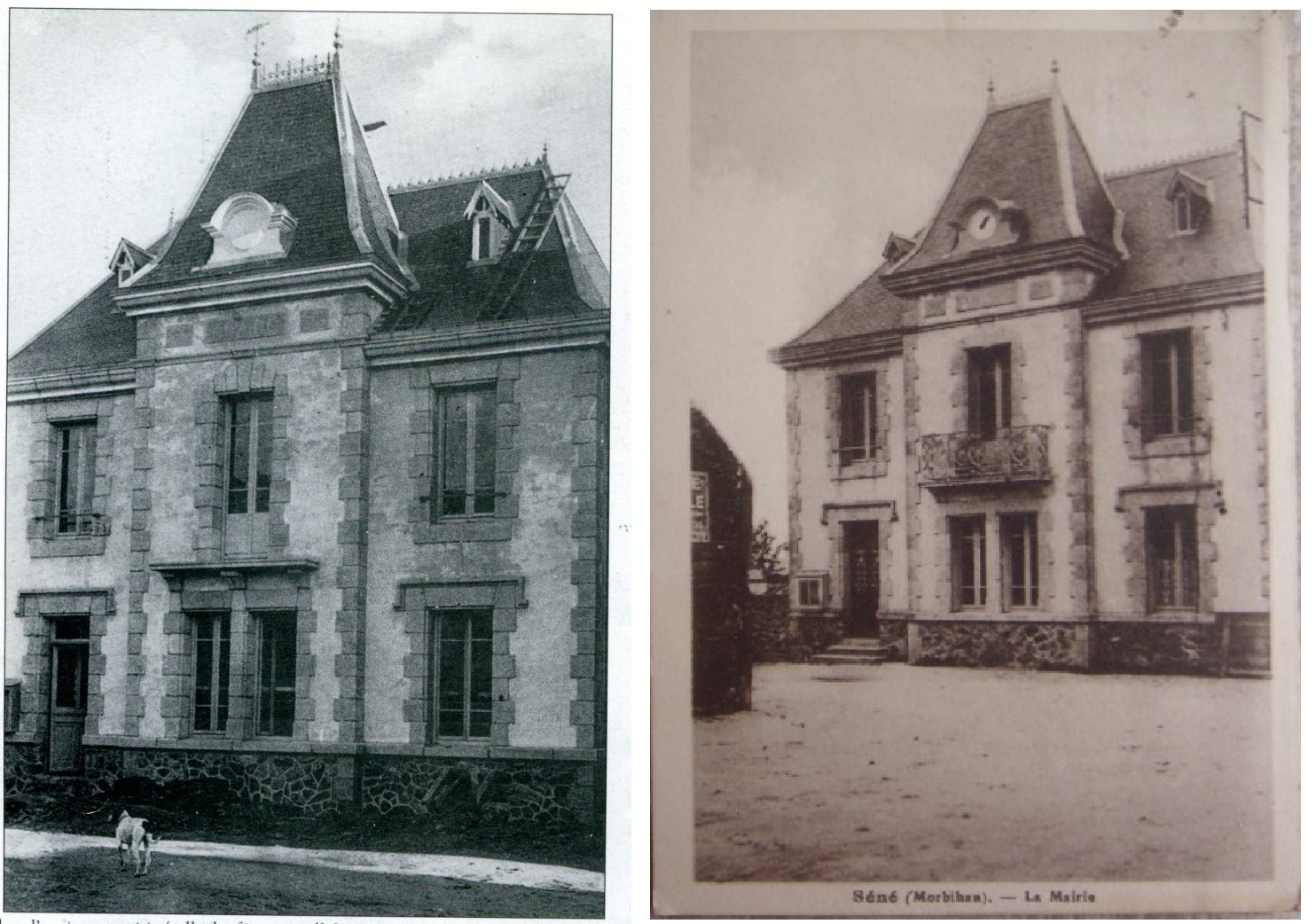
Le conseil municipal décida à l'unanimité de construire la nouvelle mairie au centre du bourg. Il acquit pour 1.000 Frs un viel immeuble appartenant au Bureau de Bienfaisance et pour 35.000 Frs, la maison Simon, qui s'élevait en plein milieu de la rue Principale. Le cadastre de 1845 permet de situer ces acquisitation immobilières de la commune. Il semble donc que la mairie fut construire en lieu et place d'un batiment existant.
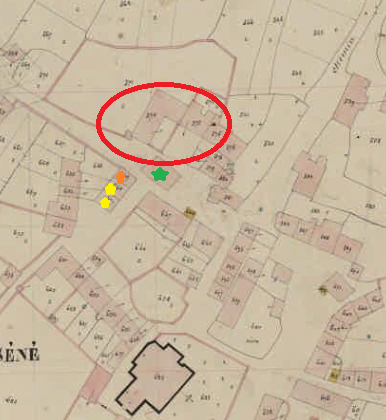
La toute première mairie de Séné date de la construction de la première école au bourg en 1846 [lire article sur les écoles]. Initiée par Vincent ROZO, c'est son successeur, Pierre LE DOUARIN qui suivra les travaux de l'école qui comprenait à l'étage, aux côtés du petit appartement de l'instituteur, une salle dédiée à la mairie.
Le 31/8/1873, le conseil municipal décide d'agrandir l'école des garçons et de se doter d'une mairie séparée. La nouvelle mairie (et la nouvelle classe) font l'objet d'un récépissé de travaux le 10/12/1874.

Sur cette photo, une réunion de marins devant la mairie.On reconnait le bâtiment avec ses contours de fenêtres et de portes en briques. On dicerne l'entrée de la cour à droite. Sur cette vue aérienne des années 1950, on reconnait les deux batiments des écoles de filles et de garçons avec la cour séparative et la petite mairie. Le plan de 1920 ci-après, confirme l'implantation de la mairie, place Coffornic jusqu'en 1928.

1953 Ci-dessus, vue des écoles du bourg. On distingue la mairie.
Ci-dessous vue latérale : Ecole nord - mairie - Ecole sud


Sur l'actuelle salle de fêtes on peut encore observer l'ancienne entrée de la toute première mairie.L'architecte a choit les briques pour les contours des fenêtres.
Le premier maire de Séné, Marc BENOIT, signe son premier acte d'état civil le 30 août 1792. Où se réunissait le conseil municipal à l'époque? Le besoin d'un lieu propre à l'administration de la commune mis donc plus de 50 ans à se concrétiser.
Le premier secrétaire de mairie fut l'institueur Pierre Maire LOISEAU en 1855.
L'inauguration de la nouvelle mairie eut lieu le dimanche 27 juillet 1930, comme nous l'annonce cet article de presse de l'Ouest Républicain. Le maire Henri MENARD, qui organisera en 1931 un meeting aérien à Cano [lire article dédié], réussit ce jour-là à faire venir un grand nombre "d'Officiels" dont Alphonse RIO, sous-secrétaire d'état du 2° Gouvernement de André Tardieu, pour à la fois inaugurer la nouvelle mairie et un pylone électrique à Bellevue, comme nouis le relate le compte-rendu du journal, "L'Avenir du Morbihan".
(Lire également l'article qui présente les grand travaux du maire (dont une nouvelle mairie) avorté à cause de la guerre)
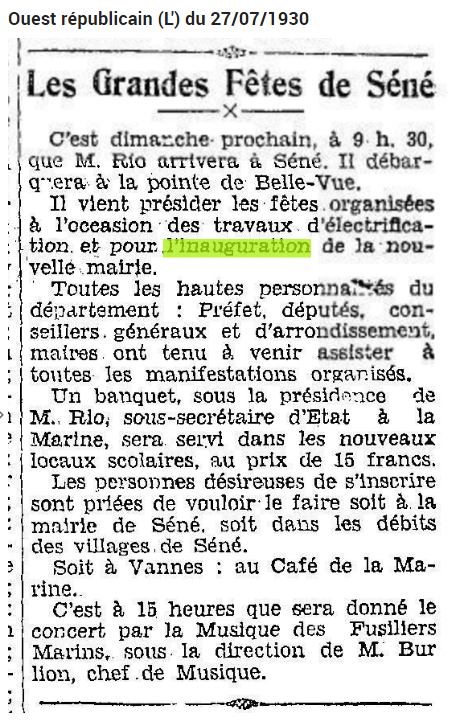

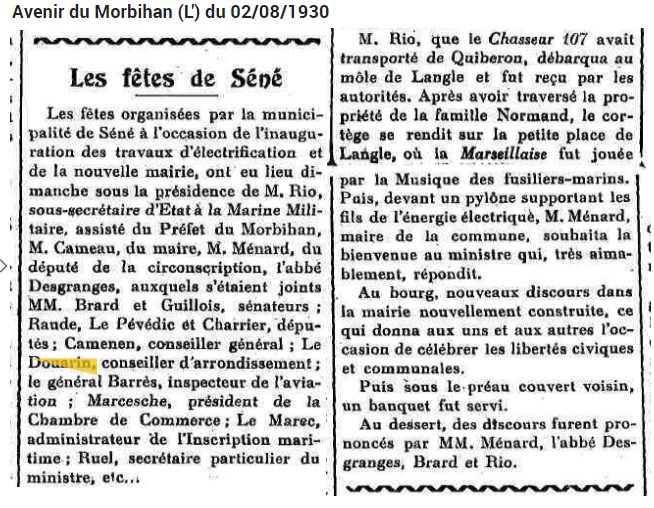
Ce dernier article indique que le banquet eut lieu sous le préau couvert voisin. Il se peut que l'école et son préau existassent déjà ou bien que la construction de la nouvelle mairie s'acompagnat de celle d'une nouvelle école et préau. Il était en effet fréquent de "confondre" école publique et mairie en ces temps là.
Cette photo nous montre une vue arrière de la mairie. Deux maisons place Coffornic seront démolies (lire article dédidé). Le batiment accolé à la mairie n'est autre que le préau . L'école à gauche apparait avec sa cour de récréation (lire article sur l'histoire des écoles).
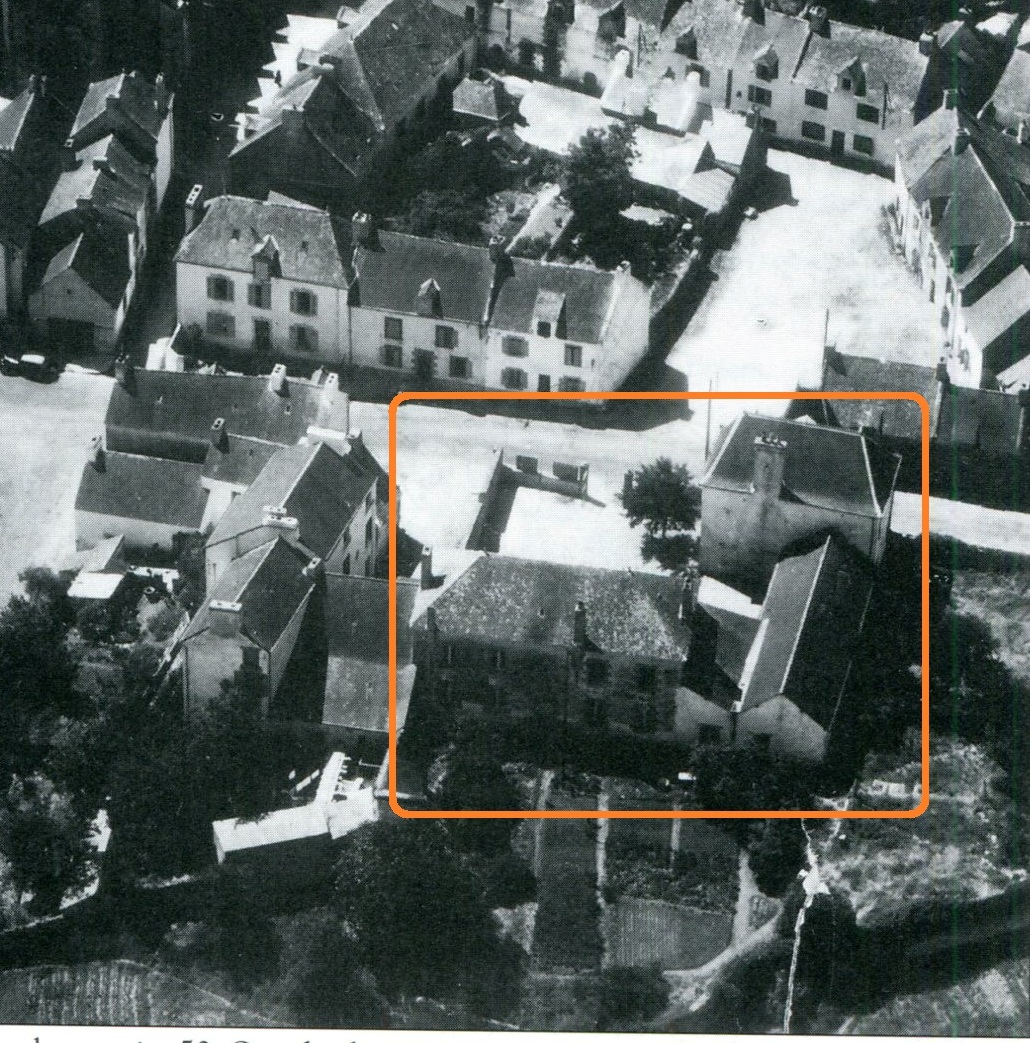
Cette vue datée de 1960, montre la mairie avec ses ateliers attenant qui occupe l'ancien préau.

Vue de 1990 en couleur, avant les travaux d'extension. L'ancien préau a laissé place à des bureaux.
Quatre projets étaient en lice pour l'aggrandissement de la mairie de Séné, décidés et réalisée sous le mandat de Marcel CARTEAU. Le conseil municipal retint le projet des architectes Christophe & Bernard GUILLOUET. Le coût de la construction s'éleva à 7.182.000 Frs TTC. Par la suite, le terrain jouxtant fut transformé en parking.
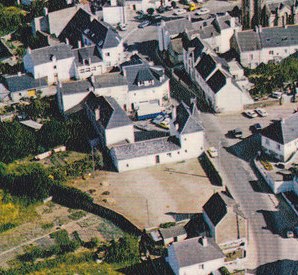
L'ancien préau de l'école qui fut réhabilité en bureau, est détruit.
Aux origines de la Salle des Fêtes
L'Institut National Géographique effectue depuis les années 1930, des relevés aériens du territoire français. Depuis la Libération, ils sont plus fréquents et précis, parfois en couleur, et permettent de retracer l'histoire d'un lieu "vu du ciel".
Cette vue plongeante de 1953 sur le bourg de Séné montre qu'à l'actuel emplacement de notre salle des fête, il existait là deux batiments occupés par les écoles du bourg (lire article dédié) et la première mairie.
Après le transfert de l'école des garçons vers l'actuel Ecomusée, les anciennes écoles trouvèrent une nouvelle utilisation.
Le relevé de 1960 montre que la maison au sud a été reconstruite pour laisser place à une 1ère salle des fêtes. La vue aérienne de 1970, ne nous montre plus qu'un seul bâtiment, la salle des fêtes telle qu'elle était avant sa rénovation entreprise en 1992.
Aujourd'hui,la salle des fêtes est fort utile aux nombreuses associations et lors de cérémonies républicaines.
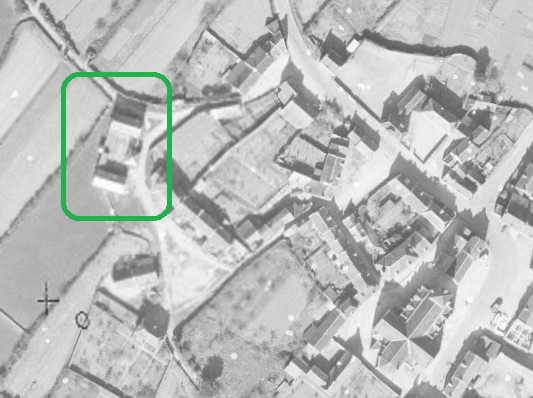
1953

Cette photo aérienne doit dater de la même époque. On y voit au premier plan les deux maisons jumelées par une cloture. Les bâtisses à gauche et à droite étaient occupées par les écoles. On devine la petite mairie au centre.

1960
Cette vue de 1960 montre la toute première salle des fêtes de Séné. Elle sera "fusionnée" avec l'autre batisse pour donner une nouvelle salle des fête plus spacieuse.

1970
Vue de l'ancienne salle des fêtes en 1991

1992
Projet de l'architecte Robert

2015
Histoire de l'île de Boëd

Les géographes savent figer le temps sur leur cartes. Au temps de Cassini, on trouve sur l'île de Boëd une chapelle et sur la côte nord plusieurs oeillets de salines sont figurés.
Cependant, la présence humaine sur cette terre date du temps des mégalithes. En effet, sur l'île de Boëd, autrefois rattachée au continent, furent élevés des dolmens dont il nous reste quelques vestiges (Lire article par Archéologie). On peut voir au Musée Gaillard, une hache en fibrolite retrouvée sur Boëd.

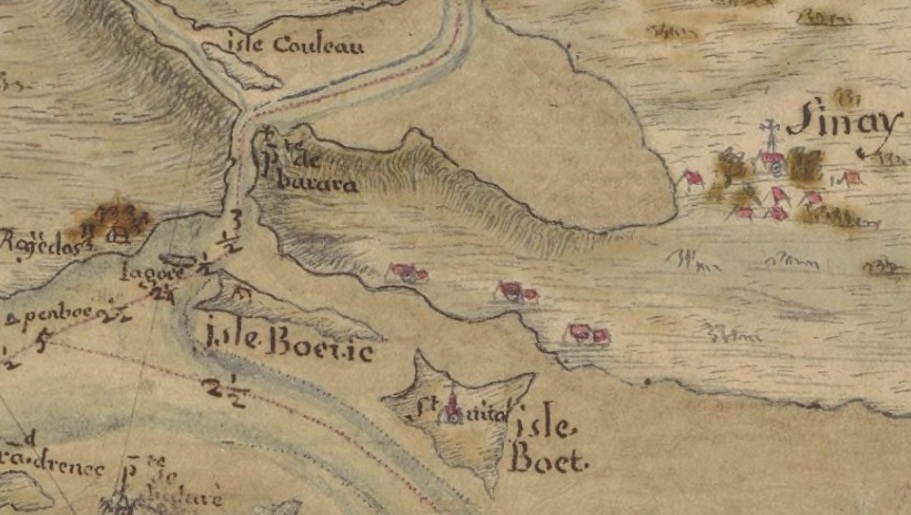
C'est sans doute pour effacer ces rites druidiques de la mémoire des habitants, que fut érigée sur Boëd une petite chapelle. Cette carte datée de 1771-1785, le situe par un carré rouge comme elle indique l'emplacement des mégalithes par deux croix rouges, l'une sur la butte du Petit Bout et l'autre à l'ouest de l'île.
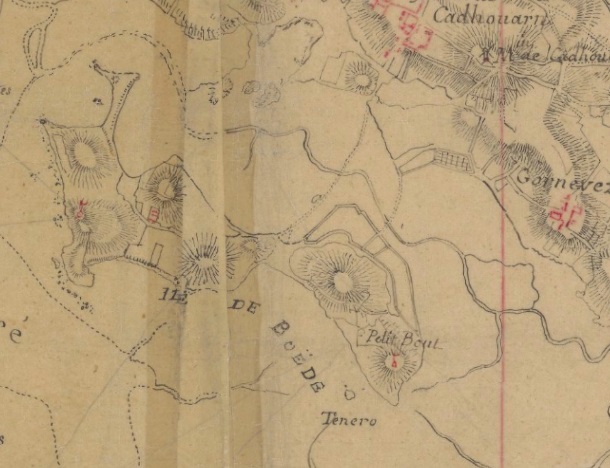
Etymologie : Le vice-amiral Antoine-Jean-Marie Thévenard [Saint-Malo 7/12/1733-Paris 9/2/1815] donne une étymologie aux mot boëd dans ses Mémoires Relatifs à la Marine Tome II édité en l'an VIII.
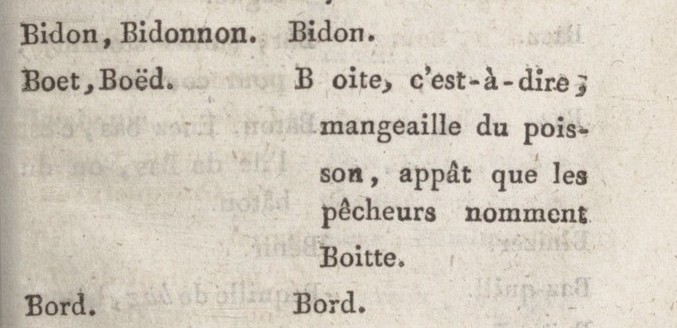
Voici ce que dit, dans son dernier ouvrage publié en 1847, François-Marie Cayot-Délandre (13/3/1796 Rennes-7/9/1848 Vannes) de la Société Archéologique du Morbihan, à propos de la chapelle et des vestiges de mégalithes:
De ce point de la côte du Morbihan à l'île de Boued, qui fait partie du territoire de Séné, il n'y a qu'une fort petite distance, qu'on peut franchir à marée basse en passant sur une digue ou chaussée établie pour faciliter les communications entre cette petite île et le continent. Une antique petite chapelle ogivale se voit de loin sur cette terre dépouvues d'arbres; elle n'offre aucun intérêt sous le rapport de l'art; elle est remarquable seulement par sa position au milieu des monuments druidiques, dont les vestiges, malheureusement très incomplets, suffisent cependant pour témoigner de l'importance qu'ils durent avoir.
Au nord-ouest de la chapelle et sur le sommet pierreux d'un mamelon, se voient les débris d'un dolmen placé au centre d'un cromlech, dont le cercle est encore assez bien tracé pour qu'on puisse le distinguer. La position de ce monument sur un monticule dont le pied est battu par l'océan, indiquerait seule l'importance de ce coin de terre sour le rapport de l'exercice du culte druidique; mais cette importance s'accroit encore par la présence d'autres monuments du même genre placés à l'extrémitié opposée de l'île, au sud-ouest de la chapelle, où se trouvent deux mamelons, dont le plus rapprochés présente un dolmen bouleversé, et l'autre trois monuments de même espèce, pour ainsi dire contigus, mais dans un état de ruine complète.
Le relevé du cadastre napoléonnien de 1810 montre une multitude de parcelles traduisant une longue présence humaine et des successions de propriétaires. Pourtant, l'île ne compte qu'une métairie et les ruines de l'ancienne chapelle Saint Vital. (Lire article dans Eglises é chapelles). Au nord est de l'île, plusieurs oeillets de marais salants.
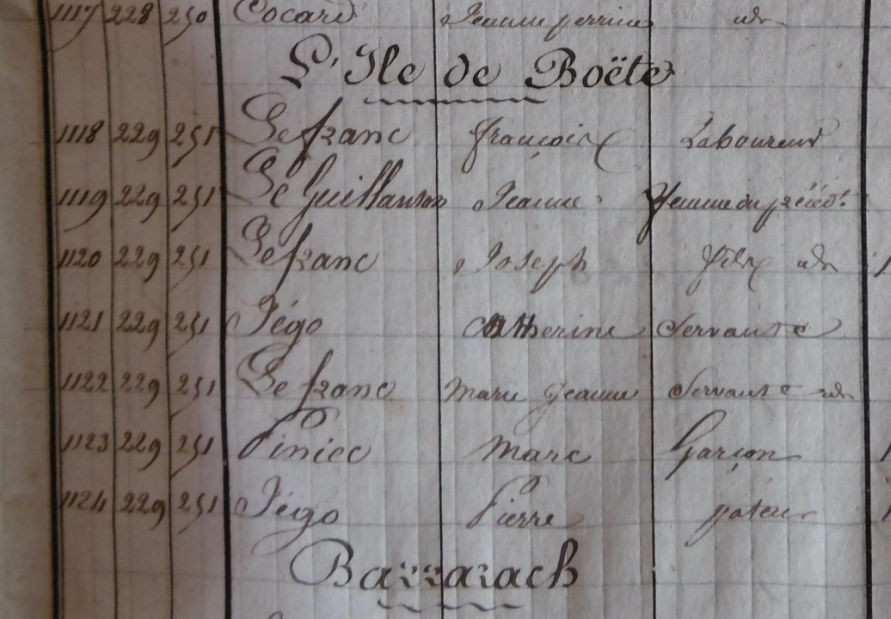
Lors du dénombrement de 1841, on ne recense aucun paludier sur Boëd, indiquant que les salines sont entretenuent par quelqu'un du continent.
François LE FRANC, né à Boët, et son épouse Jeanne LE GUILLANTON, sont établis dans la 1ère métairie de l'île de Boëd.
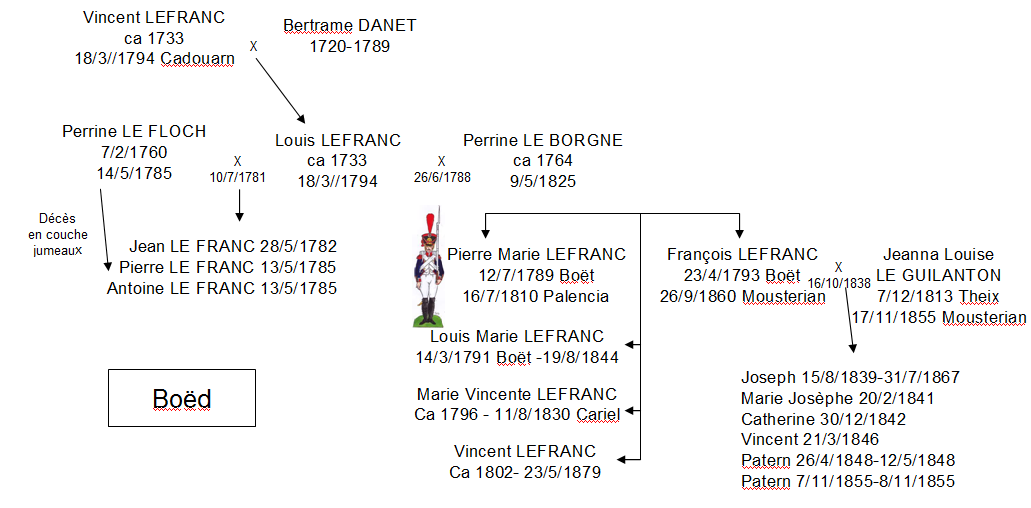
En consultant les registres de l'état civil, on peut reconstituer la généalogie de François LE FRANC. Ainsi, son père Louis LE FRANC, natif de Cariel, s'est marié en 1781 avec sa première femme, Perrine LE FLOCH, tous deux habitant Séné sans plus de précision. Leur premier enfant, Jean LE FRANC qui nait à Boëd le 28/5/1782, permet d'éstimer que les Le Franc s'établirent sur Boëd au plus tard vers 1781-82 et que leur venue sur l'île n'est pas liée à la Révolution Française.
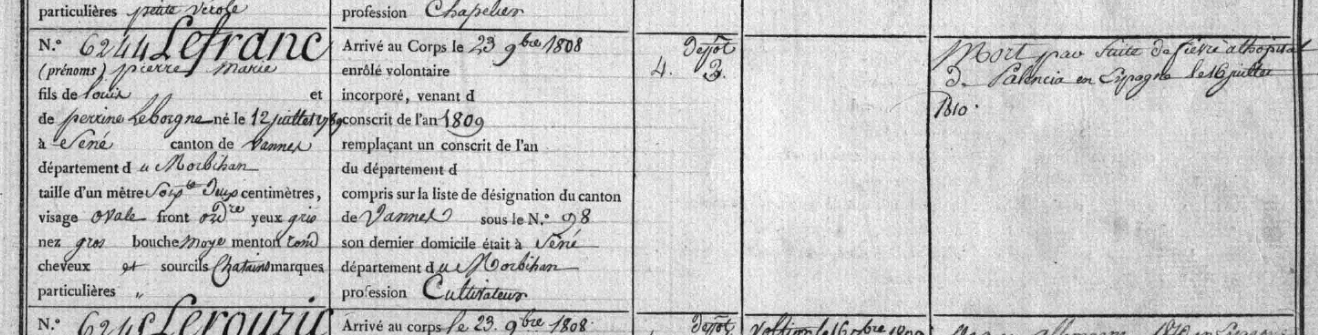
Son frère, Pierre Marie LEFRANC, est "arrivé au corps" le 23/11/1808 au sein du 75° Régiment d'Infanterie de Ligne de la Grande Armée de Napoléon 1er. Il moura de fièvre (typhoïde?) à Palencia en Espagne en 1810.
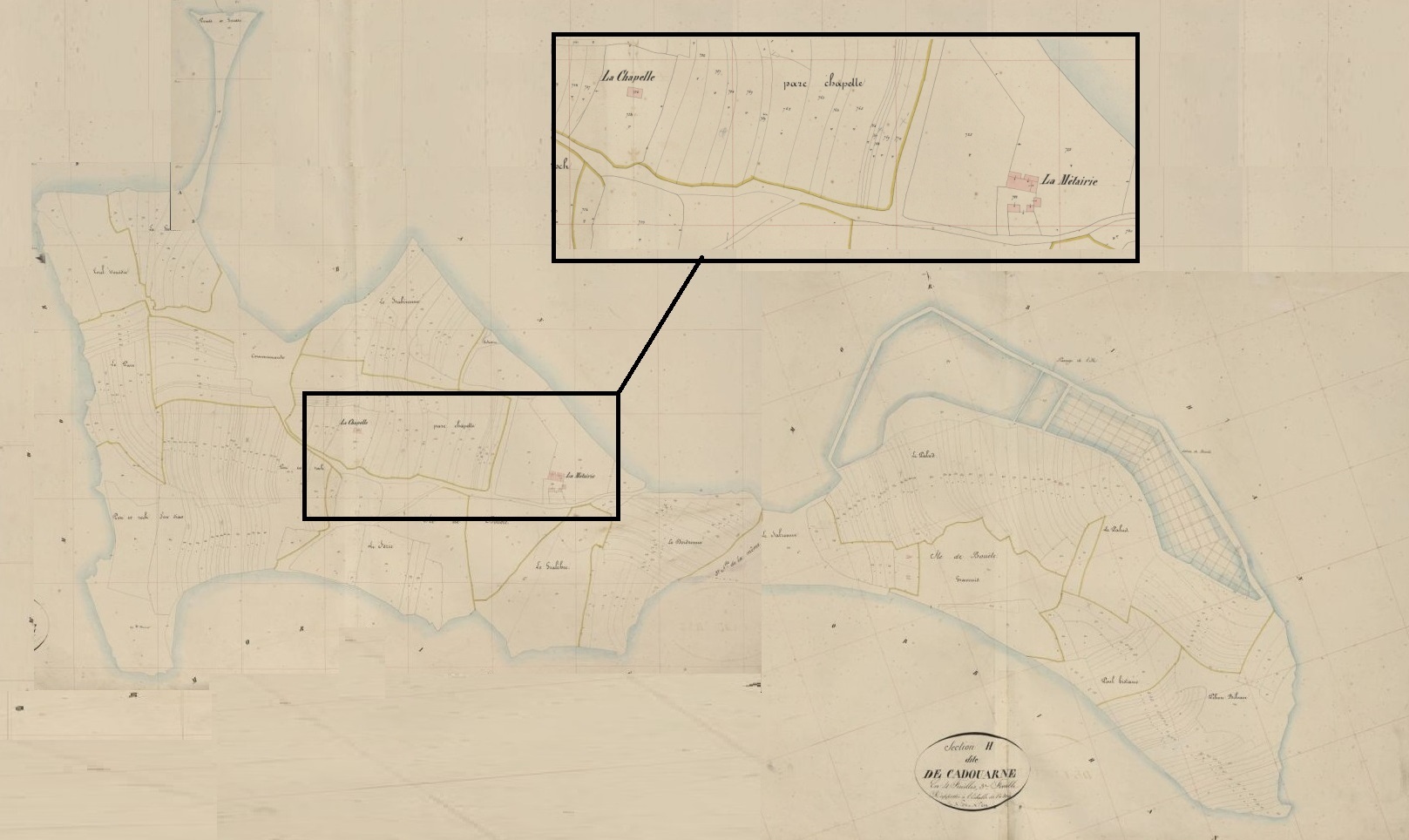
Le relevé cadastral de 1845, précise le contour des oeillets des marais salants et situe à nouveau la chapelle et la métairie occupée par les Le Franc. La comparaison des dates de naissances de leur deux derniers enfants morts en bas âge, Patern LE FRANC en 1848 et Patern LE FRANC en 1855, permet de dire que la famille Le Franc quitta l'île de Boed pour s'installer à Moustérian comme cultivateur.
1ère maison, métairie de cultivateurs : Louis LE FRANC [1782-1831] ->François LE FRANC [1831-1855]->
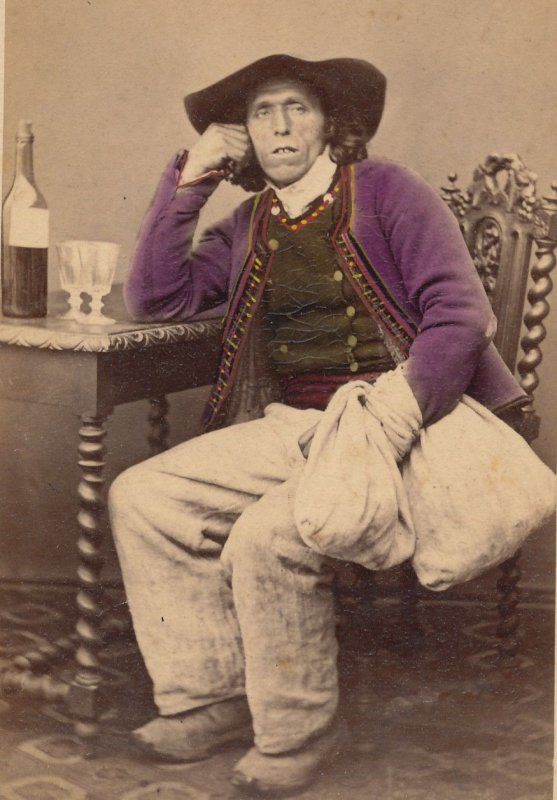
Entre 1848 et 1860, les tables annuelles des registres d'état civil incluent l'indication du village de naissance ou de décès. Ainsi est-il plus aisé de repérer la famille de Julien MONFORT [8/01/1815-1/05/1904] et Marie Vincente LE GALLIC [1817-24/6/1875], établis comme paludiers sur l'île de Boët. La naissance d'un enfant mort-né le 1/08/1839, nous apprend qu'ils étaient originaires du village du Gohavert. Leur premier enfant nait sur l'île de Boët le 13/11/1840, (après le passage de l'officier en charge du resencement), et leur septième enfant, Jeanne Marie nait à Boët le 3/5/1853. De cette époque doit dater la constructionde la 2° maison sur Boëd, occupée par des paludiers et ensuite par des cultivateurs.
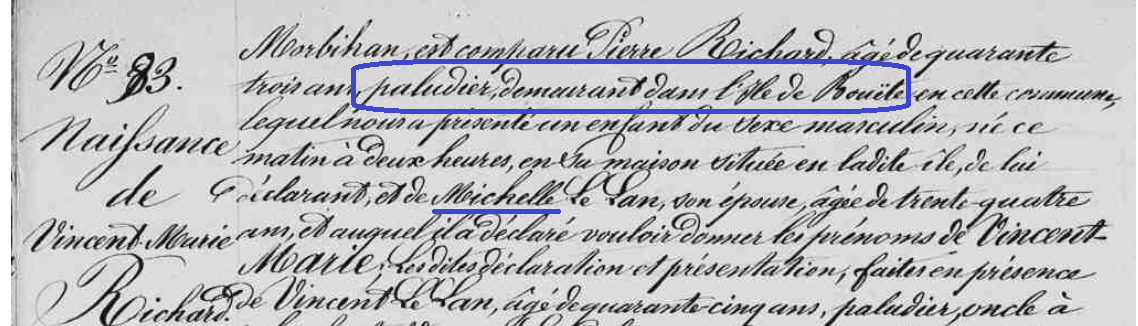
On repère également l'acte de naisance de Vincent Marie RICHARD né le 13/7/1859 et dont les parents, Pierre RICHARD et Michelle LE LAN, sont paludiers à Bouet. Leur autre enfant Michelle RICHARD nait à Billerois alors que ses parents sont journaliers sur les salines. Ils reprendront donc les salines de Bouet au départ des Monfort. Michelle épouse le 10/9/1882 Pierre Marie LE RAY mais elle déclare déjà la profession de cultivatrice, confirmant l'arrêt de la saliciculture à Boëd.
2° maison : salines de Boëd : les Monfort (1840-1855) puis les Richard (1855-1880)
Le dénombrement de 1901 indique la présence de 2 familles de cultivateurs établis sur Boëd : la famille MALRY x Savary qui emploie leurs neveux, Jeanne Louise et Arsène MALRY et la famille LE RAY x Richard.
La généalogie de Vincent Marie MALRY nous renseigne sur la date d'arrivée des Malry à Boëd. Lui (16/4/1859 Boët) et son frère Jean Louis MALRY (3/06/1857 Boët) sont nés sur l'île. Leur soeur Julienne Marie, quant à elle nait à Vannes le 1/2/1854 comme l'ainé de la famille Jean Marie le 1/7/1852. Ainsi,, leurs parents, Patern MALRY [4/1/1828-14/1/1879] et sa première épouse Marie Vincente BOTHEREL [8/9/1824-17/1/1871], originaires de Vannes, s'installent comme cultivateurs sur l'île de Boëd à la suite du départ des Le Franc vers 1855.
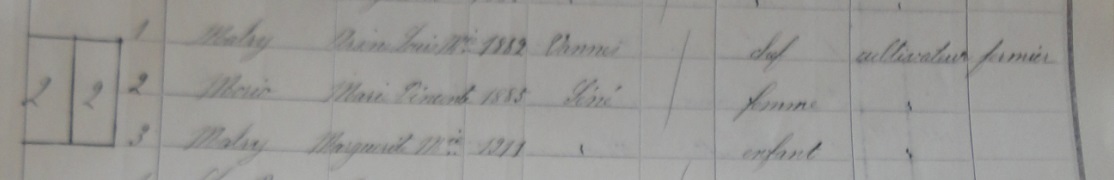
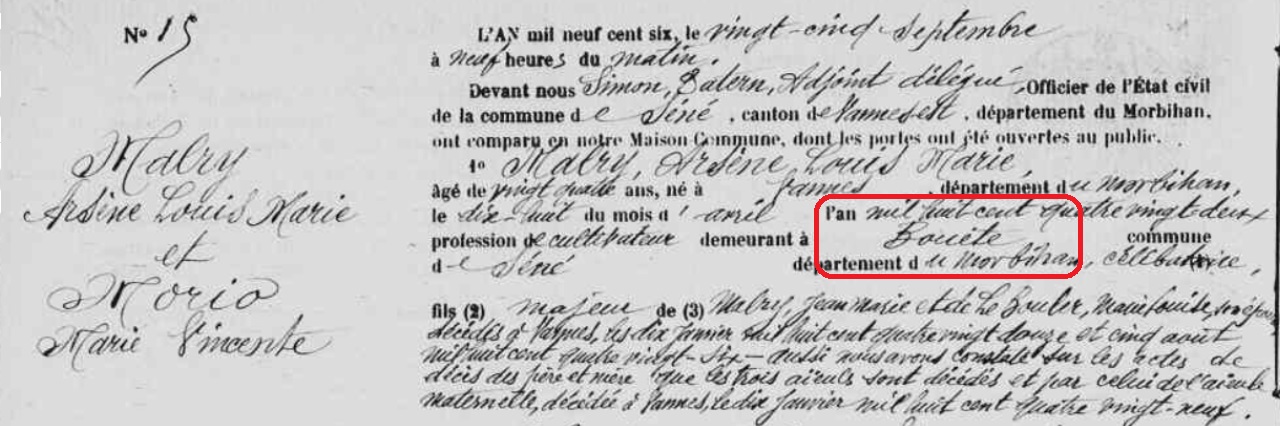
Au décès de Vincent Marie MALRY, son neveu, Arsène Louis Marie MALRY [18/4/1882-7/10/1915] reprend l'exploitation. En 1906, lors de son mariage, il est sur Boëd et lors du dénombrement de 1911, il est pointé aec son épouse et son fils. Arsène MALRY, Mort pour la France, décèdera à Tahure pendant la guerre de 14-18. (lire page Centenaire)
1ère maison, métérairie de cultivateurs :
Louis LE FRANC [1782-1831] ->François LE FRANC [1831-1855]->Patern MALRY [1855-1879]-> Vincent Marie MALRY [1880- ca1905 ]-> Arsène MALRY [ ca1905-1914]
La généalogie de Pierre Marie LE RAY [ 9/9/1846-24/5/1911] nous renseigne sur la date de leur établissement à Boëd. Lors de son mariage, le 10/9/1882, sa future épouse, Michelle Marie RICHARD [23/8/1856 -? ]déclare être cultivatrice à Boëd. Leur 1er enfant, Ange Mathurin LE RAY [11/6/1883-31/12/1902] nait sur l'île où il décède enfant.
2° maison : les Monfort (1840-1855), paludiers puis les Richard (1855-1880), paludiers puis les Le Ray, cultivateurs.
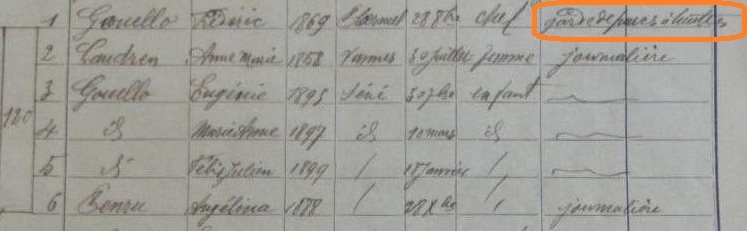
En 1906, Frédéric GOUELLO, gardien des parc à huîtres, vit également sur l'île dans la tour de Ténéro (Lire l'histoire complète de la Tour Tenero). On retrouve ces 3 familles au dénombrement de 1911.
Après la première Guerre Mondiale, il n'y a plus de gardien sur la tour de Tenero. Edouard LACROIX, ancien paludier de Michotte et son fils, Célestin LACROIX [11/11/1891627/05/1930] cultivent les terres de Boëd, comme nous l'indiquent les dénombrements de 1921 et 1926.
Le dénombrement de 1931, montre que Mme Marie Rose GUILLEMET, après le décès de son mari Célestin, continue de cultiver des teres à Boëd. La métairie de son beau-père est quant à elle reprise par Jean Marie LE VAILLANT [8/6/1877-1934].
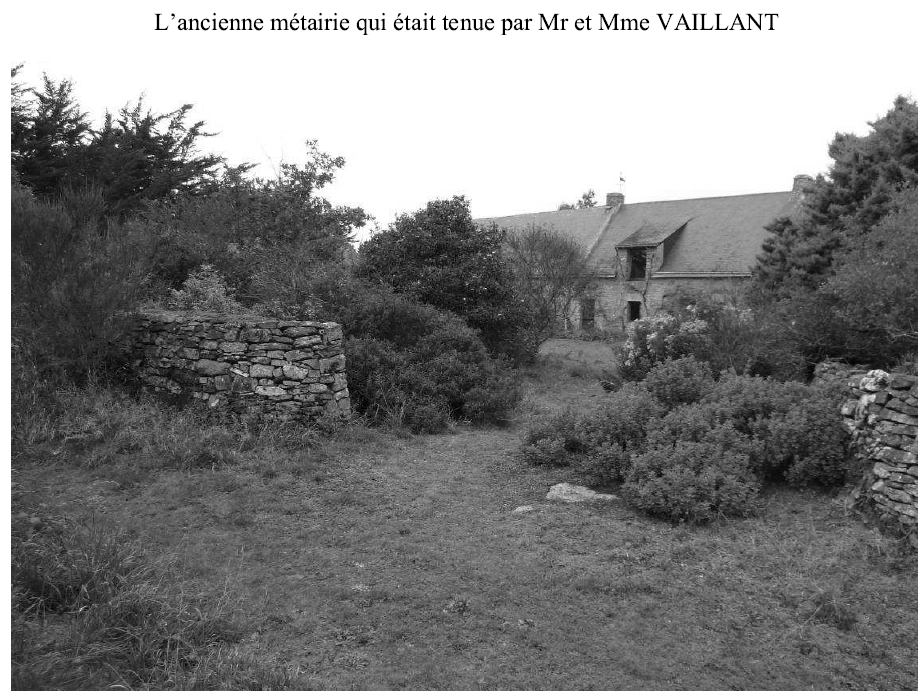
Les dénombrements de 1931 et 1936, nous indiquent que ce sont les LE VAILLANT qui travaillent les terres de Boëd mais aussi Boëdic. Mme DREAN veuve LE VAILLANT [2/12/1878-29/12/1962] et ses enfants Marie Thérèse, Julien Marie et Marie Josèphe sur Boëd; Joseph Julien Marie, Anne Marie sur Boëdic avec un domestique.
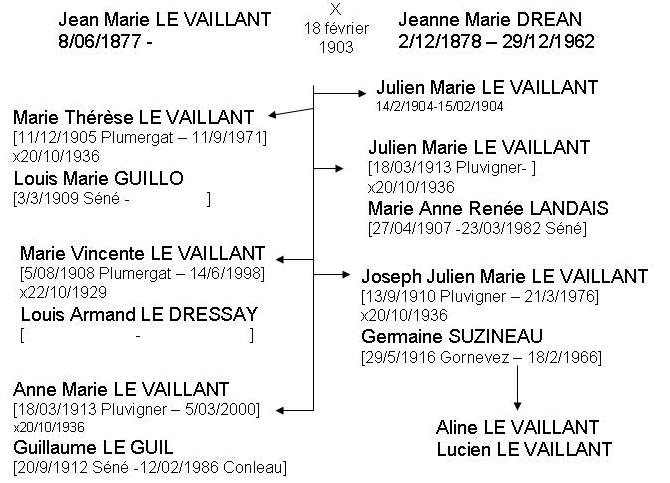
Le 20 octobre 1936, Mme Jeanne Marie DREAN, veuve LE VAILLANT, marie le même jour à Séné, quatre de ses quatre enfants (Lire article sur les noces).
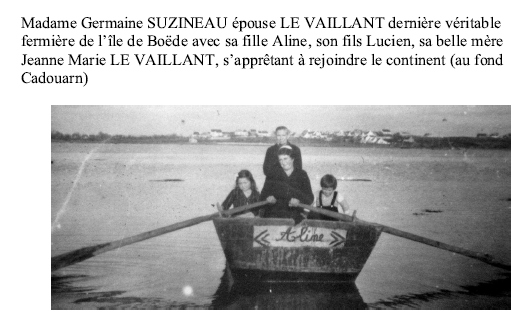
La barque à la rame était le moyen de gagner le continent à marée haute. A marée basse, un gois réapparait sur l'estran et permet de gagner l'île à partir de Cadouarn, pour des promenades ou accéder à la plus belle plage de Séné. Avant guerre, il y avait un deuxième pasage à marée basse pour les charettes aujourdh'ui perdu dans la vase comme il existait un gois qui permettait de rleier les deux îles Boëd et Boëdic.

Gois piéton entre Cadouarn et Boëd

Franchir le passage n'était pas anodin pour une population qui ne savait pas nager et à cause des vasières où l'on pouvait s'enfoncer. Plusieur noyades en témoignent :
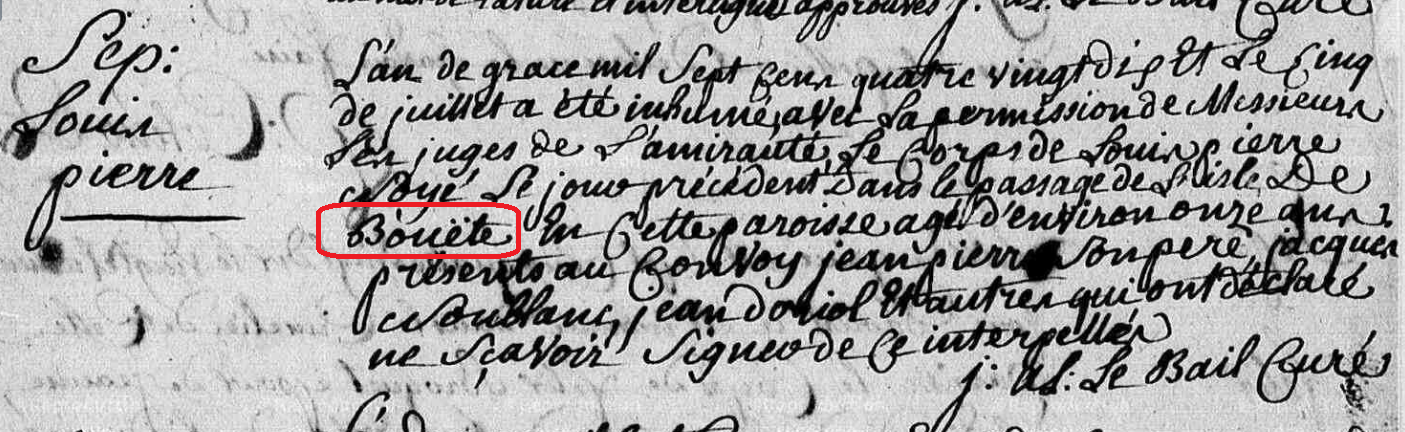
Ainsi le 5 juillet 1790 est inhumé à Séné, Louis PIERRE [1/01/1780-4/07/1789], noyé le jour précédent au passage de l'île de Bouëte.
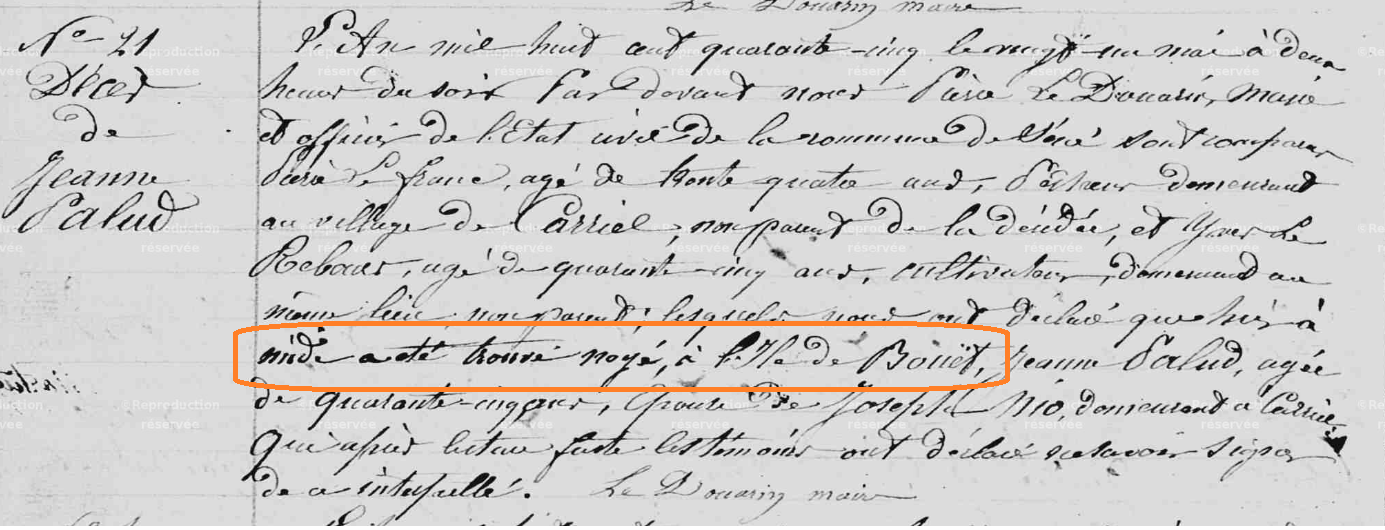
Le 21 mai 1845 on retouve le corps de Jeanne PALUD [3/10/1798-21/5/1845], femme de Jopseh NIO, noyée à l'île de Bouët.
En 1939, Julien Marie LE VAILLANT |18/3/1913 -5/06/1939] qui vit sur Boëd rend visite à son frère Joseph qui demeure sur Boëdic. En rentrant, il s'envase sur un passage qui relie les deux îles à marée basse. On retrouvera son corps au Badelle lendemain.
Après guerre, l'île a accueilli d'autres constructions puisque en plus des 2 métairies agricoles, il existe aujourd'hui sur l'île 3 autres habitations (lire page Découvertes-Balades).[rechercher les dates de construction]

Dans les année 19xx, le Conseil Général du Morbihan achète 32 ha de terres sur la point du "Peti Bout" sur un total de 48 ha que compte l'île de Boëd. Cette partie orientale de l'île constitue un "espace naturel sensible" malheureusement dans un état écologique médiocre.
.
Création de la Place Floresti
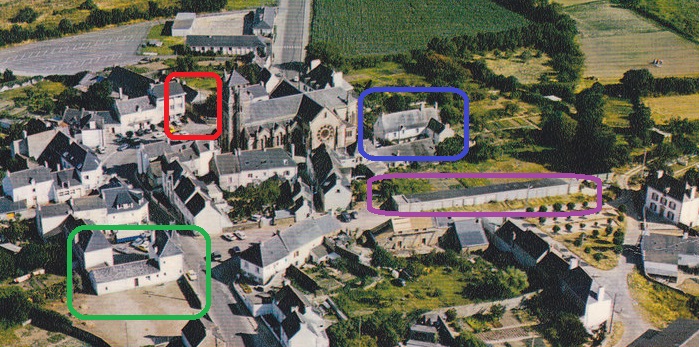
Cette vue aérienne de Séné situent 4 endroits du bourg qui ont connu une modification profonde: derrière l'église, l'ancien presbytère sera démoli; la mairie de Séné sera agrandie;deux nouvelles voies seront percées pour donner naissance à deux places: la Place Floresti et la Place Cofornic.

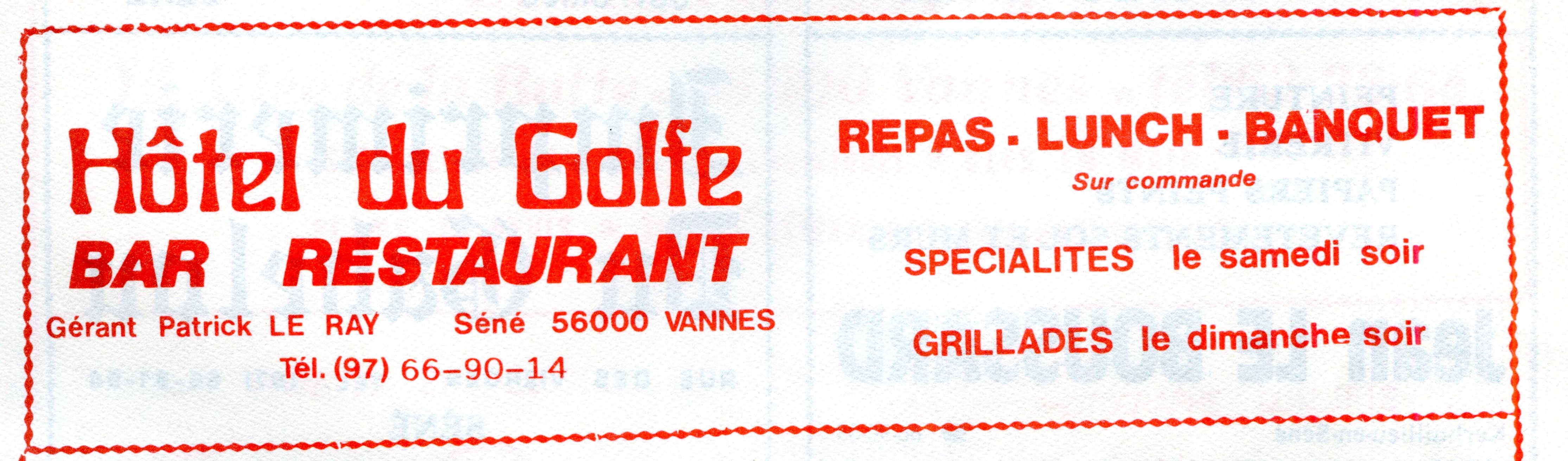
Dans les années 1960, notre commune comptait un hotel au bourg. Ce n'était pas le premier lieu pour accueillir des hôtes à Séné, car la famille Robino-Janvier savait louer des chambres au dessus de leurs commerces. A droite de l''Hotel du Golfe, une ruelle permettait de gagner la route vers Moustérian. Les véhiculent toutefois traversaient la place de l'église et tournaient après la maison du forgeron Dauder, au n°2 de la place.
Pour aérer l'urbanisme du bourg et favoriser la circulation des automobiles, il fut dicider de démolir la ferme d'un agriculteur
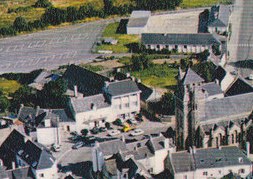
Cette carte postale ancienne de Cim, montre l'actuelle place de l'Eglise à la fin des années 1970. La route file tout droit, longe l'église avant de tourner à gauche pour emprumpter la rue des écoles. En effet, comme le montre cette vue aérienne du bourg, une longère et son mur de cloture existaient en lieu et place de l'actuelle place Floresti. C'était le siège d'une exploitation agricole. En 1964, lors du tournage du film de Bertrand MOISAN, on voit l'agriculteur ramener ses vaches à l'étable....
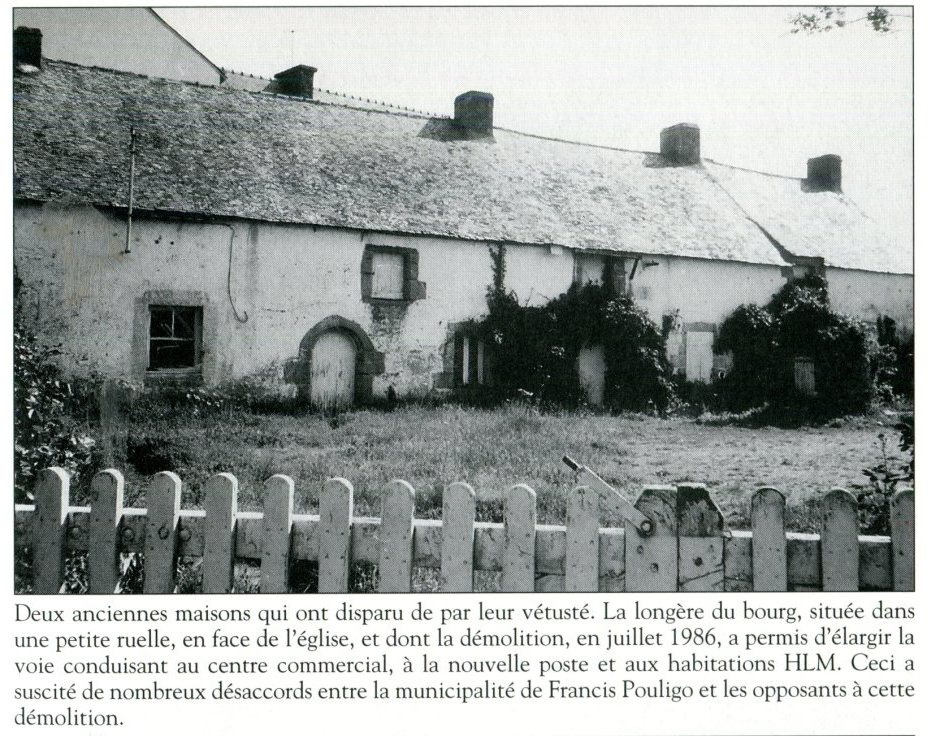

Marcel POULIGO, maire de l'époque et son équipe entreprirent d'ouvrir le bourg et de détruire cette longère pour créer un accès aux nouveaux quartiers autour du bourg et du futur centre commercial des Lilas, Les travaux de démolitions épargnèrent toutefois une maison qui hier fut le siège de la poste et aujourd'hui abrite un des restaurants emblématique du bourg, Ar Gouelenn.
Une nouvelle place était crée derrière l'hotel du Golfe et la Place de l'Eglise. La place Floresti, qui s'en souvient, tire son nom de la ville Roumaine de Floresti. Les Sinagots furent émus par la situation en Roumanie sous la dictarure de Nicolae Ceaușescu. Aujourd'hui encore, la ville de Séné et de Floresti sont jumelées.
Vue de l'glise catholique romaine de Floresti
De la Rue Principale à la Place de la Mairie
Le bourg de Séné tel que nous le connaissons aujurd'hui est le résultat d'une succession aménagements tout au long du XIX° et XX°siècle, la dernière étant la construction de la salle Grain de Sel.
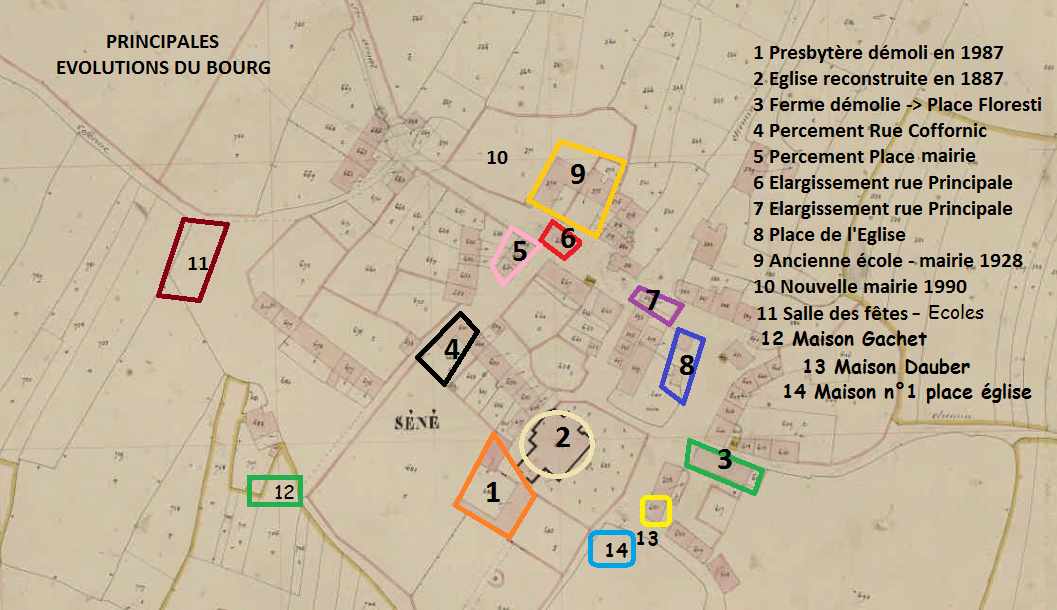
Ce plan cadastral de 1845 nous donne la position des habitations à l'époque. En couleur, ont été reportées les principales modifications par rapport au bâti actuel. Une page est dédiée aux changements intervenus Place de l'Eglise.
Nous disposons de vieilles photographies ou de vieilles cartes postales qui nous permettent d'illustrer les principales modifications intervenues dans cet espace qui deviendra les places de la Mairie et de Coffornic.

Avant de s'appeller place de la Fraternité officiellement et couramment, place de la mairie, cet espace compris entre le haut de la rue de la Fontaine jusqu'au début de la rue de Bel Air, s'est appelé rue Principale, nom qui apparait au bas de vieilles cartes postales On peut dater sa création lors de la destruction de la maison du cabaretier Simon (N°6) qui était carrément flanquée au milieu de la chaussée. La photographie ci-dessous, datée d'autour de 1900, nous montre sans doute un baptême réunissant des Sinagots devant ce qui deviendra le n°1 de la rue de la Fontaine, notre bar-tabac du bourg. A droite, on reconnait la devanture en bois d'un commerce, d'abord boucherie puis épicerie de la famille Janvier. Bouchant la vue, la maison Simon, massive, en pierre. En 1870, Le Digabel y tua son voisin de deux coups de couteau..

Repassons à présent les numéros de la Place de la Fraternité afin de noter les changements intervenus dans la passé, en zigzaguant entre les numéros pairs et impairs.
n°2- Bar-Cabaretier-Restaurant Robino-Bar-Tabac
Cette autre vue, plus récente, montre à gauche l'épicerie Janvier, mitoyenne du bar-restaurant des Robino. Le n°2 de la Place de la Mairie restera une épicerie pendant de longues années, puis sera démolie et reconstruite par accuiellir une épicerie. Un restaurant s'y est installé en 1998 quelques temps avant de devenir le siège d'une agence immobilière.
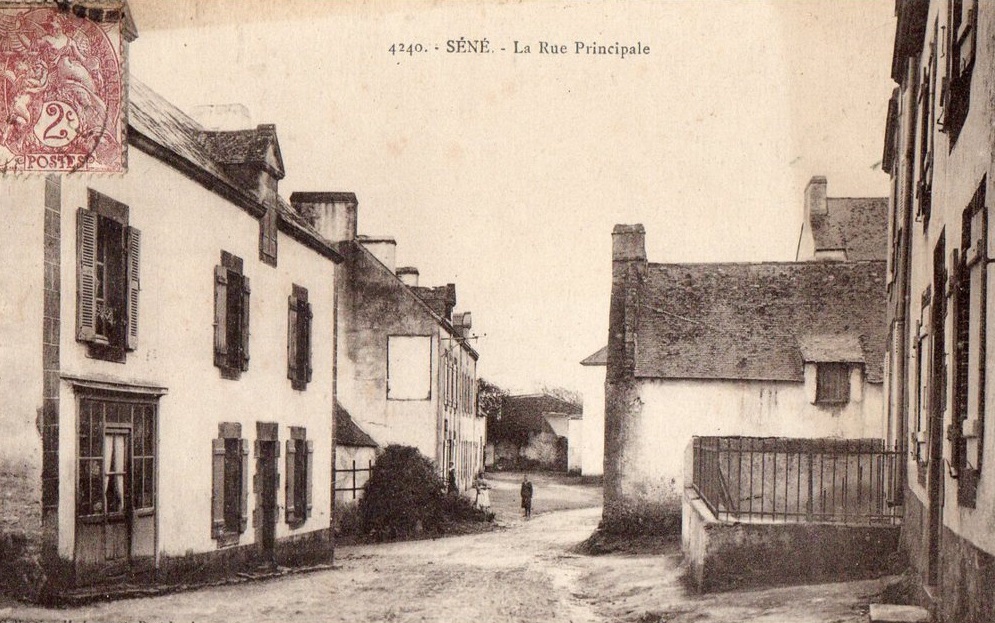
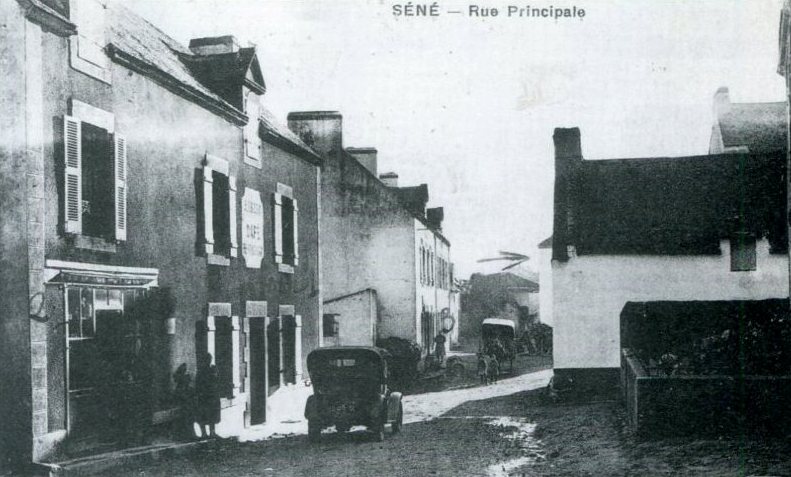

Cette photo montre l'angle de la rue de la Fontaine avec la rue Principale dans l'entre-deux-guerres où se situait le restaurant Robino qui est devenu ensuite un bar pui un bar-tabac.
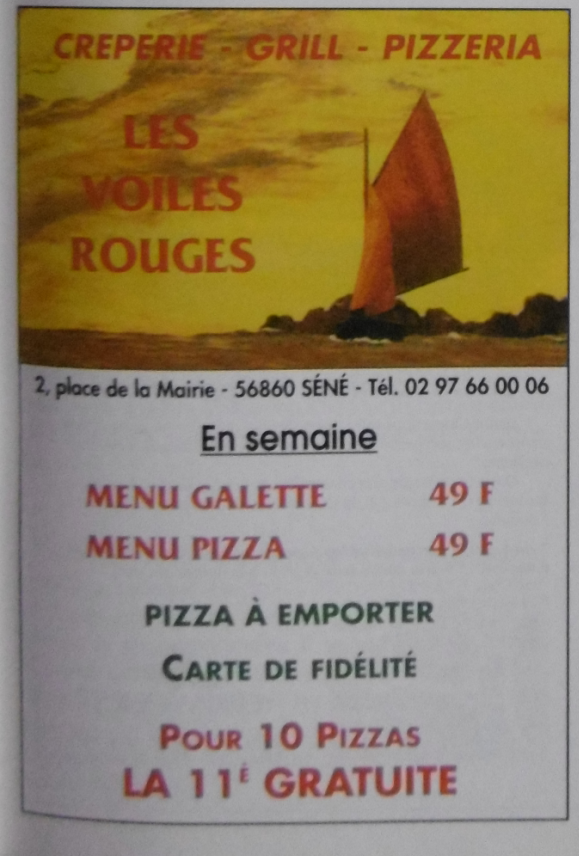
En face, juste au débouché de l'actuelle rue de la Fontaine, il y avait une maison qui fut elle aussi détruite pour faciliter le passage vers la place de l'église (N°7). Sur cette vieille vue, on situe cette maison à droite. Il en reste aujourd'hui, un petit garage à l'entrée de la ruelle du Recteur.
n°1-Maison - Bibliothèque - Habitation :
Une fois passée la ruelle du Recteur, on trouve une grande maison qui fut le siège de la bibliothèque municipale avant la réalisation de la médiathèque GRAIN DE SEL. La maison d'habitation précedent la bibliothèque était flanquée d'un muret qui sera également démoli pour faciliter la circulation.
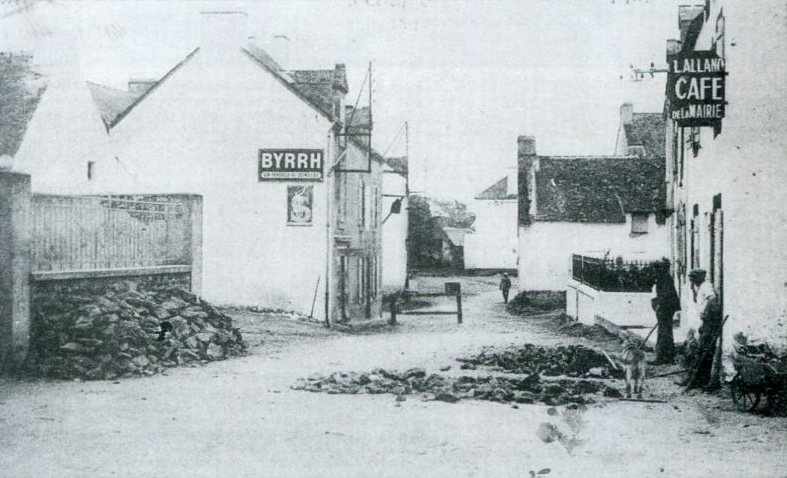

Ironie de l'histoire, la municipalité a vendu courant 2020 la vieille bibliothèque qui redevient une habitation.

n°3-n°5 Habitation et annexe de la mairie :
Cette vieille vue aérienne, extraite d'une carte postale CIM, doit dater du début des années 1960. On reconnait à gauche la maison qui deviendra la bibliothèque. On peut voir l'allure des anciennes façades des maisons situées aujourd'hui au n°3 et n°5 (reconstruite en 1972). Il y avait un "style sinagot" dans ces maisons qui dispoait d'un chien-assis au raz du palncher du toit pour éclairer les combles; des ouvertures ceintrées de pierre de taille; une porte centrale; des façades peintes en blanc, des volets de bois aux fenêtres..
Si le n°3 reste une habitation complètement remodelée, le n°5 également transformé, est devenu une annexe de la mairie toute proche qui acueille aujourd'hui les services de la jeunesse. Dans cette maison se sont succédés les bureaux du Receveur buraliste, ancêtre des services fiscaux et de la poste. Ensuite vint le Café de la Mairie, tenu par Louis ALLANO, dans les années 1930.
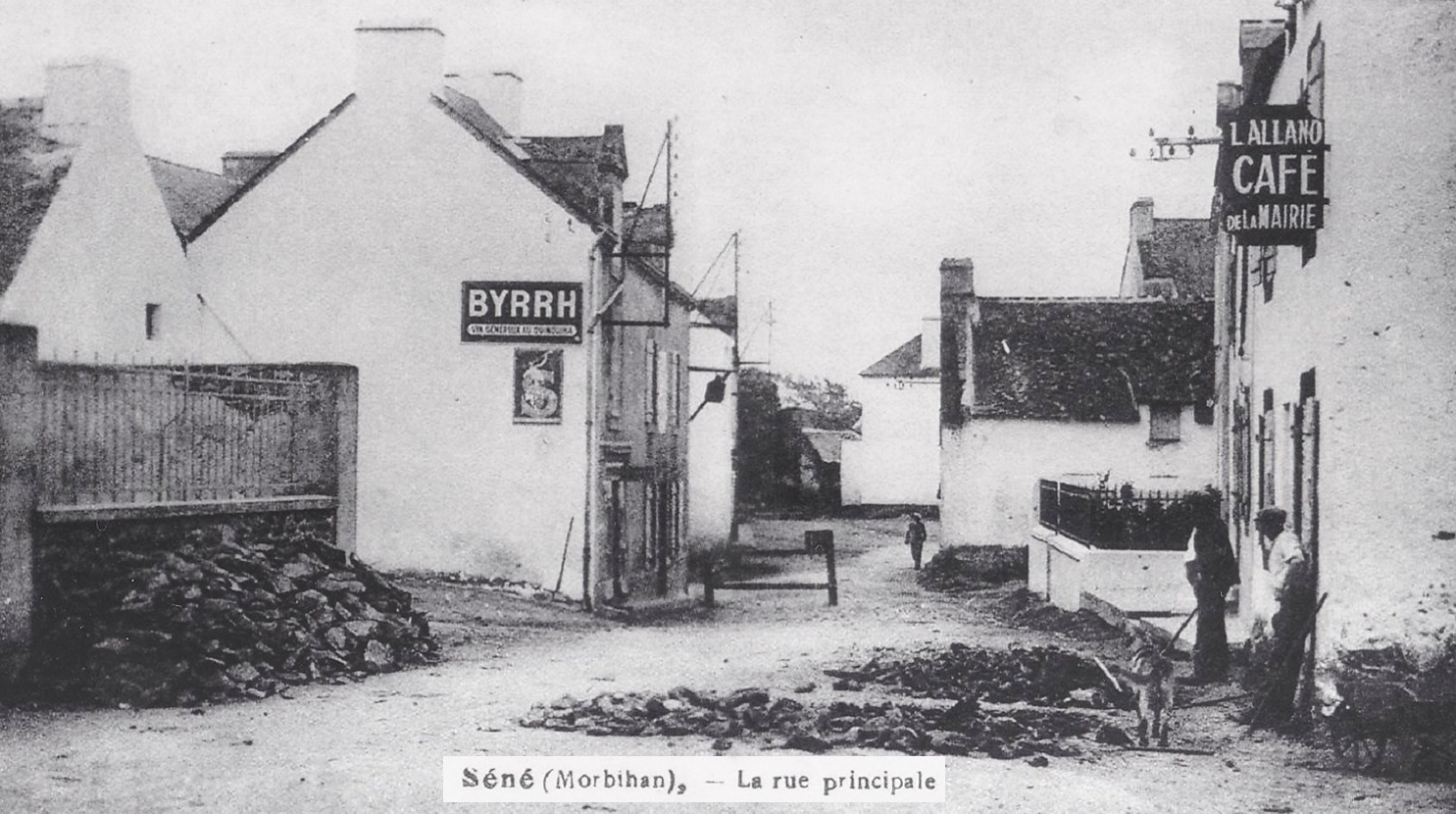
Dans les années 1960, la maison était habitée par la famille Balacon qui était réparateur de vélos. Cette photo un peu flou sort du bulletin municipal de décembre 1998. A gauche, sur la mur de la maison au n°5, on reconnait le logo de la Caisse d'Epargne qui ouvrit sa première agence au milieu des années 1980.
Cette même photo montre la "petite longère" qui fut construite derrière la banque et qui aujourd'hui abrite au n°5bis, un autre service de la mairie et au n°5ter, un cabinet médical.

n°4-n°6-n°8 habitations:
Il faut chercher les n°4, n°6 et n°8 coincés derrière l'agence immobilière. Ces maisons ont de toute évidence été remodelées. En poursuivant côté pair, on arrive au parvis de l'Hotel de Ville avec le grand bâtiment de l'écomusée, qui accueillait jusqu'au années 1955 l'école publique. L'entrée de la mairie construite sur la rue Principale en 1924 est donc sise au n°10 comme le montre le plan cadastral de l'IGN. Pour autant, sur les annuaires, la mairie est au numéro n°6 !!
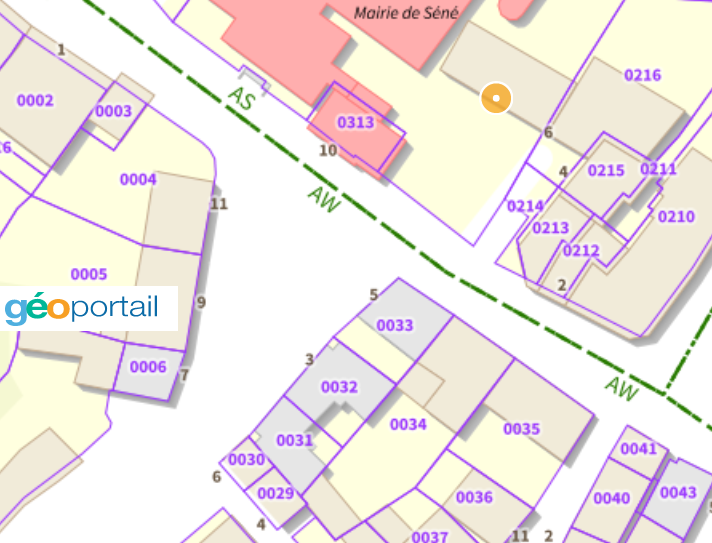
La création de la place à proprement parlé, remonte à la démolition des deux habitations qui étaient flanquées en son centre. (voir ci-avant N°5). Deux autres démolitions intervinrent dans les années 1950-1960. Au sud,(N°4) la maison au bout de la rue des Vierges obstruait le passage vers la place de Coffornic. Il y avait certes un pasage tellement étroit, que les anciens avait dû rabotter la maison du n°7 (librairie Marée Pages) pour laisser passer les charrettes. Le principal accès se faisait par l'actuelle rue du Golfe qui desservait la première école municipale et la première mairie avant d'accéder aux autres habitations.
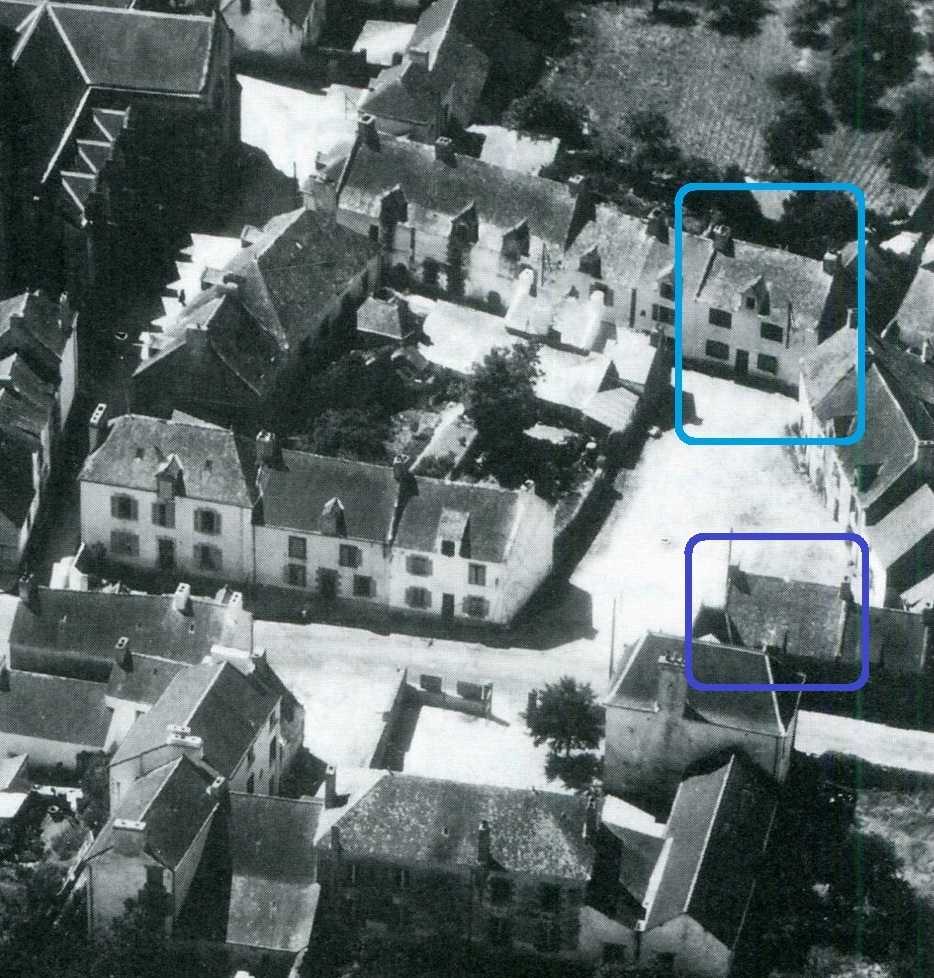
L'autre démolition concerna une maison en face la vieille mairie, ce qui permis d'élargir la place.

n°7 La librairie Marée Pages
n°9 : La belle demeure de 1770:
Il faut lever les yeux pour apercevoir sous la fenêtre du chien-assis de gauche, une inscription gravée sur la pierre. Il est écrit trois lettres IHS et une date 1770. Cette inscription IHS 1770 pourrait dater la construction de cette maison déjà présente sur le plan du cadastre napoléonnien de 1810.

n°11 Maison d'habitation :
Il faudrait retrouver une vue de l'ancienne maison avant sa démolition et sa reconstruction.

Les DANO, damnés de la terre de Cantizac
En cette fin de XIX°siècle la famille DANO composée de Jean DANO [23/7/1807 Surzur - 30/3/1876 Séné], sa femme Marie Vincente LE FRANC [1820 - 10/12/1884 Séné] et leurs enfants, quitte Theix et vient s'installer à Cantizac comme cultivateurs.

Cette extrait d'un plan du cadastre de 1845 donne un aperçu de ce que devait être les abords de l'étang de Cantizac, avec le moulin sur la digue et le Manoir de Cantizac, doté d'une fontaine et d'un puits. De l'autre rive du ruisseau, les champs drainées de Keravelo. (lire aussi histoire du moulin et du manoir). Jean DANO décède en 1876 à Séné laissant une veuve avec ses enfants. Entre 1845 et 1863, établis sur Theix à Saint-léonard, non loin de Séné, M. et Mme Dano auront eu 9 enfants. Il semble qu'une fois à Séné, aucun enfant Dano ne soit né à Cantizac.
Un de ces enfants Dano nous intéresse, il s'agit de Jean Marie DANO [18/5/1847 Theix - 16/6/1893 Séné].
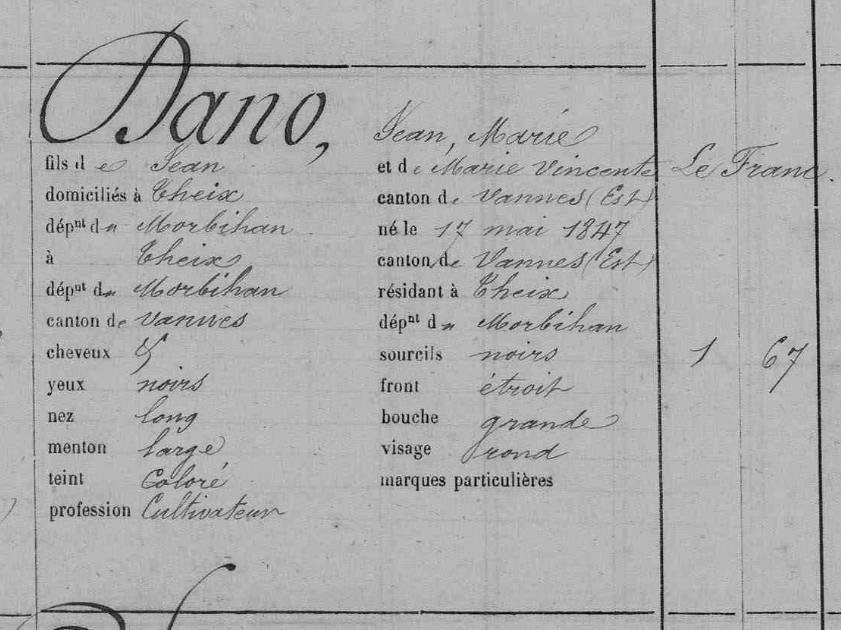
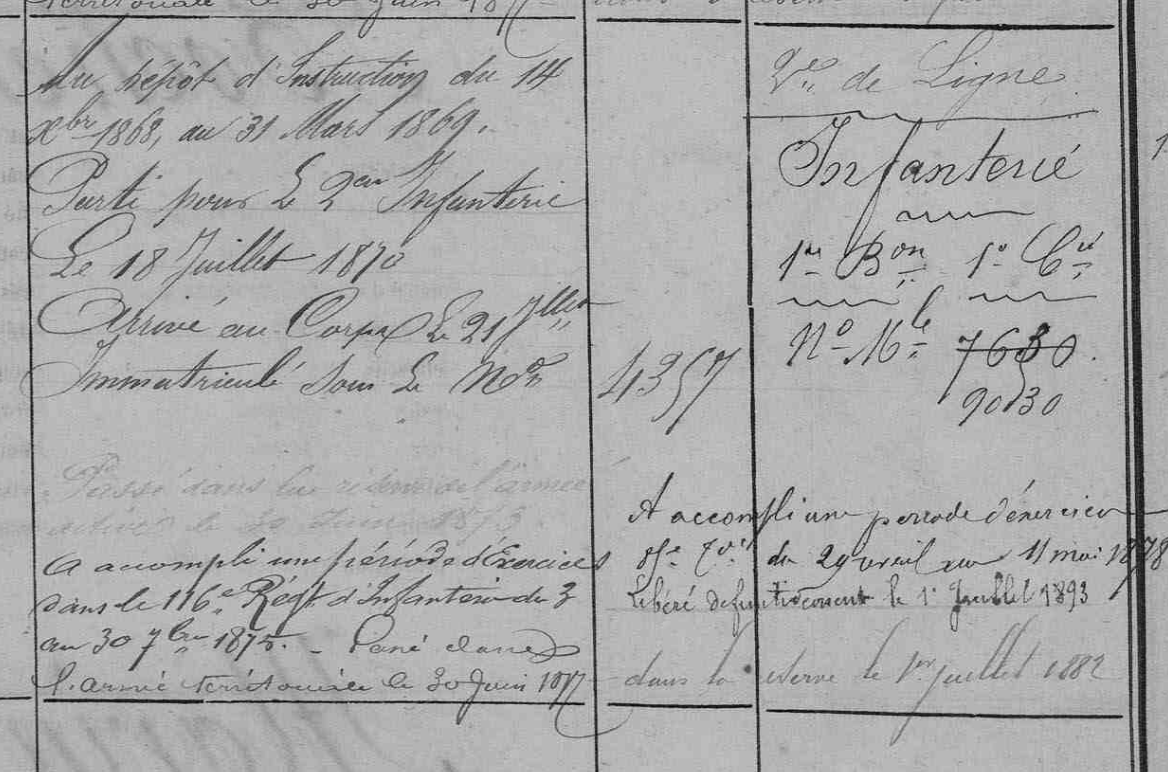
Vers l'âge de 20 ans Jean DANO fait sa conscription, comme nous l'indique sa fiche de matricule. Il sera mobilisé dans l'infanterie pendant la Guerre de 1870 contre les Prussiens. Sa domicilation est encore à Theix. L'examen du lieu de naissance de ses frères et soeurs montre qu'ils sont nés à Theix entre 1845 et 1863. On peut penser que la famille Dano s'est établie à Séné après la guerre de 1870.
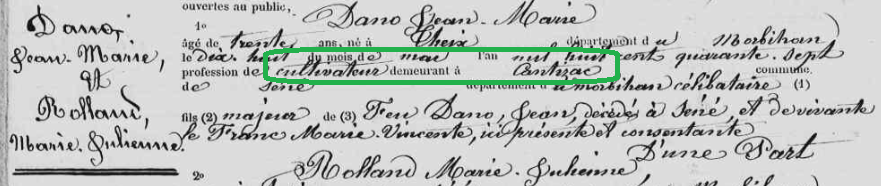
A l'âge de 29 ans, cultivateur à Cantizac, il se marie à Séné le 29/7/1877 avec Marie Julienne ROLLAND [6/4/1851 - 4/8/1914] également cultivatrice.
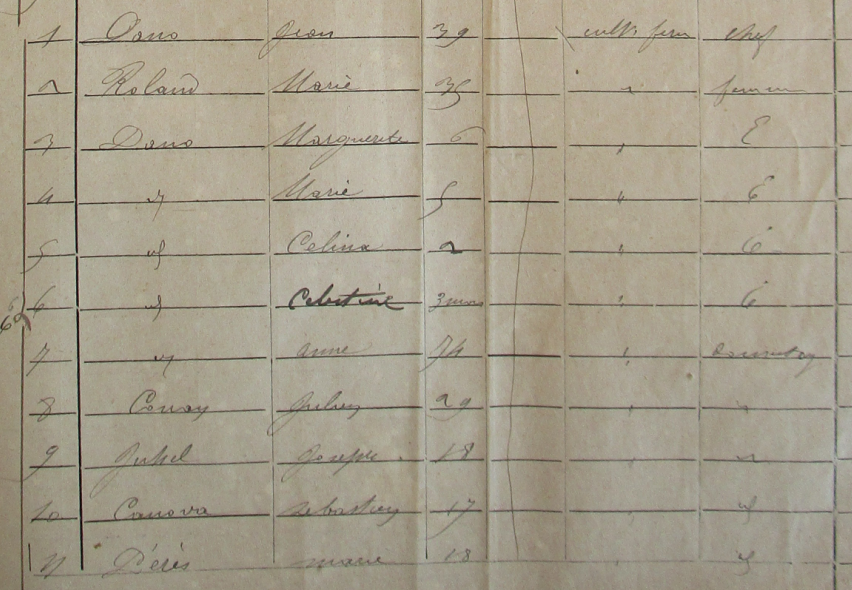
Au dénombrement de 1886, le chef de la famille Dano est cultivateur fermier à Cantizac La famille Dano compte 4 enfants et 5 domestiques dont une parente; Anne Dano.
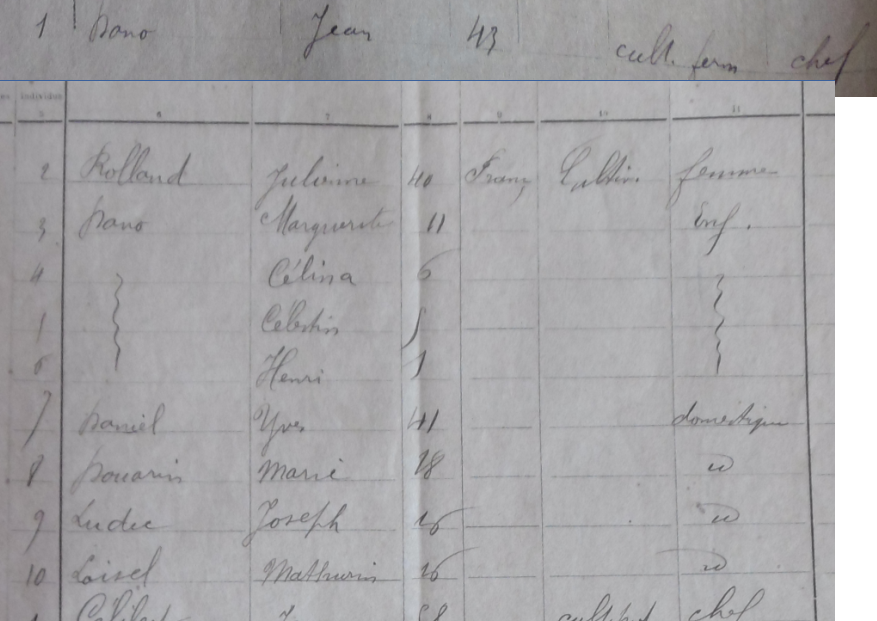
Au dénombrement de 1891, la configuration familiale à fortement évolué. On y voit 3 enfants avec des prénoms différents et 4 domestiques confirmant une certaine aisance de ces cultivateurs.
Pourquoi s'interresser à cette famille de cultivateurs comme il en existe d'autres à Séné ?
En parcourrant les registres de l'état civil, sur la période 1870-1900, on ne manque pas de voir les (trop) nombreux actes de décès concernant les DANO. Cette succession de naissances et de décès d'enfants en bas âge au sein de la famille DANO interoge l'historien local.
Marie Célestine [5/8/1878 - 26/12/1882] décède à l'âge de 4 ans la famille compte alors une 2° petite fille, Marie Marguerite.
Marie Marguerite [6/9/1879 - 16/4/1894] décèdera à l'âge de 15 ans, le même jour que son frère de 6 mois
Marie Louise [11/9/1880 - 17/4/1890] décède à l'âge de 9 ans.
Jean Marie [17/11/1882 - 9/2/1883] troisème enfant qui décède à l'âge de 2 mois.
Marie Célina [17/6/1884 - 7/5/1909] se mariera le 27/5/1902 à Patern BOCHE, agriculteur de Keravelo, aura 3 enfants dont un survivra et décèdera à l'âge de 25 ans.
Marie Célestine [17/2/1886 - 19/2/ 1913], deuxième du nom, se mariera le 25/4/1911, mais décèdera à l'âge de 27 ans sans descendance.
Julien Marie Désiré [20/6/1888 - 11/10/1888] décède à 3 mois
Henri Joseph Marie [20/8/1889 - 19/9/1902] décède à l'âge de 13 ans
Jules Marie [1/10/1890 - 7/1/1891] décède âgée de 3 mois.
Marie Julienne [20/4/1892 - 6/4/1894] décédée à 2 ans.
Jean Marie [22/9/1893 - 16/4/1894] deuxième du nom, enfant posthume, décède à l'âge de 6 mois.
Jean DANO et sa femme Marie Julienne ROLLAND auront eu entre 1878 et 1893, 11 enfants (presque) tous morts de leur vivant ! 4 nourrissons (2 mois, 3 mois, 3 mois et 6 mois), 2 jeunes enfants (2 ans et 4 ans), 3 jeunes adolescents (9 ans, 13 ans et 15 ans) et 2 jeunes mères de 25 et 27 ans.
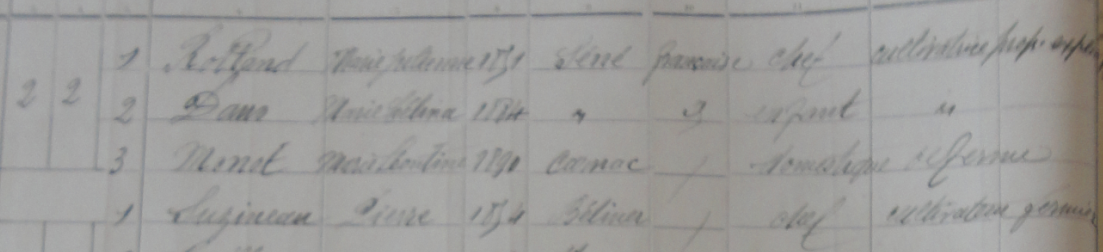
En 1911, lors du dénombrement d'avant guerre, Mme Marie Julienne ROLLAND, veuve DANO est désormais cultivateur propriétaire mais depuis son mariage elle a perdu son mari et 10 de ses 11 enfants !
Ses 2 seules filles arrivées à l'âge adultes meurent à 25 ans pour Marie Célina en mai 1909 quelques mois après le décès de son 3° enfant, et à 27 ans pour Marie Célestine en 1913. A sa mort, Mme Rolland veuve Dano aura enterré toute sa progéniture.
Quelles hypothèses peut-on faire pour expliquer une telle hécatombe au sein d'une même famille?
On peut malheureusement les faire toutes : manque d'hygiène pour les nourrissons, manque d'hygiène après l'accouchement et pendant l'allaitement; maladies infectieuses pour les enfants, peut-être l'épidémie de choléra à Séné en 1893 (lire article sur Paterne KERGAL, l'infirmière); conséquence des grossesses et des acouchements pour les jeunes mères. La mort le même jour (16/4/1894) d'un enfant de 6 mois et d'une de 15 ans étaye la cause d'une maladie infecieuse d'autant qu'on note un autre décès le 6 de ce même mois. Une maladie congénitale n'est pas non plus à écarter. L'eau de la fontaine et du puits étaient-elles saines? On sait que la tiphoïde était fréquente à cette époque comme les maladies transmises par les animaux domestiques. (Lire article Puits et Fontaines)
L'unité de lieu interpelle aussi. Il faut se rappeller la présence de paludisme endémique tout autour de Séné comme le révèlera une étude de 1922. (Lire article dédié). La famille Dano vit près de l'étang de Cantizac et laboure des terrres sur Keravelo qui, bien que drainées, comportent maintes mouillères riches en moustiques...
La seule descendance des Dano sera Henri BOCHE, fils de Patern BOCHE et Marie Célina qui se mariera en 1927 et décèdera en 1957 en Mayenne. Ses héritiers connaissent-ils le sort malheureux de leur aïeux?
1870, deux coups de trop pour LE DIGABEL
Le plus halletant pour un historien local, même amateur, est de flairer une piste, de dénicher une anecdote et mettre à jour un fait inconnu.
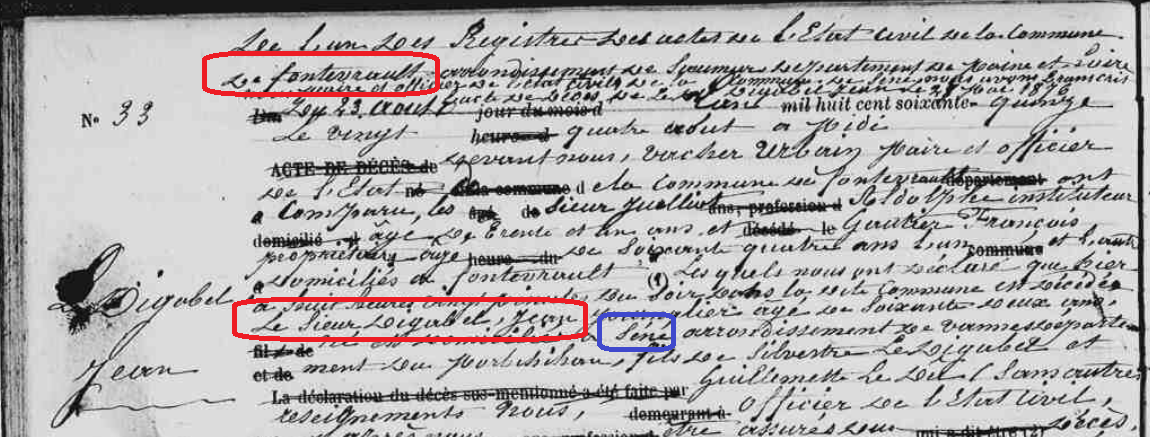
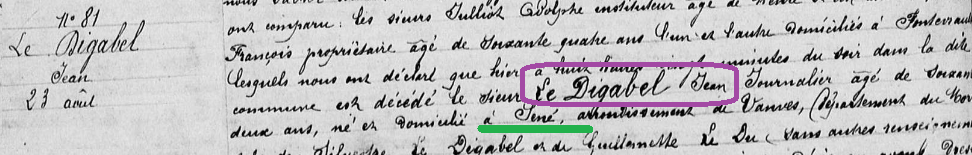
Ainsi, en étudiant l'histoire des boulangers de Séné, un acte de décès attire l'attention. Jean LE DIGABEL, natif de Séné est décédé à Fontevraud le 23/8/1875. Cet acte, retranscrit à Séné reprend les informations de celui établi dans la cité angevine célèbre pour son abbaye. Mais qu'est allé faire Jean LE DIGABEL [14/1/1813 - 23/8/1875], boulanger de son métier au bourg de Séné, âgé de 62 ans, si loin de son village natal !
De plus, il semble avoir oublié sa profession, puisqu'il est déclaré journalier. Est-il allé travaillé à Fontevraud? Est-il décédé au cour d'un voyage? L'abbaye de Fontevraud a été restaurée à la fin du XIX° siècle, a-t-elle eu besoin de beaucoup de main d'oeuvre jusqu'à recruter en Bretagne? Mais Jean LE DIGABEL n'est ni tailleur de pierre ni maçon et son âge ne colle pas à cette hypothèse! Cette abbaye ne fut-elle pas avant une prison? LE DIGABEL aurait-il été interné à la prison de Fontevraud?
Quelques échanges d'emails avec les Archvies du Maine et Loire et le responsable du secteur "Archives modernes" transmet de précieuses informations que l'on peut étayer par d'autres documents.
"Monsieur,
Comme suite à votre demande d’information concernant Jean Le Digabel décédé à Fontevrault le 23 août 1875, Voici les éléments principaux relevés dans le dossier
- Jean Le Digabel né à Séné le 13 janvier 1813, (son père Sylvestre est boulanger, lire article sur les boulangers)
- Profession : journalier et lors de son entrée à la prison « se dit boulanger »
- Marié, 6 enfants, sait lire et écrire;
Au dénombrement de 1841, la famille Le Digabel apparait bien dans les registres.
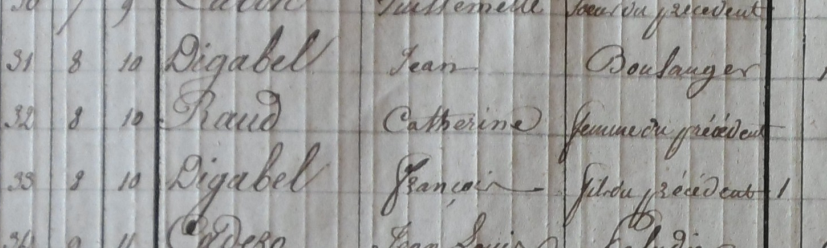
Le site Geneanet nous donne la composition de sa famille. Il aura eu 8 enfants et "seul" 2 ou 3 moururent en bas âge.
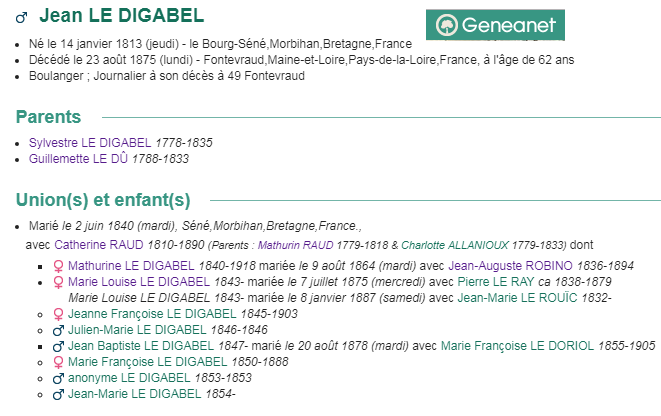
- Condamné à 5 ans de prison par la cour d’assises du Morbihan le 6 décembre 1870 pour homicide volontaire
- Pas de condamnation antérieure
- Entré à la Maison centrale de Fontevrault le 23 décembre 1870, libérable le 6 décembre 1875.
- N° écrou : 36771, plaque n° 428
- Entré à l’infirmerie le 15 février 1875 et décédé le 23 août 1875 à 8 H 20 du soir.
- Pendant son incarcération, fin juin-début juillet 1875, il a donné son consentement au mariage d’une de ses filles [Marie Louise Le Digabel] à un marin dénommé Leray qui a embarqué aussitôt après le mariage.[Il s'agit de Pierre LERAY marié le 7/7/1875]
- Par un courrier daté du 17 décembre 1875, une de ses filles Mme Robineau boulangère à Montsarac, [Il s'agit de Mathurine Le Digabel épouse Jean-Auguste ROBINO] commune de Séné demande des nouvelles de son père qui aurait dû rentrer à son domicile une fois la peine expirée.[On ne va pas accueillir son père à la fin de sa détention. Décédé le 23 août, l'administration pénitencière n'a semble-t-il pas averti la famille du décès.]"
Ainsi, la piste du criminel était la bonne. Jean LE DIGABEL a commis un homicide volontaire et a été incarcéré à la prison de Fontevrault. On comprend qu'à quelques semaines de sa libération, après presque 5 ans de réclusion, il tombe malade et décède à l'hôpital du centre pénitenciaire. On s'étonne d'une peine "que de 5 ans" qui doit être mis en relation avec les circonstances de l'homicide.
Comment un honnête boulanger de Séné a-t-il tué quelqu'un en automne 1870? Qui était la victime?
On ne le dira jamais assez, les départements de France et de Navarre mettent de plus en plus en ligne leur archives et les côtes de nombreux dossiers archivés.
Quelques clics sur le site des archives du Morbihan et on trouve le dossier de Jean LE DIGABEL natif de Séné sous la côte 2U2-540 (au passage on tombe sur d'autres procès relatifs à des Sinagots, de nouveaux articles en perspective!). A la faveur d'une RTT, on file rue des Vénètes à Vannes consulter le dossier du procès en assises.
L'acte d'accusation retrace les circonstances de cet homicide :
Le 30 septembre 1870,
[nous sommes un vendredi, depuis le 4 septembre 1870, la III° Répûblique a été proclamée à Paris occupée par les Armées prussiennes. Le 1 septembre, l'Empereur est défait à Sedan. La France vaincue par les Etats allemands, qui instaure le Reich le 18 janvier à Versailles. La France signera un Armistice le 28 janvier 1871 mettant fin à cette guerre déclarée par Napoléon III, le 19 juillet 1870. Elle paiera rubis sur l'ongle de très fortes indemmnités de guerre.]
vers sept heures du soir, Le Digabel et Sylvestre Chelet , paludier, âgé de vingt sept ans, demeurant au bourg de Séné, se trouvaient ensemble dans le cabaret de Vincent Patern Simon.
[On retrouve la famille Chelet au dénombrement de 1841 et on note que celle-ci vit juste à côté du "débit de boisson" tenu par M & Mme Simon. Plus tard, Vincent Patern SIMON, leur fils, reprendra le "débit de boissons" après son mariage avec Julienne GUELZEC. Le "Sylvestre Chelet frère du précédent" se mariera et aura un fils, Sylvestre CHELET [15/8/1843-30/9/1870], notre victime.
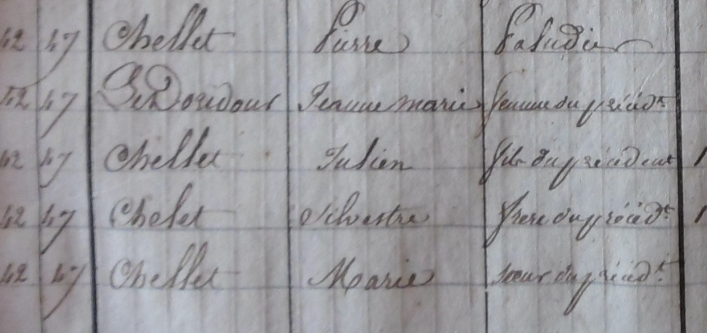
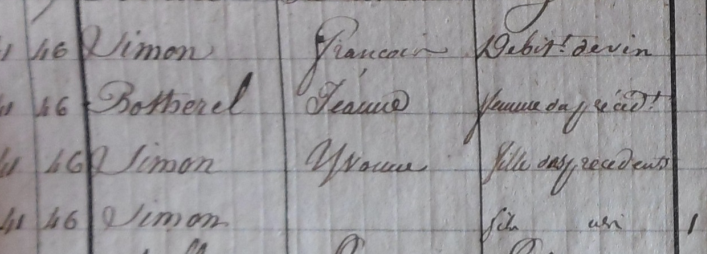
Ce dernier [Sylvestre CHELET, âgé de 27 ans] qui était un peu pris de boissons, dit en plaisantant à son camarade : "tu es trop vieux, tu n'es plus bon à rien; si les Prussiens venaient ici, ils te tueraient tout de suite" en même temps, il faisait avec le pied tomber le chapeau de Le Digabel.
Toutefois, cette première querelle n'eut pas de suites car à quelques instants de là le Sieur Landais trouvait Chelet et Le Digabel dans des termes de la meilleure amitié. Chelet bientôt après, se prît en dispute avec le cabaretier Simon qu'il atteignit d'un coup de pied à la cuisse et qu'il renversa sur le dos. Au bruit de cette scène, Le Digabel qui était sorti, rentra et reprocha à son compagnon de ne s'attaquer qu'à des vieillards. L'un et l'autre se colletèrent alors mais la femme Vincent mit fin à la querelle en ordonant à l'inculpé de quitter le cabaret.
Celui-ci sortit aussitôt et alla se poster à quelques pas de la maison située en face de l'auberge. Deux ou trois minutes après, Chelet paraissait : "sors donc dehors" B...lui cria Le Digabel. "Viens donc boire une chopine" lui répondit Chelet en s'avançant vers lui; il lui posa familièrement la main sous l'épaule. A cet instant même, Le Digabel, sans répliquer un mot, saisit à la gorge son adversaire et lui porta deux coups de couteau. Chelet ne poussa pas de cri. Il fit en trébuchant quelques pas et alla tomber à une quinzaine de mètres de l'endroit où il avait été frappé. Un quart d'heure après, il était mort.
L'examen du cadavre effectué le lendemain chez la victime révelèra deux blessures à la poitrine et à l'abdomen portées "par un couteau à la mae acérée".
Le 1er coup de couteau "a été donné avec une telle violence que le couteau a nécéssairmeent traversé la peua, les muscles, coupé le carticlage intercostal de la 6ème côte et traversé le péricarde et perforé le vendticule droit du coeur". Le seonde blessure est une plaie pénétrante dans l'abdomen. L'ouverture extérieure de 2 1/2 cm de long est à peu près verticale et étalé sur 4 cm le long de l'ombilic. ...Cette blessure interesse la peau, les muscles de l'abdomen et de l'estomac dont la face extérieure est perforé."
Malgré la guerre et le changement de régime politique en France, la continuité de l'Etat est assurée et justice rendue. L'instruction du procès a lieu avec l'aide d'un interprète pour assister les témoins qui parlent breton. Maître Caradec est l'avocat commis d'office pour défendre Jean LE DIGABEL. Le 10 novembre 1870, Jean LE DIGABEL est mis en accusation. Il reconnaitra son homicide.
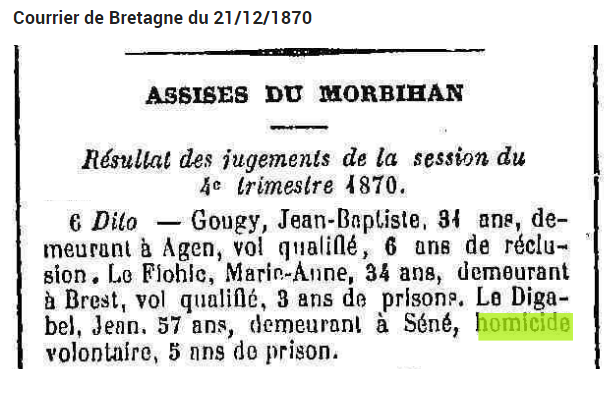
Jean LE DIGABEL fut condamné à 5 ans de prison le 6 décembre par les Assises du Morbihan et interné à la prison de Fontevrault le 23 décembre 1870. Il décèdera de maladie le 23 août 1875.
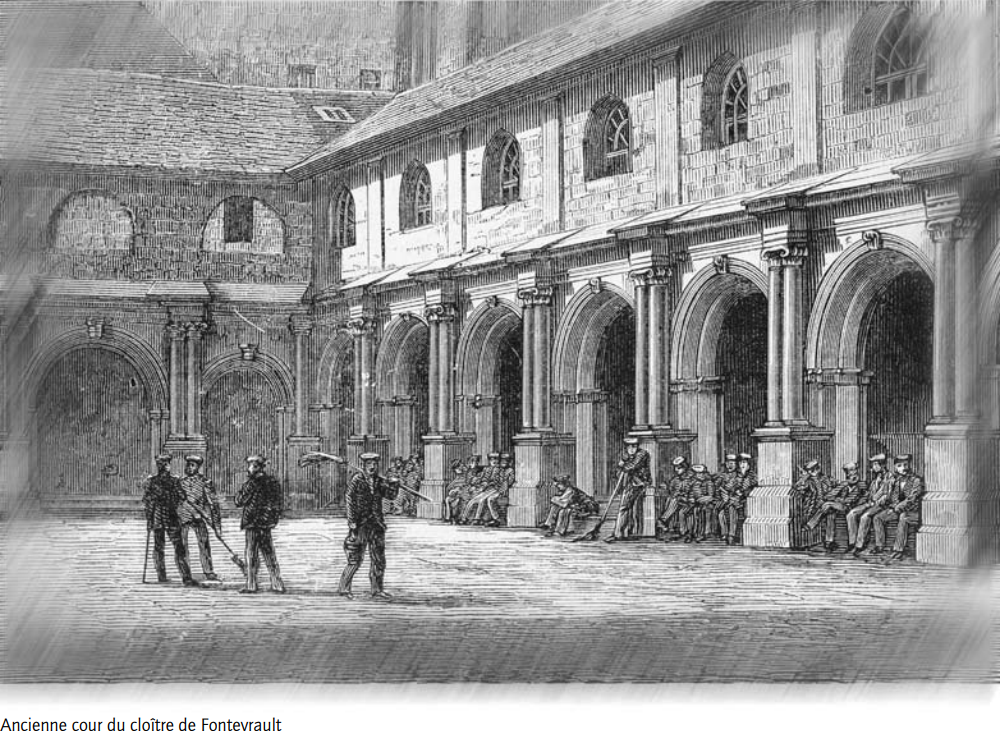
Henri MENARD, un maire moderne à Séné

Le nom d'Henni MENARD apparait dans le livre de Camille ROLLANDO "Séné d'Hier et Aujourd'h'ui ". On lit également son nom en bas des actes de décès sur le régistre d'état civil de Séné. Il y a bien eu un maire au nom de Henri MENARD, dont la patronyme ne sonne pourtant pas breton...
On en déduit qu'il remporte les élections du 5 et 12 mai 1929 et est élu pour un mandat porté à 6 ans. Il sera réélu en 1935, lors des élection des 5 et 12 mai comme en témoigne cet article de presse. Il s'est entouré de l'ancien maire Patern LE CORVEC.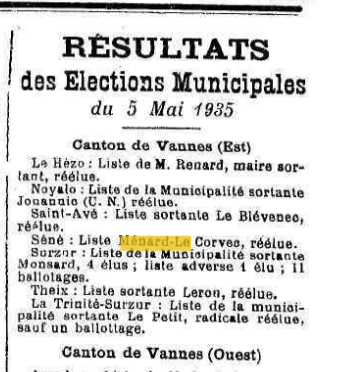
Un autre article de presse des archives du Morbihan daté de juillet 1932 permet de mieux identifier notre "homme"..
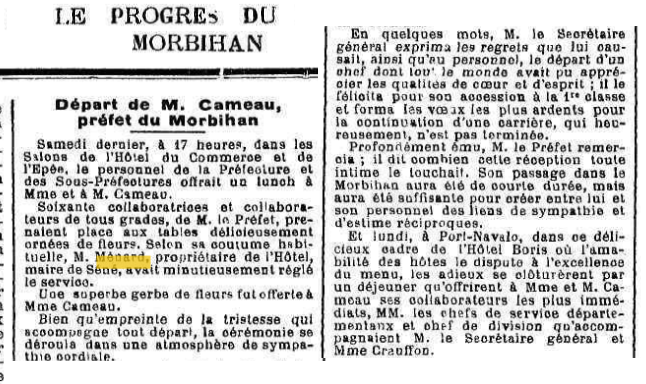
L'hôtelier de Vannes devient maire de Séné:
On y apprend que le marie de Séné est bien Henri MENARD, qu'il est aussi propriétaire de l'Hôtel du Commerce et de l'Epée à Vannes rue du Mené. C'est une personnalité locale, un notable qui accueille dans son établissement la cérémonie pour le départ du Prefet. Cette information est corroborée par un autre article de presse daté de juillet 1937 qu nous apprend que l'hôtelier a fait faillite et nous donne le nom de son épouse Germaine Louise BRIARD.
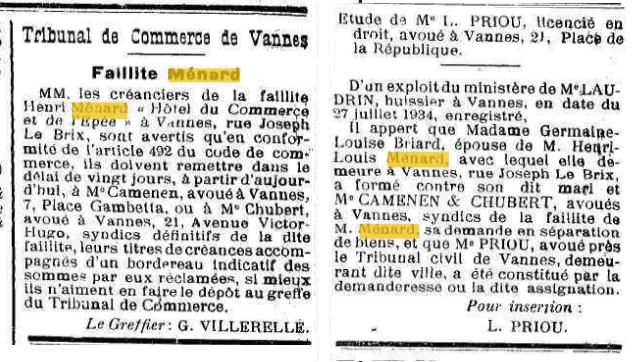
La consultation des archives du Calvados permet de retrouver l'acte de naissance de Henri MENARD et sa fiche de matricule. Il nait à Caen le 20 mai 1887 où son père est cuisinier. Sa fiche de matricule, classe 1907, nous apprend qu'il choisit également le métier de cuisinier qui le conduira à devenir hôtelier. Pendant son service militaire dont il sort caporal, il intègre l'administration militaire. On lit sur cette fiche qu'à l'âge d'accomplir sa conscription, il vit à New-York !
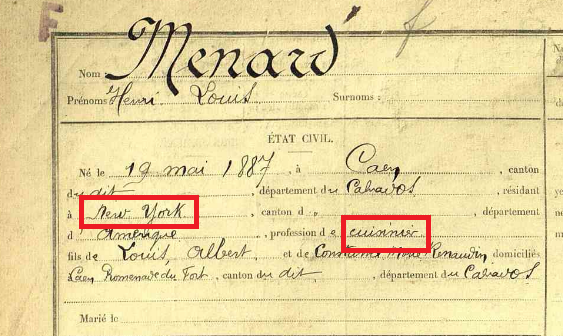
Son fils, Henri Paul MENARD se souvient:''mon père est aller deux fois aux Etats-Unis pour découvrir le pays". Henri Louis MENARD a épousé Germaine Louise BRIARD [24/3/1892 Vire- 13/4/1983 La Guerche] à Neuville dans le Calvados le 21/11/1911. Son nom n'apparait pas dans les dénombrement de Séné de 1926. Les registres du dénombrement à Vannes pour 1926 (ici reproduit) et 1931 mentionnent l' hôtelier et son épouse, entouré du personnel de l'hôtel, parmi lesquels, Maria AVRY [1/9/1905 Lorient-21/3/1957 Versailles] qui tient la caisse de l'Hôtel du Commerce et de l'Epée à Vannes acheté vers 1910.
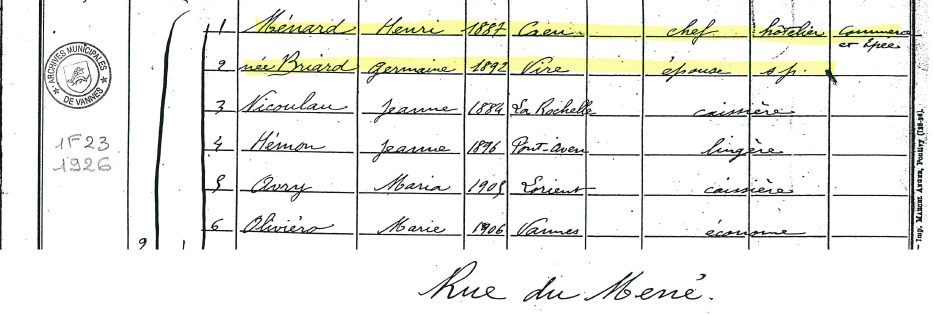
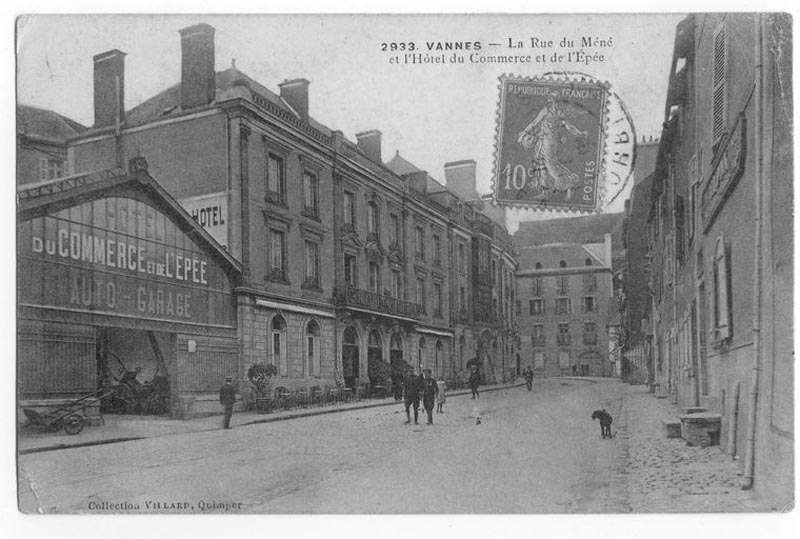
Cet établissement à quelques pas de la mairie de Vannes est sans doute un lieu où les notables du département se réunissent. Il a certainement tissé des liens avec des "électeurs sénatoriaux" du Morbihan. Comment est-il arrivé à briguer le mandat de maire de Séné? Son fils se rappelle qu'il fut d'abord conseiller municipal à Vannes avant "d'être appeller à Séné". Il est certain que cette aura locale séduira les agriculteurs, les marins pêcheurs et la majorité des électeurs de Séné puis qu'ils voteront majoritairement pour lui à deux reprises.
Quand la guerre de 14-18 éclate, il est mobilisé au seins des services de santé. Il est fait prisonnier à Maissin en Belgique lors de la journée meutrière du 22 aout, qui fit 25.000 morts, dont les Sinagots TIPHAIGNE et MONTFORT. Il bénéficie d'un échange de prisonniers et rejoint les services de l'administration de la santé. Il sera officier à la fin de la guerre.
De retour à Vannes, il reprend la gestion de l'hôtel avec son épouse. Il cotoire les notables locaux, se fait remarquer et devient conseiller municipal à Vannes.
Courant 1928, Maria AVRY quitte l'hôtel où elle travaille pour gagner une clinique à Boulogne-Billancourt. Là, elle accouche de Henri Louis, qui sera reconnu par son père naturel Henri MENARD en 1935. Après la faillite de l'hôtel, Henri MENARD cherchera à divorcer de son épouse légale, qui mettra des obstacles à cette séparation.
L'annuaire téléphonique de 1932 nous indique qu'il résidait bien à Séné du côté de Saint-Laurent.
Cependant, Henri MENARD ne saura pas concilier vie publique et bonne gestion d'un hôtel. Il est en faillite en 1937. Sa femme demande une séparation de bien. Son acte de naissance nou sindique qu'elle se remariera après le décès de son mari.

Si il n'est pas heureux pour sa propre union, en tant que maire il en célèbre d'autres et notamment, il marie en 1930 Xavier LE PENRU à Louis BENOIT et pose pour une photo lors de ces noces mémorables.

Ces quelques articles de presse à suivre donnent un aperçu de l'action d'Henri MENARD pendant ces années d'entre deux guerres. Le premier nous indique de la nouvelle mairie de Séné, décidée par Ferdinand ROBERT en 1924 sera inaugurée en 1930 et que cette même année, la fée électricité arrive à Séné; le second relate un meeting aérien à l'hippodrome de Cano; le troisième nous décrit la fête de Séné en août 1932 et le dernier montre que Henri MENARD avait soin de faire rayonner sa commune avec par exemple l'organisation d'une conférence agricole en février 1937.
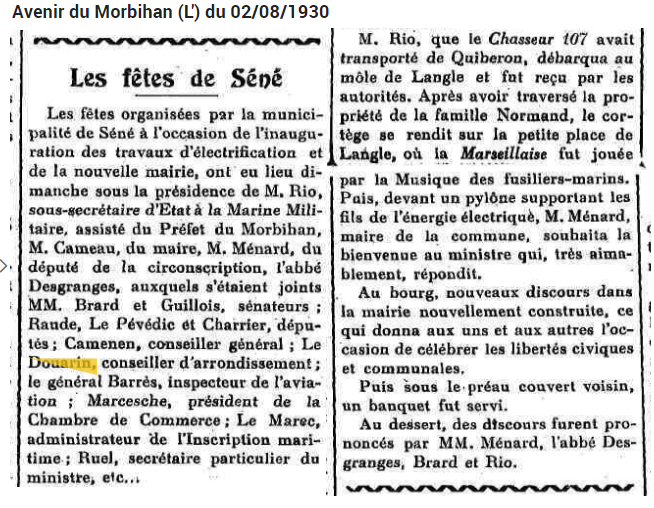
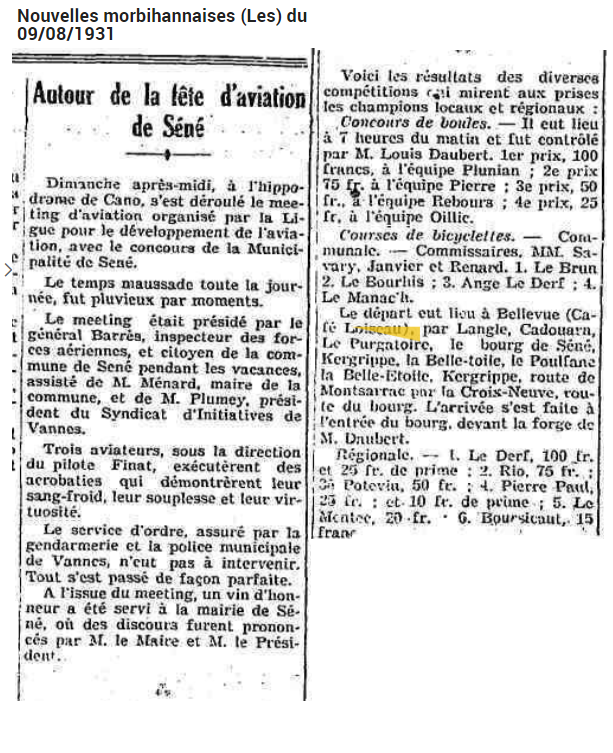
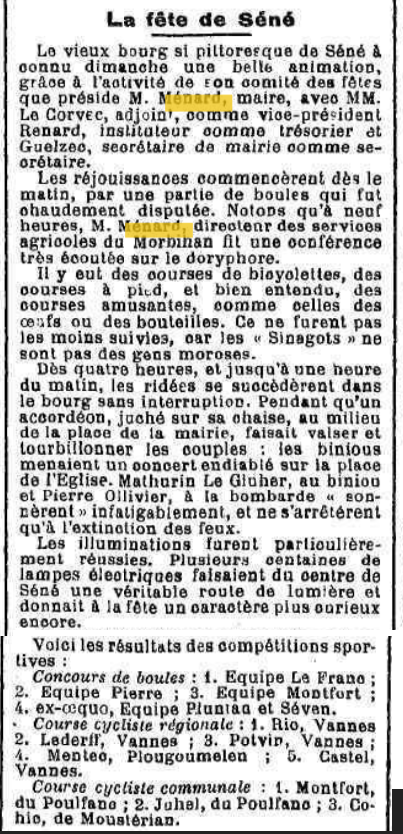
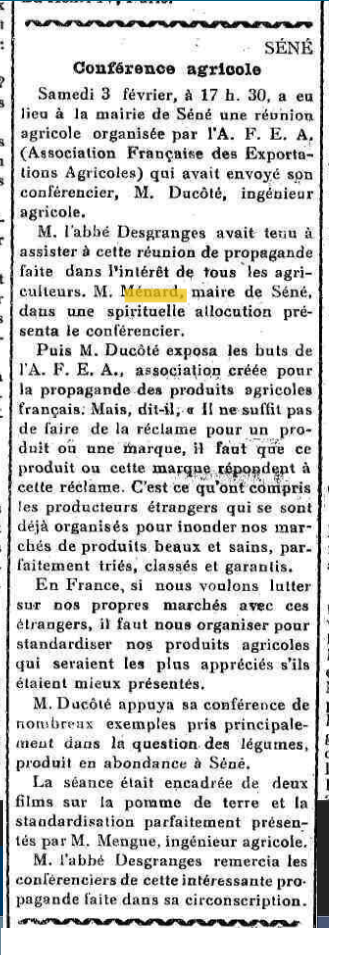

Sur cette photo datée de 1930 [Collection J. Danielo] On y reonnait :le cantonnier de Séné (1), M. ler maire et son épouse (3-4), Eugénie ROBINO et son fils Goerges (5); Marie ROLLAND, employée du café du-restaurant du bourg; Madeleine LAURE, employée de l'épicerie "Janvier" (7) et Anne Marie ROBINO, dite veuve Janvier, épicière (9).
En mars 1933, Henri MENARD est promu Chevalier de la Légion d'Honneur.
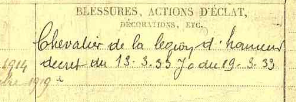
Au mérite aussi de la municipalité dirigée par Henri MENARD, la poursuite de l'électrification, comme nous le rappelle Camille Rollando : "Tout d'abord l'électrification du village 'de Montsarrac vers 1934. Jusque là, l'éclairage se faisait à la bougie, à la lampe "pigeon" ou avec des lampes à pétrole (à pied ou à suspension). Tout à basculé d'un seul coup. Il suffisait de tourner un bouton et tout resplendissait".

Par décret du 14/7/1936, Henri MENARD reçoit le Mérite Agricole. Au cours de 1937 a lieu la deuxième rupture de la digue Lorois. Les terres autour de l'ile Mancel sont innodées. Le temps de réfléchir à sa reconstruction et se fut la guerre. A la Libération, le projet ne sera pas repris. Durant la magistrature de Henri MENARD, la route vers Vannes passant sur la digue de Cantizac est construite (Source Emile MORIN).
Le grand projet abandonné à cause de la guerre
En 1938, Henri MENARD est maire de Séné depuis 1929. Fort apprécié de ces administrés il modernise Séné. Le Conseil municipal réuni le 3 juillet 1938, vote une délibération au sujet d'un projet de "Grands Travaux".
L'équipe municipale de l'époque part du constat qu'il est vain de moderniser l'école des filles qui est dans un état lamentable de délabrement et qu'il vaut mieux construire un nouveau groupe scolaire en vue d'y assurer l'enseignement scolaire, la pratique du sport et l'enseignement ménager et agricole pour les adultes.
Le groupe scolaire comprend des appartements pour deux familles à chacune des ailes, deux classes de garcons, une classe de filles et une classe enfantine. Les batiments abritent une catine, un cabinet médical et sont dotés du chauffage central.
Il propose également d'abandonner la mairie construite en 1928 et que le maire a pourtant inauguré en 1930 pour y mettre à la place la poste. Le projet prévoit en effet la construction d'une nouvelle mairie attenante à une salle des fêtes ou foyer laique d'une capacité de 420 places avec une scène et un vestibule pour les utilisateurs.
Le 2 octobre 1938, on lit sur la délibération du conseil municipal de Séné : "M le Présdient fait connaitre à l'Assemblée qu'il juge le moment opportun d'adjoindre au groupe scolaire une salle de réunion pour le foyer laïque, laquelle pourrait être utilisée pour des conférences ou des réunons organisées par les oeuvres postscolaires. les instituteurs et institutrices de la commune pourraient également s'entendre pour donner dans cette salle des projections, des soirées artistiques ou musicales pour le plus grand bien de leurs élèves."
On ne peut que relever la modernité de ce projet auquel est adjoint la construction d'une piscine en lisière du Golfe du Morbihan.
Le projet est donné à l'architecte Germain de Vannes. Ils est présenté à l'Inspecteur Primaire et le maire écrit au Ministère afin de solliciter la plus grande des subventions. Un prêt sur 30 ans est approuvé par financer ces "grands travaux".
A la veille de la guerre, le projet s'établit à 1.728.650 Frs. En 1940, après l'armistice, il est toujours d'actualité. Le maire suggère même de faire travailler les soldats démobilisés à ce projet. L'Occupation allemande et la Guerre mettront fin au projet du maire Henri MENARD. Démi de ses fonctions par l'Etat Français de Vichy, il retrouvera son écharpe triclore à la Libération.
Les plans qui suivent permettent d'apprécier la modernité et l'anticipation du projet. Bien plus tard, les maires successifs ont réalisé par étape le projet MENARD. La mairie sera aggrandie dans les années 1990; La vieille école des filles laissera place à une nouvelle salle des fêtes; Le nouveau groupe scolaire Dolto naitra dans les années 1970. La médiathèque et la salle de spectacle Grain de Sel, plus petite que le projet d'Henri Ménard, complètent l'offre culturelle et éducative à Séné.. Il ne manquerai qu'une piscine pour concrétiser la projet de "grand travaux" d'Henri MENARD !
Dans un courrier daté du 19/3/1939 adressé à l'Académie de Rennes, l’Inspecteur Primaire du Morbihan nous dresse une description précise du groupe scolaire :
Le projet qui nous est transmis est un très beau projet, établi suivant la conception élargie que l'on se fait actuellement d'une école moderne :
1) aux deux ailes, deux pavillons distoncts pour les logements, comportant des locaux suffisants soit pour deux ménages, soit pour 4 cléibataires : disposition heureuse qui assure pleine libeté à l'administration pour nommer le personnel enseignant sans autre considération que celle du service scolaire à assurer
2) Attenant à chacun de ces pavillons, une école de garçons à deux classes d'une part et une classe de filles à une classe d'autre part, avec local supplémentaire en prévision de la création éventuelle d'une classe enfantine
3) Au centre une cantine scolaire commune à laquelle les élèves des deux écoles accèderont en pasant par des lavabos distincts installés de part et d'autres de la cuisine de la cantine.
4) Une galerie suit les classes sur toute leur longueur, interrompue par la cuisine de la cantine de manière à conserver aux deux écoles leur caractère distincts : disposition ingénieuse et pratique quant àau fonctionnement du service de cantine
5) cet ensemble est complété par un cabinet médical, un vestiaire par cvlasse, deux jardions, le chauffage central est prévu.
6) Les écoles ont chacune cour, préau et privés distincts. Les privés sont pourvus de lavabos.
7) Une 3° cour est prévue : elle a son utilité pour le service d'interclasse de la cantine. D'autre part elle pourrait aisément être transformée en cour spéciale de jeux réservés à la classe enfantine en cas de création de celle-ci.
A proximité de l'école, l'installation d'une piscine est également prévue.
je suis d'avis d'approuver le projet prsenté....L'inspecteur primaire."
Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne qui vient d'envahir la Pologne....
La parenthèse de René François FAYET, nommé par l'Etat Français:

Le 26 septembre 1939, le gouvernement Daladier substitue, par décret, l’autorité du préfet à celle du maire. En novembre, il dissout les conseils municipaux communistes et révoque leur maire. Un an plus tard, le gouvernement dirigé par le maréchal Pétain, modifie autoritairement les institutions et décide, le 16 novembre 1940, que les maires seront nommés dans les communes de plus de 2 000 habitants et qu’ils choisiront eux-mêmes leurs conseillers municipaux, confirmés ensuite par le préfet. Séné est concerné par ce retour au système de 1815…
C’est en 1942 qu’une indemnité est accordée au maire, indemnité réclamée depuis 1891 par les socialistes. A Séné, le Préfet du Morbihan choisit René François FAYET, né à Brest le 21/01/1888.
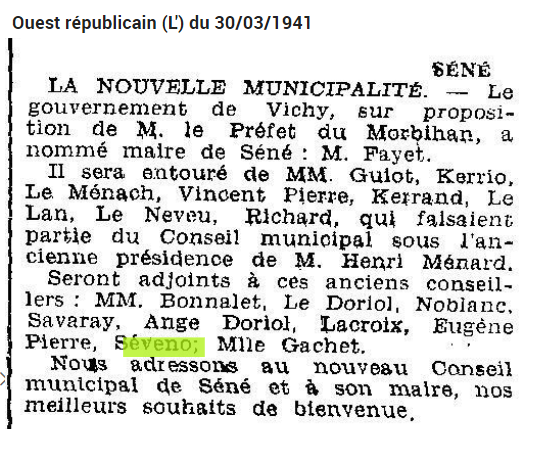
C'est un ancien combattant de la grande Guerre, ingénieur de fomation, cité pour son courage pendant la campagne contre l'Allemagne. Il finira ces jours à Séné, le 29/11/1967. Sa nomination fait réagir les Sinagots. Dans son ouvrage, "Les maires du Morbihan" (1929-1959), le professeur Christophe RIVIERE écrit :
'Lorsque l’on analyse la carrière politique des maires nommés sous Vichy, on peut constater que 29,56 % de ces derniers sont révoqués ou démissionnent avant la fin de leur mandat. Il est intéressant de relever ici que parfois, les populations contestent la légitimité de ces notables imposés par Vichy et réaffirment leur soutien aux élus désignés par le suffrage universel. Par exemple, à Séné, dans l’arrondissement de Vannes, Henri Ménard, maire radical élu en 1929, est remplacé sur ordre de la préfecture en mars 1941. L’installation de son successeur, René Fayet se passe mal car, lors de la première séance, 4 conseillers municipaux émissionnent en protestant contre la façon dont les nouvelles nominations ont été faites. L’ensemble du Conseil municipal, à majorité radicale, est en effet remanié au profit d’une très nette majorité de républicains URD. Un article du Nouvelliste de Bretagne souligne même que des groupes de Synagots se rassemblent pour exprimer leur mécontentement."
Le maire patriote:
Henri MENARD fait des aller-retour entre Séné et Méru (60) où il est directeur de l'hôpital en 1936, puis économe des Hospices Civiles de Beauvais. En 1939, il est mobilisé comme directeur de l'hôpital de Beauvais mais il sera réformé pour diabète. Son fils se souvient: "mon père a entendu le tout premier Appel du 18 juin à la radio. Après la Débacle, lors de l'été 1940, Henri MENARD, son fils et sa compagne, viennent se réfugier à Séné où ils sont accueillis chez Mme NOBLET au bourg. Sous l'Occupation, alors qu'il dirige l'hôpital de Beauvais, il participe à un réseau visant à cacher des déportés du camp de Royallieu avec l'aide de l'hôpital de Compiègne. Sa santé s'affaibli. Le Gouvernement Provisoire de la République doit reprendre l'administration du pays. Par décret, Henri MENARD, comme les autres maires en France est rétabli dans ses fonctions. Il en reviendra pas à Séné à cause de son état de santé. Le directeur du Sanatorium de Villers sur Marne décède dans cette commune d'un cancer colorectal le 30/1/1946.
Ernestine MORICE, parcours de vie [1909-1999]
Lorsqu'on arrive au centre ville de Séné, par la rue de la Fontaine, on ne peut pas loupper la fresque murale montrant le portrait d'une mamie qui vous accueille avec son sourire chaleureux.

Le Télégramme en date du 13 avril 2017, nous raconte l'origine de cette fresque singulière inaugurée le 9 avril 2017 en présence de Luc Foucault, maire,d'Hervé Pellois, député du Morbihan, d'Anne Phelippo-Nicolas, maire adjointe en charge de la culture, et de nombreux Sinagots, et des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Ernestine MORICE.
Une autre grande photo mosaïque était visible sur le mur du rond-point qui articule la rue du Verger et la route de Nantes au Poulfanc avant l'avancée des travaux.

Pendant plusieurs mois, durant l'année passée, dans les quartiers, villages, écoles, commerces, et lors des événements associatifs, les habitants ont croisé l'un des photomatons numériques installés sur la commune et se sont photographiés. 3.400 clichés ont été ainsi collectés par Jacques Morvan, de l'association « Opération Joconde » chargée de la construction finale d'un portrait-fusion."
Mais qui était exactement Ernestine MORICE, désormais immortalisée dans cette fresque photographique?
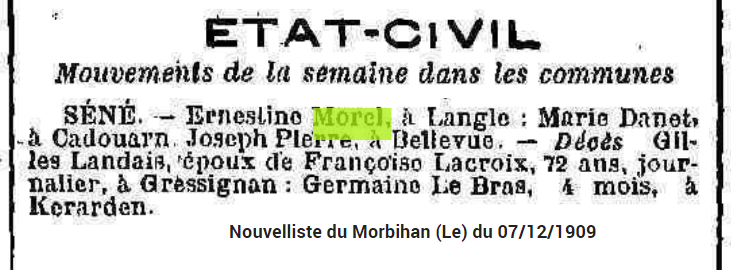
Ernestine MOREL nait au village de Bellevue le 9 novembre 1909. Son grand-père François Marie MOREL [1849-1895] périt en mer en 1895. Son corps fut rendu par la mer au large de Saint-Pierre de Quiberon.
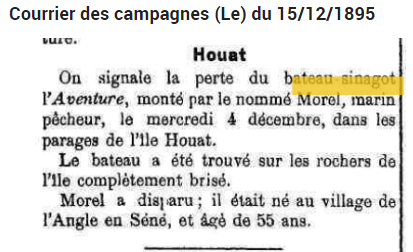
On ne s'étonnera pas de savoir que le père d'Ernestine, Julien Marie MOREL [21/04/1878-28/10/1956] est marin pêcheur lors de son mariage en 1901 avec Angèle Marie PIERRE [30/04/1874-26/04/1913], qui s'occupera d'une famille nombreuse comme nous l'indique le dénombrement de 1911.
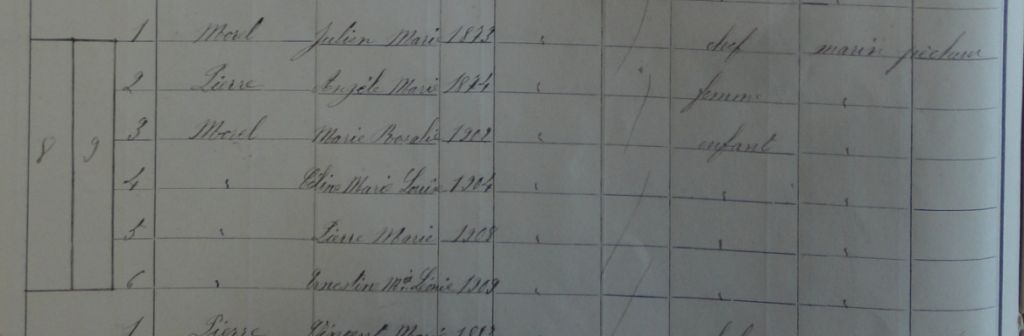
Ernestine est le 4° enfant de cette famille de pêcheurs. qui est endeuillée en 1913 avec le décès de leur maman, Angèle PIERRE. Jean Marie MOREL se remariera quelques mois plus tard avec Véronique LE ROY [23/09/1899-14/07/1957] , dont il aura un 1er enfant Julien Marie avant guerre.
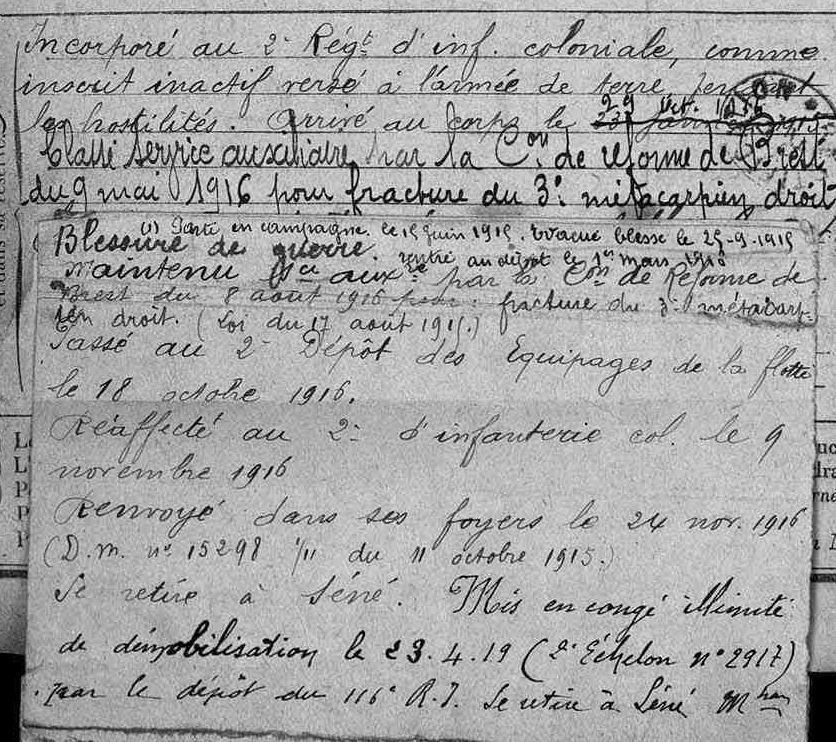
Pendant la Première Guerre Mondiale; Julien Marie est appelé à combattre sur le front. Il sera blessé au combat comme en témoigne sa fiche de matricule. L'ancien combattant reviendra à Séné affaibli par sa blessure.
Au sortir de la guerre, en 1918 comme l'indique le registre de l'école de Bellevue, Ernestine arrête sa scolarité et aide sa mère aux taches du foyer. L'extrait de naissance d'Ernestine nous apprend qu'en 1921, elle est "adoptée par la Nation". Le foyer perçoit ainsi une aide de l'Etat, car le père est un blessé de guerre.
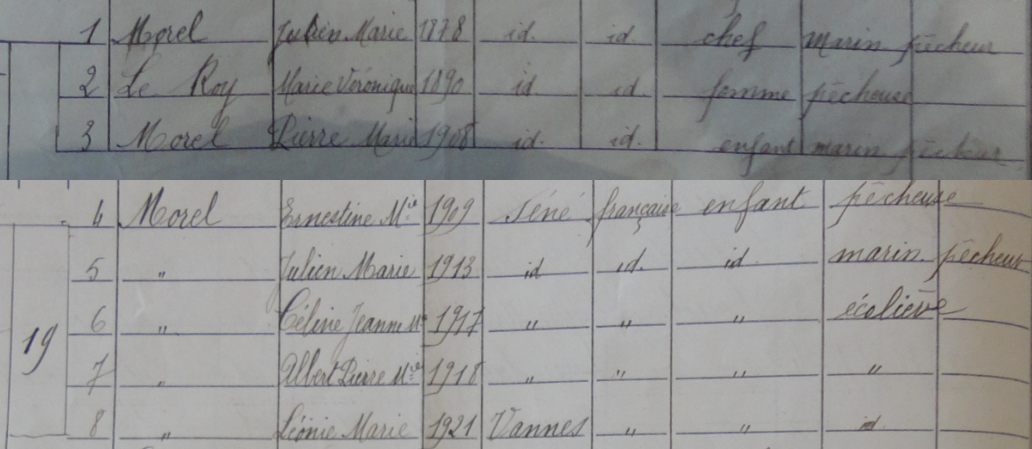
Comme l'indique le dénombrement de 1926, la famille s'est aggrandie et compte 6 enfants sous le même toit. La famille a dû s'installer quelque temps sur Vannes où nait Léonie.
Ernestine, dévouée à ses frères et soeurs, attendra l'âge de 28 ans pour se marier le 1er juin 1937 avec Patern MORICE [11/04/1909-19/03/1976].
De cette union naitront deux enfants, l'aîné, Jean Jacques [2/6/1943-27/9/1990] et Marthe [26/3/1938-20/10/2008].
Le 31 décembre 1950, la chapelle de Bellevue est inaugurée et fort naturellement, le recteur Poezivara confit les clefs à Ernestine MORICE dont la maison est sise en face le nouveau lieu de culte sinagot.
Femme de matelot, mère au foyer, Ernestine travaille en saison dans une usine de sardine à Quiberon. A la retraite, lorque son fils s'installera pêcheur à Séné, elle ira vendre du poisson pour compléter ses modestes revenus. Sa petite fille se rappelle que son oncle la déposait sur une cale à l’Ile d’Arz ou sur une cale de Arradon. Elle vendait son poisson chargée sur une brouette...
En 1976, Ernestine perd son mari, Patern MORICE. Malgré une reversion de veuve, Errnestine doit se mettre à la pêche à pied pour compléter ses revenus. Elle part à marée basse sur l'estran de Langle et de Boëdic, son île préférée.

Si en semaine elle porte un petit bonnet, pour aller au marché à Vannes ou participer au club Vermeil, elle se couvre d'une belle coiffe vannetaise. Lors de la Fête de Port-Anna, elle s’endimanche et son sourire généreux retient l'attention des photographes.

En 1980 FR3 fait un reportage sur les derniers marins de Séné à l’initiative du recteur Joseph LE ROCH. C’est la seulle femme admise dans le café de Bellevue. Cette première apparition télévisuelle va faire sa renommée.
Dans les année 80, Ernestine emmène ces petites filles sur Boëdic lors de pêches à pied mémorables. La scène interpelle le photographe @Plisson qui l'immortalise à la pêche, dans son potager et la met en scène sur la barque du bateau de son fils..

Au cours de cette décennie, le très regardé magazine de FR3,Thalassa, lui consacre un reportage. La légende s'installe et Ernestine se prêtera volontiers au jeu des média sans trop rien savoir à l'époque de son "droit à l'image"...
En avril 1987, le journaliste Pierre BONTE lui consacre également un reportage dans son émission. Dans les années 80, à l'initiative de la Région Bretagne,Ernestine enregistrera également des chansons en français. En 1987, Ernestine participe à l'inauguration du foyer-logement au bourg, comme d'autres femmes vetues de la traditionnelle coiffe vannetaise.
Cette autre photographie la montre lors de la Fête de Port Anne en 1988.
En juin 1990, elle participe au fêtes du jumelage avec Donegal, comme en témoigne cette autre photographie extraite du bulletin municpal.
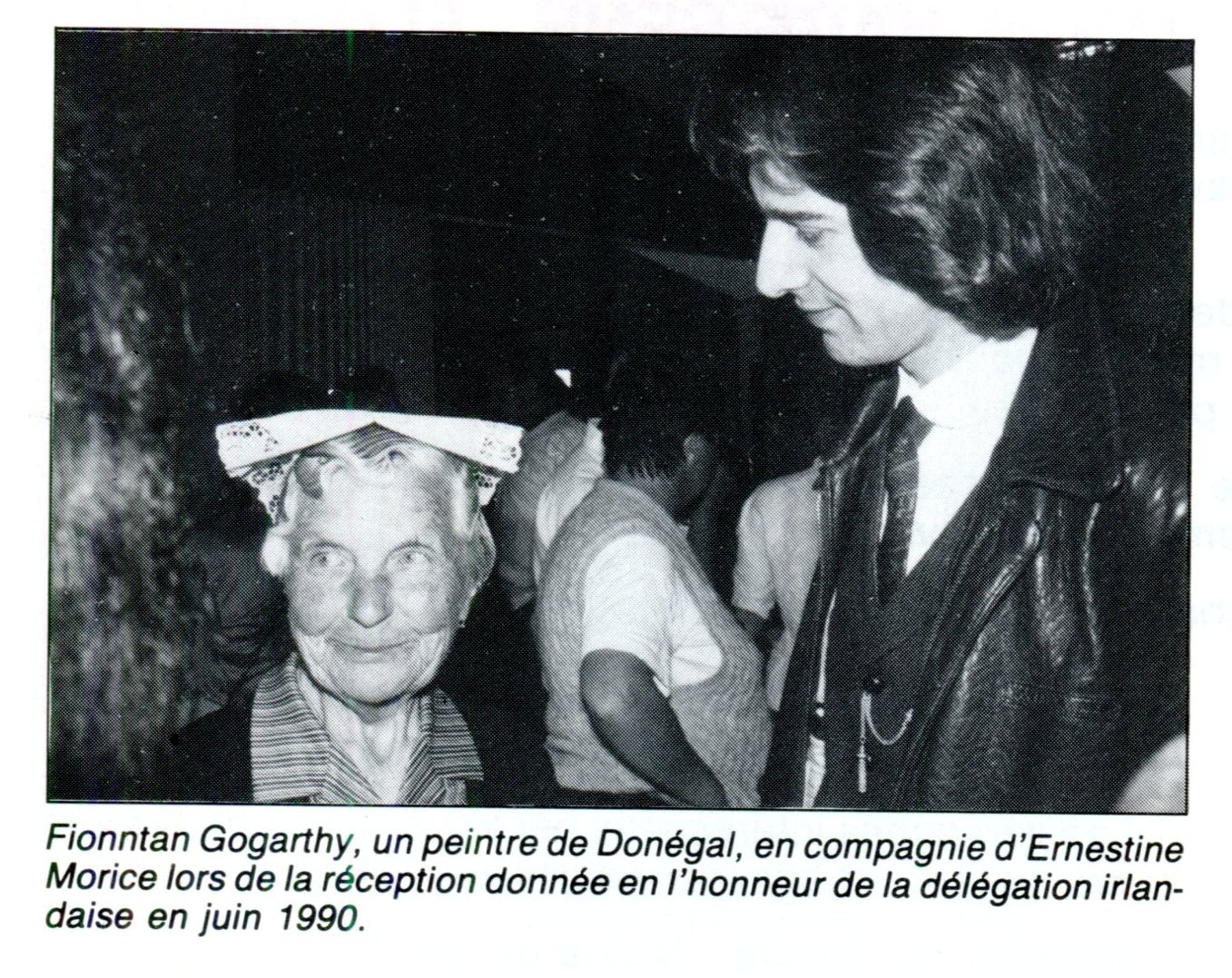

Ernestine MORICE en compagnie de Patern RICHARD
En septembre 1990, le décès accidentel de son fils Jean Jacques lors d’un retour de pêche, sera surmonté par l'arrivée dans la famille de son premier arrière petit-fils.
Après quelques mois d’hospitalisation, Ernestine décède le 24/10/1999 des suites de la maladie d’Alzheimer à l'hôpital de Saint-Avé.
Lors de ses obsèques, Jean Richard écrira ce petit poème en sa mémoire.
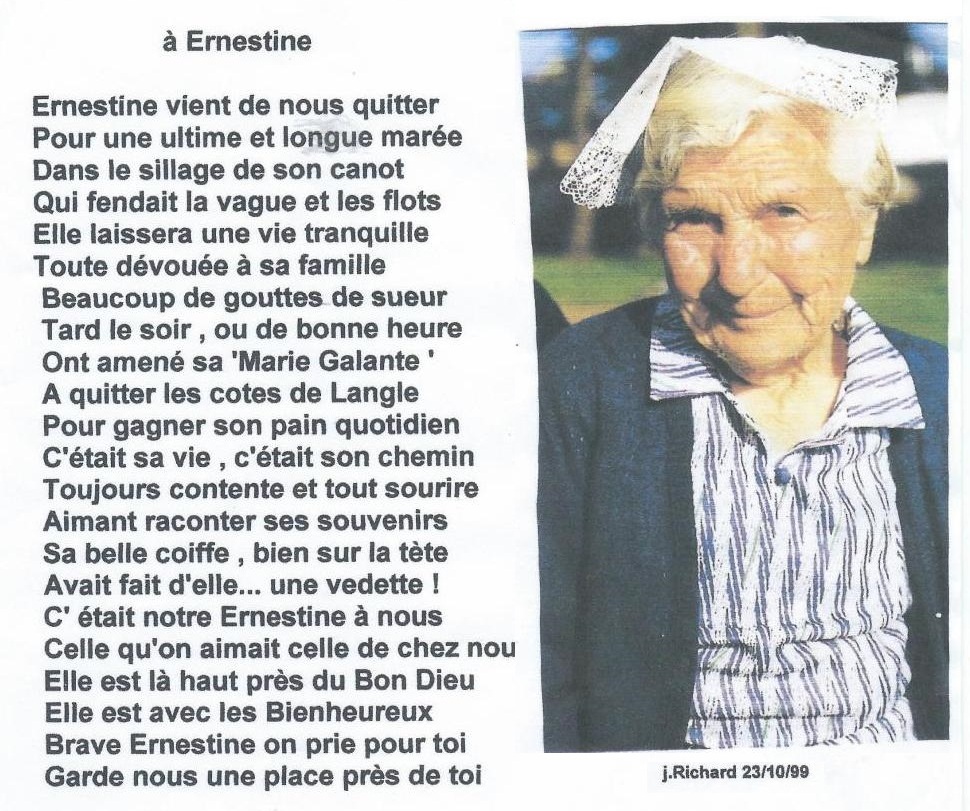
Rendue célèbre par le petit écran, elle a été photographiée de multiples fois lors d'apparitions publiques à Séné, Ernestine MORICE savait porter la coiffe vannetaise comme d'autres dames de Séné. Toutefois, son charisme, tel qu'il se ddégage des photos ou des films, et sa gentillesse ont contribué à sa célébrité locale. Elle est devenue une figure emblématique de la commune et mérite à ce titre le nom d'une rue de Séné et une fresque murale au bourg.
Les maires honoraires de Séné
Wiki-sene a demandé aux 4 anciens maires de Séné de se présenter et de rédiger un petit résumé de l'histoire de leur mandat à Séné.
Les contenus ont été mis en forme, avec quelques sous-titres en gras, pour aérer le texte,, quelques insertions de photographie, mais le texte reste fidèle aux "copies remises" par nos anciens élus que je remercie de leur participation.
Daniel MALLET [1980-89]
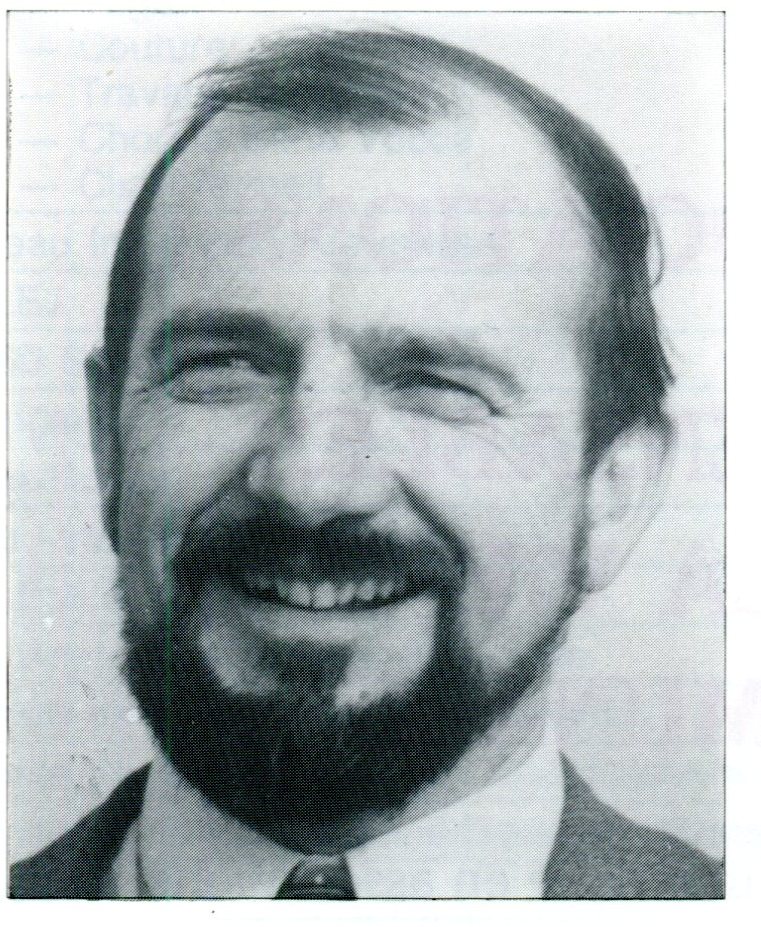 Un breton du nord vers le sud…
Un breton du nord vers le sud…
Je suis Daniel MALLET, né le 10/01/1943 à la Fresnais (35), côte nord de Bretagne près de Cancale.
J’ai fait mes études aux beaux-arts de Rennes jusqu’en 1965. J’ai obtenu un diplôme national supérieur aux beaux-arts de Paris puis je suis devenu professeur en arts plastiques en lycée et collège. Premiers postes au lycée Malherbe de Caen puis Rennes, Alençon, Redon et enfin au collège Gilles Gahinet à Arradon.
En retraite depuis 2003, j’ai été marié en 1965, mon épouse était professeur d’espagnol et j’ai deux filles et cinq petits enfants. Mon épouse est décédée en 2003 son dernier poste étant au collège Cousteau de Séné auparavant au collège Jules Simon de Vannes.
Sinagot depuis 1970…
Nous avons acheté un terrain et construit Route de Bindre à Séné en 1970. Mes enfants allaient à l’école du Poulfanc.
Elu depuis 1977…
En 1977, j’étais président des parents d’élèves de cette école et M. Guyomar Albert, le maire de l’époque, m’a proposé de faire parti de sa liste pour les élections de 1977 à l’époque par liste ouverte, Séné étant une commune de moins de 3.500 habitants. J’ai été élu à la suite de quoi je fus élu 1er adjoint chargé du sport et des affaires scolaires durant trois années.
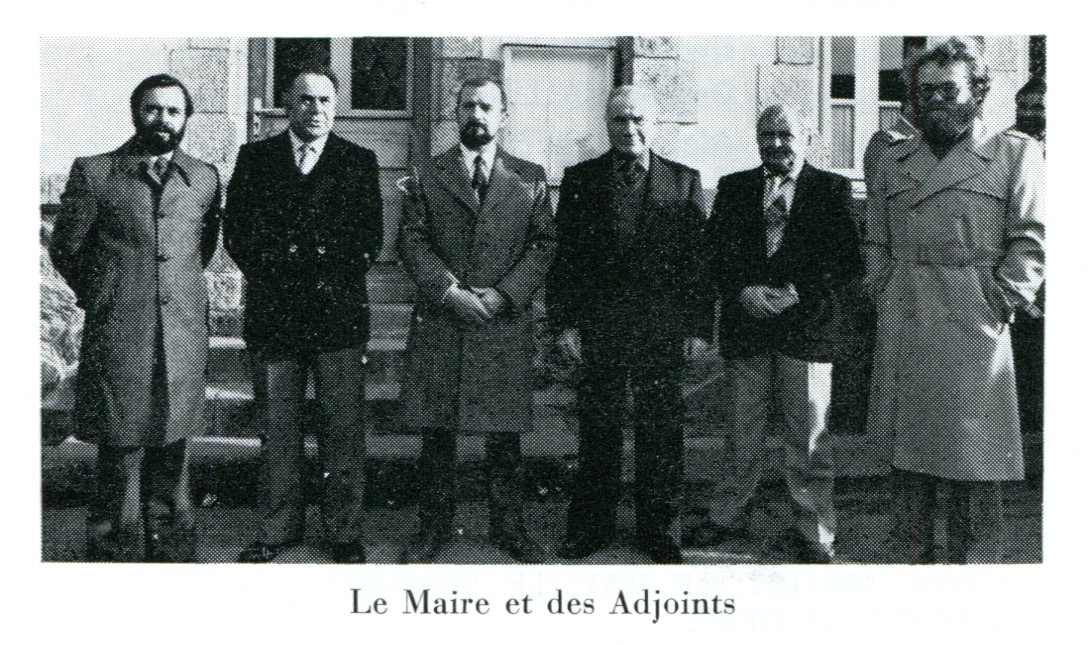
Sur la photo : le maire et ses 5 de ses adjoints à reconnaitre parmi :Bernard TOUCHARD, Alain LE DERF, Louis GUELZEC, Gilbert LE BOULICAUT, Claude CALATAYUD et BERTRAND.
Maire en 1980…
Après que Albert Guyomar démissionne pour raison de santé (il est décédé de la maladie d’Alzheimer), j’ai été élu maire en 1980.
Une succession d’équipements pour la commune …
Les chantiers furent la cale de Port Anna, la construction de la nouvelle école de Langle, la construction de nouveaux terrains de football à Le Derf, Langle et Cano ; la salle associative de Limur, le rond-point d’Intermarché et le début de la zone commerciale du Poulfanc, l’agrandissement de l’école du Poulfanc et le démarrage de la cantine scolaire et de l’école maternelle du bourg, la construction du tennis couvert au Derf ; la salle des fêtes du bourg, les prémices de la réserve de Falguérec avec la SEPNB et des sentiers côtiers en 1989.
Je suis de nouveau le 1er adjoint de Marcel Carteau et ces chantiers furent continués et terminés comme le tout à l’égout et les stations de relèvement, salles des associations, salle des jeunes et ancienne bibliothèque, poste et maisons HLM.
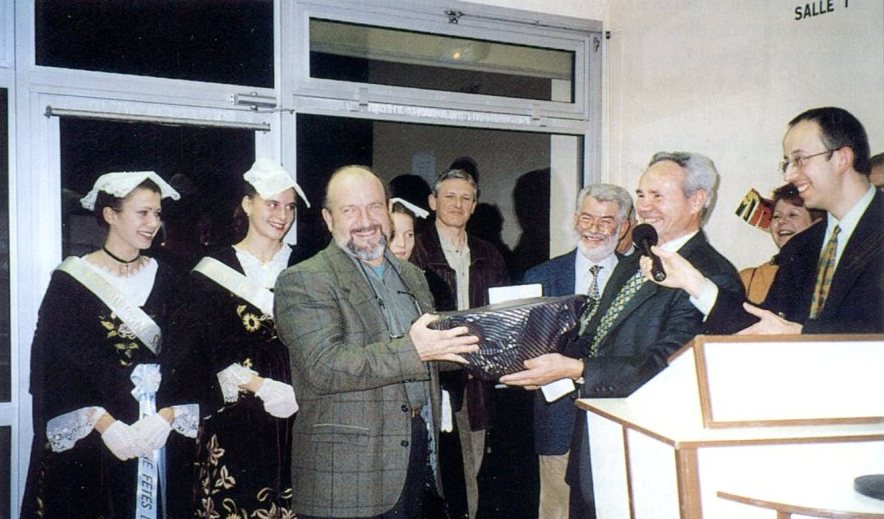
Médaille d’Argent pour son engagement municipal…
Au total, j’ai fait 4 mandats pendant 12 ans maire et maire adjoint et 12 ans comme simple conseillé, décoré de la médaille d’argent pour 24 années au service de la commune de 1977 à 1996.
Un artiste peintre sinagot…
Depuis je fais toujours parti de « Arts Sinagots » que j’ai mis en place en 1989 (dans le cadre du bicentenaire de la Révolution) et poursuis mon œuvre de peintre.

Francis POULIGO maire de Séné de 1983 à 1989.
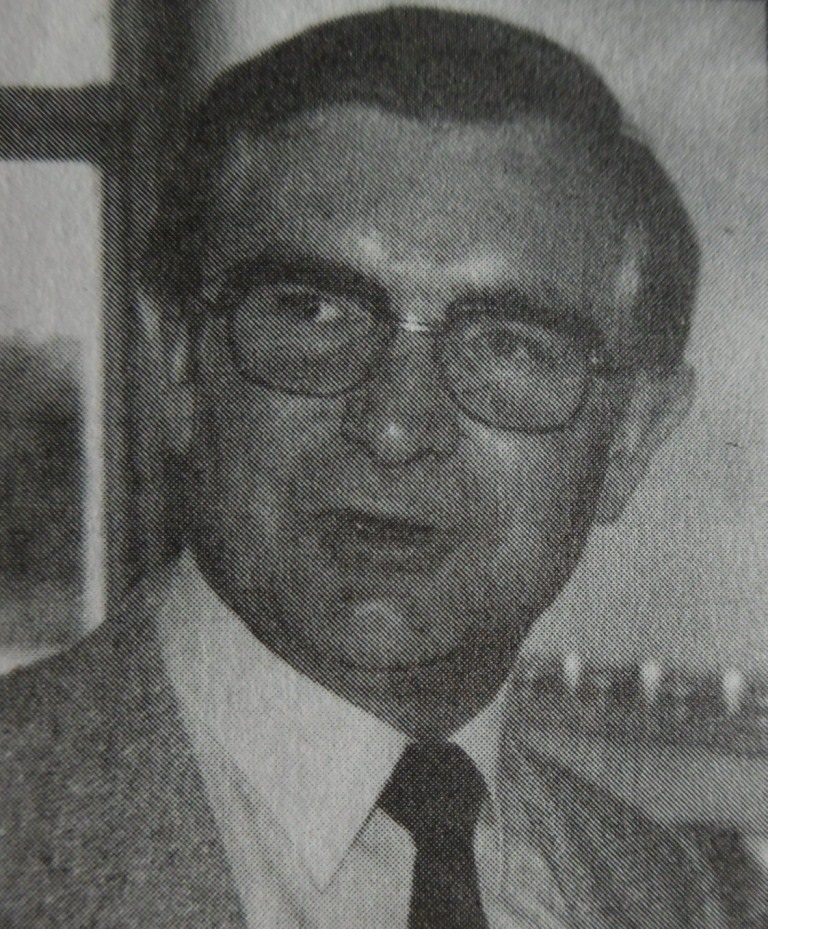
Francis, André, Marie POULIGO, né le 13 janvier 1942 à Plérin - Côtes-du-Nord
LA FAMILLE :
Le père : crée, en 1945 à la fin de la guerre, une petite entreprise de transport et de ventes de sables et matériaux de construction, de bois de chauffage… Cette petite entreprise d’une dizaine de salariés dans les années1970, se tournera vers les travaux publics et privés… Elle sera reprise par les 3 frères à la retraite du père : Guy, Claude, Francis.
La mère : tient un café qui est aussi l’annexe de l’entreprise familiale.
De 1946 à 1961 : écoles maternelle, primaire puis lycée classique jusqu’en 4e, puis études professionnelles de comptabilité.
De 1961 à 1963 : service militaire dans la Marine à Cherbourg. Quartier-Maître Fourrier
1962 : Mariage – 4 enfants – 10 petits-enfants
1971 – Construction d’une maison à Séné
PARCOURS PROFESSIONNEL
1963 -1964 : Cabinet d’expertise comptable à St-Malo,
1964 : chef comptable entreprise de bâtiments, à Rennes, importante et en difficulté, cliente du cabinet d’expertise. Liquidation.
1965 à 1981 : Groupe Agro-alimentaire GUYOMAR’H. Chef comptable puis Directeur Administratif de la Société BETINA à St-Nolff, Centre de Sélection et de production de la Dinde, 150 salariés, 4 filiales dont 1 italienne. Leader dans ce marché. Responsabilité de l’ensemble des services comptable, Administratif, Informatique, Personnel, Fiscalité, Juridique du Siège et des filiales.
1981 à 1990 – Directeur Administratif de la Société GALINA (Groupe GUYOMARC’H introduit au second marché) – Abattoir de poulets – à Vannes – 600/700 salariés – 2 filiales – mêmes fonctions que chez BETINA.
1990 à 1993 – Directeur Financier Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan au Port de Pêche de Lorient (jusqu’au transfert du Port à la Compagnie d’Exploitation des Ports – Filliale de la Compagnie des Eaux) et Directeur de la Caisse des Dockers Ports de Commerce et de Pêche.
1993 à 1996 – Contrôleur de gestion auprès des services (Antennes locales de la CCIM, Ecoles de formation, Port de Commerce, aéroport de Lorient, Chorus) de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan .
1997 – Directeur du Parc des Expositions CHORUS à Vannes : Organisations de Salons, d’expositions de manifestations, de spectacles…
1998 – Départ en pré-retraite après la reprise du CHORUS par la Ville de Vannes.
EN MARGE DE MES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES
J’ai occupé des fonctions d’administrateur,
D’une Caisse de Retraites,
D’un Comité Interprofessionnel du Logement
D’une Banque Mutualiste
PARCOURS ASSOCIATIF
Successivement Président, Vice-Président, Trésorier ou membre de diverses associations : écoles, Société des Courses, Foire Expositions de Vannes, AVLEJ, Croix-Rouge, club de sports, Défense de campeurs-caravaniers, Société St-Vincent-de-Paul…
Avec une mention particulière pour « LA YOLE DU MORBIHAN » dont je suis un des membres fondateurs. (de 1988 à 2007).
PARCOURS D’ELU ET DE MAIRE
1977 à 1983 – Conseiller Municipal d’opposition sous le Mandat d’Albert GUYOMARD, puis de Daniel MALLET en 1980 après la démission de Mr GUYOMARD. Mandat cool, sympa, pas ou peu politique.
1983 à 1989 – Maire
1989 à 1992 – Conseiller Municipal d’opposition. Pas cool, très politisé. Démission pour des raisons professionnelles –travail prenant à Lorient, et aussi manque de motivation et d’intérêt.
2001 à 2008 - Adjoint au Maire Patrick SALIC. En charge de : finances, personnel, communication, eau et assainissement.
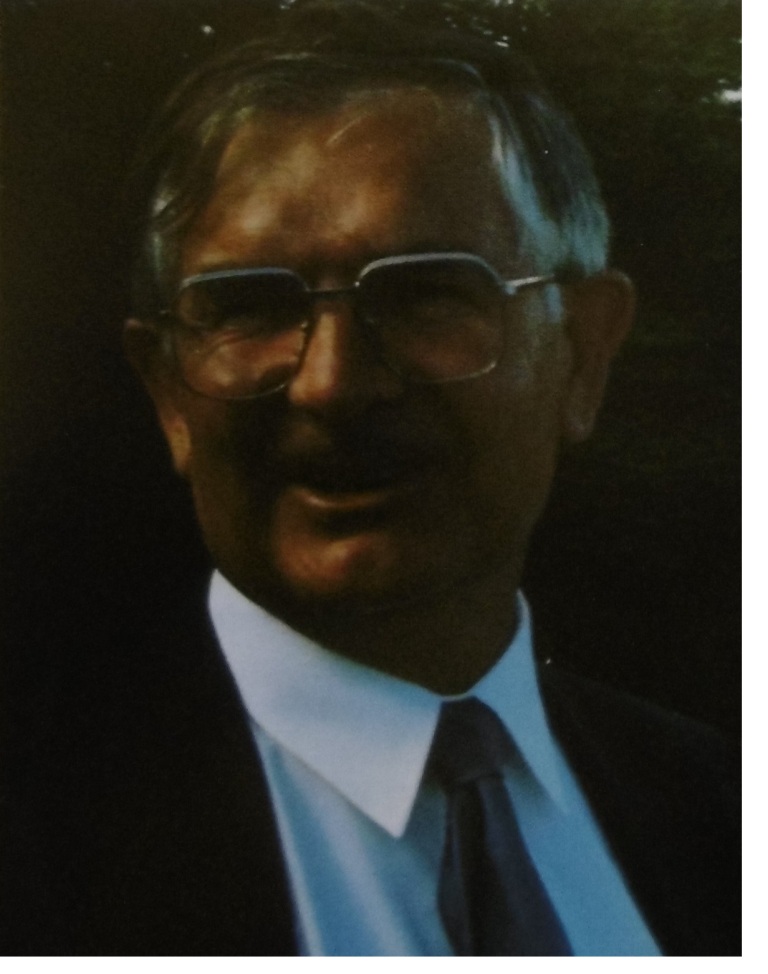
Emilien NOBLANC : travaux. Agriculture. Eau. Assainissement
Geneviève RIGUIDEL : Urbanisme
Laurent DRILHON : Affaires scolaires
Michel DUPUIS : Sports et Associations
Emile LE HUITOUZE : Affaires Sociales
Bernard LESCOUBLET : Affaires économiques
Gérard ALLANIOUX - Affaires Maritimes
REALISATIONS PENDANT LE MANDAT 1983 – 1989
Affaires Maritimes
1985 - Capitainerie de Port Anna
1988 – CM du 23/9/1988 - Décision de construire un Sinago « Jean et Jeanne ». Création d’une Association qui doit porter le projet « Un Sinago pour Séné ». Ce bateau sera mis à l’eau en 1989 (ou 1990 ?) Lire article dédié.
Affaires scolaires
1983 – Organisation du Restaurant Municipal qui est ouvert en septembre (accueil des enfants du Public et du Privé)
1987-1988 – Collège Cousteau
1987–1988 – Complexe sportif Cousteau
1987 – 1988 – Route d’accès au Collège
Sports et Associations
1984-1985 – Création d’une base nautique à Moustérian
1985-1986 – 1ère Salle de sport au stade Le Derff
1986 – 1er terrain de tennis au stade Le Derff
1986 – Salle multifonction de Limur
1988 – Tribunes du terrain de Foot-ball Le Derff
Environnement et voiries
Jonction entre la zone du Poulfanc Séné et la zone du Prat Vannes
1984 – Négociation de gestion du réseau eaux potables avec la Compagnie Générale des Eaux. Les principes retenus restent valables encore aujourd’hui.
Achat et aménagement des terrains pour liaison du bourg et le Centre commercial des Lilas.
Environ 5 kms d’aménagement de chemins littoraux
Affaires sociales
1987-1988 - Construction d’un Foyer-Logement pour personnes agées
En cours de mandat, construction de plusieurs lotissements HLM
Urbanisme
1986-1987 Construction des ateliers Municipaux
1987 – Construction du presbytère. Démolition de l’ancien presbytère en gardant sa porte entrée, visible aujourd’hui.
1986 – Gros travaux sur la toiture de l’église.
Affaires économiques et tourisme
1985 -1986 -Centre Commercial des Lilas. Négociations et ventes des terrains ZAC
1986 – Négociation avec la cimenterie implantée au Poulfanc. Développement de la zone commerciale du Poulfanc
1987 – le SIVOM du Pays de Vannes attribue à Séné la construction d’une Auberge de Jeunesse. Achat des terrains route de Moustérian. Construction en 1992. (CM du 20/11/1987)
Affaires politiques
1984 – Jumelage avec la commune de Geispolsheim (Alsace)
1984 – Création d’un SIVOM (Syndicat à Vocation Multiple) du Pays de Vannes, avec les communes 1ère couronne de Vannes – Mutualisation des services suivants : Services de secours. Transports urbains. Tourisme. Ecole de Musique. Activités Economiques
MARCEL CARTEAU, maire de Séné de 1989 à 2001

Un Vendéen qui deviendra sinagot en 1968...
Né le 16 janvier 1934 à St Pierre du Chemin (Vendée), de parents agriculteurs. 30 mois de service militaire en Allemagne et en Algérie.
Se marie dans la même commune le 6 octobre 1959.
Technicien agricole sur le canton de la Gacilly et Guer, puis formateur au centre de formation en Elevage de Kérel en Crédin, puis Technicien Départemental en élevage bovins à la Chambre d’Agriculture du Morbihan. C’est à cette occasion qu’il vient habiter à Séné en 1968.
A Séné il participe à différentes associations au niveau de l’école et au démarrage de l’association familiale. Puis devient conseiller municipal en 1981 et Maire de 1989 à 2001, 2 mandats consécutifs.

Election de 1989

Election de 1995.
Les principales réalisations :
En voirie : Création de l’avenue Mitterrand qui devait se prolonger jusqu’à St Léonard mais à été refusé par le tribunal en raison de la loi littoral.
Déplacement de la route qui traversait le champ de course à l’extérieur.
Création de la voie de sortie du bas de Cadouarne pour des questions de sécurité suite à un feu de maison que les pompiers n’ont pu accéder à temps. Création de la déviation du bourg avenue Donégal et aménagement de la route du gouavert
Urbanisme : construction des HLM : à Langle et agrandissement de l’école. Création d’HLM à côté du Collège Cousteau Réaménagement du centre Bourg avec agrandissement de la Mairie, déplacement et construction de la poste et des HLM, bureau du crédit agricole et commerces, Maisons des associations, Bibliothèque municipale en face du café. Achat et aménagement du parc de Cantizac jusqu’au pont lisse. Création dev la ZAC de Kerfontaine pour des logements HLM et des propriétaires privés.
Environnement :Aménagement des chemins piétons en bordure de côte sur la majeure partie de la commune
Création de la Réserve naturelle d’Etat des Marais de Séné, lancée en 1990 et crée officiellement en 1996 avec une gestion tripartite originale associant la commune la SPNB devenue Bretagne vivante et l’amicale de chasse de Séné. Transformation d’une Porcherie pour truies (1 sur 6) en centre d’accueil et bureaux.
Création de l’auberge de jeunesse de Séné par l’agglomération.
Création de la Base Nautique de la pointe de Bil par l’agglomération.
Inauguration du nouveau Collège Cousteau de Séné réalisé par le département avec la contribution de la municipalité précédente de Francis Pouligo. C’est Michel Rocard 1er Ministre ayant un logement à Montsarrac qui a bien voulu l’inaugurer en Présence de Raymond Marcellin Président du Conseil Général et en Présence de Pierre Joxe Ministre de l’intérieur.
Agriculture : Aménagement foncier de toute la commune pour permettre l’installation de maraichers et autres agriculteurs sur la commune. Les parcelles étaient souvent trop petites et difficiles à entretenir, certaines devenaient des friches.
Création des chemins entre quartiers : A cette occasion la commune a acheté les chemins pour desservir les parcelles mais en modifiant les tracés pour permettre à la fois l’accès aux parcelles et le déplacement en vélo ou à pied d’un quartier à l’autre.
-Mise en place de la gestion des mouillages par la commune
Avec la participation d’associations, jumelage avec une ville de Roumanie (Floresti), puis deux d’Irlande : Donégal-Ballischanon.
Patrick SALIC, maire de Séné de 2001 à 2007
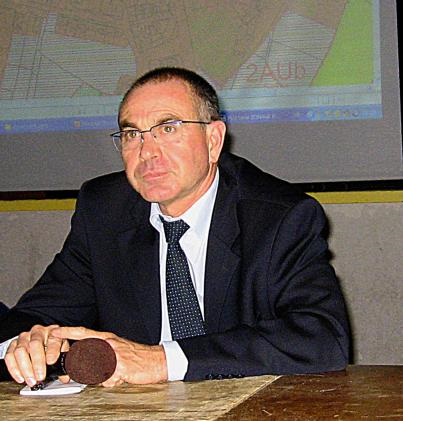 Un enfant de la Nation.
Un enfant de la Nation.
Né le 31 octobre 1954 à Vannes. Je perds mon père militaire alors que je n'ai que 10 ans. Ma soeur et moi sommes pupilles de la Nation au décès de notre père en 1964.
Notre mère n'a alors que 28 ans. Employée de la mairie de Vannes en temps qu'ATSEM, elle élève ses deux enfants, moi et ma soeur. Elle sera représentante syndicale CTFT à la mairie de Vannes. Nous habitons en lisière de Séné, rue de la Lande pendant toute mon enfance.
Jeune enfant, j'ai été scolarisé en primaire à l'école Saint Joseph de Vannes puis en secondaire au collège Jules Simon à Vannes. Je rejoins ensuite le Centre d'Instruction Naval au lycée naval de Brest puis j'incorpore le Prytanée militaire de la Flèche, l'un des 6 lycées militaires en France.
Bachelier, j'entame des études de médecine dentaire à Rennes. Fidèle à mes origines vannetaise, je m'installe en tant que chirurgien dentiste à Theix en 1981.
Un engagement en politique lié à ses proches.
J'épouse ma femme pharmacienne de profession en 1984. Nous aurons deux enfants. Mon beau-père est adjoint à la mairie d'Auray avec le maire de l'époque M. Naël. Ma mère a été sur la liste de Pierre PAVEC, maire de Vannes.
J'adhère au RPR en 1981 et notre famille s'installe à Montsarrac eà Séné en 1988. Je suis conseiller municipal de Séné en 1998. Je suis élu maire de Séné en 2001 après avoir battu M. Carteau au 1er tour et éliminié Mme Marie Chevalier au second tour, car la tête de liste avait changé entre les deux tours. Pendant mon mandat de 2001 à 2008 je suis également vice-président de l'Agglomération et vice-président de la commission économique.


Les principales réalisations durant son mandat :
Voirie : Création de la route du Goah Vert; Réfection de la route de la Pointe du Bil à Moustérian. Divers travaux de voirie et des réseaux d'adduction et d'assinissement. Rénovation de la cale de La Garenne.
Urbanisme : Lotissement de Kerfontaine, lotissement La Croix du Sud, Lotissement Vent du Golfe, lotissement de Kercourses. Résidence Les Paludiers. Retructuration du centre commercial au Poulfanc.
Culture : réalisation du Théâtre de Verdure
Equipements : réfection des ateliers municipaux. Création de la salle Salicorne à Langle. Rénovation du Centre Nature de la Réserve de Falguérec. Agrandissement de la salle de Limur. Pole tertiaire route de Nantes.
Sport : Estension du gymnase au collège Cousteau. . Club house salle du Derf. Extension mur escalade à Cousteau. Terrain de football de l'hippodrome. Salle de dojo au Derf.
Enfance-Education : Création du Pole Enfance rue des Ecoles : multi-accueil, relai assistantes maternelles et Centre de Loisirs.

Inauguration du Pôle Jeunesse

Aimé CAPPE, instituteur libre...à bicyclette

Parmi les cartes postales anciennes de Séné qu'Emile MORIN a réuni dans son livre intitulé" Le Pays de Séné", une, singulière, nous montre une vue sur l'église Saint Patern avec au premier plan, un cycliste., qui par sa présence donne un aspect pittoresque au cliché.
Emile MORIN nous raconte que ce cycliste,photographié dans cette rue de Séné, qui deviendra la rue des écoles, n'était autre que l'ancien instituteur de Séné, Aimé CAPPE [8/9/1878-4/7/1946].
"Ses anciens élèves se souviennent qu'ils devaient l'aider à monter sur le vélo qui n'avait pas de frein. Avec la rue en pente, il se retrouvait souvent au lieu-dit "Le Purgatoire" où les enfants devaient aller le chercher pour le remonter jusqu'à l'école."

Le photographe David qui pris le cliché vers 1913, immortalisa ainsi Aimé CAPPE, instituteur qui se réclama jusqu'à ses derniers jours de l"école libre". Né à Carnac, d'un père menuisier et d'une mère ménagère, Aimé CAPPE, était un fervant militant de "l'école libre" comme nous l'indique cette coupure de presse datée de 1910.
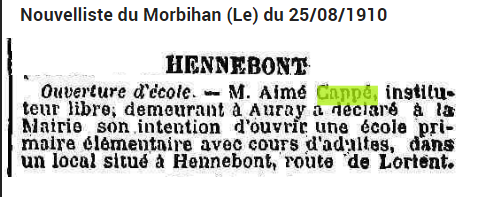
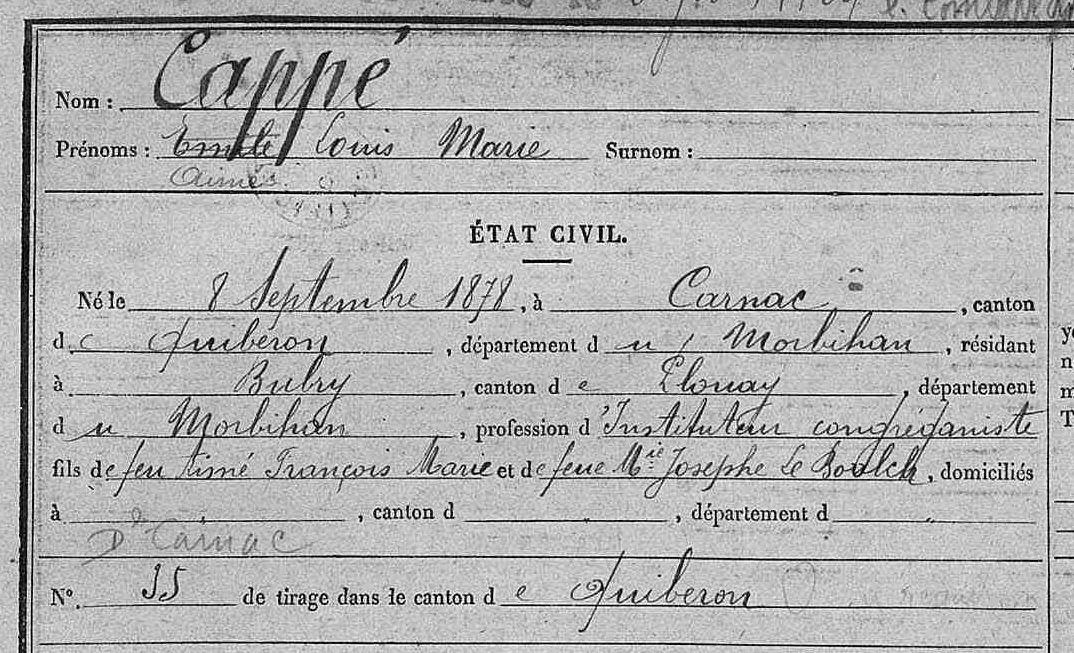
Sa fiche de matricule nous indique que son père étant décédé et qu'en tant que fils aîné, il est dispensé de conscription. Le jeune "instituteur congréganiste" comme le nomme le fonctionnaire laîc vers 1920, lors de la rédaction de la fiche de matricule, travaille sans doute pour subvenir au besoin de sa mère et de ses frères et soeurs. Cependant, il passe 9 mois au sein du Régiment des Chasseurs à pied entre nov-1899 et sept-1900.
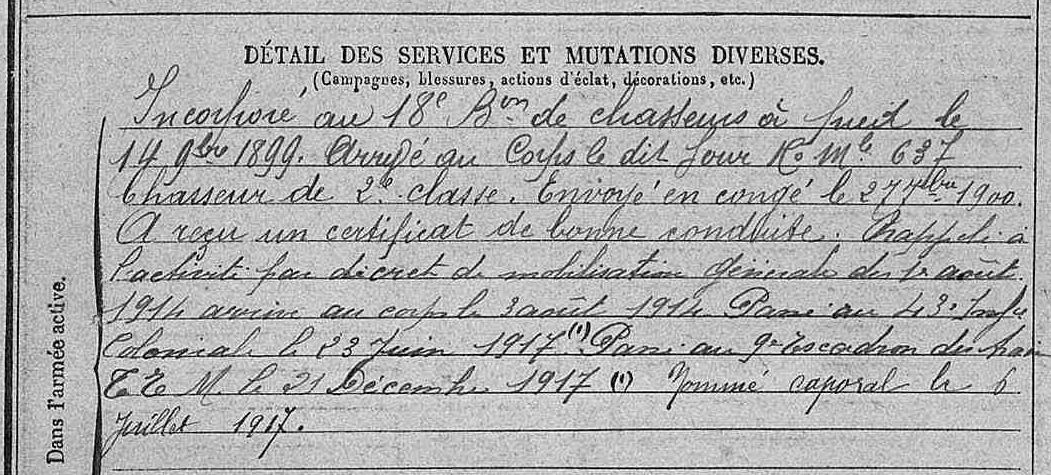
En 1914, il est mobilisé, d'abord dans le 47° régiment d'Infanterie Coloniale puis dans le 9° Escadron du train. Il sera nommé caporal en 1917.
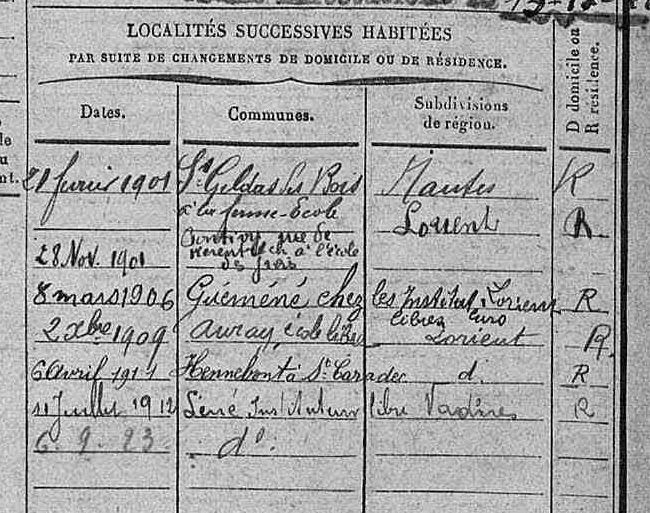
L'administrration des Armées est organisée et oblige régulièrement ses hommes à déclarer leur situation professionnelle. Cette même fiche de matricule nous renseigne sur les différents postes d'instituteur d'Aimé CAPPE avant son affectation à Séné.
Au dénombrement de 1911, son nom n'apparait pas dans les registres de Séné. Sa fiche de matricule indique une arrivée à Séné en juillet 1912. Au dénombrement de 1921, celui qui suit la guerre, Aimé CAPPE fait partie de "équipe pédagogique" de l'enseignement privé de Séné aux côtés du recteur de l'époque, Pierre OLLIER, et d'un autre instituteur, Célestin LE BIHAN.
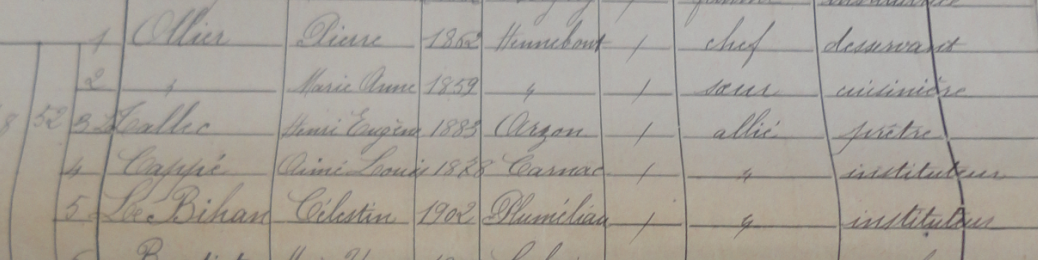
La guerre aura emporté 91 Sinagots "Morts pour la France" et laissé à Séné un grand nombre d'Anciens Combattants. Aimé CAPPE rejoint l'Union Nationales des Combattants, U.N.C., comme en témoigne ces articles de presse. dont il sera un membre très impliqué et une plume appréciée.
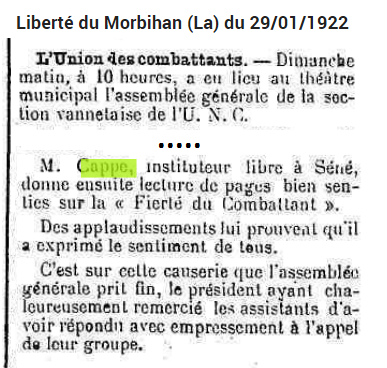
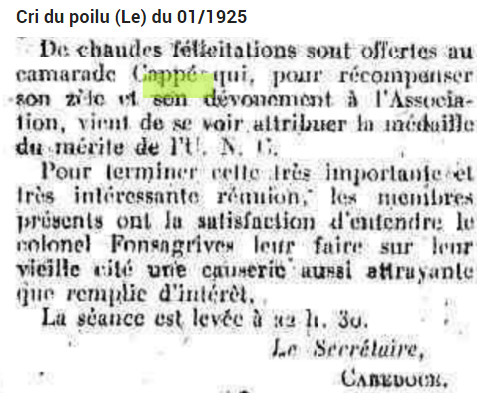
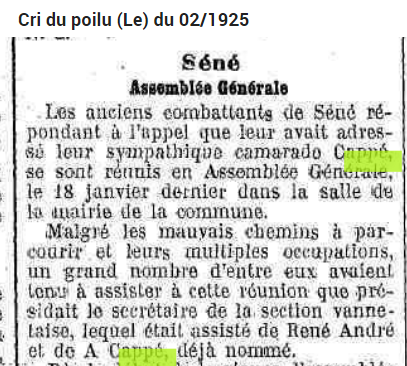
Au dénombrement de 1926, Aimé CAPPE est "institueur privé" aux côtés de Marie Rosalie LANGLOIS et de Paul André HARDY. En 1931, CAPPE est recensé comme "instituteur libre" aux côtés de Yves Pacifique LAVAIRIJE.
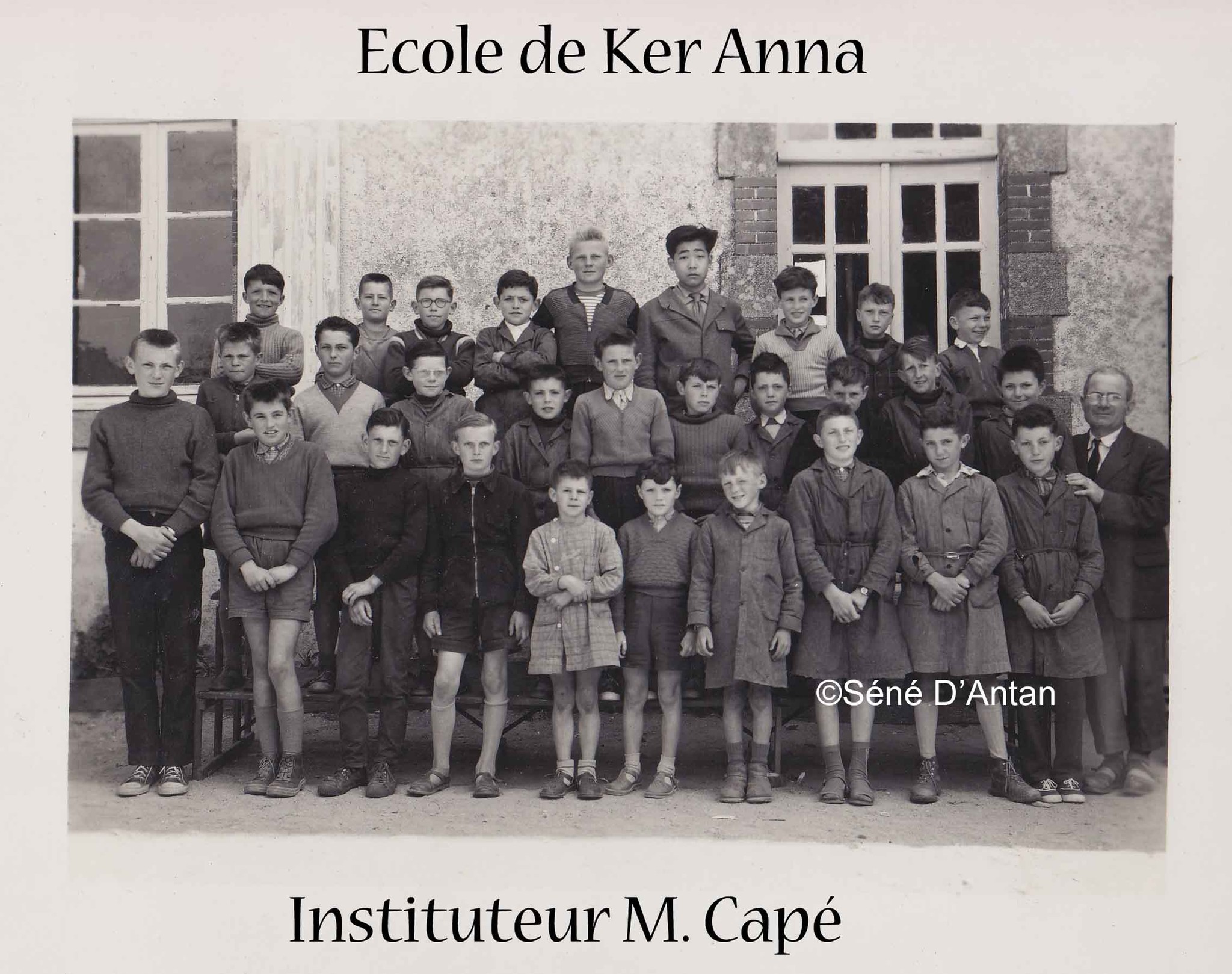
Le 11 novembre 1937, Aimé CAPPE organise la cérémonie du 11 novembre qui se finit par un repas chez Mlle Robino.
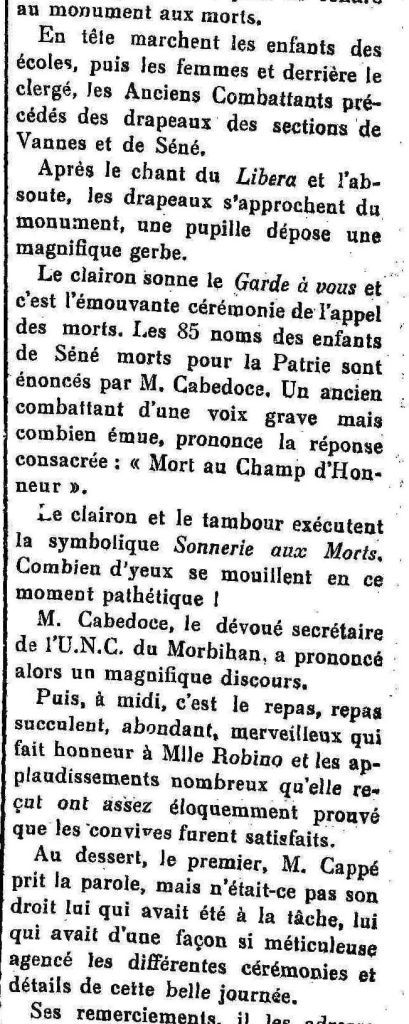
Toujours membre actif de U.N.C. il parvient à réunir cette association sur Séné à plusieurs reprises et il organise la cérémonie de commémoration des 20 ans de l'Armistice, le dimanche 27 novembre 1938..
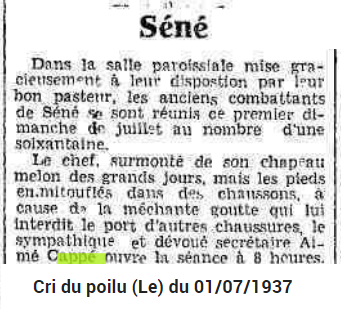
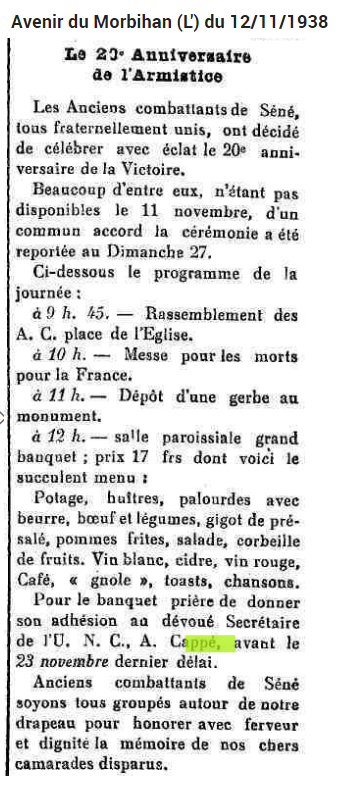
Aimé CAPPE, l'instituteur dans l'enseignement privé catholique, immortalisé sur sa bicyclette, personnage de "carte postale" décède en 1946. Il sera inhumé dans la tombe du recteur Georges Le Buon, toujours visible dans la partie ancienne de notre cimetière. On ne sera pas étonné de l'épitaphe qu'il choisit.
Recteurs de Séné "actuels"
Alberto LEQUITTE [2003-2013]
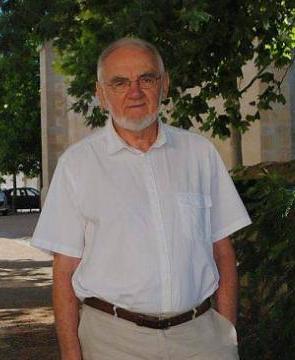 Recteur de la paroisse de Séné pendant onze ans, Albert Le Quitte, que tout le monde appelle Alberto en raison de son passé au Mexique et au Honduras a quitté la paroisse de Séné en 2013 pour des aventures franco-mexicaines. Il répondait à quelques questions d’un journaliste du Télégramme avant son départ :
Recteur de la paroisse de Séné pendant onze ans, Albert Le Quitte, que tout le monde appelle Alberto en raison de son passé au Mexique et au Honduras a quitté la paroisse de Séné en 2013 pour des aventures franco-mexicaines. Il répondait à quelques questions d’un journaliste du Télégramme avant son départ :
Que retenez-vous de ces onze années à Séné ?
Beaucoup de souvenirs. En onze ans, j'ai appris à connaître Séné et ses habitants. La présence des gens montre que je ne suis pas passé inaperçu (sourire). Je suis émerveillé et reconnaissant de ce qu'ils ont manifesté. Je retiens aussi la rénovation de l'église que j'avais suivie. Mais ce qui compte, c'est ce que l'on a laissé chez les gens.
Pour quelle raison comptez-vous retourner au Mexique, début octobre ?
J'ai passé 27 ans de ma vie en Amérique latine, dix ans au Honduras et dix-sept ans au Mexique. Le Pape François a dit quelque chose, et je suis d'accord avec lui : un prêtre doit être capable de s'ouvrir au monde. Il ne doit pas rester dans sa sacristie, mais au contraire aller aux périphéries. Je serai à mi-temps entre le diocèse de Vannes et celui de Mexico. Il passera alternativement trois mois à Plaudren, puis trois mois en Amérique centrale. Il faut se faire plaisir.
À quel moment avez-vous voulu repartir vous installer au Mexique ?
C'est très récent. Ça s'est passé rapidement car j'ai tout de suite eu le feu vert du diocèse. Tous les ans, on est amené à dire si on veut changer ou non. Moi, je voulais retourner là-bas. Je pense que onze ans, c'est suffisant.
Qu'allez-vous faire là-bas ?
L'idée est de se mettre au service d'une église qui existe déjà et de se mettre dans le moule rapidement. Je suis resté attaché au Mexique.
Le 21 juin 2006, lae calvaire de Sainte-Anne est sollennellement restauré rue des Ecoles.

Michel GICQUELLO [2013-2016]

Succédant au père Alberto, nommé au Mexique, le père Michel Gicquello a pris possession de sa nouvelle paroisse en septembre 2013.
Après un bref séjour comme enseignant en Afrique, le nouveau curé de Séné, avait été ordonné prêtre en 1974 en l'église de Guéhenno, dont il était originaire. Ce fils d'agriculteurs aura exercé dans de nombreuses paroisses du Morbihan (Josselin, Auray, Saint-Christophe à Lorient ; Saint-Vincent-Ferrier à Vannes, ainsi que dans la Presqu'île de Rhuys.) Il n'aura laissé que de bons souvenirs à Arzon où il officia pendant neuf ans, son plus récent ministère.
L'abbé Michel Gicquello, a été nommé en 2016 aumônier de la maison de retraite des frères des écoles chrétiennes à Kerozer (Saint-Avé).
Bernard PLISSON [juillet-2016 à 2020]
Sources: article Le Télégramme 9/1998 et Ouest france 9/2016.
Originaire de Locminé, Bernard PLISSON a fait son petit séminaire à Sainte-Anne-d'Auray, puis son grand séminaire à Vannes et à Rennes. Il a été ordonné prêtre en 1974. Il a alors été nommé vicaire à Ploermel pendant six ans où il s'occupe de jeunes.
En 1980, il a quitté la France pour s'installer en Afrique dans un diocèse au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo), où il était responsable d'un foyer pendant neuf ans, sa mission y a été de préparer les jeunes séminaristes à leur future fonction de prêtre. Il y restera neuf ans, à l'est du pays, au bord du lac Tanguanyica. « J'étais chargé d'un foyer-séminaire accueillant des jeunes de 15 à 20 ans en classes secondaires. Une trentaine d'entre eux sont actuellement prêtres », confie-t-il.
En 1989, le père Plisson rentre en France pour devenir vicaire à Saint-Gwen, à Vannes. Trois ans plus tard, il est à la fois curé de Pluvigner, de Bieuzy-Lanvaux et Camors. L'évêque de Vannes lui a ensuite proposé d'être curé d'Arradon et recteur de Ploeren.
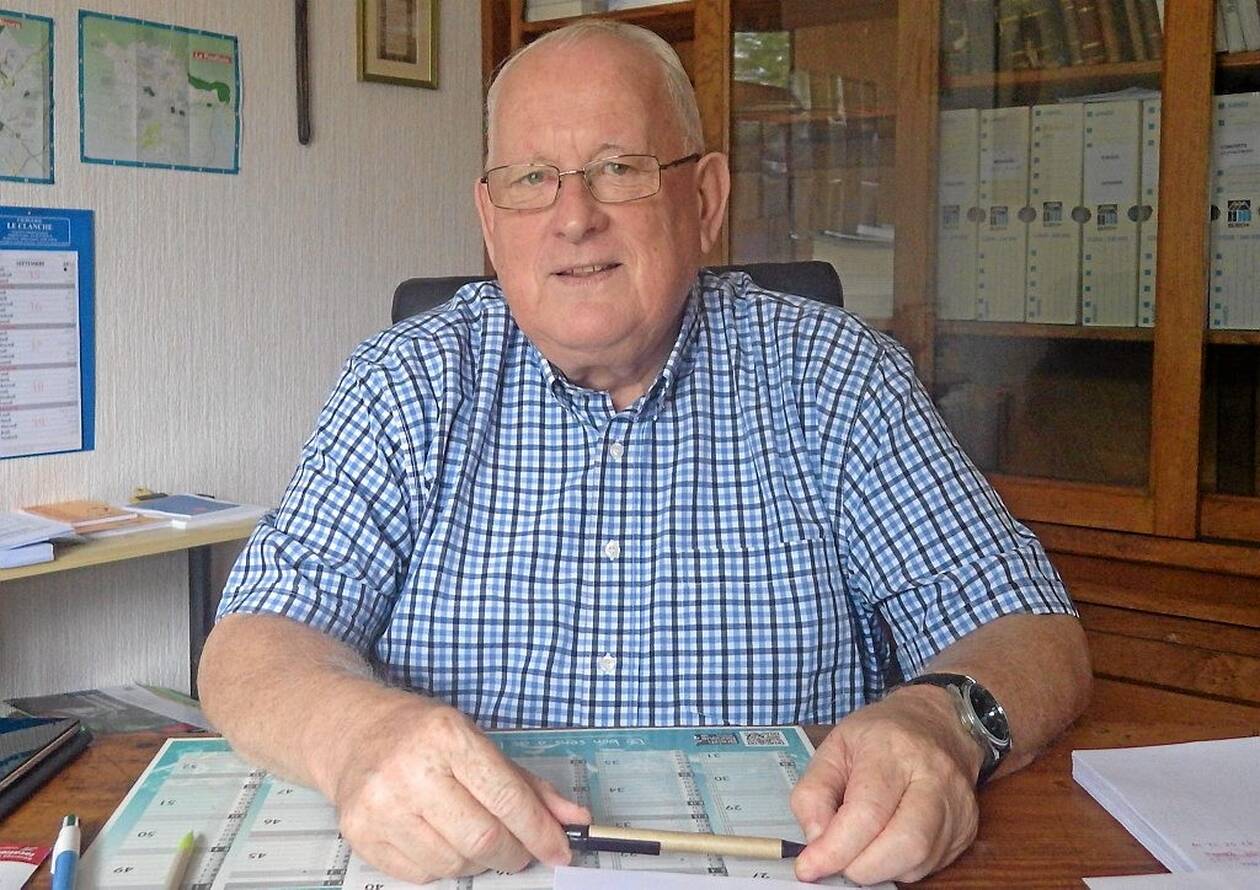
En octobre 2013, Bernard PLISSON effectue une mission pastorale au Maroc où il a travailla à l'archidiocèse de la cathédrale de Rabat pendant trois ans. Ce n'était pas une première pour le père Plisson qui avait été volontaire en Algérie pour enseigner le français pendant ses études au séminaire, un an en banlieue d'Alger et un an en Haute-Kabylie.
« Au début de mes études au Grand séminaire, entre 1968 et 1970, je suis parti deux ans en Algérie dans le cadre du service militaire, mais au titre de la coopération, explique le prêtre. J'ai exercé un an dans la banlieue d'Alger et l'année suivante en Grande Kabilie. »
A son retouir en France et en Bretagne, en juillet 2016, l'évêque de Vannes le nomme recteur de Séné. Il s'installera dans la paroisse officiellement le 11 septembre.
Tombé malade en 2019, il doit s'absenter de la paroisse. Le père Patrice MARIVIN de la cathédrale de Vannes administre la paroisse de Séné.
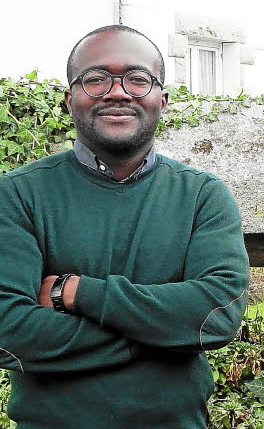
L’Abbé Jean-Paul SOSSAH assure le service liturgique en septembre 2021 et jusqu'à la nomination de Georges Henri PERES.
Georges Henri PERES, depuis septembre 2022

Georges-Henri PERES, né en 1977, est originaire de Cossé-le-Vivien en Mayenne.
« Je suis cinquième d'une famille de six enfants. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Ma famille est catholique pratiquante. » Certains de ses oncles sont mêmes prêtres. « Ça facilite beaucoup les choses. »
Vers 13, 14 ans, son désir de devenir prêtre est là. « J'ai pris mon temps pour réfléchir. À 22 ans, je suis arrivé à une croisée des chemins. Je terminais ma maîtrise d'Histoire. »
Finalement, l'envie de travailler prend le pas. Georges-Henri Pérès passe alors son Capes. « Dans la foulée, j'ai trouvé un poste d'enseignant en banlieue parisienne. J'ai beaucoup aimé ce travail mais le désir de devenir prêtre est devenu plus fort, plus irrésistible. » Il sera professeur durant quatre ans.
Mais l'appel de Dieu est le plus fort. «Cela faisait vingt ans que je souhaitais devenir prêtre. Les quatre années qui ont suivi, je les ai passées au monastère de La Cotellerie de l'ordre de Saint-Augustin, en Mayenne, où j'ai appris à prier. Je suis parti en me disant que la présence dans une paroisse correspondait plus à mon tempérament».
En 2008, Georges-Henri Pérès a intégré le séminaire de Rennes et a repris en parallèle ses études d'histoire en master 2 avec une spécialité qui n'a pas dû laisser Mgr Centène indifférent: l'histoire du diocèse de Vannes.
Historien, il a le souci de faire partager sa foi grâce à des conférences, des émissions de radio consacrées aux Evangiles, à la Bible et à l'histoire du Chritianisme.
Quelques enregistrements du père Georges Henri PERES:
Le Cantique des Cantiques - Eucharistie à l'école de Marie, 20 Mai 2015; Hentoù Breizh, chemins de Bretagne, ou les origines de la foi en Bretagne, avec RCF Sud Bretagne; Femmes de la Bible; La Passion de Jésus Christ selon Saint-Jean ;
Il est ordonné diacre le 17/09/2011 à l'âge de 34 ans. Il est nommé en juillet 2012, nouveau prêtre, vicaire au service des paroisses de Sainte-Anne-d'Auray et de Brec'h, et chapelain à la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Il est nommé à la paroisse de Séné en juillet 2022 et tient sa première messe le 11 septembre 2022.