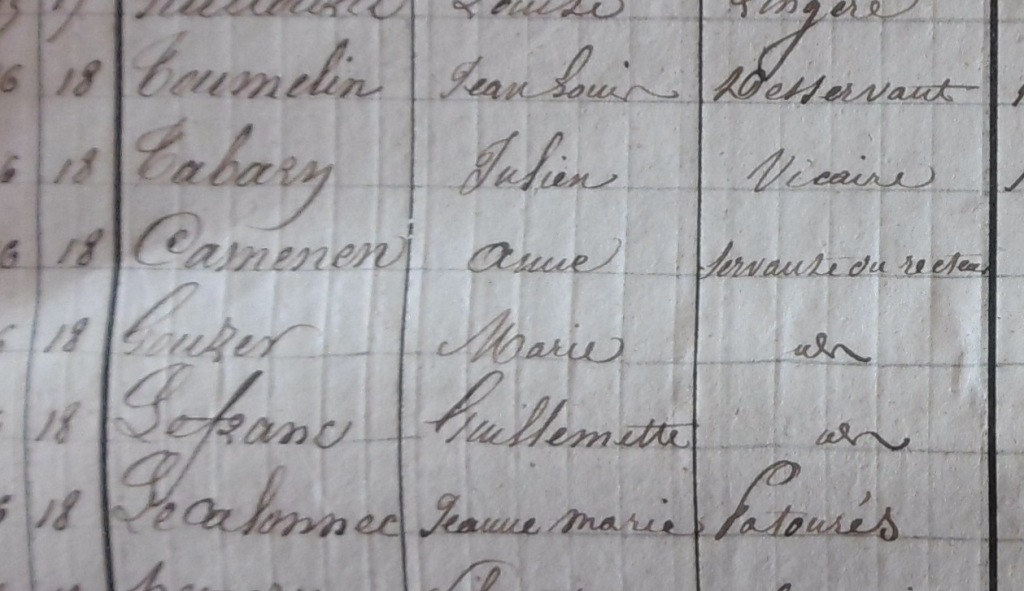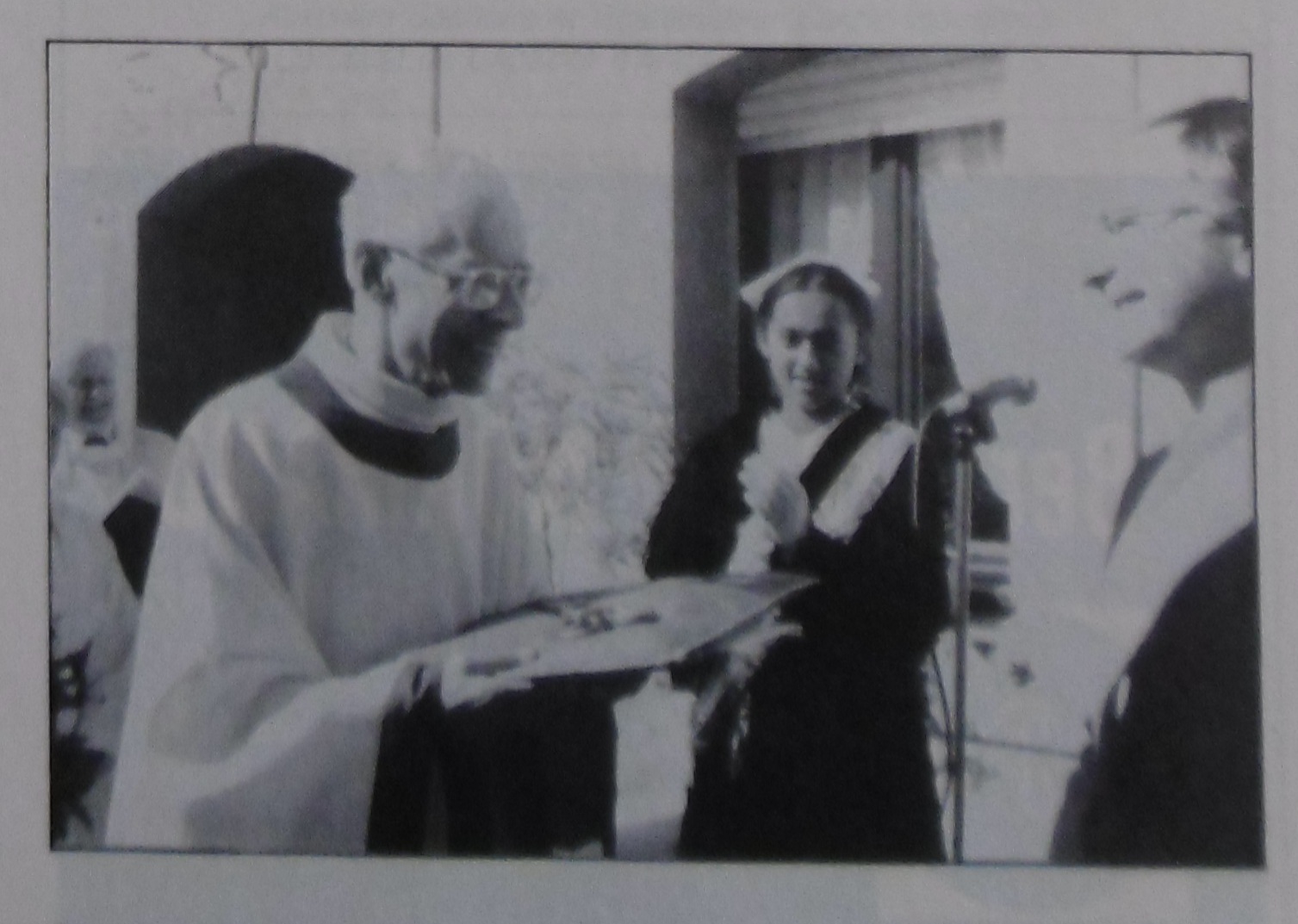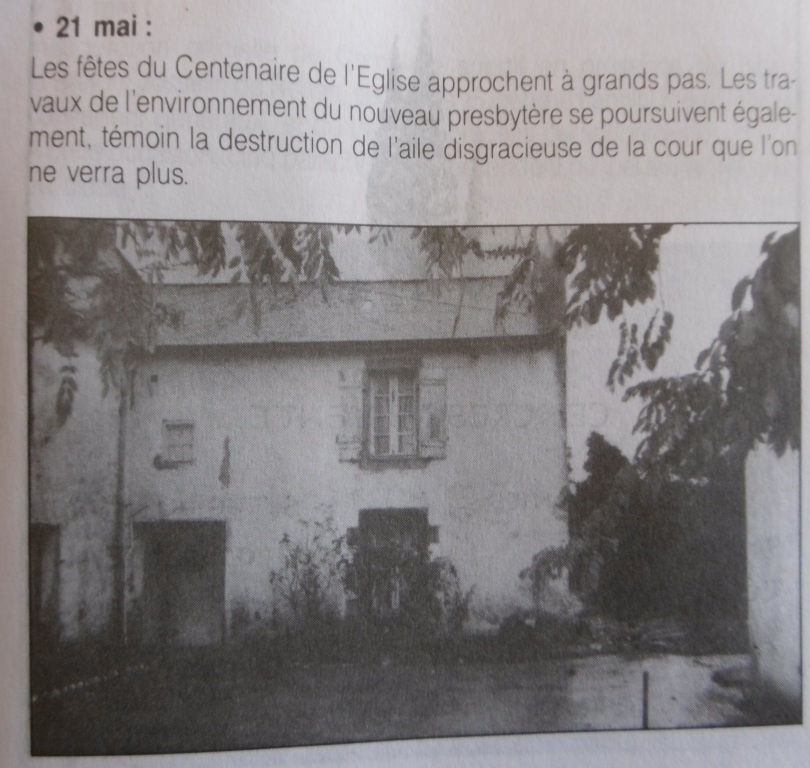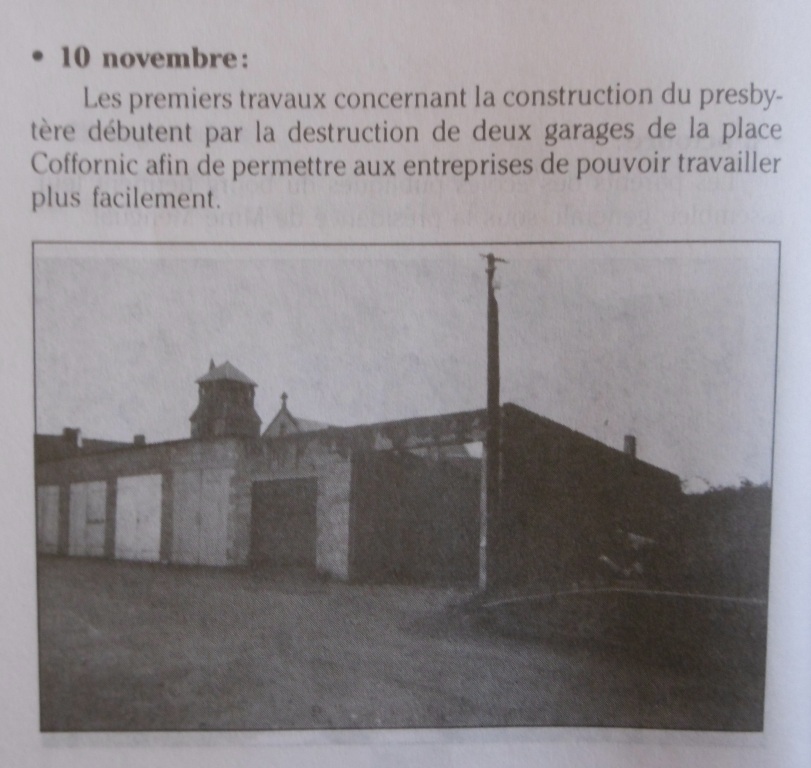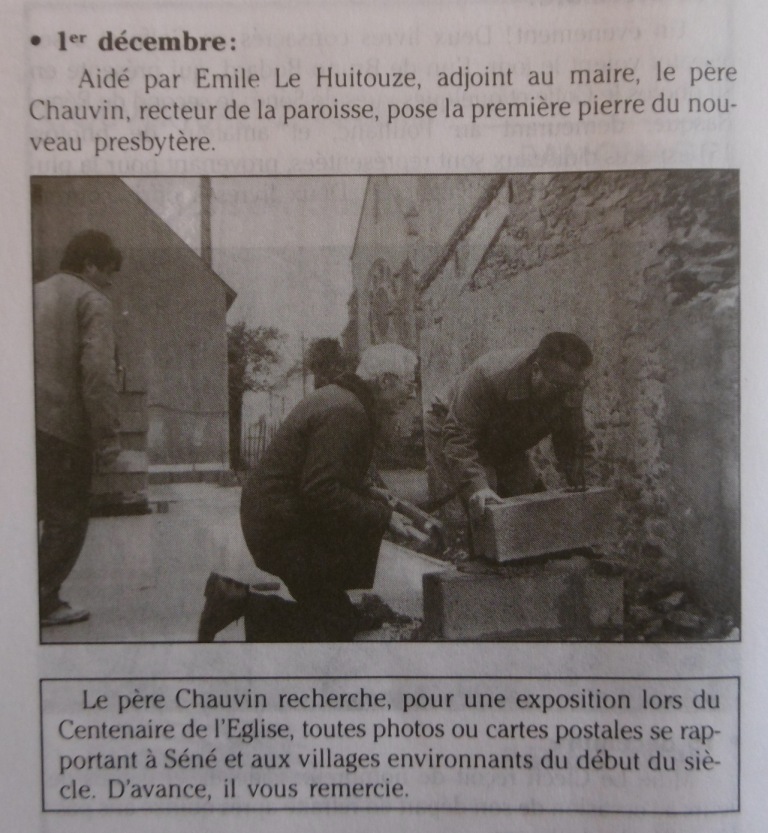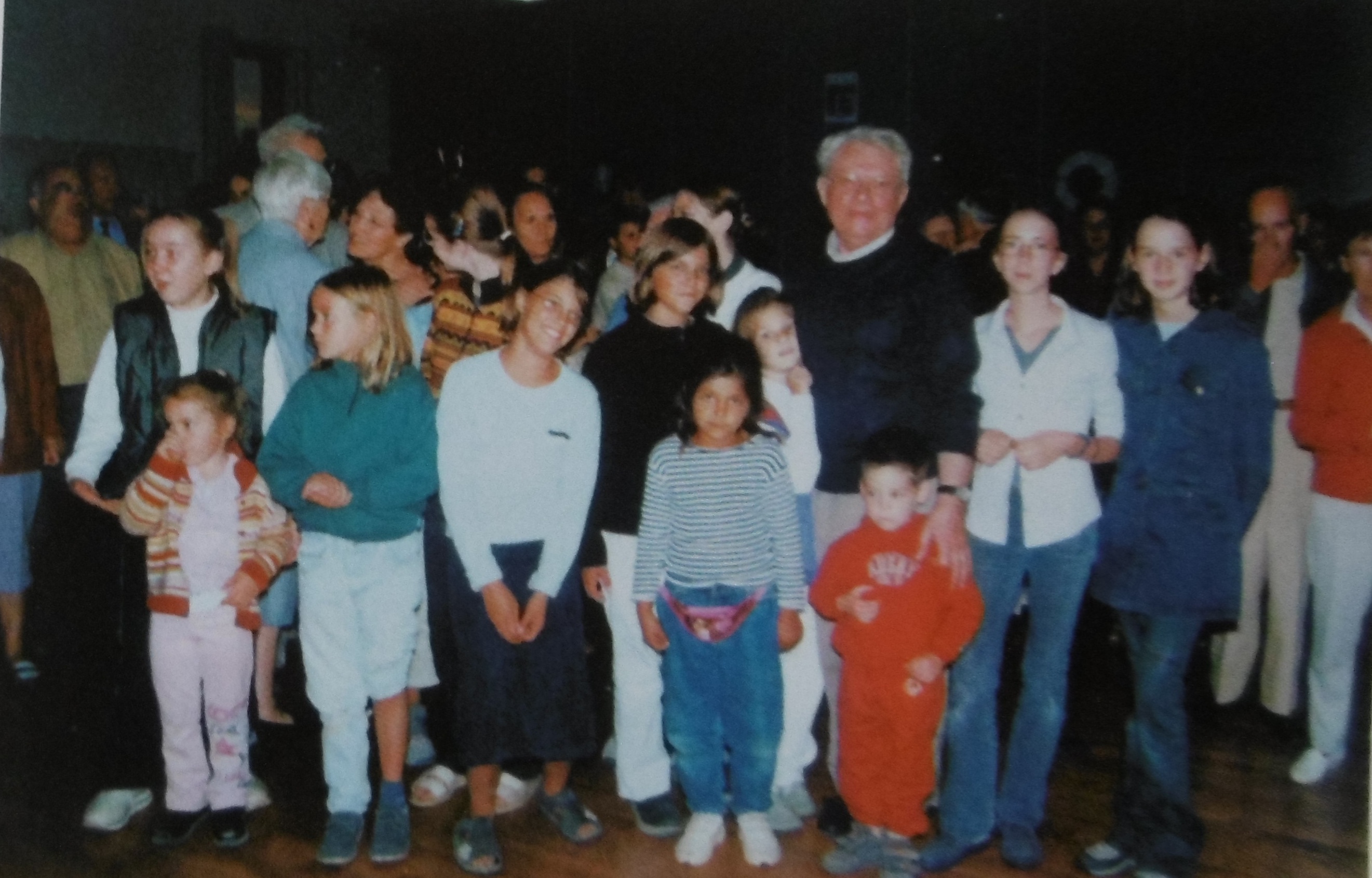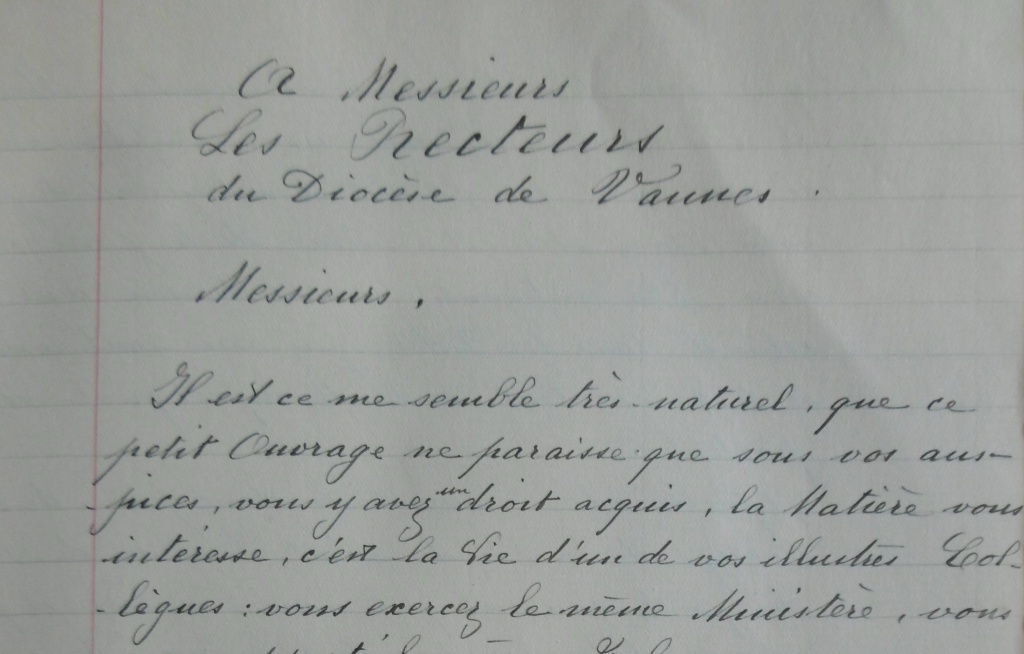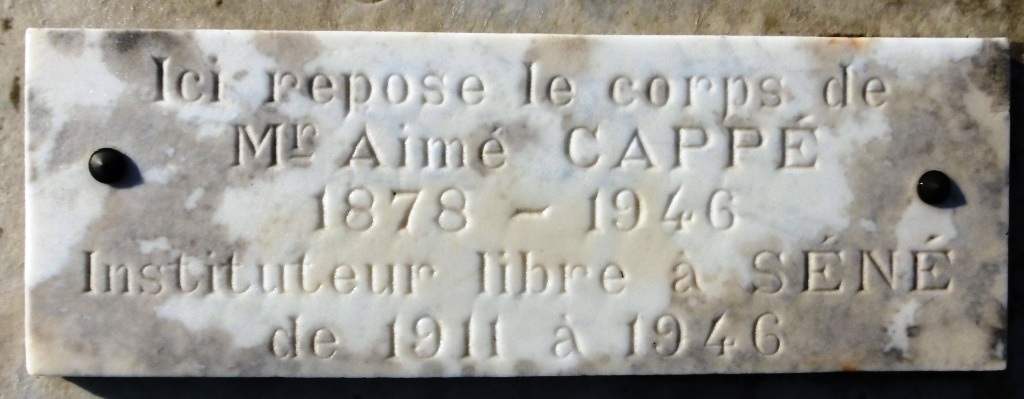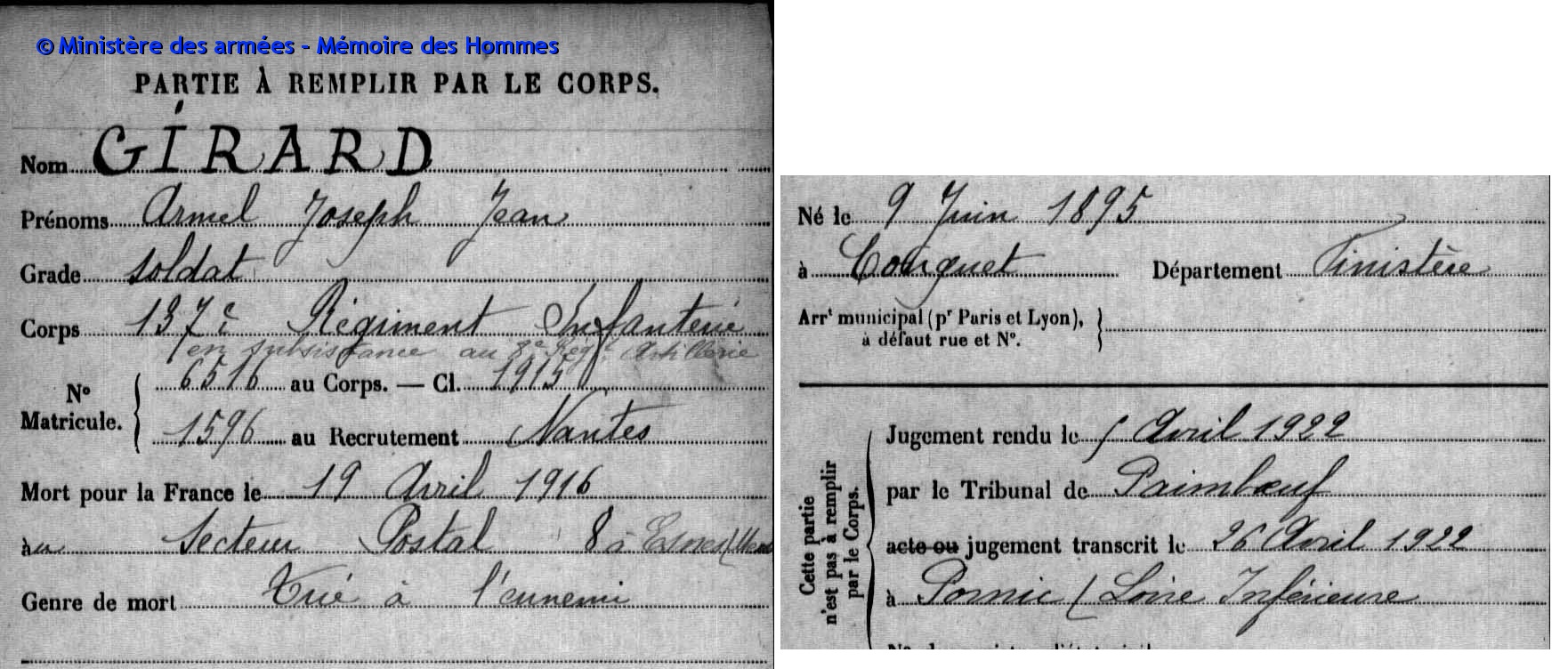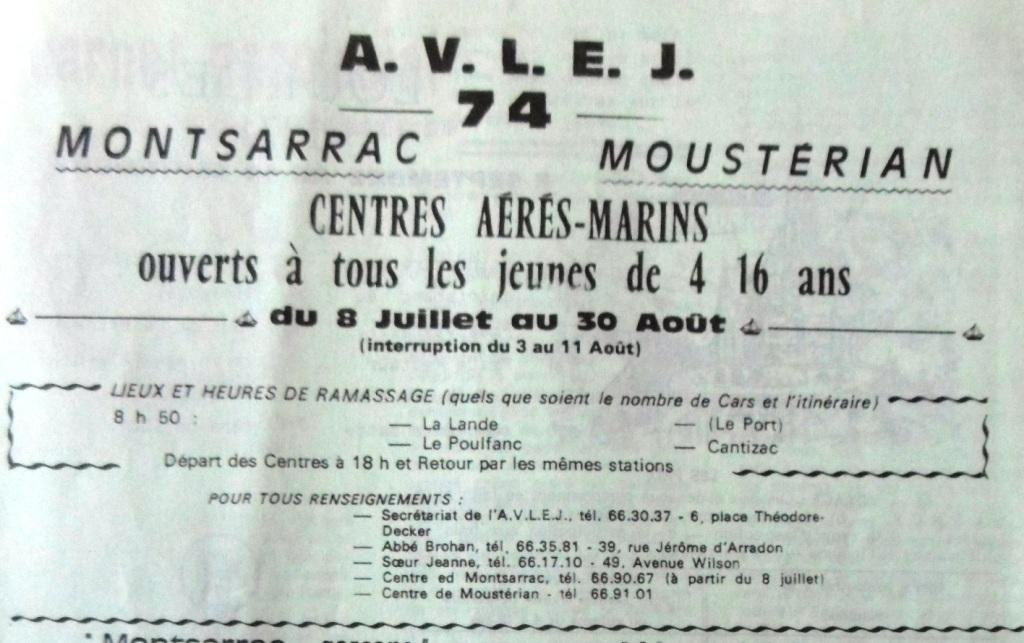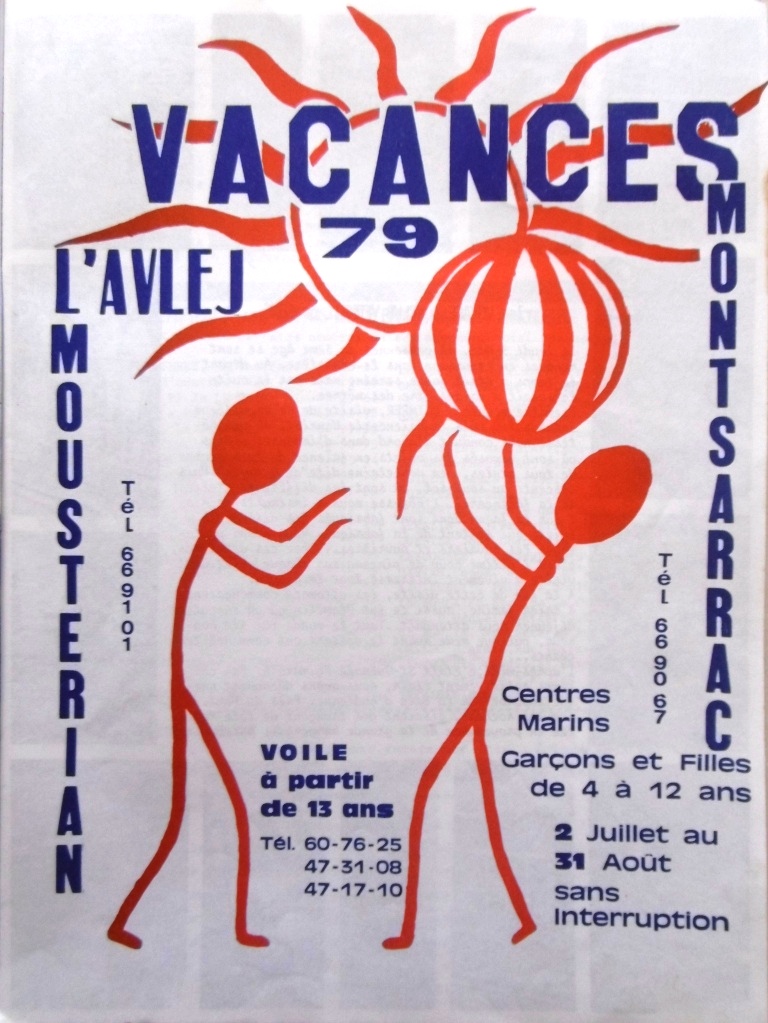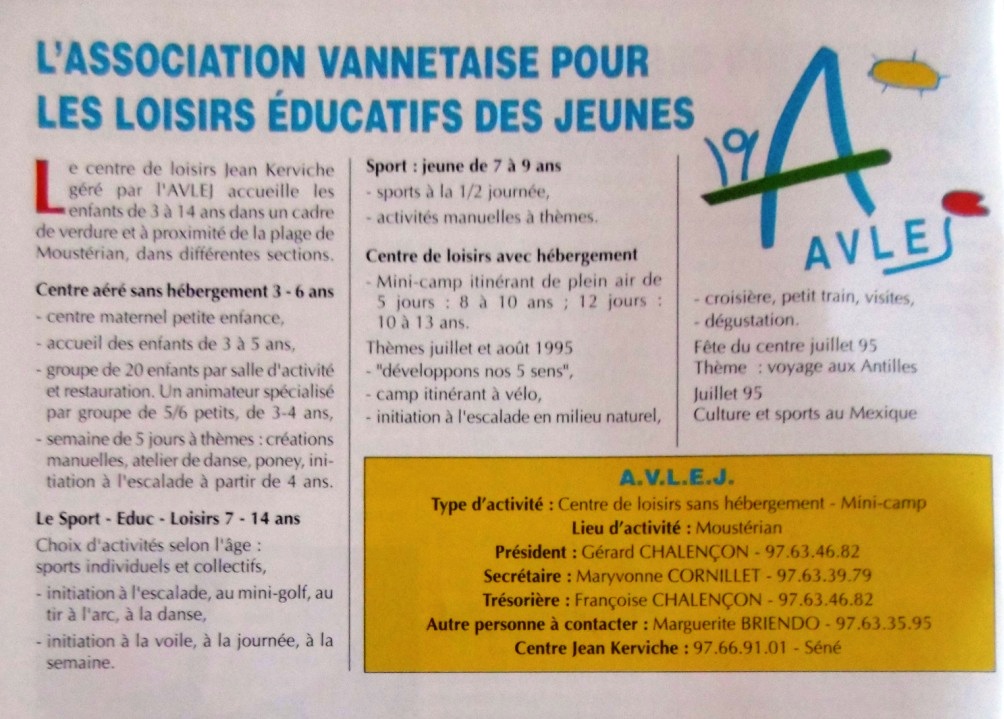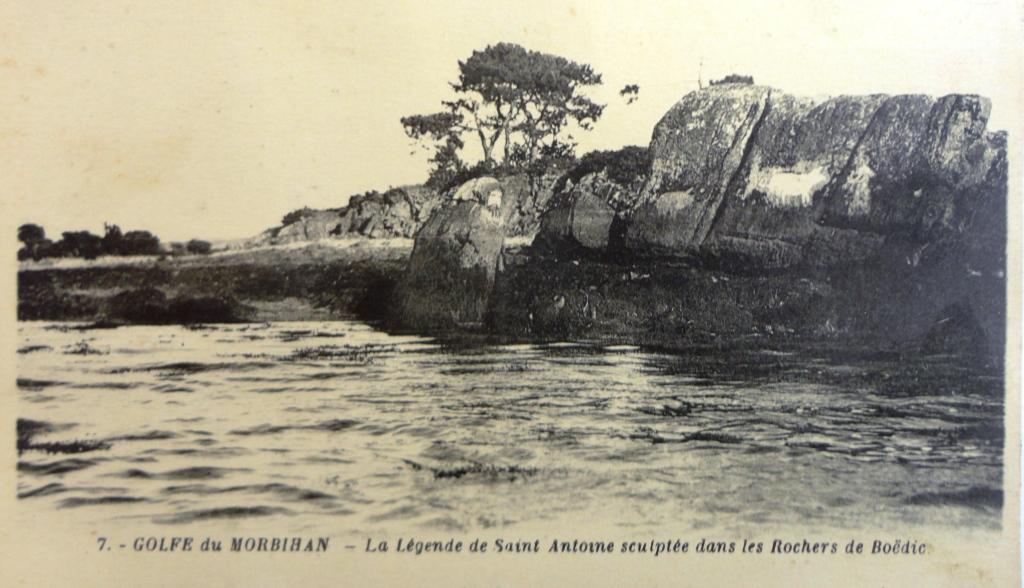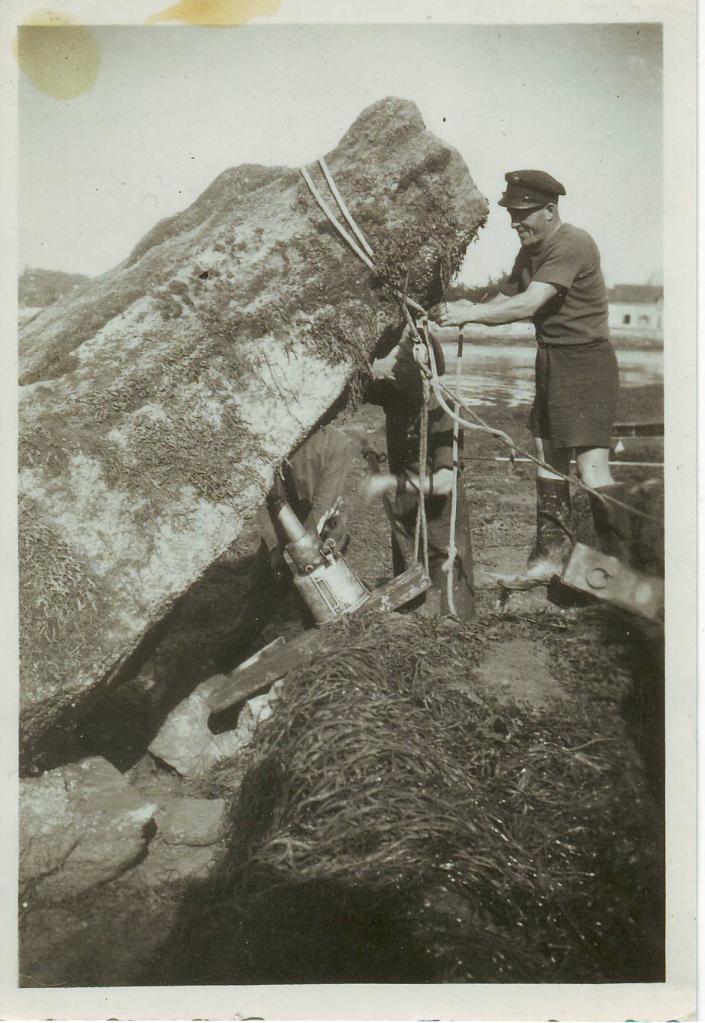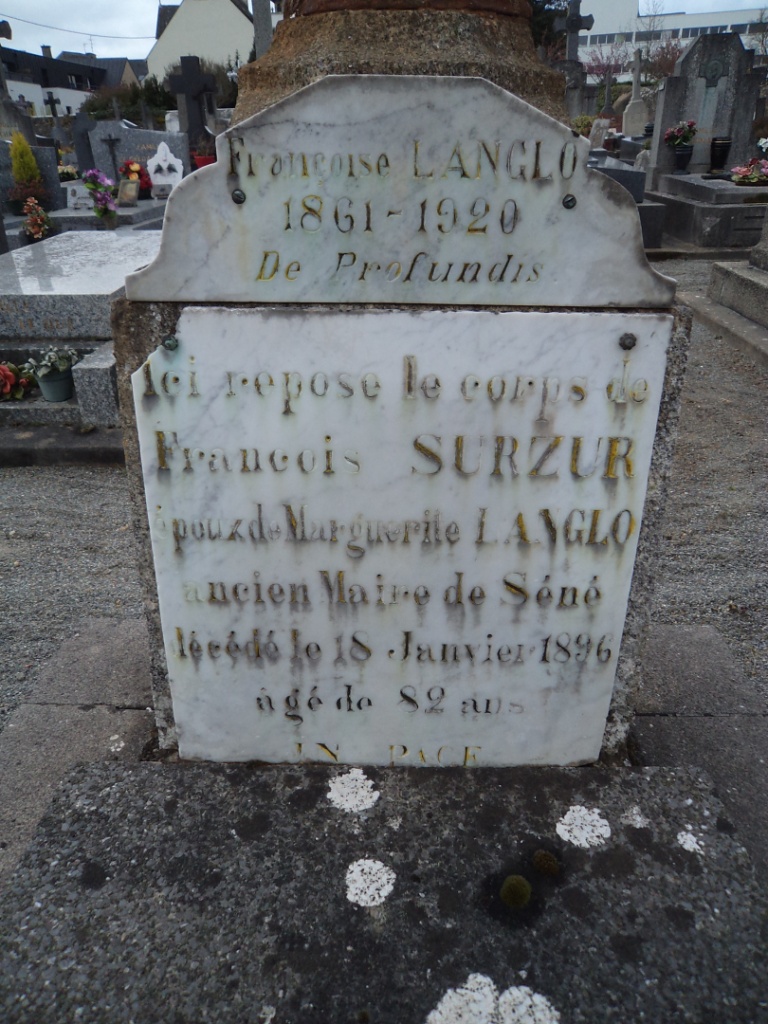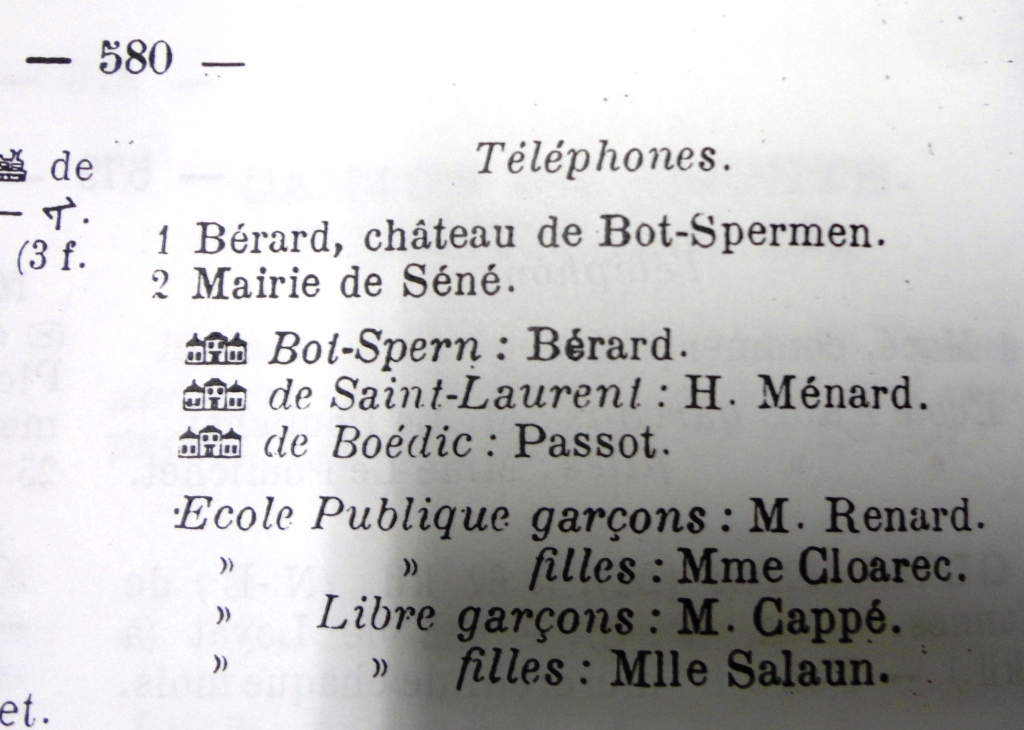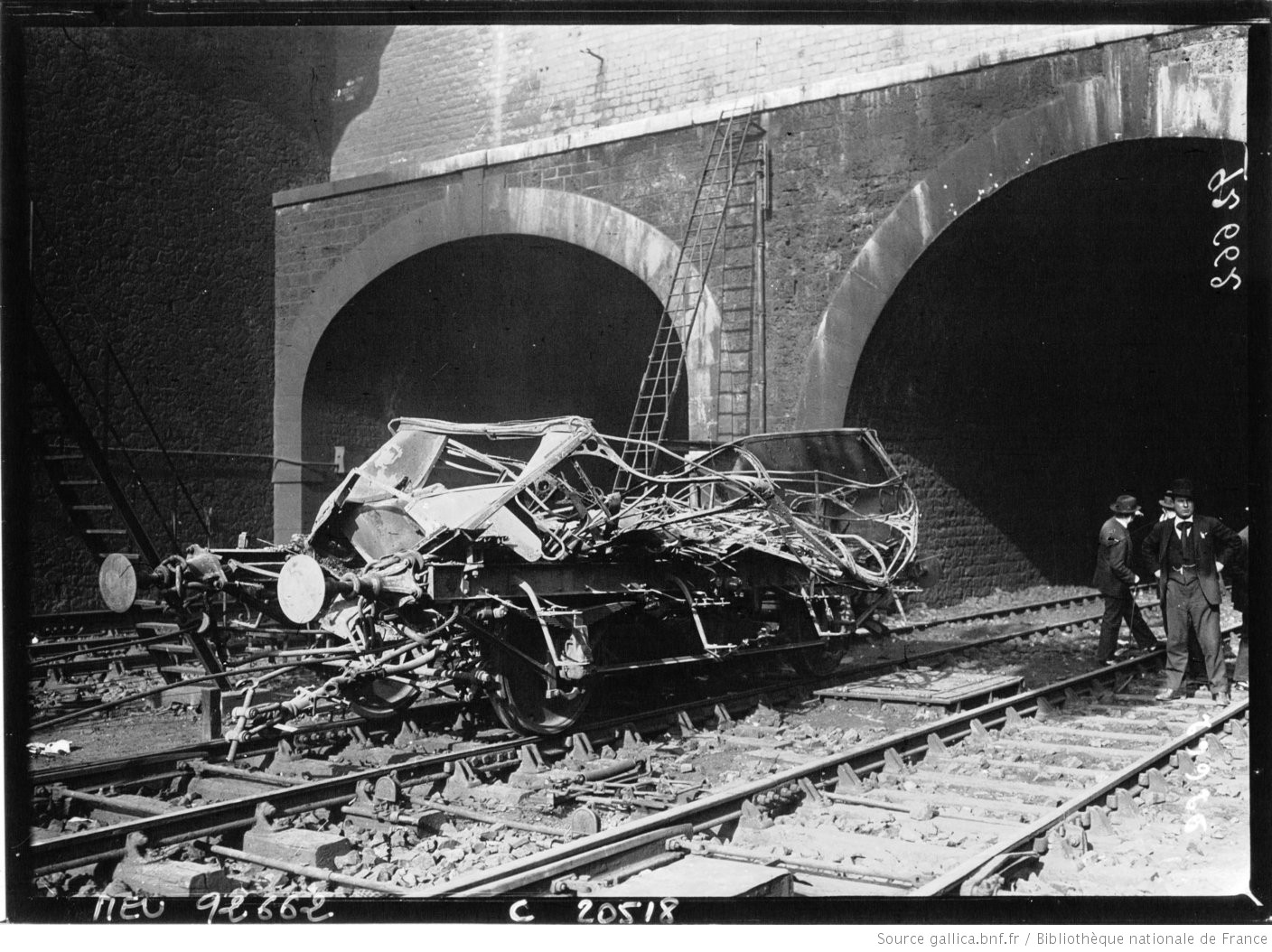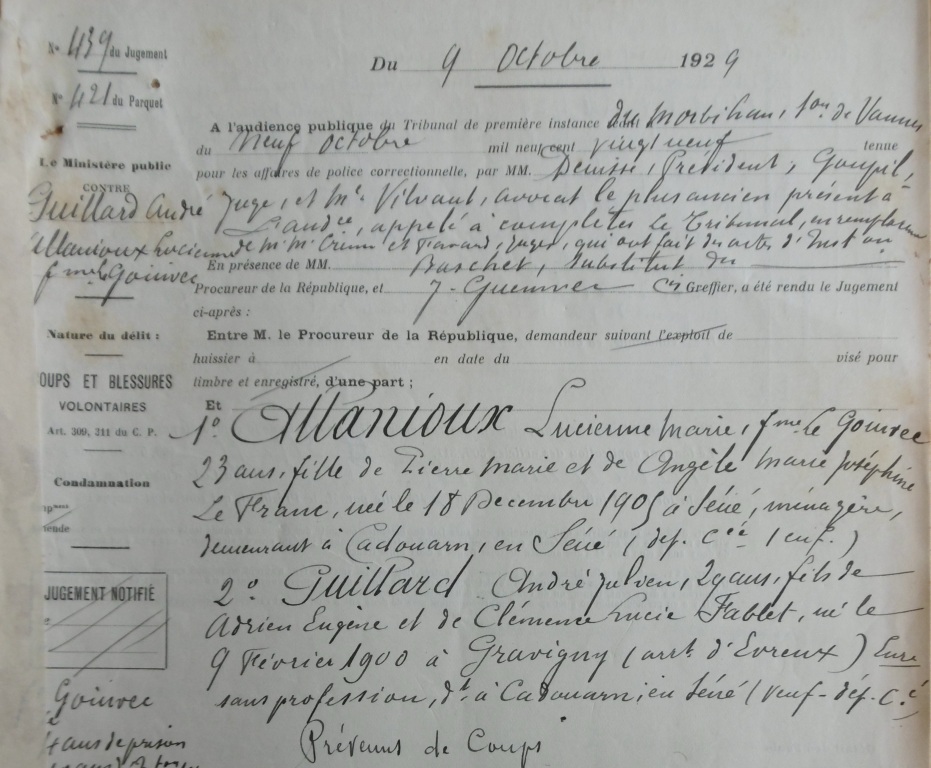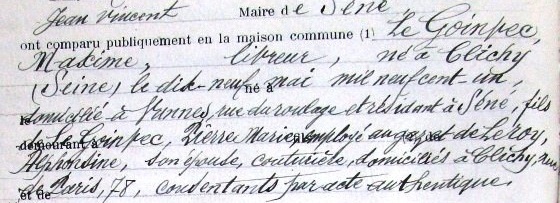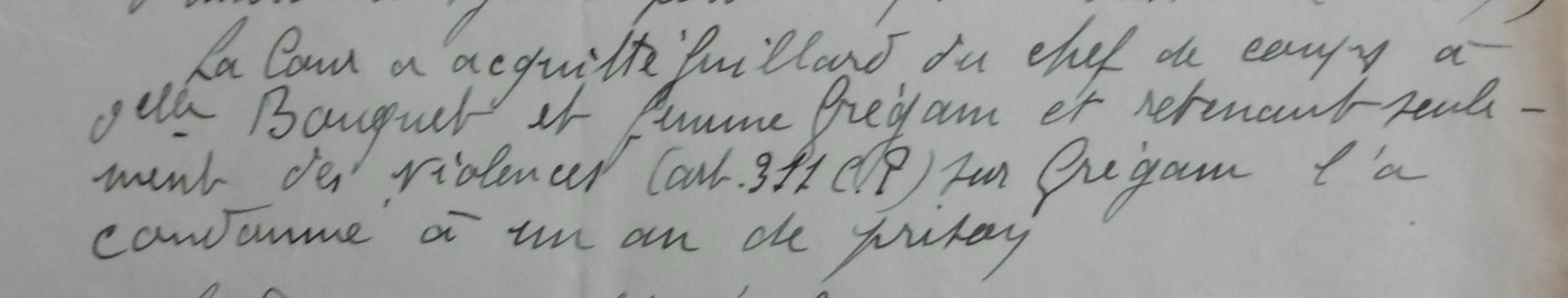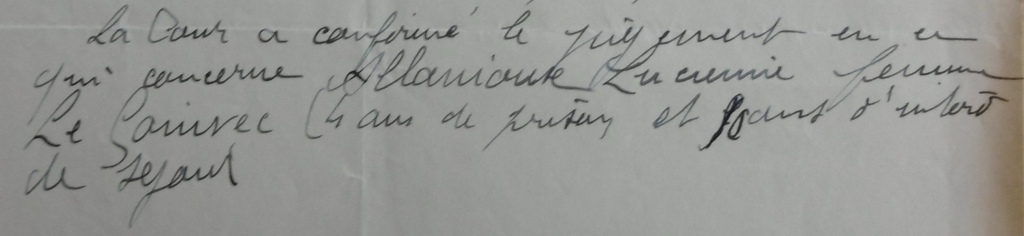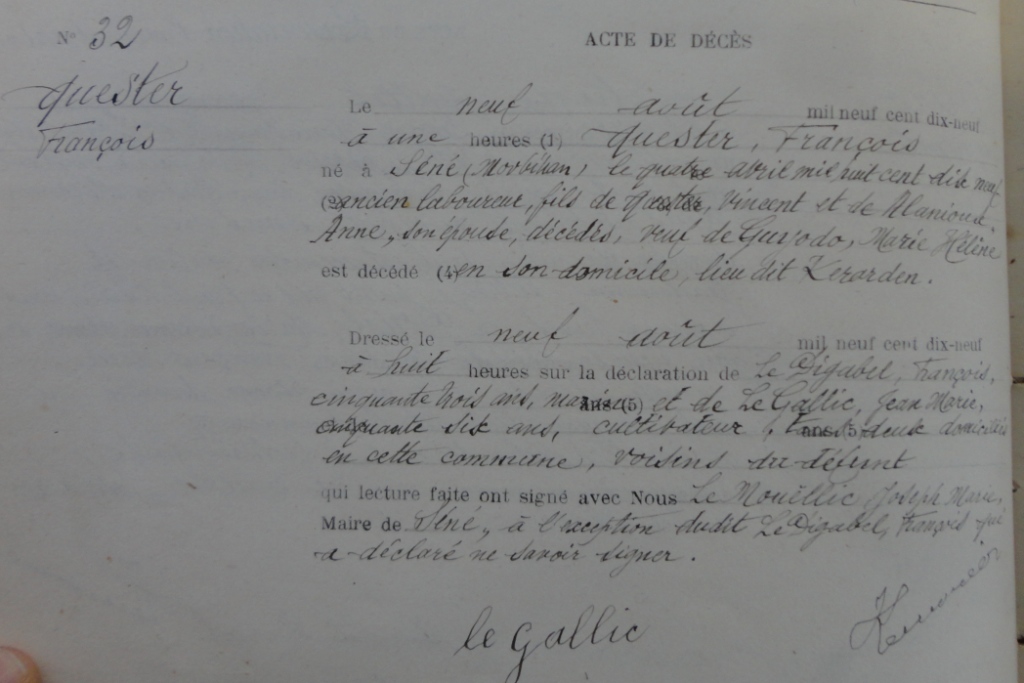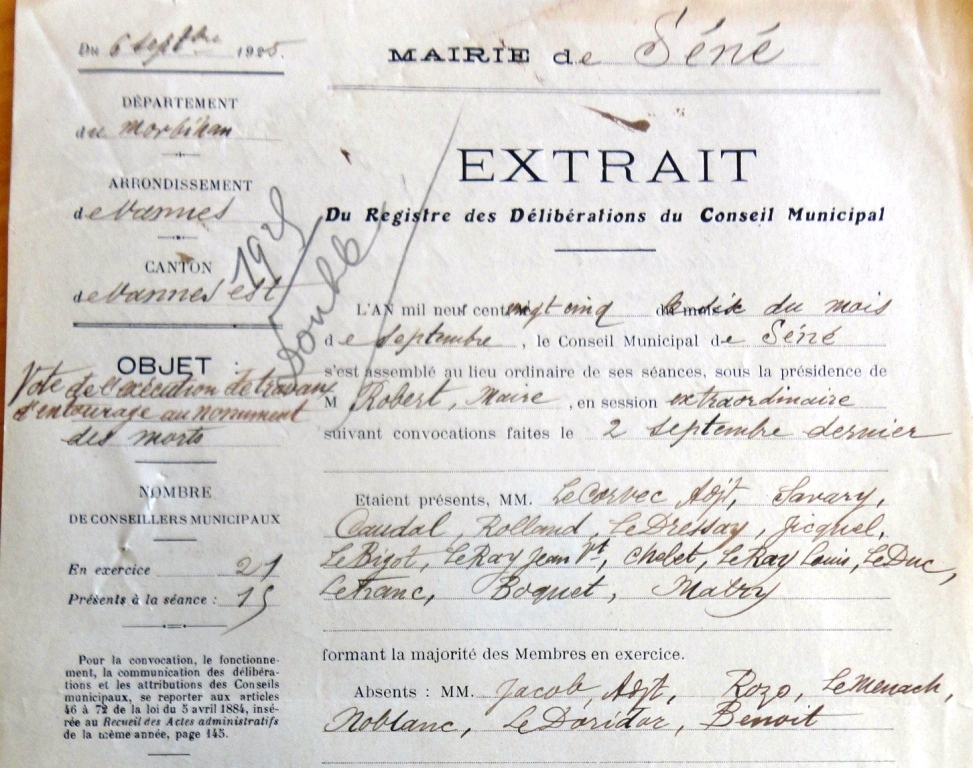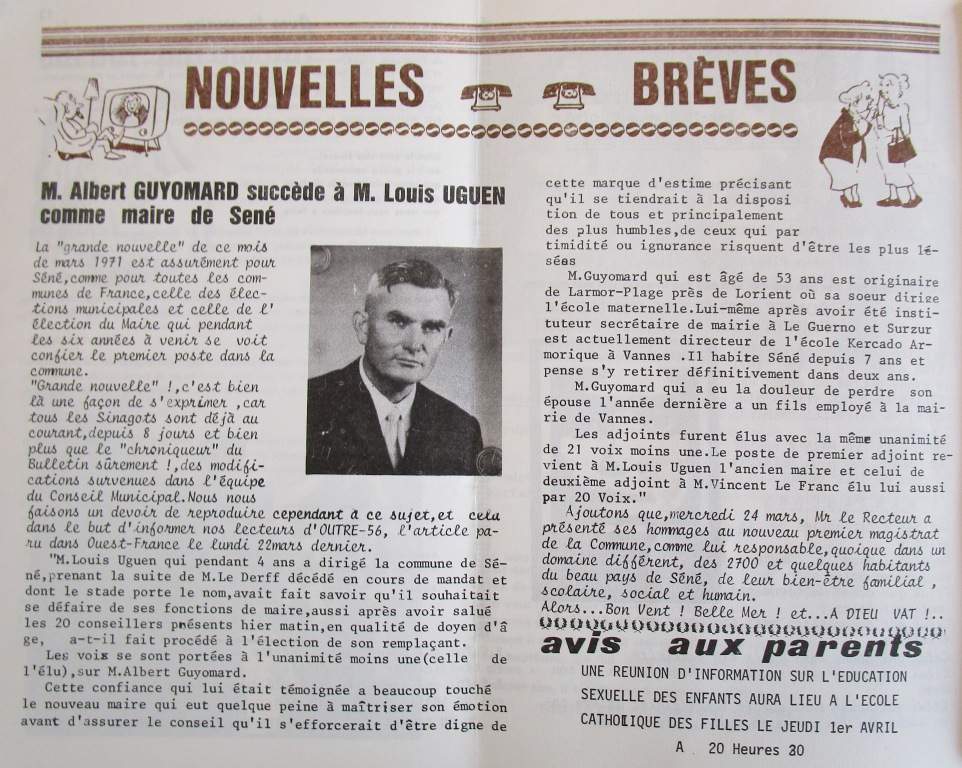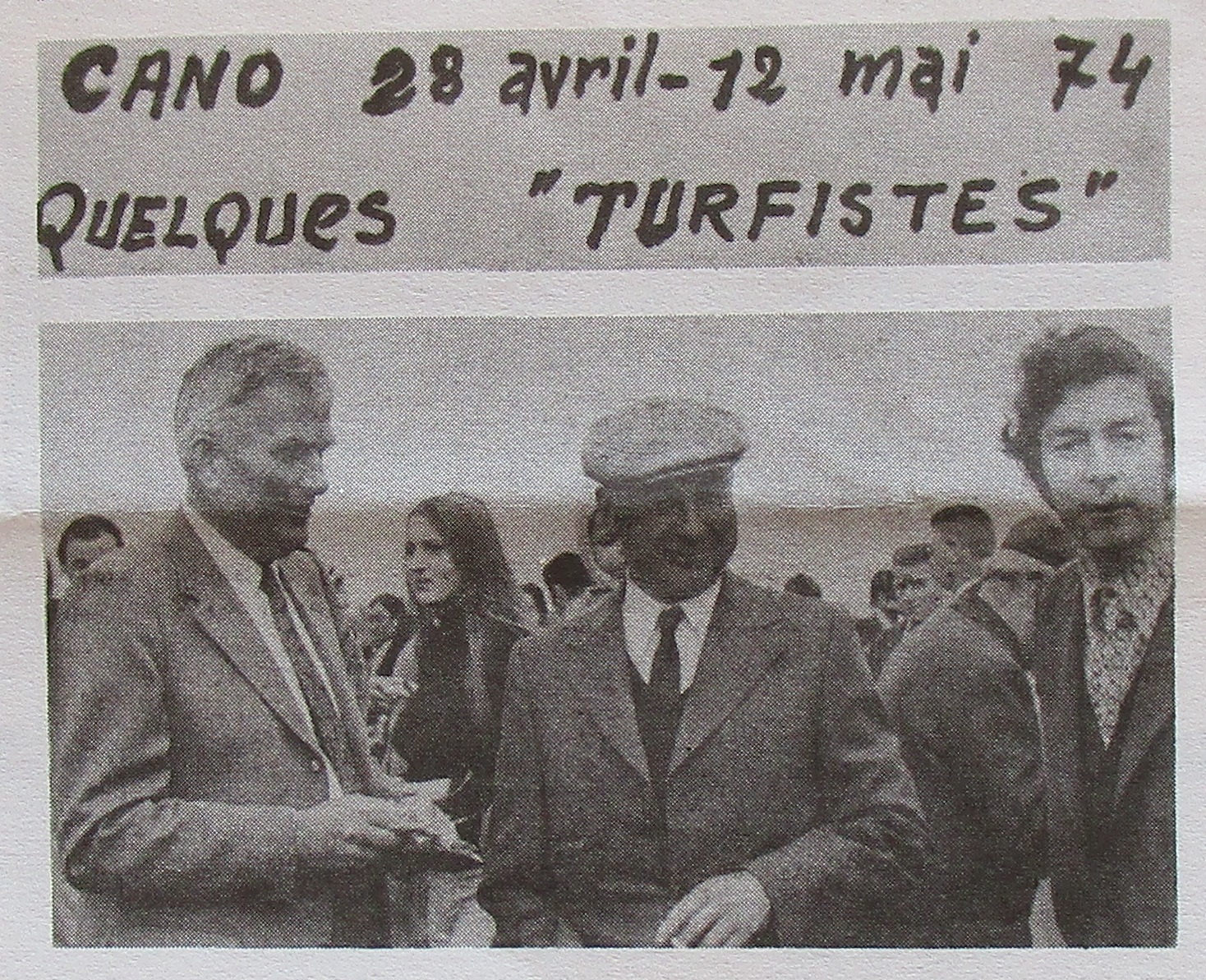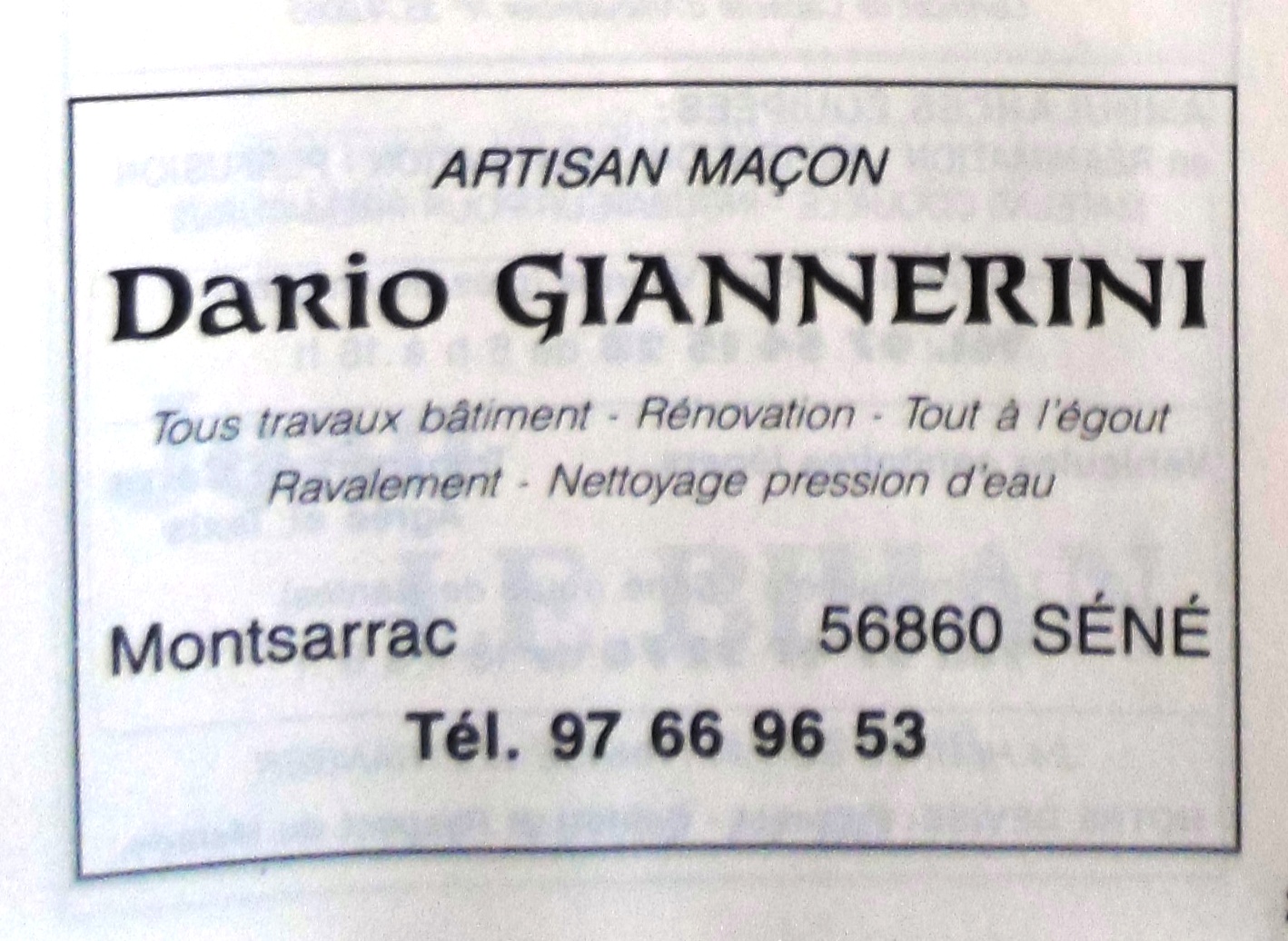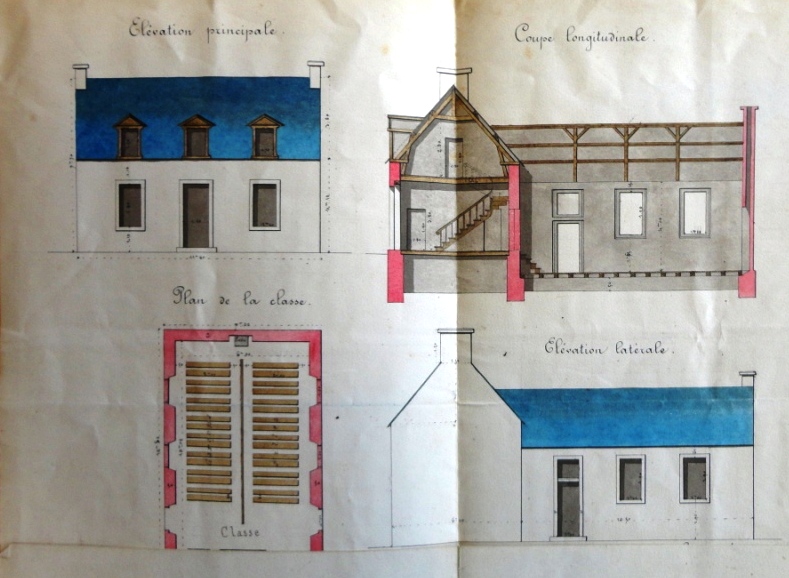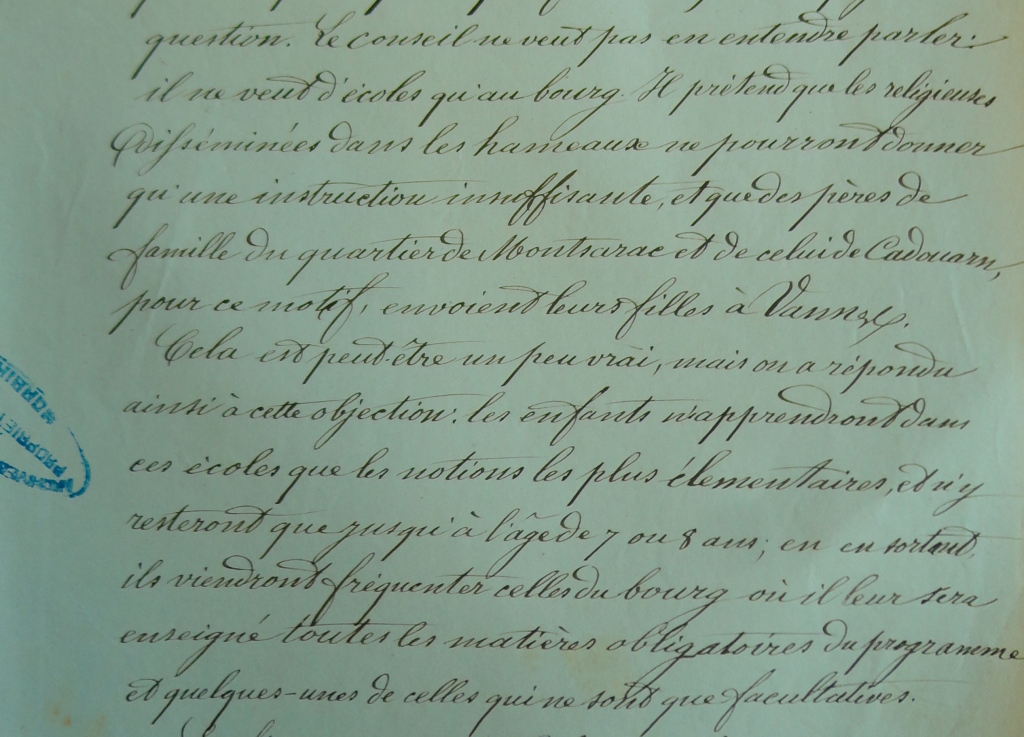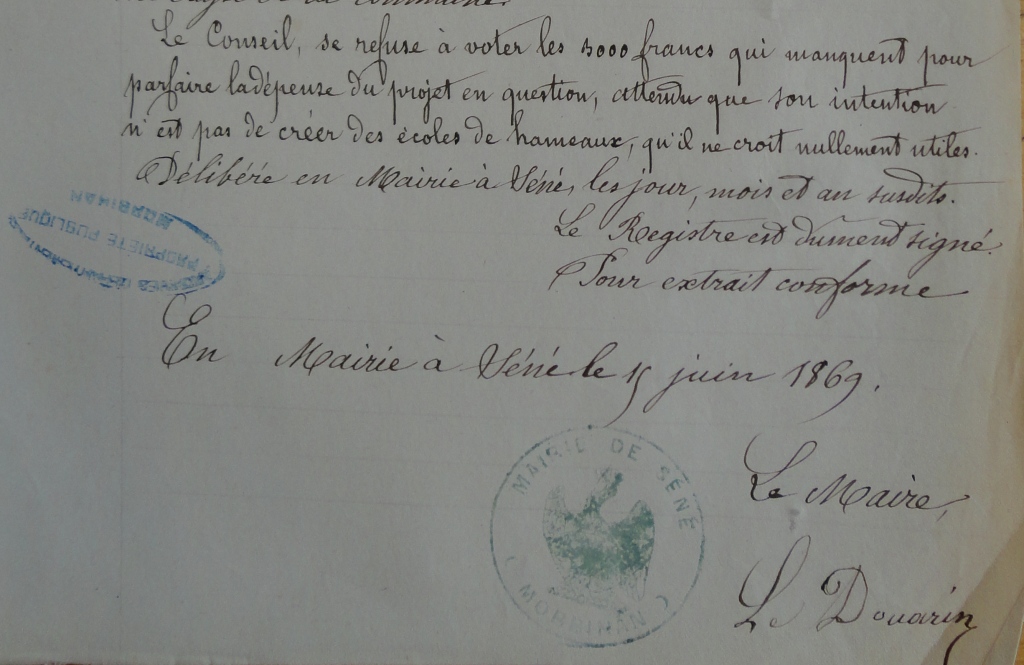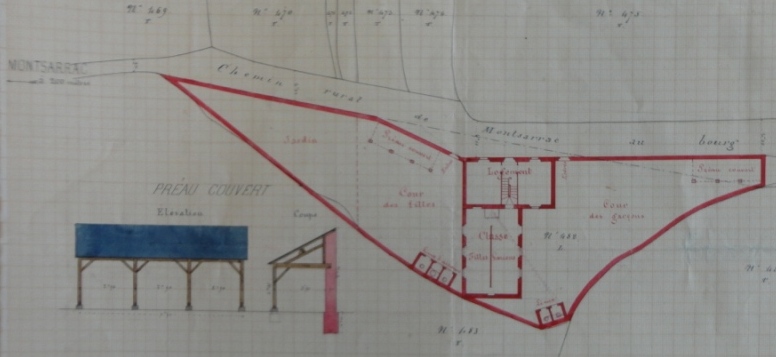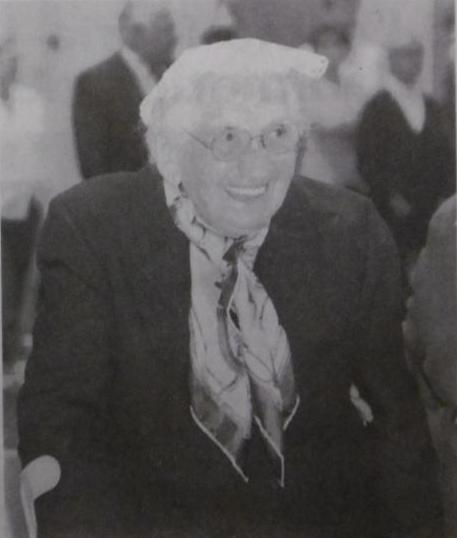CHRONIQUE
Recteurs de Séné sous l'Ancien Régime
Texte repris du bulletin de la Société Polymathqiue du Morbihan.
Liste des recteurs de Séné de 1400 à 1789.
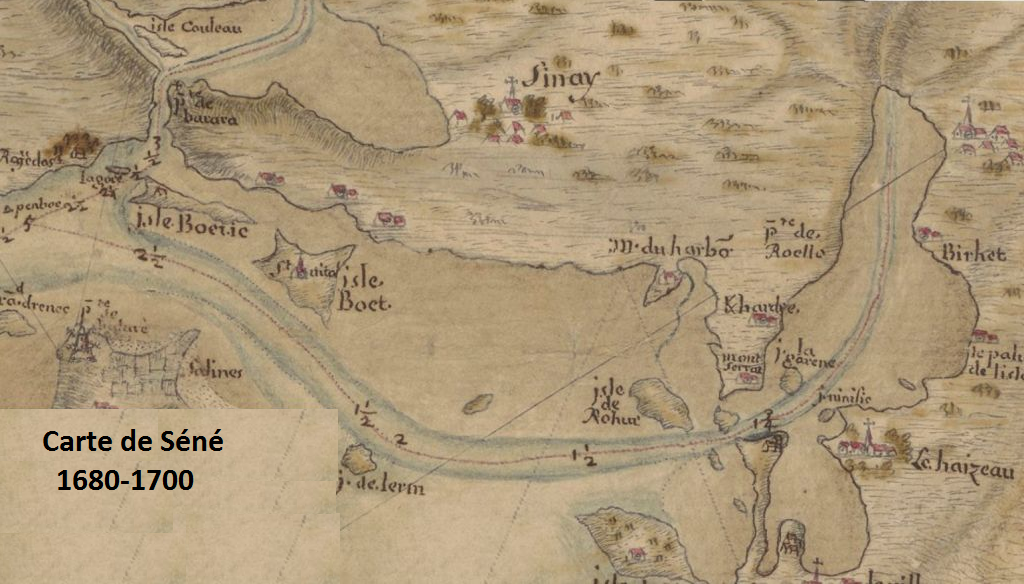
1401 Jean DERIAN, chanoine et recteur de Séné (Source JM Le Mené)
1431-1432. Bertrand d'Auray.
1461 Pierre de Bodéan, de la famille et du manoir de ce nom en Saint-Jacut, fut présenté à ce rectorat par le duc de Bretagne, on ne sait à quel titre. Il dut résigner vers 1474, date d'une vacance de la paroisse de Séné ; mais il ne mourut qu'en 1498, ayant été recteur aussi de Caden, de Malestroit et Missiriac, qu'il avait résignées peu avant son décès.
1500 R. Jean Bodremont, dont on ne connaît que le nom et la date de sa résignation.
1500 Jean Le Guénédal , simple clerc tonsuré du diocèse.
1507-1533. R. Jean du Magouéro, recteur de plusieurs autres paroisses, avait résigné en 1533, mais avec réserve des gros fruits jusqu'à son décès arrivé vers le 25 août de l'année suivante.
1533 Jacques de Keralbault, simultanément recteur de Guéhenno et qui résigna lui-même à une date inconnue.
1553-1560. Guillaume de Kaerjocze, mort en mai 1560.
1560-1565. Jean de Kaerjosse, évidemment de la famille du précédent. Il mourut le 21 septembre 1565.
1565 Guillaume de Bogar, chanoine de Vannes, résigna peu de temps après la date de ses provisions
1568 Robert Gousserif, d'Arradon, donne procuration, le 11 février 1568, pour résigner entre les mains de i'évèque, et devient plus tard recteur de Berric. Il fit de longs efforts pour récupérer son rectorat de Séné.
1568 R. Jean Keralbault, clerc du diocèse, pourvu par l'Ordinaire, le 12 février 1568, prit possession le 14, et résigna le surlendemain, pour permuter avec le suivant contre son canonicat.
1568 R. Jacques de Keralbault, chanoine de Vannes, pourvu par I'évèque, le 16 février 1568, résigiia le 29 du même mois, purament et simi^ementy entre les mains de son coliateur.
1568-1569, R. Christophe Le Scourchic, prêtre du diocèse, pourvu par l’évêque, le 29 février 1568, prit possession le l«r mars. Moins d'un an après, il donna procuration, le 23 février 1569 , pour résigner entre les mains de l’Ordinaire.
1560-1578. Guenhaél Le Calvé, diacre de Pluvigner, pourvu par l’évêque, le 3 décembre 1569, prit possession le 4. Il ne reçut la prêtrise que le 18 février de l’année suivante.
1578 Regnault ou René Nouvel, chanoine de Vannes, mort en octobre 1578.
1578-1591. Olivier Ganault, ancien secrétaire de l’évêché et recteur de Baden, débouta ses compétiteurs Alain Guéhauff et Robert Gousserff qui s'obstinait toujours dans ses prétentions.
1591-1616. f Gilles Boschier, dit Capitaine, et prêtre du diocèse de Saint-Malo, mourut en janvier 1616.
1616-1661, f Nicolas Le Ray, de Saint-Nolfï, pourvu par le Pape, le 18 mars 1016, prit possession le 15 mai. H mourut au presbytère vers le 26 mai 1661.
1669-1694. f Yves Kergadic dut mourir en novembre 1694. C'était un prédicateur distingué, à en juger par les éloges donnés à une station de carême prêchée par lui à Sarzeau en 1685.
1695-1700. R. Denis Le Sabazec, né et baptisé le 8/09/1664 à Corlay, prêtre du diocèse de Comouaille, pourvu par le Pape, le 26 février 1695, ne prit possession que le 26 juin. Malade, il résigna,. en janvier 1700, entre les mains de l'Ordinaire , et mourut vers 1705.
1700-1705. f Grégoire Le Toulec, prêtre à Quibéron, pourvu par l'évêque, le 16 janvier 1700, prit possession le même jour. Il mourut sur la fin du mois de mars 1705,
1705-1720. f Etienne Foyneau, d'Angers, sous-chantre de la cathédrale de Vannes et recteur du Mené, pourvu par l'Ordinaire, le 9 juillet 1705, prit possession le 12. Malade, il donna procuration, le 30 juin 1720, pour résigner entre les mains de l"évêque , et mourut en septembre suivant.
Avant de devenir recteur de Séné, fonction qu'il occupe dès le 21 janvier 1706, le personnage s'est montré quelque peu indiscipliné. Le premier juillet 1701, il est ainsi condamné à passer trois mois au séminaire de Saint-Méen, pour un scandale causé à la paroisse de Saint-Salomon à Vannes "et qui s'est répandu par toute la ville au sujet d'une personne mal notée" (sic).
Plus tard le 2 janvier 1705, on lui demande de ne pas se mettre à genoux au pupitre à côté de l'officiant sur le marchepied, ce qu'il affecte de faire depuis quelque temps. Cité par Olivier Charles dans son livre Jean Richin et consorts archiprêtres infâmes (édité en décembre 2022) Chanoines, cultes et discipline du choeur dans la cathédrale de Vannes au début du XVIIIe siècle
1721-1749. Pierre Le Nevé , né à Treffléan le 24 jdovembre 1673 et ordonné prêtre à Saint-Brieuc en tseptembre 1699, passa les premières années de son ministère dans sa paroisse natale. Il était curé de Saint-Patern, lorsque la paroisse de Séné lui fut conférée par l'évêque, le 12 mars 1721 ; il prit possession le 3 avril. Décédé dans son presbytère, à l'âge de 77 ans, le 23 novembre 1749, il fut inhumé le 25 dans le cimetière, où sa tombe se voyait encore naguère, avec une inscription édifiante (1). L'ancienne sacristie de Séné, qui possédait plusieurs de ses reliques, renfermait aussi son portrait dessiné par Lhermitais, notre pëintre breton. Sa vie a été publiée et Tresvaux l'a reproduite dans son édition des Vies des Saints de Bretagne.
Lire aussi article sur Pierre LE NEVE
1750-1789. f Guillaume Jallay, de Saint-Palern , heureux au Concours du 10 février 1750, fut pourvu de Séné par le Pape le 23 mars, et en prit possession le 11 mai. Décédé au . presbytère, à l'âge de 73 ans, le 14 décembre 1789, il fut inhumé, le 15, dans le cimetière , auprès de son prédécesseur. Jusqu'à la reconstruction de l'église, on y voyait encore sa tombe.
1789-1802. Pierre Coléno, de Billiers et curé de Plescop, pourvu par l'évêque, le 17 décembre 1789, prit possession le 18. Sans que nous sachions ce qu'il devint pendant les mauvais jours, il disparut en septembre 1792. Maintenu à la tête de sa paroisse après le Concordat, il prêta serment entre les mains du préfet , le 15 octobre 1802.
Lire Recteurs de Séné depuis la Révolution
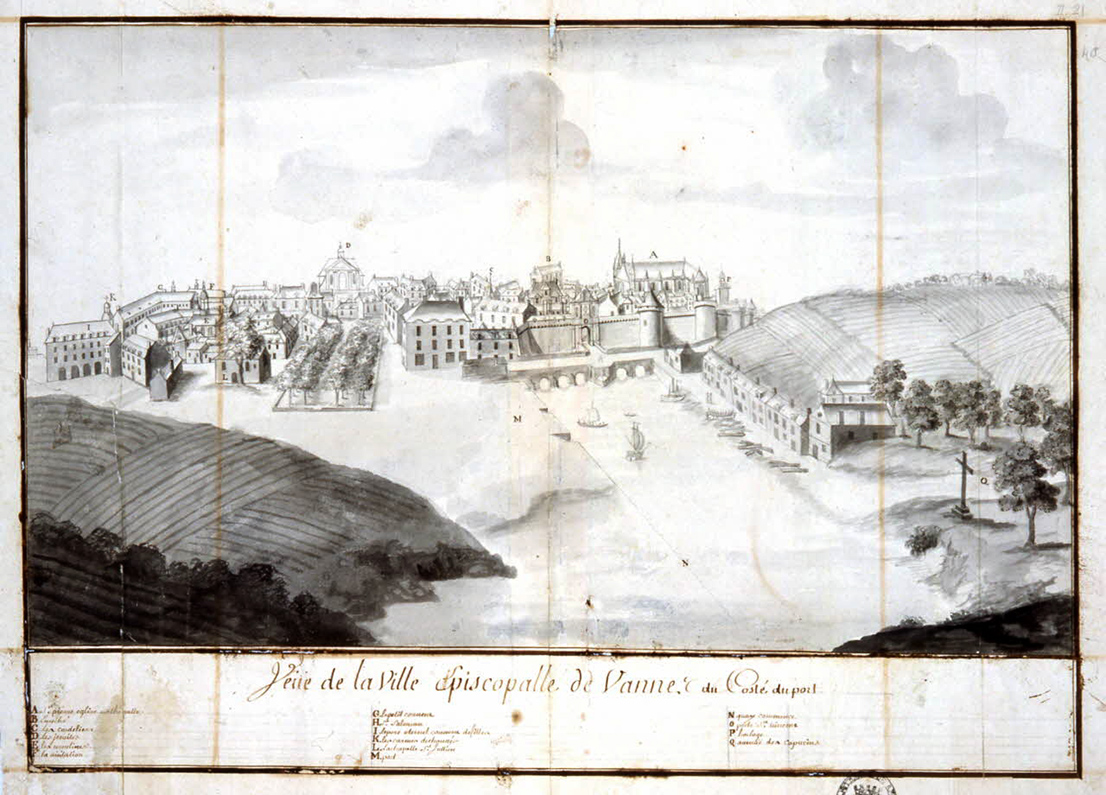
Recteurs de Séné depuis la Révolution
Article repris du livre de Camille Rollando, "Séné d'Hier et d'Aujourd'hu"i, lui-même issu d'un article publié dans la revue de la Société Polymathique du Morbihan. L'article est ici enrichi de documents et de photos.
Quand le 14 juillet 1789, la Bastille est prise par les insurgés, depuis près de 40 ans, Guillaume JALLAY est recteur de Séné où il a succédé à Pierre LE NEVE (lire article). Il n'aura pas à subir les affres de la Révolution et de la Terreur. (Lire article sur BENOIT et LETOULLEC).
Guillaume JALLAY Xx/xx1716-1750-1789-14/12/1789
De saint Patern, heureux au concours du 10 février 1750, fut pourvu par le pape le 23 mars et prit possession de sa cure le 11 mai. Décédé au presbytère, à l’âge de 73 ans, le 14 décembre 1789, il fut inhumé le 15 dans le cimetière, auprès de son prédécesseur. Jusqu’à la reconstruction de l’église, on voyait encore sa tombe. L'acte du décès porte la mention "venerable et discret".
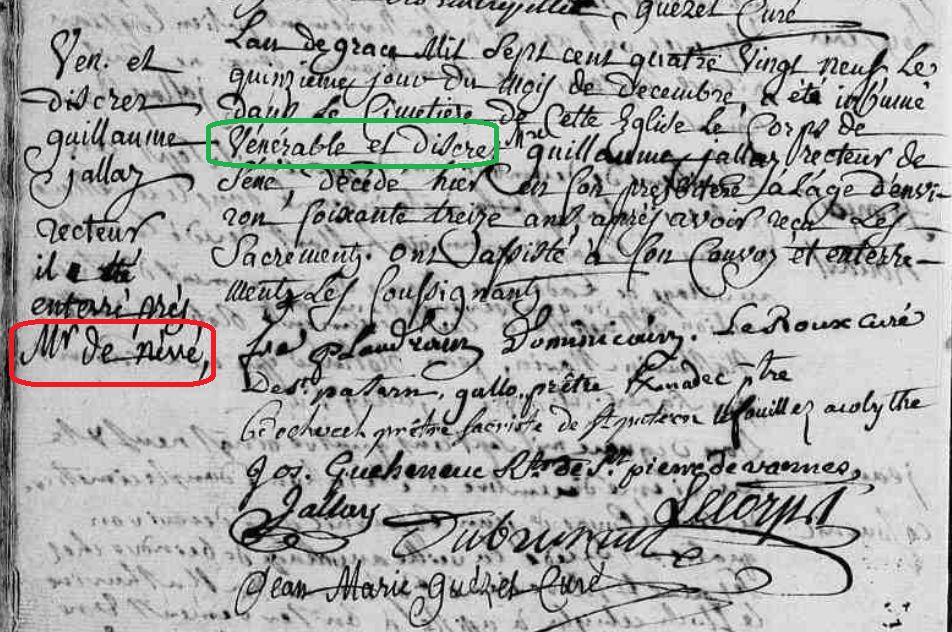
Pierre COLENO 16/5/1756- 1789-1822-15/2/1822
Né à Billiers sans que son extrait de baptême n'indique les profession des parents. Il est curé de Plescop. Pourvu par l’évêque le 17 décembre 1789, il en prit possession le 18, sans que nous sachions ce qu’il devint pendant les mauvais jours, il disparut en septembre 1792. Maintenu à la tête de sa paroisse après le concordat, il prêta serment entre les mains du préfet le 15 octobre 1802. Il mourut en 1822 à l’âge de 66 ans à Séné.
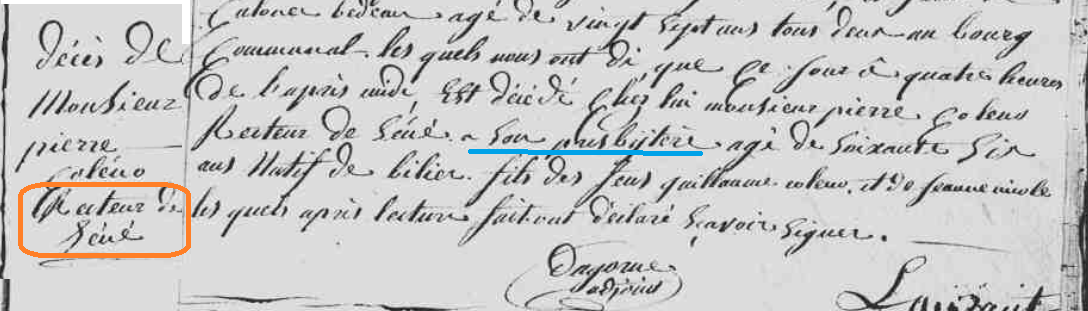
Sous son magistère à Séné plusieurs vicaires furent en poste : Le Bail, Laudrin, Martin, Jégat, Daniel, Le Clainche, Le Colleter (source Rolando).
Selon cet article de presse, le recteur COLENO est à l'origine de la première école à Séné, école de filles tenue par les religieuses des Filles du Saint-Esprit, ouverte en 1817.(Lire article sur l'histoire des écoles à Séné).
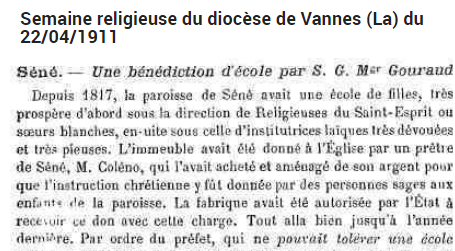
Jean Louis TOUMELIN 31/5/1787-1822-1868-12/12/1868
Né à Carnac en 1787, d'un père matelot, mourut à Séné dans sa 82° année. Après avoir navigué pendant un certain temps, il entra au grand séminaire de Vannes et fut nommé prêtre le 24 septembre 1814. D’abord vicaire de Locmariaquer, en charge du secteur de Saint-Philibert. Le 18 février 1822, Mgr de Bruc, évêque de Vannes (1817-1826), lui confia le rectorat de Séné, où il demeura jusqu’à sa mort, 47 ans plus tard, en 1868. Il fut très regretté par ses paroissiens.
Ces deux articles de presse d'époque montre que le père TOUMELIN oeuvra pour sa commune tout au long de son long magistère. On comprend qu'il établit sur Séné une religieuse en charge des soins infirmiers auprès des Sinagots. Il a fondé l'école catholique du bourg (qui deviendra par la suite l'école Sainte-Anne) et deux ans avant sa mort, en 1866, il ouvrit une autre école à Montsarrac, alors le village de Séné le plus peuplé.
En 1836, un de ses vicaires, Joachim GUILLOME, établi à Séné publie une grammaire bilingue français-breton (lire article dédié).
Au dénombrement de 1841, l'effectif éclésiastique à Séné comporte le "desservant", le père Toumelin, aidé par un vicaire, Julien Tabary. Trois servantes du recteur sont aux soins des deux prêtres qui ainsi peuvent demeurer dans leur chaire jusqu'à leurs vieux jours. Notons la présence au presbytère d'un "patourès", sans doute un enfant de l'assistance.
Son acte de décès montre également que le recteur de Séné était aidé dans sa fonction par des vicaires, Julien CADORET et Jean Mathurin LE MOING, contre-signe l'acte de décès. Les actes paroissiaux indiquent le noms de plusieurs vicaires qui se succédèrent à Séné sous le magistère de TOUMELIN : Guyonvarch, Couédel, Dagorne, Erdeven, Le Lohé, Guillaume.
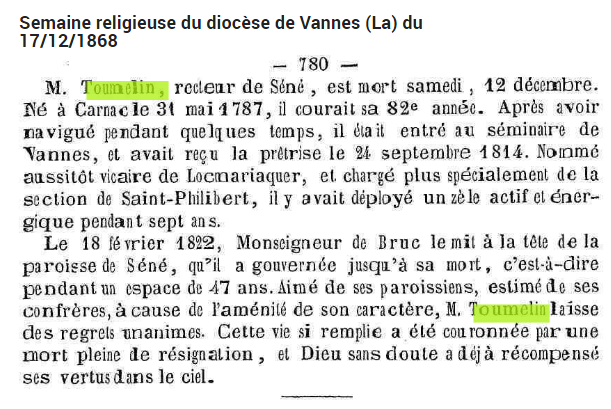
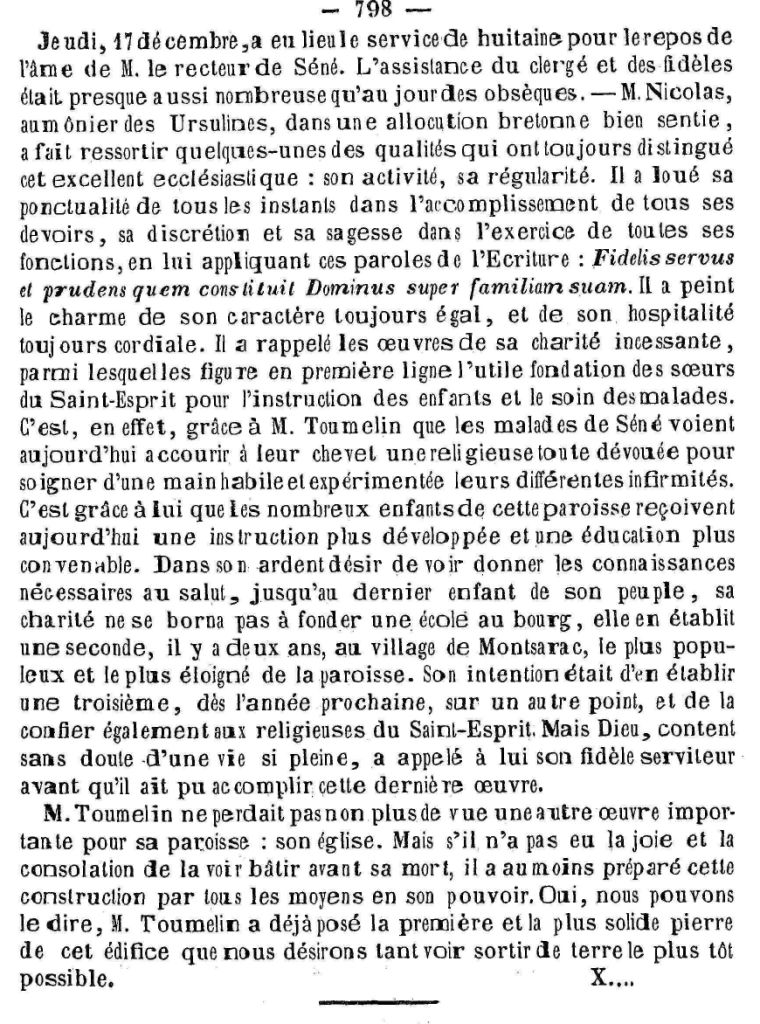
François JOURDAN 13/8/1821-1868-1876-xx/xx/xx
Né en 1821 à Quiberon, son père est capitaine de chasse-marée. Il est ordonné en 1848, recteur de Noyalo en 1867, fut nommé à Séné le 31 décembre 1868 qu'il quitta en 1876 comme nous lindique ces deux coupures de presse.
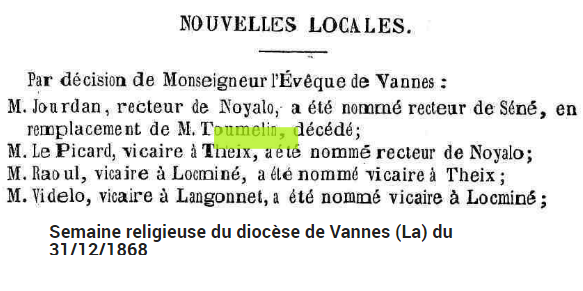
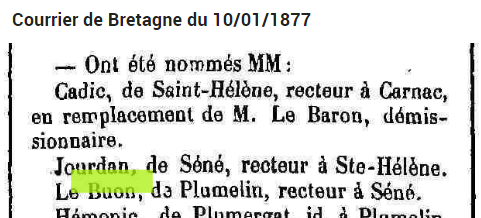
Rollando a pointé les vicaires suivants en poste à Séné pendant le magistère de JOURDAN : Guyonvarch, Delaquèze, Seveno, L'Hermitte.
Georges LE BUON 13/1/1831-1877-1901-22/11/1901
Né à Brandérion en 1831, son père est cultivateur, ordonné en 1855, recteur de Plumélin en 1872 puis de Séné le 1er janvier 1877. Décédé en 1901 à Séné. Enterré au cimetière communal avec sa soeur qui fut durant sa vie d'écclésiastique, sa servante.
Au dénombrement de 1886, l'effectif du presbytère se compose du curé, aidé d'un prêtre pensionnaire. La soeur de Georges LE BUON et deux domestiques assurent l'intendance.
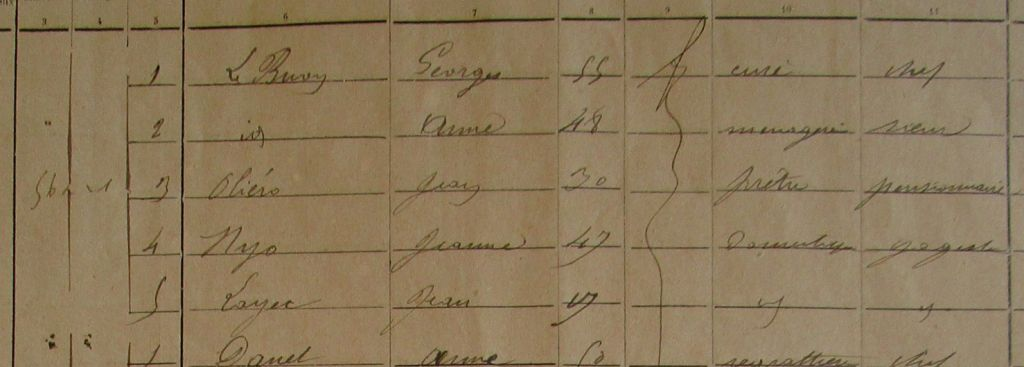
Au dénombrement de 1901, le presbytère loge également des instituteurs. Deux vicaires, Jacques Dondo et Jean Baptiste Oliéro épaulent le père Le Buon âgé de 70 ans.
Comme nous le rappelle cet article de presse d'époque, durant son magistère, la nouvelle église Saint Patern fut construite et le recteur LE BUON est à l'origine de la création d'une école de garçons à Séné. La tombe de Goerges LE BUON est visible à l'entré du cimetière de Séné.
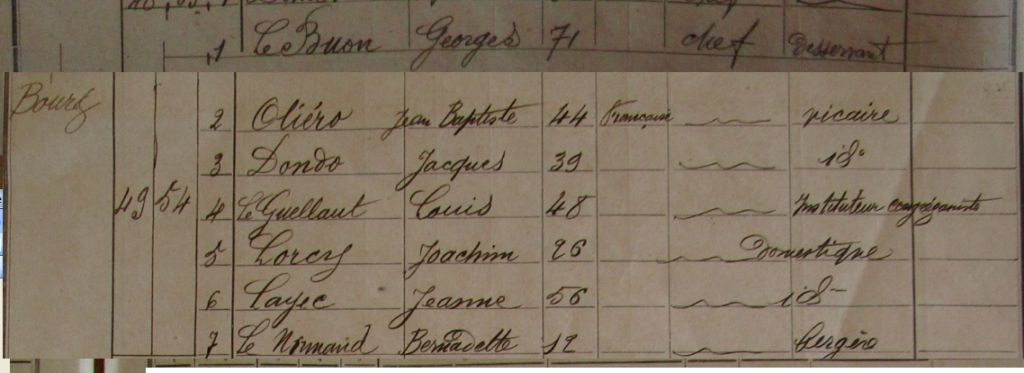
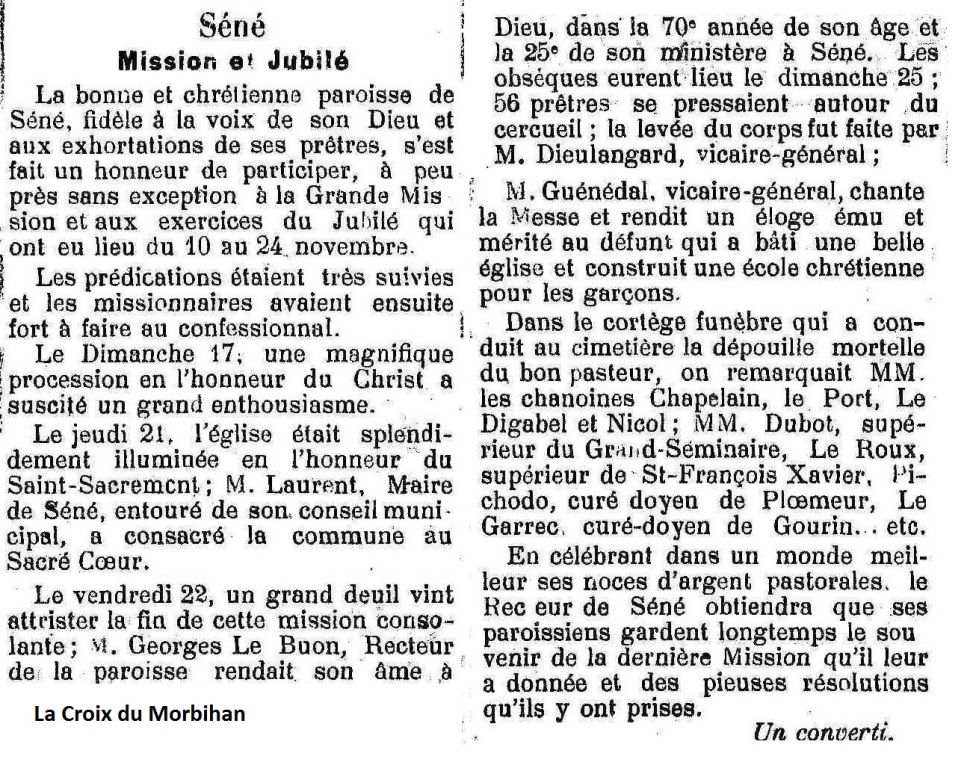
Désiré BELLEGO 9/4/1853-1901-1914- xx /xx/1914
Né à la Trinité-Carnac en 1853, son père est menuisier. Il ne fait pas sa conscription en 1873
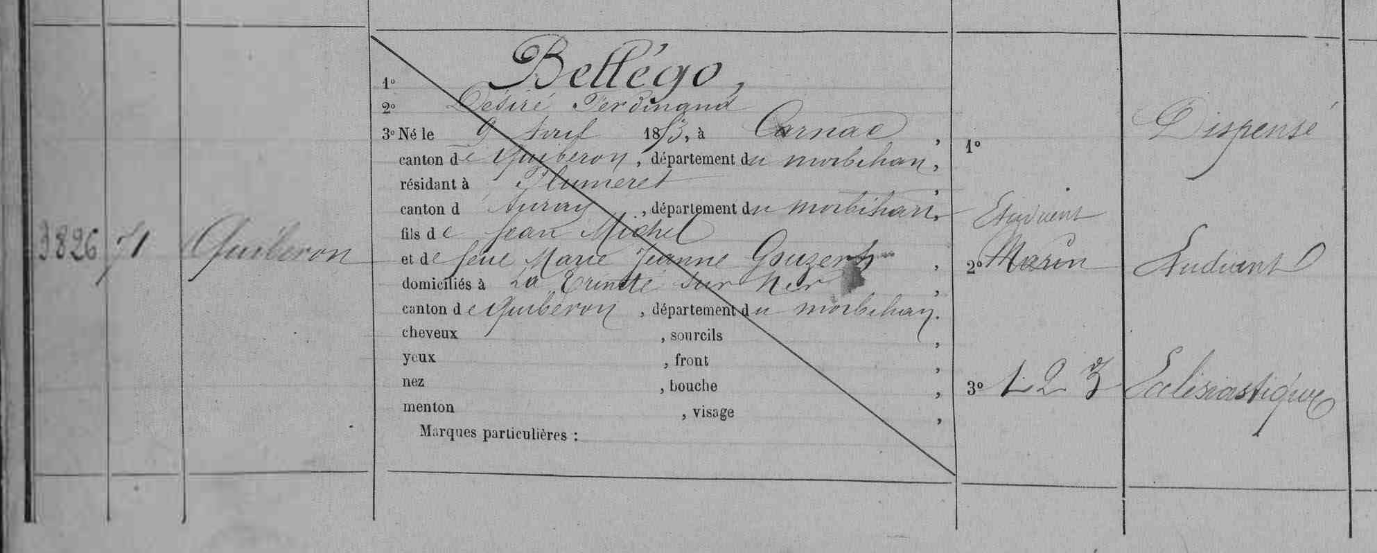
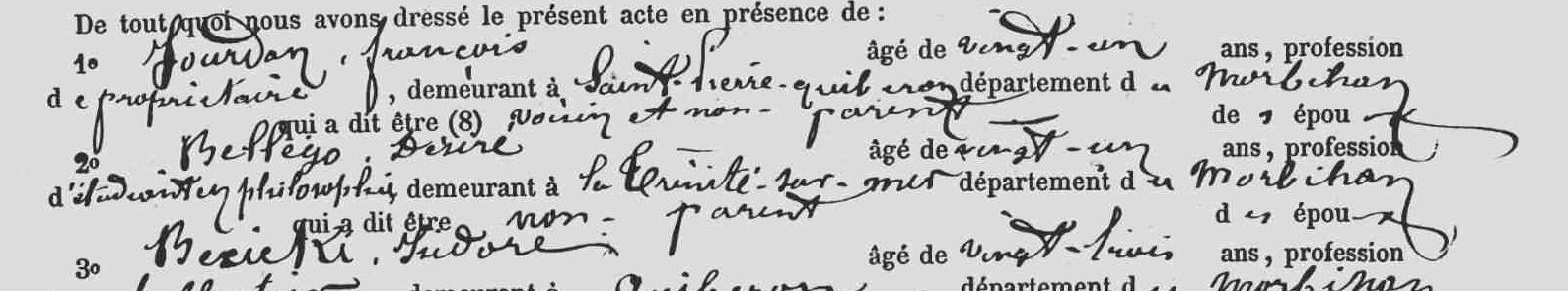
Il étudie la philosophie et devient prêtre en 1877, recteur de Houat en 1888, de Camors en 1896, puis de Séné le 14 décembre 1901. Son nom apparait au dénombrement de 1911. Le recteur BELLEGO est aidé par Jules Mathurin JAVET ou JOSSET et Prosper BLANCHO, prêtres à la paroisse.
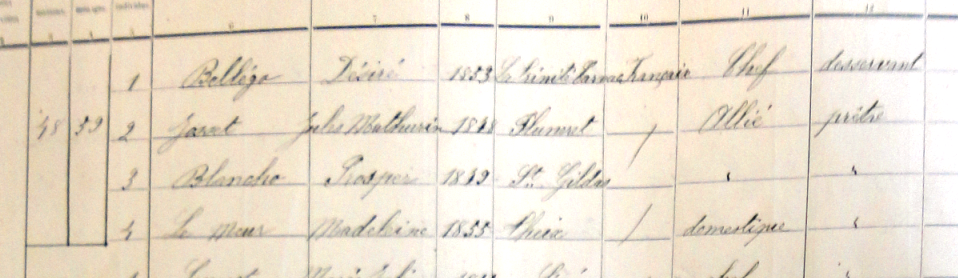
Après la confiscatin de l'école du bourg et l'expulsion des congrégationistes, le curé Bellego fut à la manoeuvre avec Mlle Gachet pour contruire près du Pont Lis une nouvelle école privée à Séné comme le relate cet article de presse.
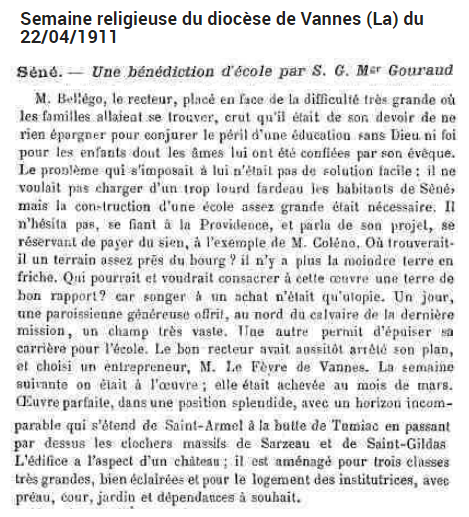
Il mourut en 1914 alors que la 1ère Guerre Mondiale vient d'éclater.
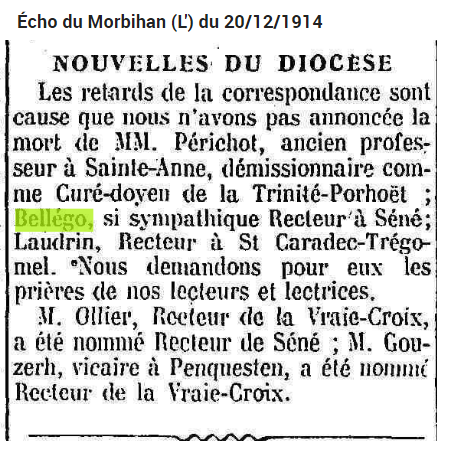
Pierre Joseph OLLIER 26/2/1862-1914-1932-xx/xx/1936
Né à Hennebont en 1862, son père est cultivateur, ordonné en 1866, il est exempté de service national.
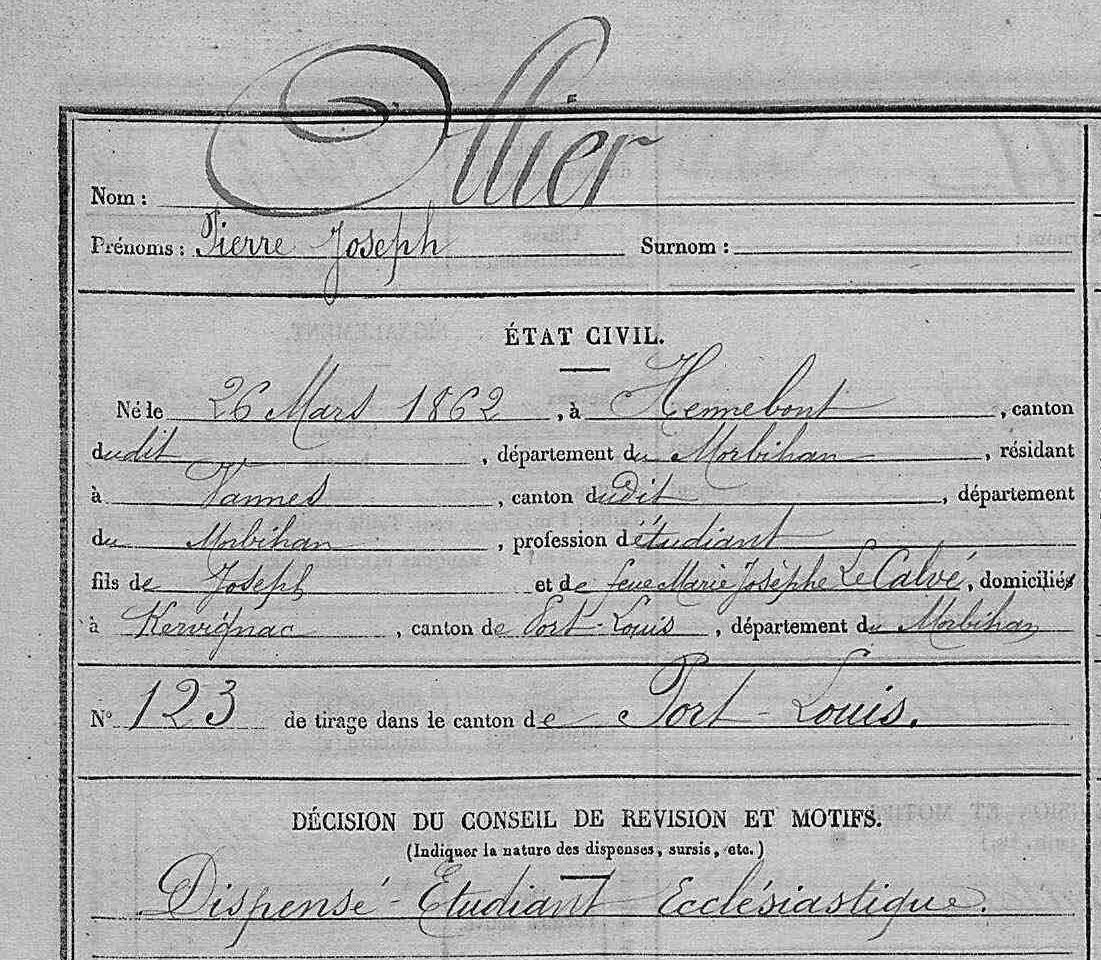
Il est recteur de la Vraie-Croix en 1909, de Séné en 1914 et durant les années de guerre. Au dénombrement de 1921, le presbytère loge le recteur, sa soeur dévouée Marie Anne Ollier, qui décèdera en 1930 à Séné, le vicaire, Henri Eugène TALLEC, et deux éclésiastiques aux fonctions d'instituteurs au bourg, dont Aimé CAPPE (lire article). Des religieuses installées au bourg complète l'effectif d'enseignants catholiques. Un autre vicaire sera en poste à Séné, Le Bourser (sources Rollando)
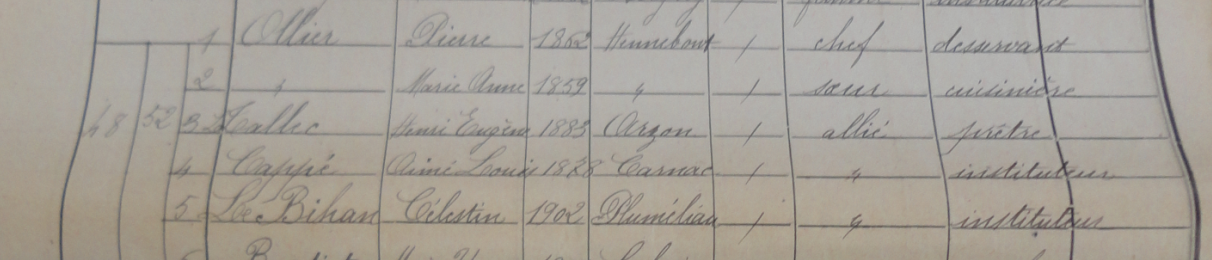
En 1931, l'effectif paroissial se compose de Pierre Joseph OLLIER, âgé de 69 ans, aidé par le vicaire Désiré Henri LE ROCH. Cappé et Lavairije sont instituteurs. Le presbytère loge également un enfant domestique et écolier, sans doute issu de l'assistance qui aide la cuisinière.
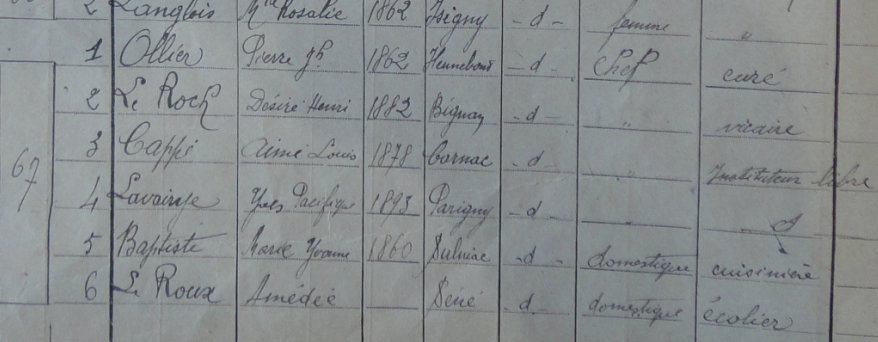
Pierre Joseph OLLIER décède en 1936, après avoir donné sa démission de Séné en 1932, si bien que son décès ne semble pas avoir été relayé dans la presse locale à Séné, malgré 18 ans de présence sur la paroisse.
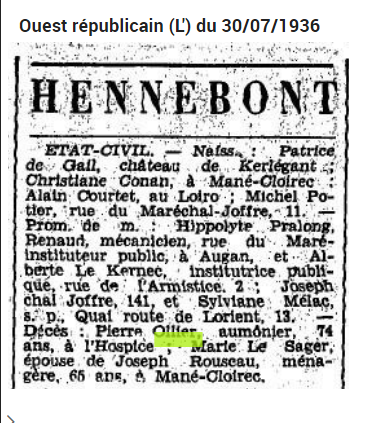
François Marie POEZIVARA 5/1/1880-1932-1956-6/3/1957
Né à Baden en 1880, son père est marin. Il entre au Petit Seminaire comme le montre cet article de presse .
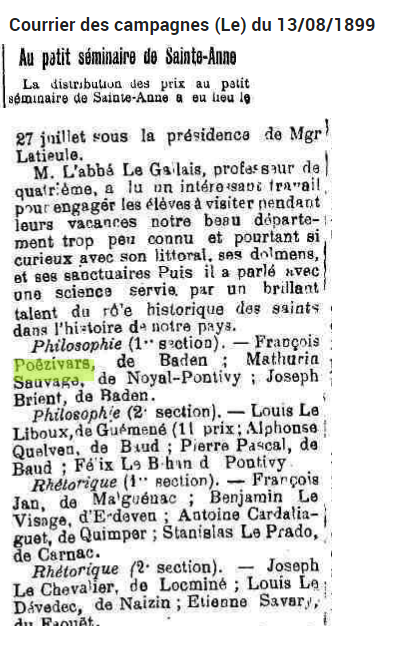 Il est ordonné en 1904. Il est professeur jusqu'en 1909 avant de rejoindre comme vicaire la paroisse de Languédic.
Il est ordonné en 1904. Il est professeur jusqu'en 1909 avant de rejoindre comme vicaire la paroisse de Languédic.
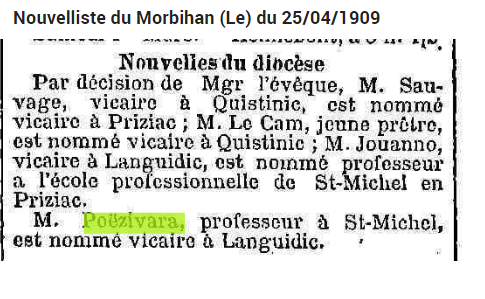
Pendant la 1ère Guerre Mondiale, le prêtre Poezivara est mobilisé dans un régiment d'infirmiers. Il recevra la Croix de Guerre.
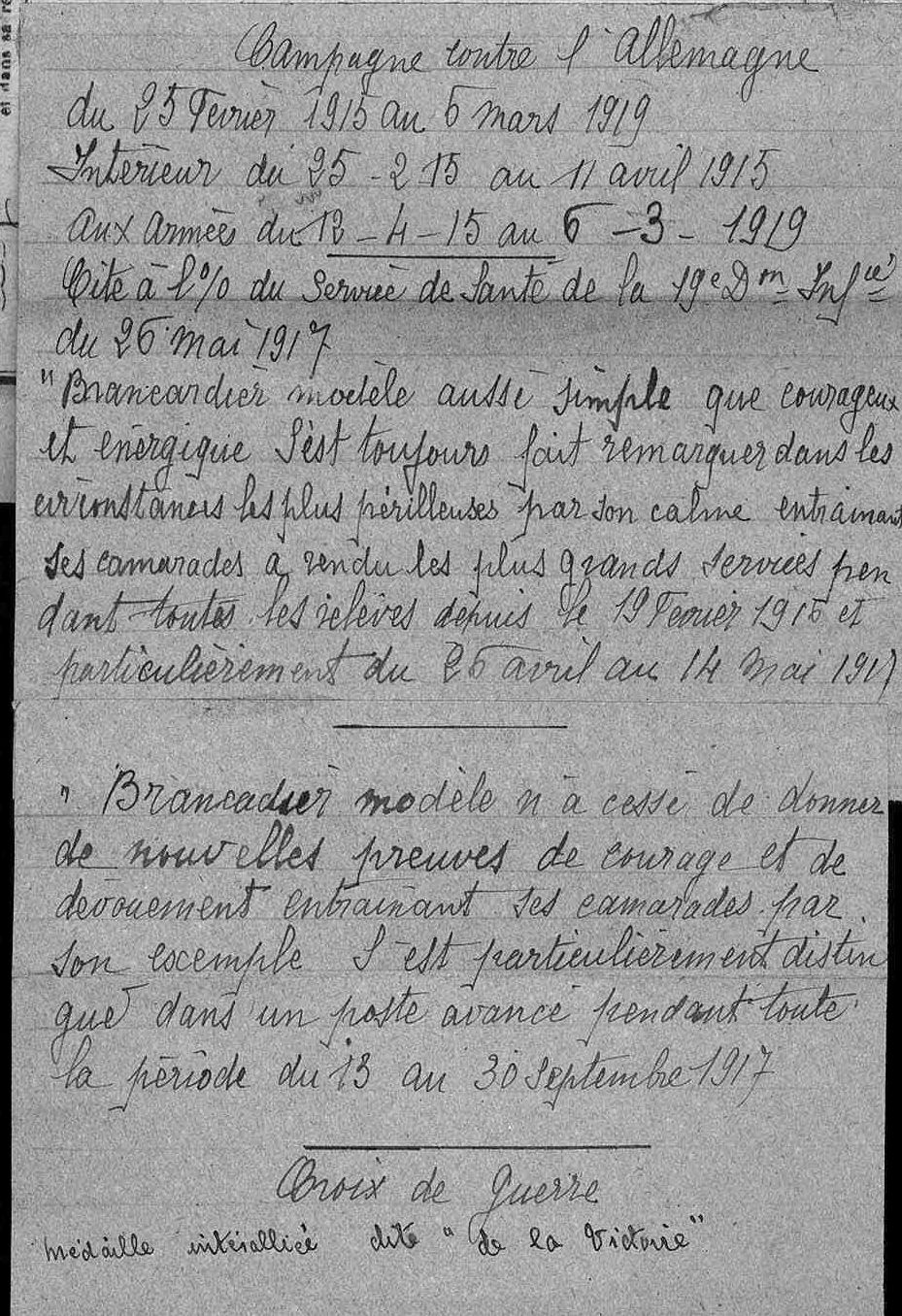
Après un poste à Sarzeau, il est recteur de Le Sourn en 1930, de Séné en 1932.
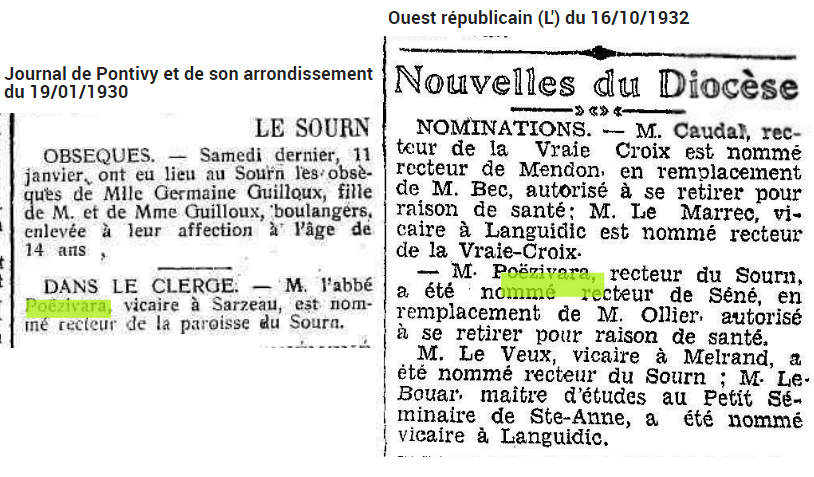
Au dénombrement de 1936, l'équipe paroissiale de l'époque se compose du desservant POEZIVARA, du vicaire Gouzerh, qui deviendra recteur de séné, des instituteurs Cappé et Lorho. L'intendance est assurée par Mme Dorso, assistée de la nièce du recteur. Rollando cite les vicaires suivants : J.Drouet, E. Perron, M. Dugor, D. Philippe.
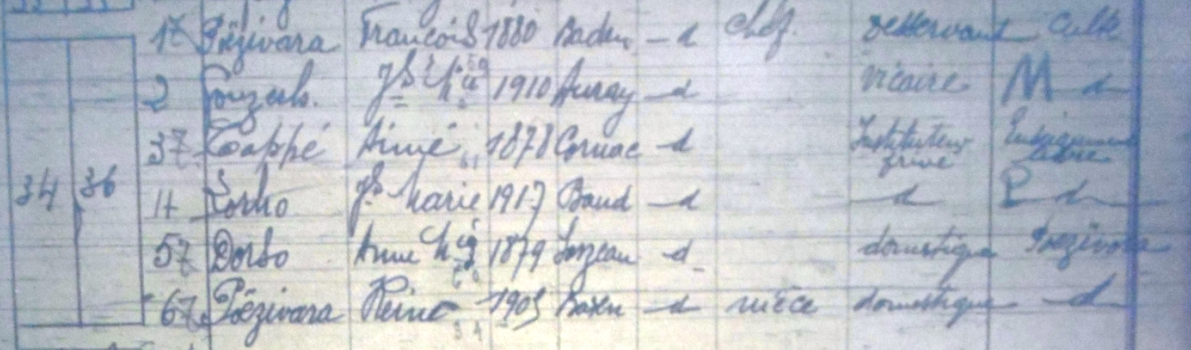
Démissionnaire en 1956 pour des raisons de santé, il mourut en 1957 à Sainte Anne d’Auray. Il fut inhumé à Séné aux côtés de son illustre prédecessuer, Pierre LE NEVE.
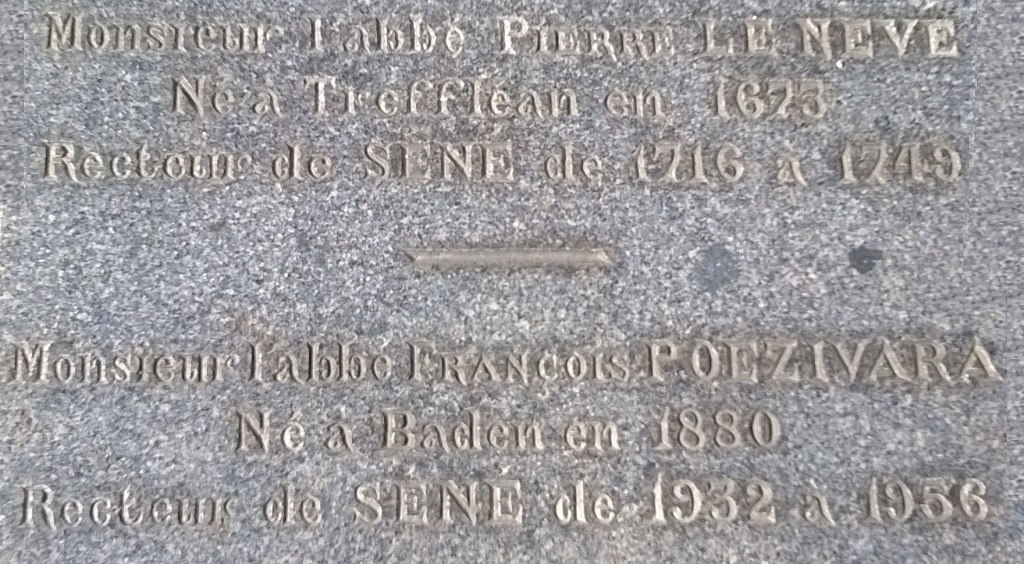
François Marie CORLOBE 31/12/1908-1956-1958-xx/xx/1958
Né à Crach en 1908, fils d'un menuisier, ordonné prêtre en 1934, recteur de Silfiac en 1948, de Séné en 1956. Mourut en 1958.
Joseph GOUZERH Xx/xx/1910-1958-1968-xx/xx/xx
Né à Auray en 1910, ordonné en 1935, d’abord vicaire de Séné pendant 8 ans auprès du recteur Poézivara. Puis recteur de Sainte Brigitte en Malguénac. Recteur de Séné en 1958. Muté à Locqueltas en 1968. Au dénombrement de 1962, le vicaire Louis RIVALLAIN est en poste à Séné.
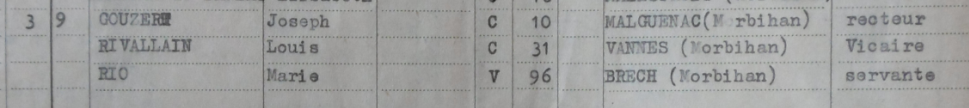
Joseph LE ROCH -30/06/1923 Baud - 18/01/1988 Vannes - Recteur de 1968-1980 :
lire article dédié
Alphonse CHAUVIN 4/4/1925-1980-1991-xx/xx/2007
Né à Caden en 1925, ordonné prêtre le 29 juin 1949, Puis fut nommé vicaire instituteur de Nivillac le 2 février 1950 après avoir été vicaire instituteur à Brech. Par la suite il fut nommé vicaire à Carentoir. Vicaire à la cathédrale de Vannes pendant 17 ans, nommé recteur de Séné le 19 octobre 1980. Quitte ses fonctions le 2 octobre 1991. Il décède à Vannes en 2007. Son nom figure avec ceux des autres écclésiastiques de Vannes au cimetière de Bosimoreau.


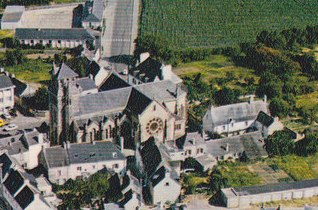

Photo collection Emile Morin Le Pays de Séné
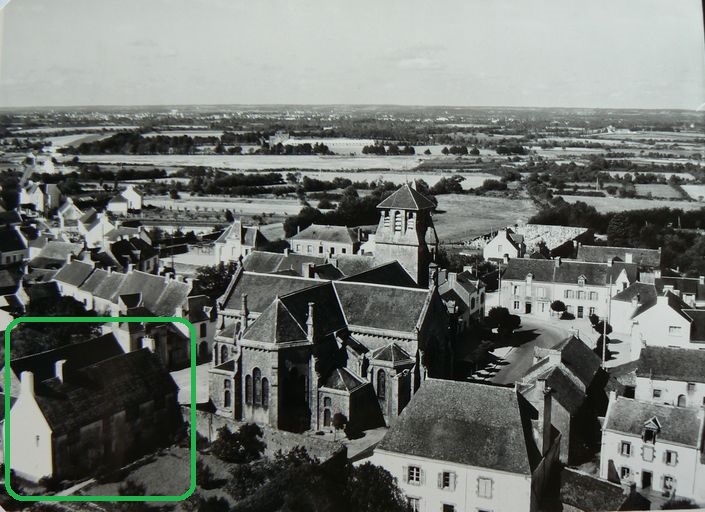
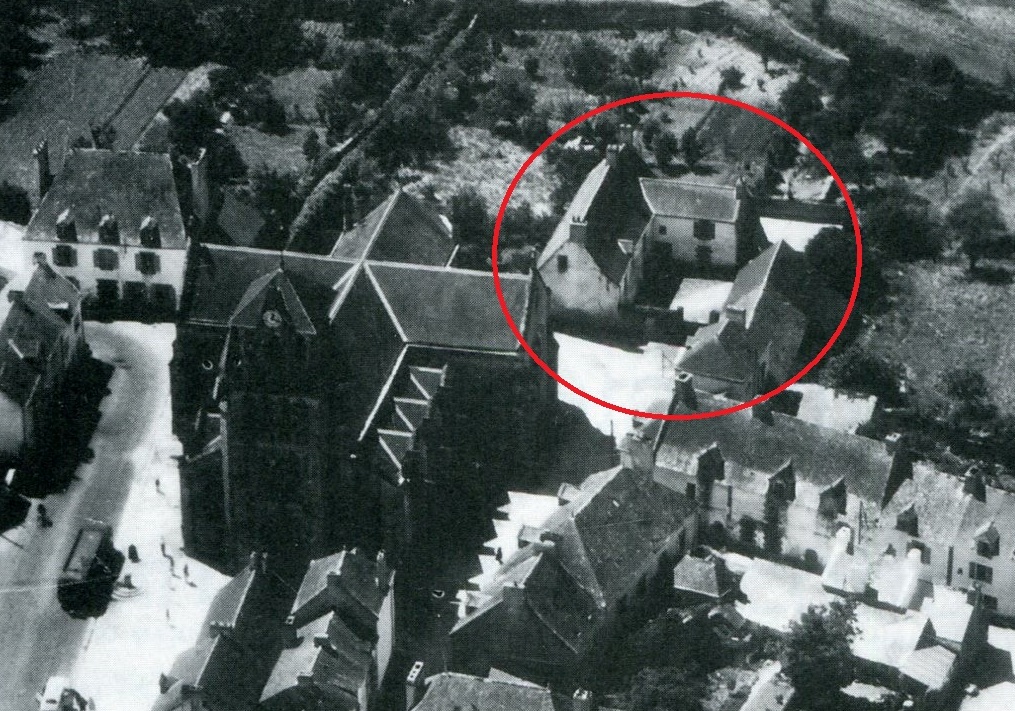
Durant son magistère eu lieu le centenaire del'église Saint-patern et l'ancien prebsbytère fut détruit pour laisser place à l'actuel.
Alphonse Chauvin (recteur) et Francis Pouligo (maire)
L'inauguration donna lieu à une grande cérémonie à Séné comme nous le relate Emile Morin dans son livre" Le Pays de Séné" : "le 27 septembre 1987, à l'occsaion des fêtes du Centenaire de l'église Saint-Patern, de grandioses cérémonies se sont déroulées à Séné. Lors de ces fêtes, le père Alphonse CHAUVIN, recteur de la paroisse, et Francis POULIGO, maire de la commune, reçurent monseigneur Pierre Boussard, évêque de vannes, ainsi que de nombreuses personnalités civiles. Une quinzaine de prêtres originaires de Séné, ou ayant exercé leur ministère, assistait aux cérémonies, retrouvant avec nostalgie leur "vieux presbytère", tandis que le père Chauvin inaugurait, ce jour-là, son nouveau domicile."
Maurice GUILLERME Xx/xx/1930-1991-2003-xx/xx/2013
Né à Saint Martin sur Oust, ordonné prêtre en 1956. Après avoir été curé de Sainte Anne d’Arvor à Lorient, nommé recteur de Séné le 26 juillet 1991.
Après 11 année passées auprès des Sinagots, Maurice GUILLERME, a quitté la commune pour intégrer l'équipe pastorale au Guiriel à Hennebont. Les Sinagots ont pu lui témoigner leur affection lors d'une soirée en son honneur à la salle des fêtes où plus de 300 personnes étaient présentes pour lui rendre un véritable hommage. (Extrait du bulletin municipal).
Article de presse, révisé paru après son décès.
Ancien prêtre de la paroisse de Séné, Maurice GUILLERME avait quitté celle de Hennebont en 2009, pour se retirer à la résidence Saint-Joachim, à Sainte-Anne-d'Auray. À 83 ans, il continuait son apostolat en tenant des permanences d'accueil et d'écoute pour les pèlerins de la basilique.
Né à Saint Martin sur Oust en 1930, ordonné prêtre en 1956, Maurice GUILLERME fut d'abord professeur de lettres classiques à Sainte-Anne-d'Auray, pendant quinze ans. Puis, ce furent quinze autres années d'aumônerie dans l'enseignement public, notamment au lycée Dupuy-de-Lôme, à Lorient. Avant d'arriver à Hennebont, il fut recteur de la paroisse de Sainte-Anne-d'Arvor puis de Séné, de 1991 à 2002.
À Hennebont, il faisait partie d'une équipe de quatre prêtres à desservir le doyenné, mais il était surtout en charge de la paroisse du Guiriel. Très relationnel, jovial, il affichait le sourire, pour cacher le mal qui le minait, une polyarthrite qui, petit à petit, le paralysait. « Maurice, c'était d'abord un physique, se souvient Michel Audran, le curé d'Hennebont. C'était un footeux, un cycliste invétéré. Mais l'ancien proffesseur était aussi très charpenté intellectuellement, si je puis m'exprimer ainsi. Son charisme, il le tournait vers les 25-45 ans, ce 2e âge qu'on ne voit pas beaucoup dans les églises. Les jeunes, c'était son affaire. »
Lire l'article : Pierre LE NEVE
BENOIT - LE TOULLEC, victimes de la Terreur
Camille Rollando, dans son livre intitulé "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", nous donne une liste des recteurs de Séné. Pour la période révolutionnaire, on lit que Guillaume Jallay, recteur à Séné de 1750 à 1789, décédé le 14 décembre 1789 à Séné, ne connut que très peu les soubresseaux de la Révolution.
Son successeur, Pierre Coléno, natif de Billiers, fut nommé le 17 décembre 1789. Rollando nous dit "qu'il disparut en septembre 1792 [à éclairicir]. Maintenu à la tête de sa paroisse après le Concordat, il prêta serment entre les mains du préfet le 15 octobre 1802. Il mourut en 1822."
Cependant, la liste des recteurs ne tient pas compte des autres éclésiastiques en poste à Séné. Ainsi les registres paroissiaux nous montrent la signature de Le Bail, de Le Tual et d'un certain Le Toullec, curé ou prêtre à Séné.
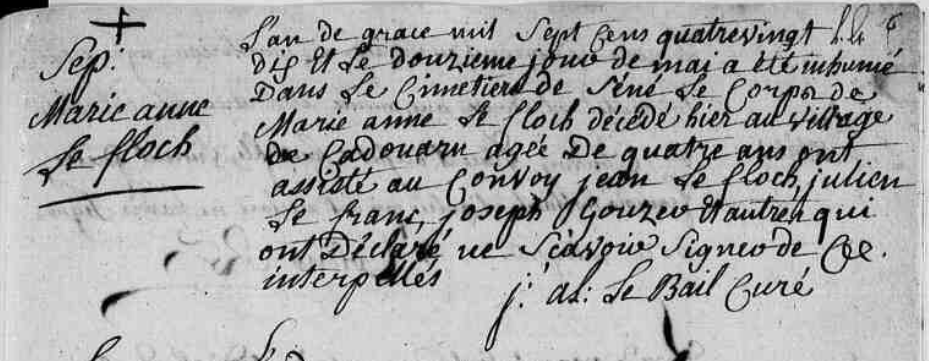
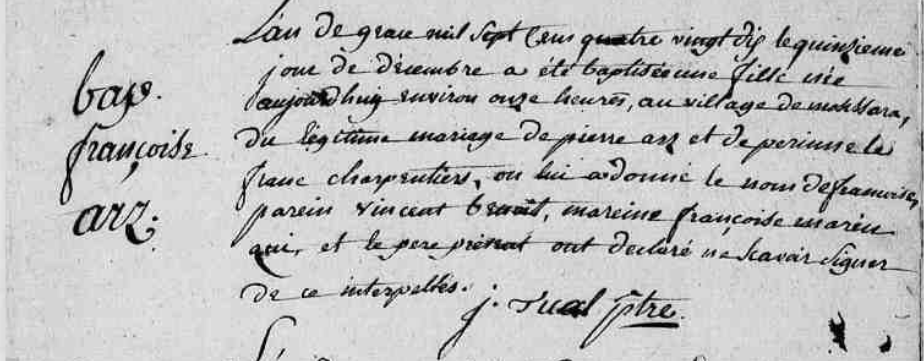
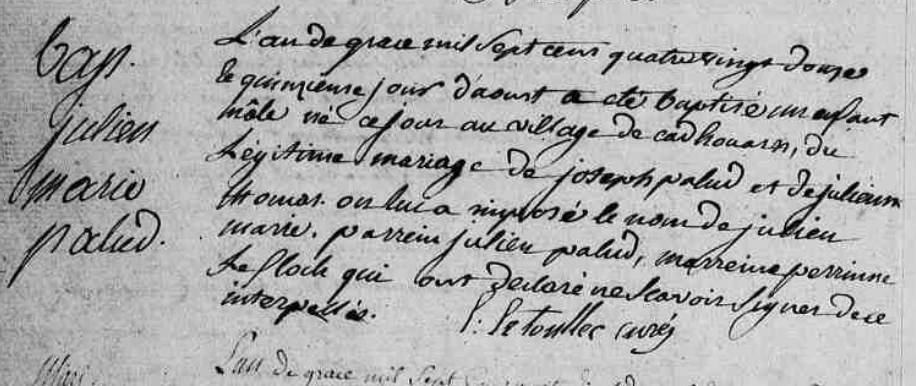
Dans son ouvrage, "Les prêtres du Morbihan victimes de la Révolution (1792-1802)" le chamoine LE FALHER (J.) rédige en 1921, une biographie des 24 guillotinés, des 18 déportés et des 21 prêtres assassinés, accompagnée de documents officiels. Le chanoine Le Falher fut l'auteur d'études majeures sur la chouannerie dans le Morbihan, de monographies chouannes et aventures de guerre civile.
Dans cet ouvrage numérisé sur Internet, on peut à l'aide du mot clef "Séné" retrouver deux biographies de prêtres martyrisés, victimes de la Terreur révolutionnaire, en lien avec notre commune Séné.
Vincent BENOIT, vicaire de Sulniac [17/02/1745-30/08/1794] et curé à Séné en 1772-75.
Louis LE TOULLEC, vicaire à Séné [7/04/1762 - 2/06/1794]
avec pour autre point commun, d'être mort en déportation à Rochefort dans les geôles révolutionnaires.
Avant de dresser leur portrait et leur destin tragique, on mentionnera le sort de Michel EVENO. D'après l'ouvrage publié en 1989, à l'occasion du Bicentenaire de la Révolution, sous la driection d'André MOISAN, abbé et conservateur de la Bibliothèque des Archives Diocésaines, à l'Eveché de Vannes, intitulé EGLISE ET REVOLUTION dans le Morbihan, on apprend que Michel EVENO natif de Séné, mourut en exil.
Michel Eveno nait le 8 avril 1752 à Kernipitur en Séné fils de Julien et Marie La Chaussée. Il est tonsuré en 1778 et devient titulaire la même année de la chapellenie de l’Isle en Noyalo. Il est sous-diacre et âgé de 40 ans quand il déclare, à la citadelle de Port-Louis, le 9 septembre 1792 qu’il veut se déporter dans la partie septentrionale de l’Espagne. Le 18 septembre il sort de Port-Louis, il est embarqué avec 26 autres prêtres sur la goélette La Flèche, capitaine Joseph Petit en baie de Cardelan en Baden est signalé après juin 1797. Il serait mort en exil.
Vincent BENOIT, vicaire de Sulniac [17/02/1745-30/08/1794]
L'abbé Vincent BENOIST est né le 17 février 1745 au village de Cariel en Séné, fils de Joseph, capitaine de barque, et de Nicolle Rolland comme nous le confirme son extrait de naissance. La fratrie comptera 9 frères et soeurs installés à Cariel.
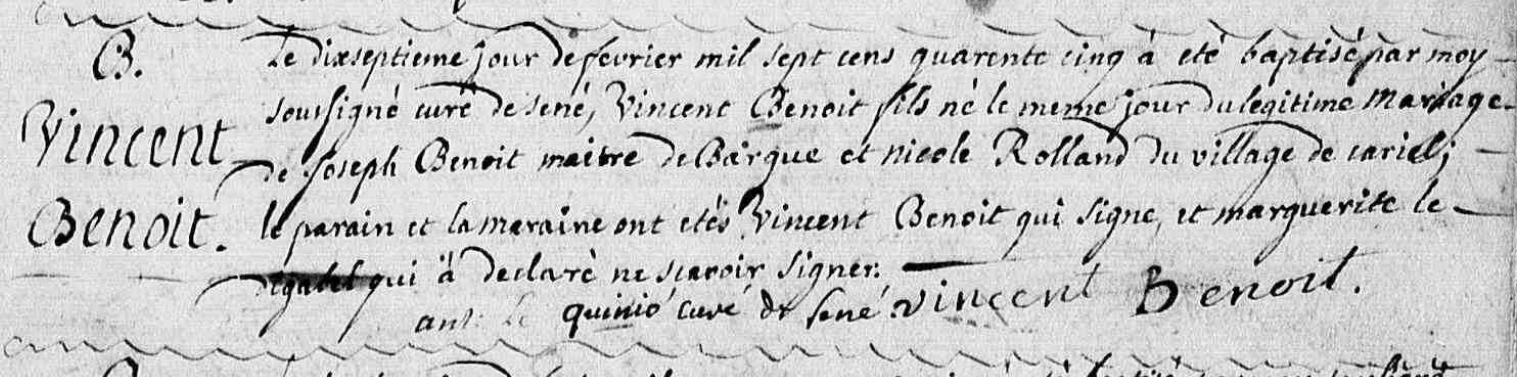
Le jeune Vincent BENOIT fut ordonné sous-diacre à Notre-Dame du Mené le 22 septembre 1770, diacre le 16 mars 1771, il est ordonné prêtre le 21 septembre 1771 par Monseigneur Charles-Jean de Bertin. Il devient vicaire chargé de la frairie Sainte-Marguerite de Sulniac.

Chapelle Sainte Marguerite à Sulniac
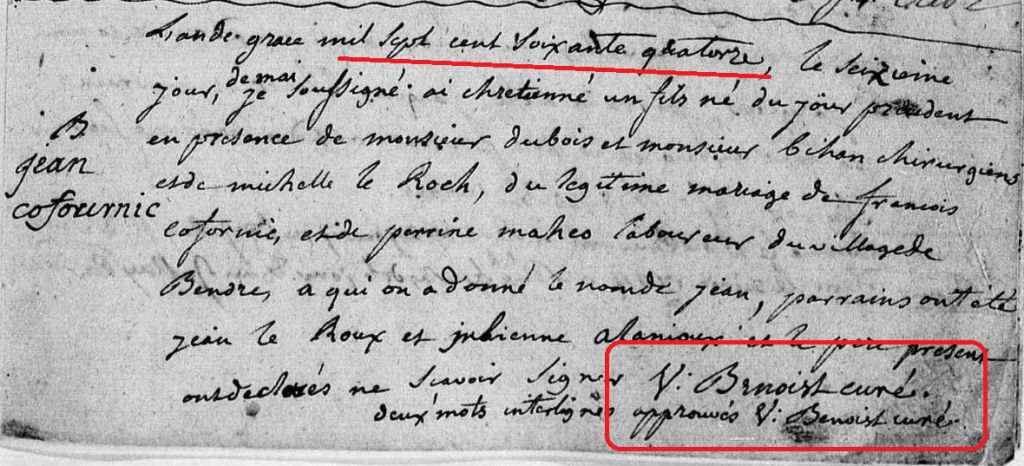
Quelques actes civils sur les registres témoignent de son affectation à Séné entre 1772-1775. Pendant la période révolutionnaire, il fut détenu à la Retraite des femmes à Vannes en octobre 1782?, puis arrêté le 11 octobre 1793 comme insermenté :
"Nous avons saisi chez lui un prêtre caché dans le grenier, et revêtu de son costume; nous l'avons jugé de bonne prise ainsi que sa chambrière, qu'il nous a dit être sa sœur; après d'autres perquisitions chez lui, nous y avons apposé les scellés", dit le rapport du citoyen Bosquet.
On comprend, que sa soeur, l'a suivi dans sa vie d'écllésiastique, comme il arrivait souvent au sein des familles nombreuses.
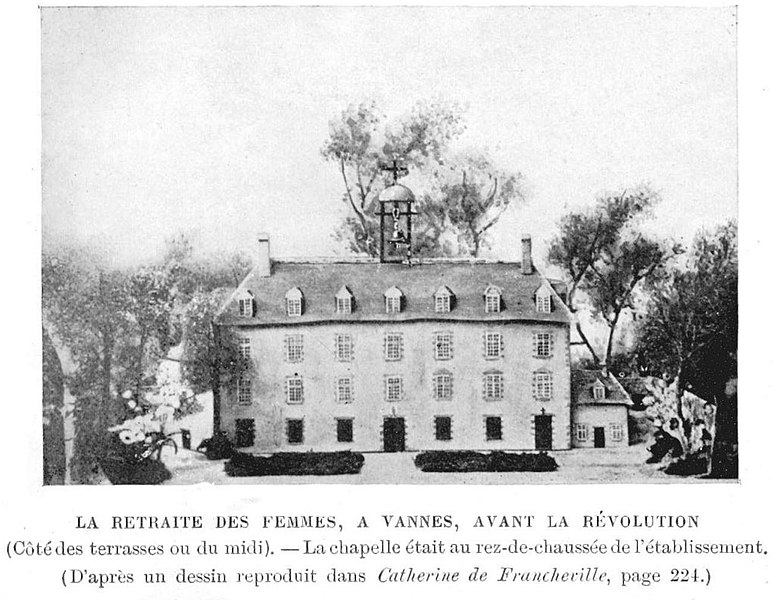
Ecroué de nouveau à la Retraite des femmes de Vannes, il est du nombre des dix-sept prêtres embarqués à Vannes sur "Le Patriote" le 3 mars 1794.
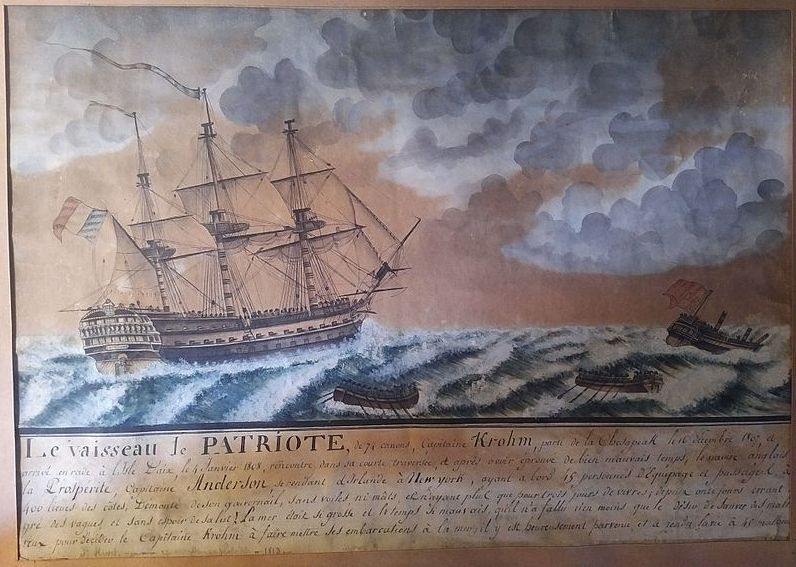
Arrivé à Rochefort le 26 mars il est transféré dans une des prisons-pontons, des bateaux désaffectés, dont on avait retiré mats et voiles, et qui servaient de prison flottantes.
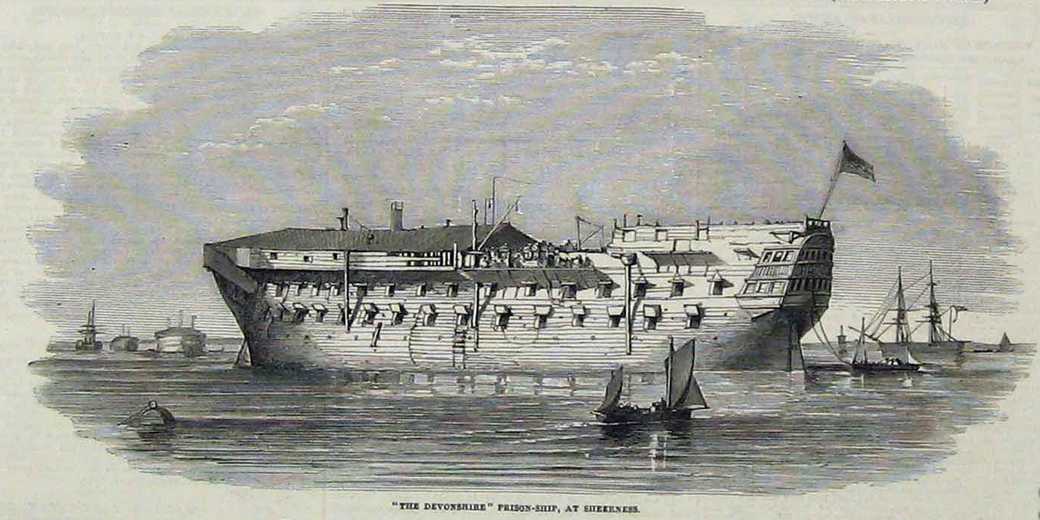
D'abord sur "La Nourrice", puis transféré sur "Les Deux Associés", un ancien vaisseau négrier.
"Ces hommes étaient rayés du livre de la République, on m'avait dit de les faire mourir sans bruit..." Capitaine Laly, du ponton les Deux Associés.
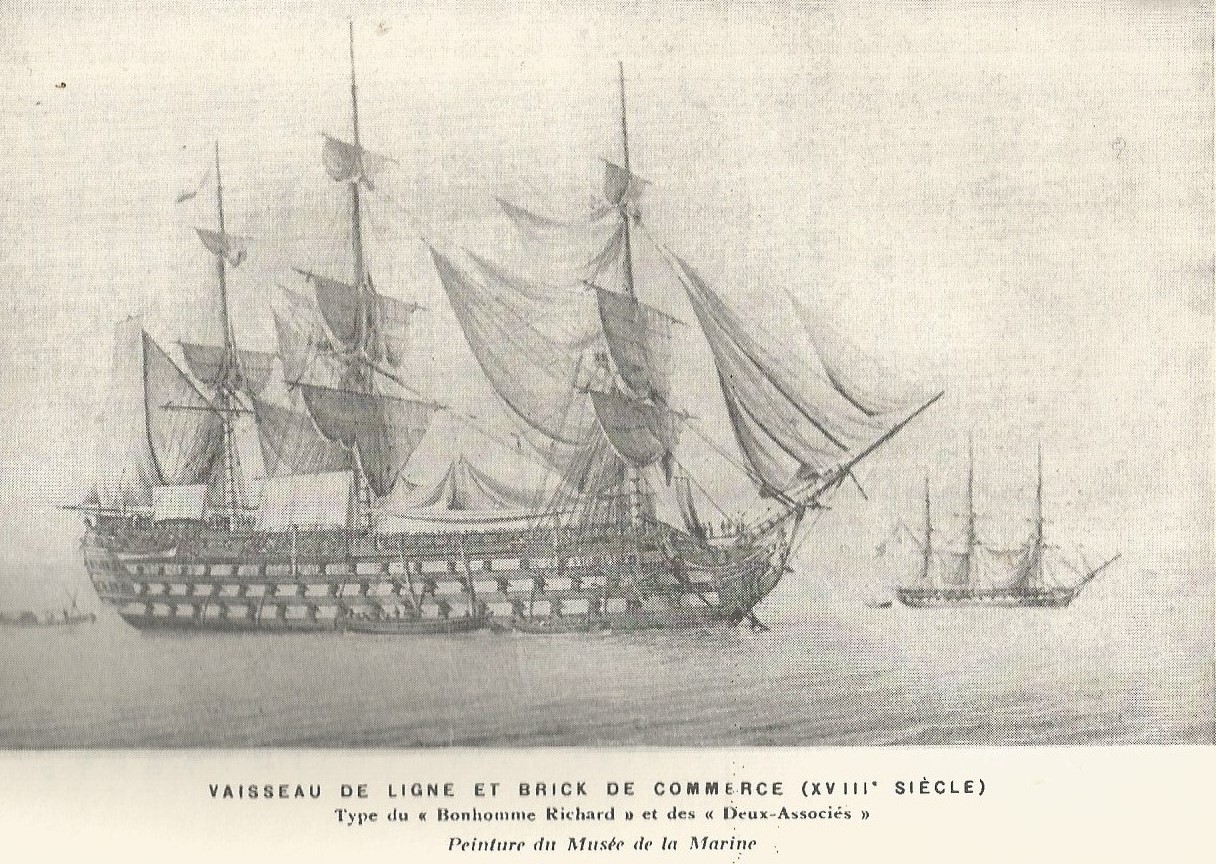
Trois pontons ancrés en rade de Rochefort servent également à emprisonner et faire disparaître 829 prêtres réfractaires pendant la période de la Terreur, durant la Révolution française. Initialement prévus pour déporter les internés vers les bagnes de Guyane, ces pontons sont finalement restés ancrés devant l'île d'Aix à partir du printemps 1794.
Les trois pontons avaient pour noms : Washington, Deux-Associés et Bonhomme Richard. 64 prêtres martyrs ont été béatifiés par Jean-Paul II en octobre 1995 et sont célébrés à différentes dates par l'Église catholique romaine, sous le vocable générique de martyrs des pontons de Rochefort.
Les pontons :
Le commandement des navires fût assuré par Laly pour les Deux-Associés et Gibert pour le Washington. Ils appliquèrent avec leurs équipages, les consignes de sévérité avec rigueur, les aggravant même parfois : pas de prière, injures, menaces, brimades physiques, nourriture infecte, pas de conversation. Mais les prisonniers continueront dans le secret une activité religieuse.
Les décès dus aux conditions de détention s'accélèrent, le scorbut, le typhus font des ravages. L'épidémie est telle qu'enfin les prisonniers valides sont transférés sur un troisième navire, l'Indien, tandis que les plus malades sont débarqués sur l'île citoyenne (l'île Madame) où beaucoup périront. L'automne 1794 est particulièrement rude, et en novembre, le vent renverse les tentes de fortune de l'hôpital installé sur l'île, les survivants sont alors à nouveau embarqués sur les navires. Les conditions matérielles de détention s'améliorent quelque peu tandis que la neige et le gel s'installent.
Vincent BENOIT meurt le 30 août, il est âgé de 50 ans et fut inhumé dans l'île Madame. Bien que martyrisé par les "Révolutionnaires", ilne figure pas dans la liste des béatifiés.
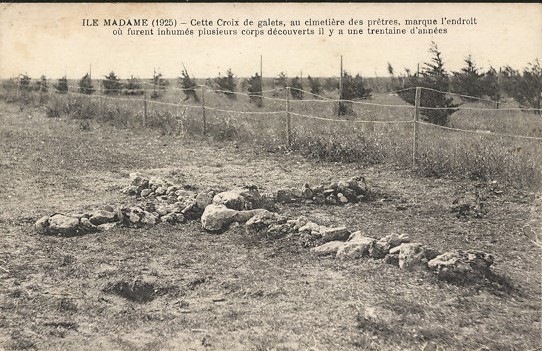
Louis LE TOULLEC, vicaire à Séné [7/04/1762 - 2/06/1794]
Sources. — Archives départementales, L. 1571, 1544, 862, 266,
Texte orginel avec quelques rajouts et illustrations.
Louis LE TOULLEC naquit à Quiberon au village de Kerdavy, le 9 avril 1762, d'Olivier Le Toullec et de Renée Le Boulair.
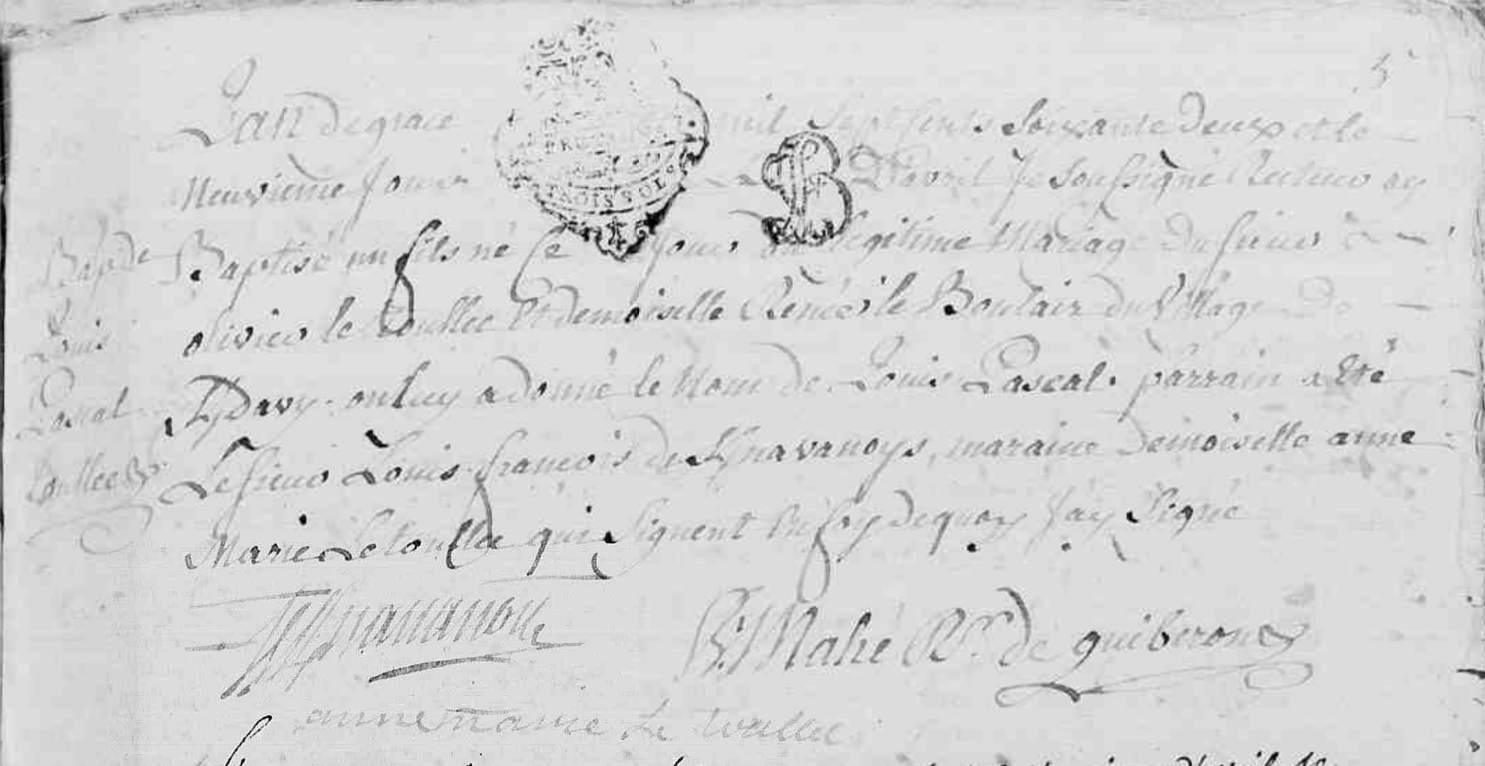
Il fut ordonné prêtres Vannes en 1790 par l'évêque Sébastien-Michel Amelot de Chaillou et immédiatement nommé vicaire de Séné. Hélas ce ne fut pas pour de bien longues années, car, l'orage révolutionnaire soufflant, M. LE TOULLEC crut meilleur de fuir devant lui.
Les registres de Séné montrent en date du 15 août 1792, le dernier acte signé de la main de Louis LE TOULLEC.
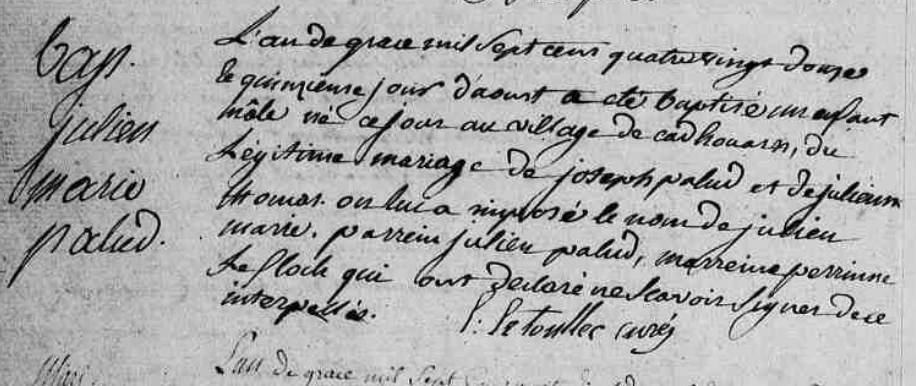
Le 30 août le recteur Coléno signe son dernier acte paroissial. Ces derniers échoient désormais au premier maire de Séné, Marc Besnoit. (Lire Histoire des maires de Séné).
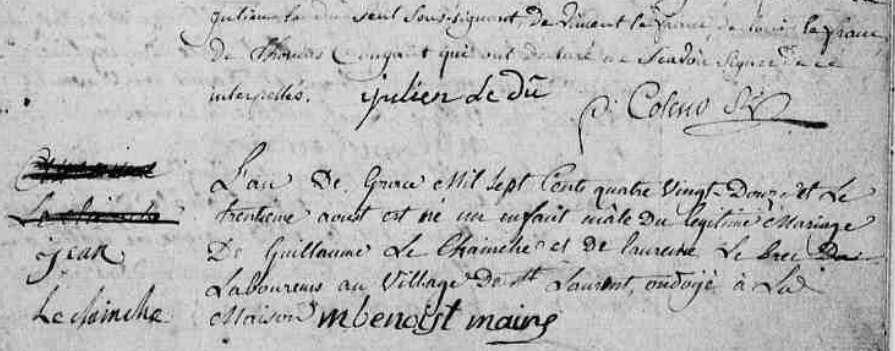
Le 22 septembre 1792, il prit donc à Quiberon son passeport pour l'Espagne (2) et cinq jours après le 27, s'y embarqua sur le chasse-marée la Sainte-Anne. Mais Dieu ne voulait pas de l’exil pour M. LE TOULLEC, il lui réservait un autre sacrifice ; les vents contraires ne cessant pas, force fut en effet au jeune prêtre de renoncer à son voyage, de reprendre terre et pour éviter les vexations, de se cacher dans son pays (3).
Pendant un an il y fit le bien, d'une main un peu rude, si l'on en croit la tradition, ce qui n'empêcha d'ailleurs ni l'estime ni même la vénération de l'entourer comme d'un voile qui le dérobait à ses ennemis.
(1) Registres de l'état-civil de Quiberon,
(2) Arch. dépt,, L. 1571, Extrait des registres de la municipalité de Quiberon.
(3) Arch. dépt., L. 1571. Extrait des registres de la municipalité de Quiberon, O, M. I. ) *
Pourtant il devait succomber.
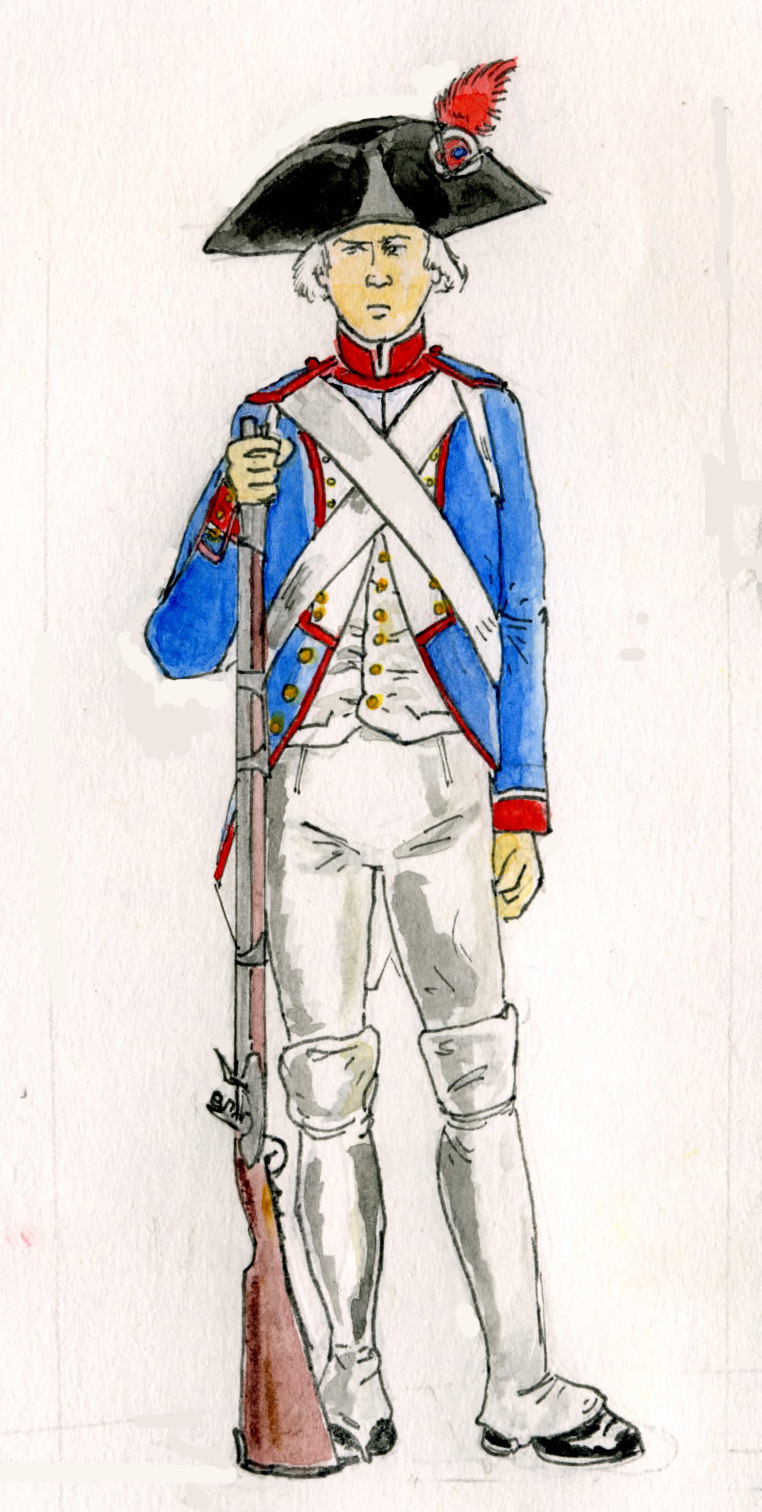 Une nuit, celle du 7 au 8 novembre 1793, comme il traversait la campagne, un fanal à la main [fanal = Feu ou lanterne placé(e) en un endroit élevé pour servir de repère ou de signal dans la nuit],, pour annoncer sans doute à ses pieux prosélytes quelque réunion religieuse, il tomba dans une patrouille bleue [Garde Nationale en uniforme bleue] qui ne manqua pas de s'en emparer. La scène se passa tout près du village de Keraud (l).
Une nuit, celle du 7 au 8 novembre 1793, comme il traversait la campagne, un fanal à la main [fanal = Feu ou lanterne placé(e) en un endroit élevé pour servir de repère ou de signal dans la nuit],, pour annoncer sans doute à ses pieux prosélytes quelque réunion religieuse, il tomba dans une patrouille bleue [Garde Nationale en uniforme bleue] qui ne manqua pas de s'en emparer. La scène se passa tout près du village de Keraud (l).
On jeta M. LE TOULLEC aux prisons d'Auray, puis à celles de Lorient, et, le 4 décembre, il comparut devant le Tribunal criminel séant en cette ville (2).
Chose curieuse, ce sanhédrin de guillotine et de sang se donnait la coquetterie de la légalité, et, quoiqu'il décidât, prenait soin, presque toujours, de s'appuyer sur des interprétations officielles de la loi.
D'abord il reconnut que M. LE TOULLEC n'avait prêté aucun serment et que dès lors il était manifestement atteint par la loi du 26 août 92. Seulement une difficulté surgissait pour son application, car elle venait d'être horriblement expliquée par la loi du 30 vendémiaire (21 octobre) qui condamnait, il est vrai, tous les insermentés à la peine de mort, mais dont l'article 14 portait : que l'ecclésiastique dans ce cas avait dix jours, après la publication ile la loi dans son département, pour se présenter devant les Administrations et demander qu'on le déporte. Or M. LE TOULLEC avait été arrêté le 8 novembre ; c'était bien près du 21 octobre, et partant ne convenait-il pas de demander au Département quel jour la loi avait été publiée à Vannes? Le Tribunal s'arrêta à cette solution et remit M. LE TOULLEC sous les verrous jusqu'à plus ample informé. Vannes consulté notifia que la loi du 21 octobre n'avait été promulguée que le 29 et alors le Tribunal, constatant que l'accusé n'avait pas eu dix jours pleins pour satisfaire à la loi, décida qu'il n'était point passible de mort, mais de déportation, 31 décembre 93 (1).
Jl) Arch. dép. L. 1571, Registre d'écrou de la prison d'Auray (Extrait).
(2) Arch. dépt., L. 1544. Sentence du Tribunal criminel da 14 frimaire lI.renvoyant l'affaire LeToullec jusqu'à plus ample înformé.
A la suite de cet arrêt, M. LE TOULLEC fut mis à la disposition du Département, qui, le 19 mars 1794, l'expédia à Rochefort par la Roche- Sauveur et Nantes (2). Nous savons, grâce au récit d'un confrère échappé aux horreurs des pontons, que, dans cette dernière ville, M. LE TOULLEC rencontra un convoi de prêtres Briochins, comme lui condamnés et auxquels il fut adjoint (3). Il ne devait plus s'en séparer. Car, avec eux, parvenu en rade d'Aix sur le Sphinx, il y tomba malade.
On le soigna avec humanité, affirme le confrère que je continue de citer; les chirurgiens du bord, fait digne de remarque, le traitèrent comme il convenait ; mais Dieu l'ayant trouvé mûr pour le ciel, l'appela à Lui dans sa miséricorde. M. LE TOULLEC mourut le 2 juin 1794. « Ses confrères lui creusèrent eux-mêmes son tombeau ; leurs mains le « descendirent dans la fosse. C'était la première fois « qu'ils mettaient les pieds sur cette île d'Aix qui « déposera à jamais contre les atrocités » qu'ils endurèrent. M. LE TOULLEC avait 32 ans.
En liberté dans notre District. Je m'empresse de vous informer que ce jour j'ai fait incarcérer le nommé Le Toullec, prêtre, qui nous a été conduit par une garde de Quiberon.
Il y a été saisi dans un champ pendant la nuit un fanal à la main. Sans doute ce fanatique cherchait ses prosélytes.
Mais heureusement il n'a rencontré que des sans-culottes qui s'en sont emparé. Je l'ai chargé sur le registre d'écrou des prisons de cette ville, en attendant que vous nous disiez ce qu'il faut en faire;
Arrestation de M. Le Toullec.
(Lettre du Procureur Syndic du district d'Auray au citoyen Procureur-général syndic du département du Morbihan).
Auray, 1 8 brumaire ILCitoyen, nous avons un contre-révolutionnaire de moins
(1) Arch. dépt. L. 1544. Sentence du Tribunal criminel du 11 nivôse u, condamnant M. Le Toullec à la déportation.
(2) Arch. dépt,, L. 862. Deux pièces.
(3) Bulletin de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord tome XLIX. 1911. Art. signé Le Masson.
Bibliographie :
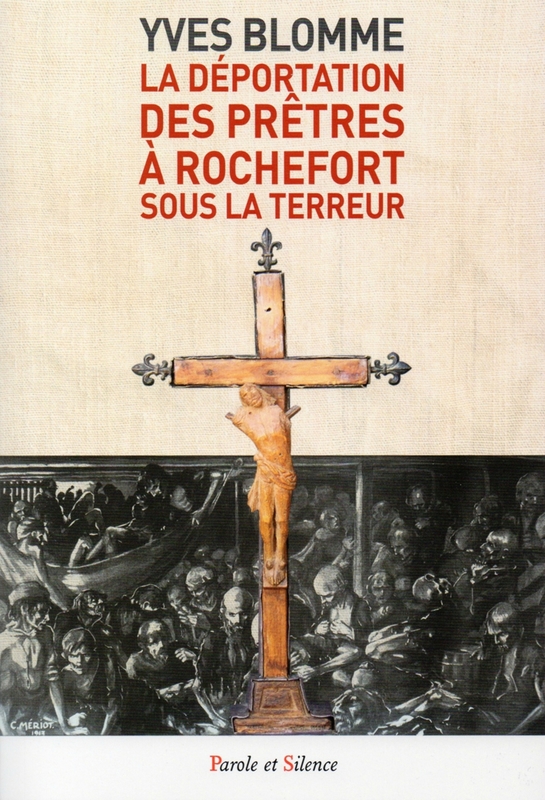
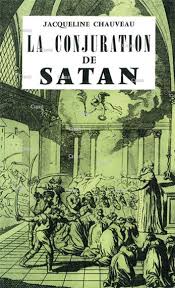
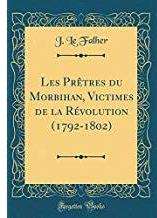
ALLANIOUX marin de dirigeable, 1887-1984
Merci à M. Jean ALLANIOUX à Gouesna'ch
Texte originel (et complété) généreusement transmis par M. Allanioux qui a souhaité faire partager sur wiki-sene, le parcours de son grand-père natif de Séné
L’histoire retrouvée du Grand-Père
Saisi au détour d’une conversation familiale, il y a de nombreuses années, j’avais cru comprendre que mon grand-père, Jean ALLANIOUX , avait fait son service militaire pendant la Grande Guerre, à bord de ballons dirigeables en tant que mécanicien.
Il s’est trouvé que le week-end dernier (14 août 2018) nous étions invités chez des amis normands et que nous sommes passés près d’Ecausseville.
Curieux de nature, nous sommes allés visiter le site, unique au monde, du hangar à dirigeables encore debout.
Lors d’une conversation avec le responsable, j’ai évoqué la situation présumée de mon aïeul et lui ai demandé si des archives existaient concernant les personnels navigants à cette époque.
Quelle n’a pas été ma surprise lors de notre départ, lorsque celui-ci me tendait un livre évoquant toute la chronologie des dirigeables de 1915 à 1937, dans lequel j’ai pu retrouver trace du passage de mon grand-père à cette époque et, surtout, une photo de lui datant de 1917.
Je remercie donc mes amis d’avoir pu concrétiser ce que je pensais être une sorte de rêve…
Pour illustrer cette histoire, hors du commun, voici donc les images qui nous replongent plusieurs décennies en arrière.
Pour plus d’informations on peut consulter la page internet consacrée au site :
http://www.aerobase.fr/historique/dirigeables.html
Jean Marie ALLANIOUX [14/01/1887 Séné - 26/10/1984] est bien natif de Séné et sa famille en cette fin de XIX°siècle vit à Bellevue. Avec un père maçon et une mère ménagère, rien ne le prédestinait à voler un jour sur un dirigeable.
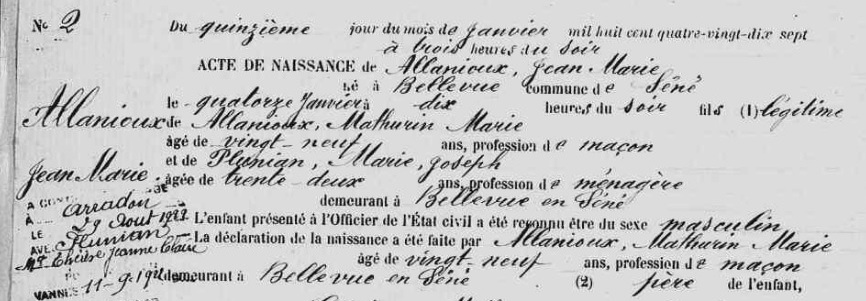
[voir sa fiche d'Inscrit Maritime à Lorient]
Au dénombrement de 1901, la famille apparait au complet. La mère est désormais cabaretière dans un des nombreux débits de boissons de Séné. La famille emploie la tante Allanioux comme serveuse.
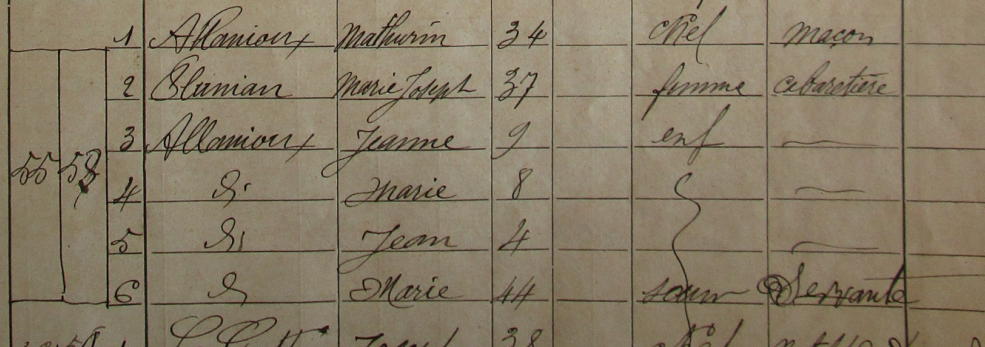
Au dénombrement de 1906, le père est désormais ostréiculteur et en 1911 patron ostréiculteur.
Quand la guerre éclate, il est trop jeune pour être mobilisé. Sa fiche de matricule nous indique qu'en 1915, il est engagé volontaire. On y apprend qu'il est matelot mécanicien de 2° classe puis quartier maître mécanicien. Rien n'indique son affectation dans une escadrille de dirigeables....
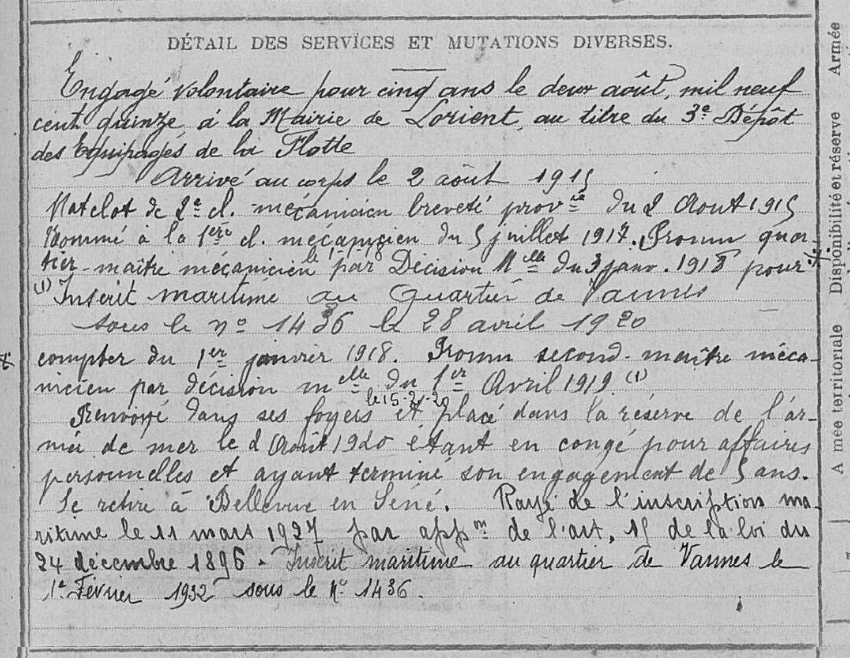
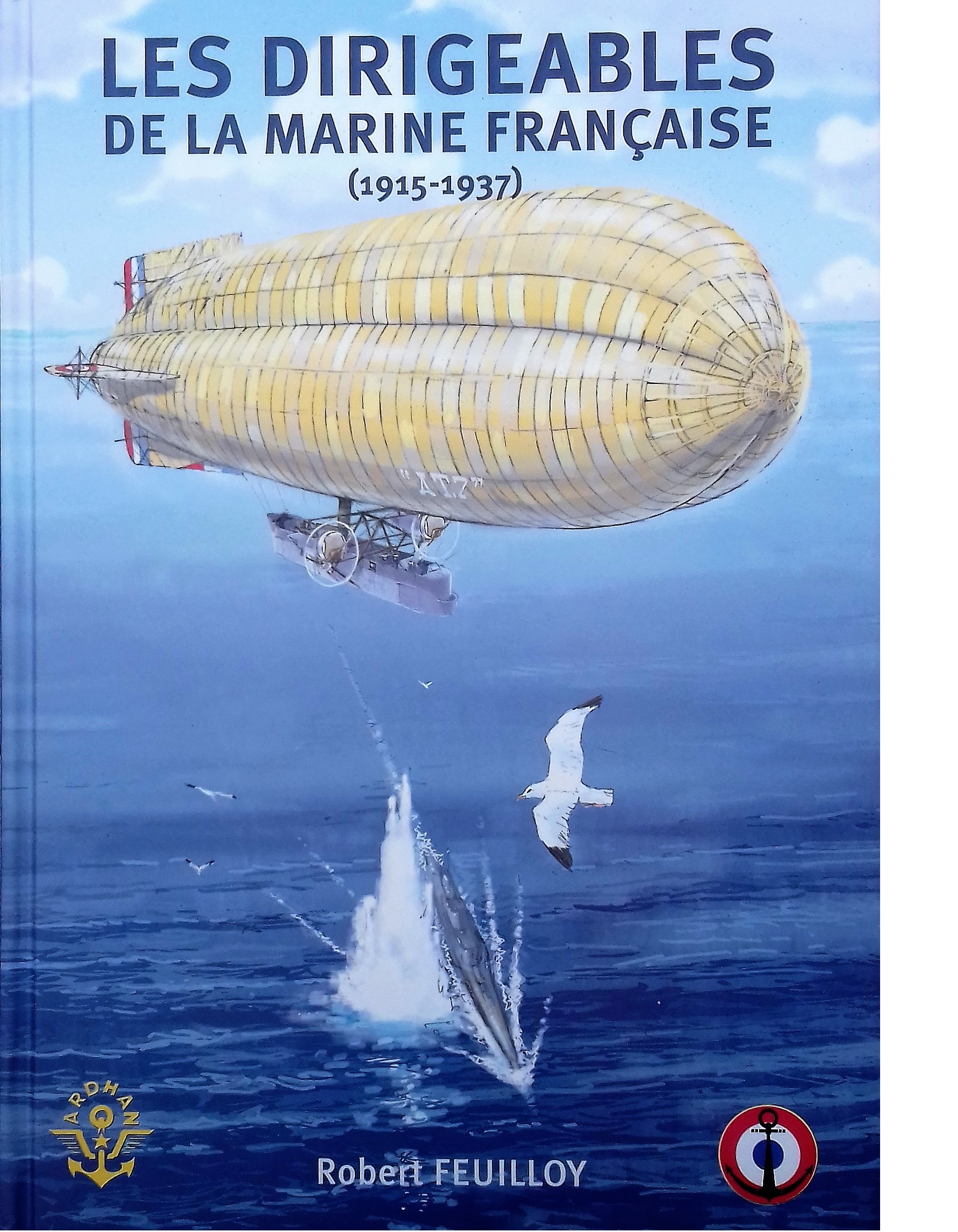
Dans son ouvrage intitulé "LES DIRIGEABLES DE LA MARINE FRANCAISE", Robert FEUILLOY nous rend compte de son énorme travail de recherhce sur cet aspect méconnu de la guerre de 14-18.
On peut être étonné du nom de l'ouvrage. Quand il s'est agit de monter des escadrilles pour de dirigeables, l'Armée a naturellement puisé dans le vivier des effectifs de la marines. L'ouvrage nous donne une liste précieuse des "marins" de dirigeables dans laquelle figure le Sinagot Allanioux.
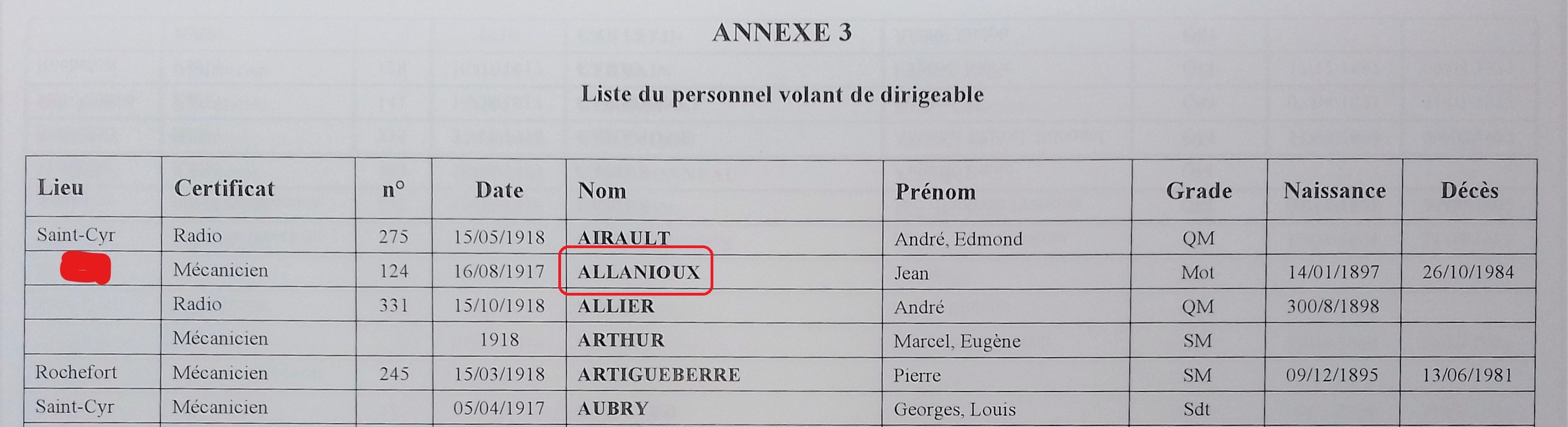
Cette photo montre le "marin" Allanioux avec son "équipage" qui emarquera sur le ballon dirigeable AT-4.
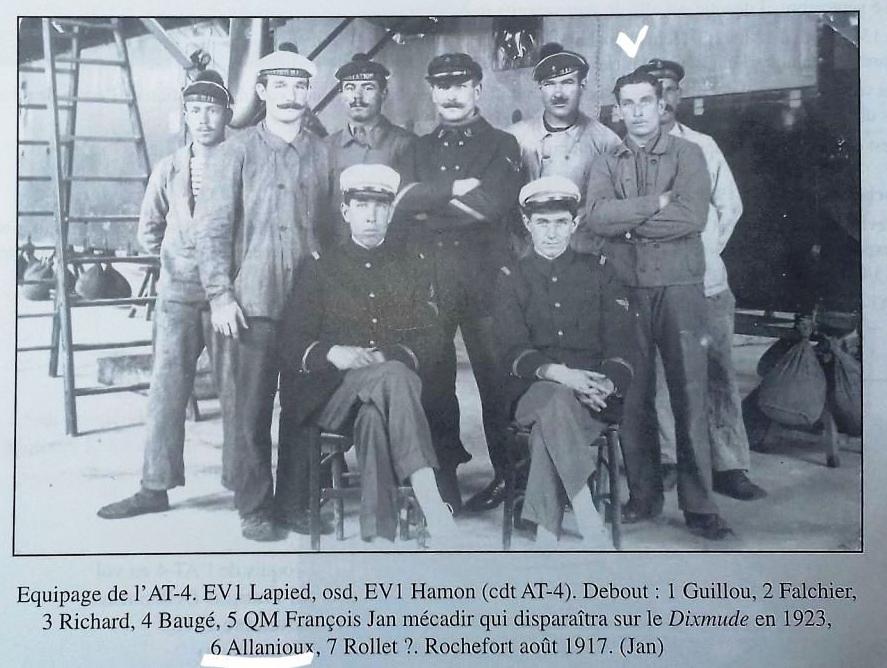
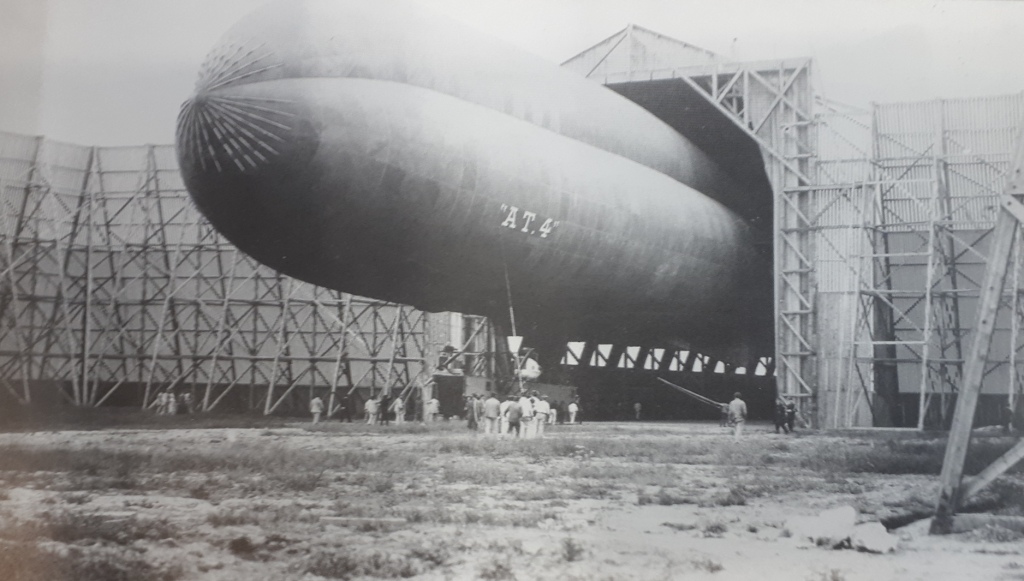
Après la guerre, Jean Marie ALLANIOUX revient à Séné auprès de sa mère veuve, qui désormais est ostréicultrice, comme l'indique le dénombrement de 1921.
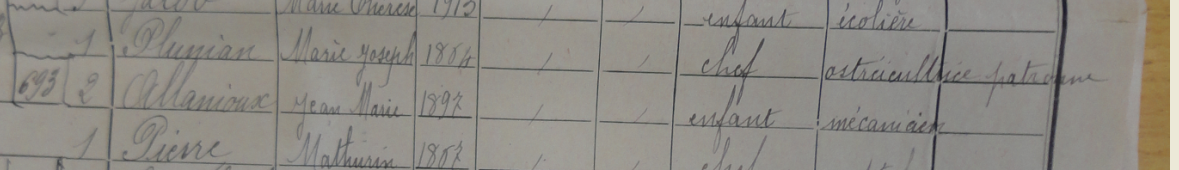
En 1922, Jean-Marie ALLANIOUX se marie en Arradon avec Marie Thérèse Jeanne Claire PLUNIAN. Il s'est installé à Quimperlé comme mécanicien général et par la suite comme ostréiculteur a Arradon. Il sera mécanicien aux Chantiers Dubigeon à Nantes et prendra sa retraite à Lorient. Il décède à l'âge de 87 ans en 1984.
Plus...
Pierre LE NEVE, recteur 1673-1749
Ce texte est paru dans le bulletin paroissial Le Sinagot alors dirigé par l'abbé Joseph LE ROCH. Je me suis contenté d'ajouter des illustrations et un extrait du livre du chanoine MENE.
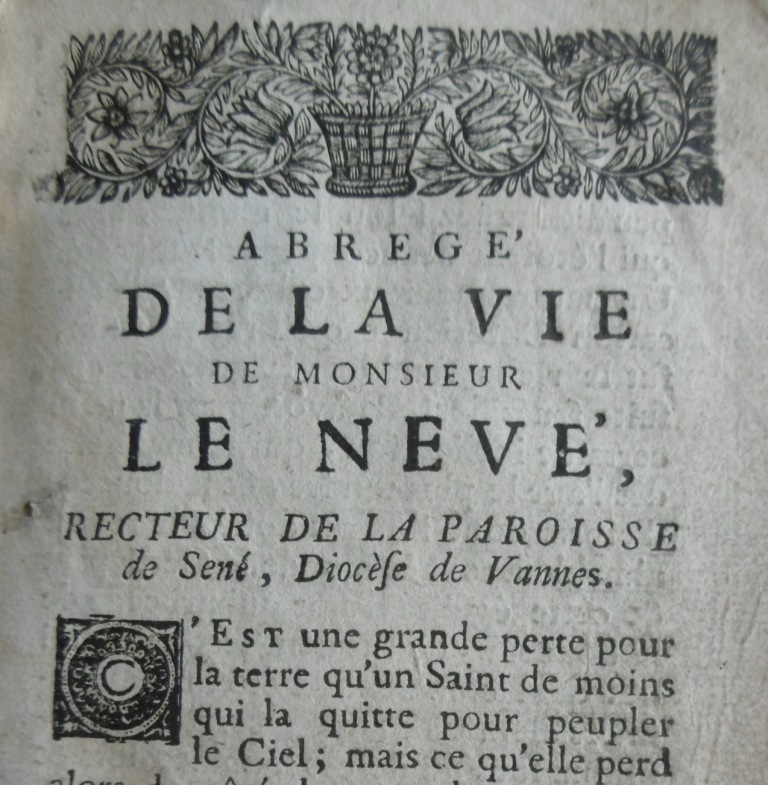
L'abbé LE ROCH reprend un vieux document intitulé "ABREGE DE LA VIE DE MONSIEUR LE NEVE RECTEUR DE LA PAROISSE de Séné, Diocèse de Vannes. Il s'agit d'un vieux livret, écrit en français du XVIII°, et qui fut retranscrit manuellement par un homme d'église non identifié à ce jour.
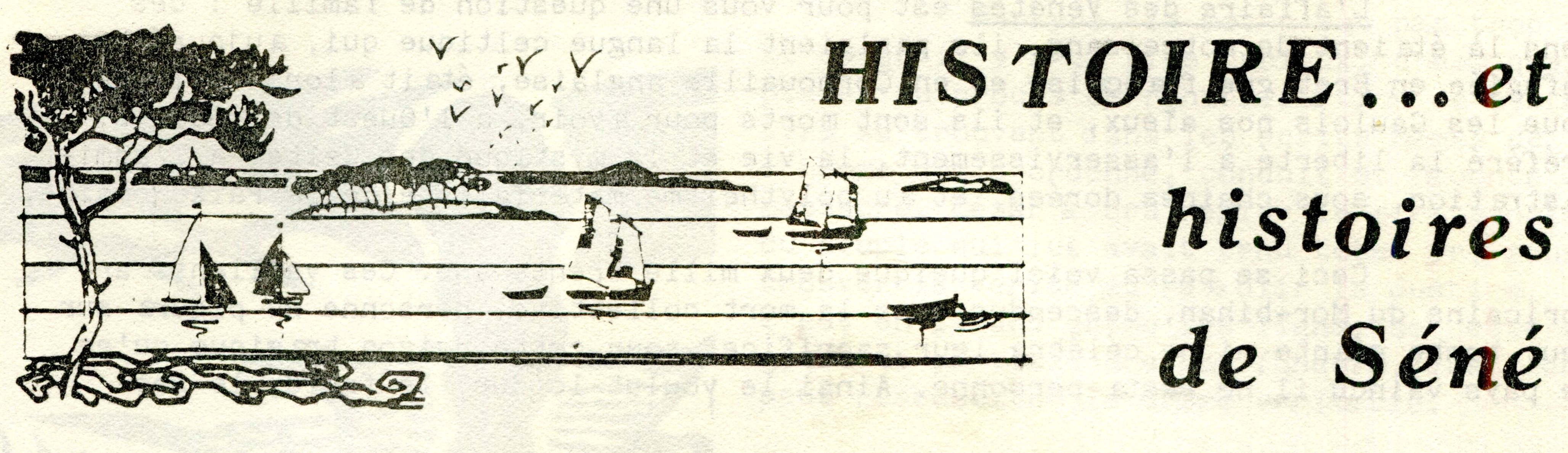
MON CURE CHEZ LES PAUVRES : L’ABBE LE NEVE
RECTEUR DE SENE AU DIX-HUITIEME SIECLE
De l’Antiquité à l’époque la plus moderne, toute l’histoire du Golfe est littéralement semée de traces religieuses. De quelques côté que l’on se aborde sur ses rives, à l’Ile aux Moines ou à Er-lannik, à Gavrinis ou au tumulus d’Arzon, toujours, tout de suite, une ombre plane, celle du christianisme ou de la religion druidique qui l’a précédé sur cette terre sacrée entre toutes.
Les épisodes de l’Histoire de l’Eglise particulières à cette contrée, beaucoup sont connus, d’autres peut-être moins. De passage à Séné, à bord des sinagots, j’y relèverai un témoignage particulièrement digne d’attention, si longtemps il demeura populaire, et encore n’est-il pas oublié : la vie admirable de l’abbé Pierre LE NEVE, [24/11/1673 Tréffléan - 23/09/1749 Séné] recteur de la paroisse au dix-huitième siècle, mort en odeur de sainteté.
ETUDE ET PIETE
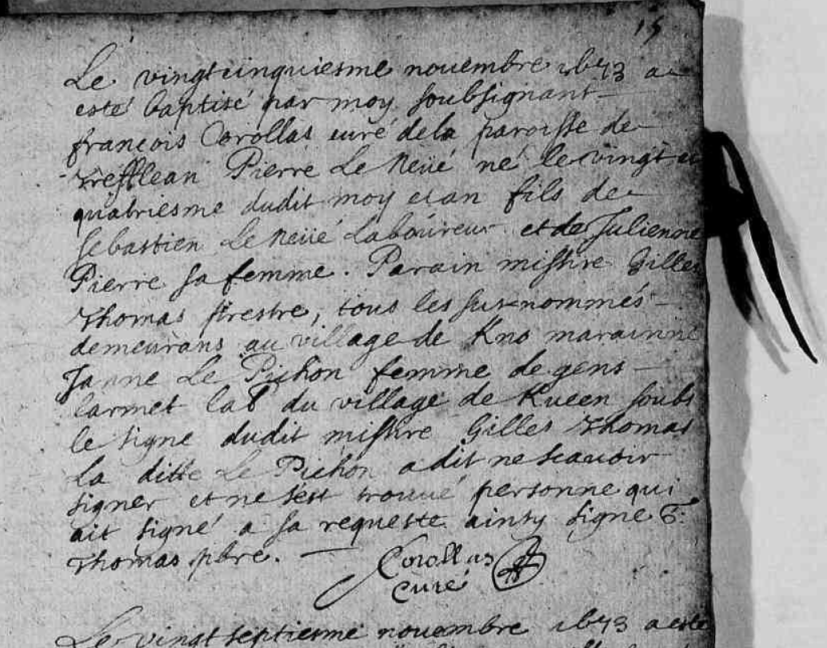
Pierre LE NEVE naquit le 24 novembre 1673, au village de Kno [vraisemblablement Kerno], en Treffléan, « de parents peu distinguées selon le monde, mais qui l’étaient beaucoup par leur piété ».[une famille de laboureurs, selon 'acte de naissance ci-dessus]
La main de Dieu était visiblement sur lui. Rien de puéril ne l’amusa. Goûter les mystères divins, s’en entretenir avec complaisance, témoigner l’empressement le plus vif à se les faire expliquer, apprendre par cœur les hymnes sacrées et les cantiques, s’en bien remplir, les chanter avec joie, et inviter ses condisciples à les chanter avec lui, voilà quels furent les délassements de ce pieux enfant, dès l’âge tendre, dont la dissipation, les ris, les jeux, sont communément l’unique partage.
On ne s’étonne donc pas que sa jeunesse fut particulièrement studieuse, appliquant son esprit à la science, autant que son âme à la piété. Ses années de séminaire furent débordantes de bonnes œuvres, gardant si peu de mesure dans son zèle, qu’il s’enflamma le sang, et voilà qu’au moment de passer les examens des Saint-Ordres, il avait les humeurs si irritées, couvrant son visage de pustules, que M. le grand Vicaire, le prit pour un homme adonné à la boisson, et il fallut attendre à l’abbé LE NEVE, l’Ordination suivante pour que justice lui soit rendue : Dieu éprouve les siens.
CURE DE SAINT-PATERN
Après quelques années de prédications, enthousiasmant les foules de sa parole, il est nommé curé de Saint-Patern de Vannes, toujours aussi actif, aussi charitable, mais surtout près des pauvres et des malheureux. Après qu’il fut mort, sa sœur a rapporté sa surprise, de voir plus d’une fois disparaître ses vêtements, son linge, ses provisions. Et l’abbé de lui répondre :
- ma sœur, les pauvres souffrent et vous avez de toute abondance.
A son père qui lui avait transmis de l’argent à changer, il écrivait le moment voulu de retourner la somme : "Consolez-vous, je vous en ai fait un trésor dans le ciel, et une échelle pour y monter ; je l’y ai fait passer en votre nom par les mains des pauvres…"
Ses malades, il les visitait toutes les semaines, faisant lui-même le lit et balayant la chambre. Selon les tempéraments auxquels il s’adressait, il savait user de patience et d’humilité, de fermeté et de courage. Un jour, il descendit en personne dans un lieu de débauche, pour en arracher une jeune fille qui se livrait aux plus vils excès.
Douze ans plus tard, la paroisse de Séné, alors plus considérable qu’aujourd’hui, et déjà elle est loin d’être sans importance, vient à vaquer. Monseigneur Fagon, évêque de Vannes, y nomme l’abbé LE NEVE. Tout le monde applaudit à ce choix, sauf l’intéressé, tant il se fait une haute idée de cette charge et qu’il s’en croit indigne, et pour l’obliger d’accepter, il lui fallut la crainte de résister à Dieu lui-même.
UNE CURE QUI N’ETAIT PAS UNE SINECURE
Elle n’était pas une sinécure, la cure de Séné, chez un peuple composé uniquement de matelots et de pêcheurs, gens grossiers et ignorants – de ce temps-là…- dont la raideur et l’indocilité avaient plus d’une fois été un écueil pour ses prédécesseurs. Lui, très vite, conquit son monde, entrant dans tous les besoins, sensible à toutes les peines, soulageant tous les maux, se faisant comme Saint-Yves, l’avocat des pauvres, comme Saint-Louis, le juge du procès, apportant souvent la caution de la somme disputée.
Autant il était bon, autant énergique, ne ménageant pas ses ouailles du haut de la chaire : « Grand Dieu, s’exclamait-il, ils voudraient qu’on leur parlât avec plus de réserve, et qu’ils vous outragent sans ménagement,. Je n’ai que l’enfer à leur montrer, et ce sera immanquablement, s’ils Vus offensent toujours, leur partage. Mon Dieu, parlez Vous-même à ces cœurs de pierre… ». Là-dessus, voilà qu’éclate un orage affreux, et à l’effroi succède la grâce dans les âmes.
Ce zèle fut si visiblement fécondé qu’en peu de temps, rapporte la chronique, les meours publiques se reformèrent, de grands désordres furent abolis, le libertinage s’éloignan et Séné devint le modèle des paroisses voisines, à telle enseigne, « qu’on distinguait ses habitants à certains air de décence et de modestie qui les accompagnait partout… »
Une parallèle à dresser avec Cucugnan….
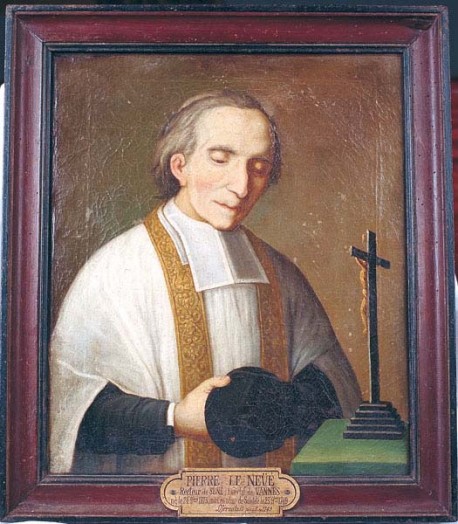
Portrait de l'abbé Le Névé [24/9/1673-23/9/1749]
peint par Jean Vincent LHERMITAIS (1700-1758).
Peinture à l'huile sur toile 40x33, de 1749. Réf PM56001231
BENEFICES
Quand on eût fait faire des Salines à Séné, elles produisirent bientôt une augmentation considérable des revenus du Chapitre de l’Eglise de Vannes et du propre bénéfice de la paroisse. On en félicitait quelquefois le curé, comme d’un grand avantage, et c’en était un en effet, qui devait vraiment lui faire plaisir.
Mais dès que ses habitants n’en profitaient point, qu’ils en souffraient même quelques préjudices, il s’en attristait au contraire et s’en plaignait comme d’un vrai mal.
- Hé ! Où iront-ils, les pauvres fens, disait-il alors, où irontils faire paître leurs bestieux, et qui leur donnera du fourrage ?
- - Mais vous en profiterez, M. de Séné ! lui répondait-on.
- - Oui, oui, j’en profite ! Beau profit vraiment : on donne à ceux qui possèdent, et on ôte à ceux qui nepossèdent pas.
- Quand au lieu des sels, dont il devait percevoir la dîme – le Chapitre lui proposa un abonnement où il y avait certainement à gagner pour lui, puisque jamais il n’aurait pou espérer, pendant sa vie, profiter sur le sel en essence à proportion de ce qu’on lui offrait en argent, la crainte seule d’engager ses successeurs, de leur occasionner dans la suite quelques domage, et aux pauvres par conséquent, lui fit rejeter cette avance quelqu’avanteuse qu’elle lui fût personnellement.
- Ce n’était point par le plus ou le moins de revenu, mais par le plus ou le moins d’actions héroïques qui’l estimait son Bénéfice.
Un jour, Monseigneur Fagon, lui en demanda la juste valeur . "Autant que votre Evêché, Monseigneur", répondit-il spirituellement. Il vaut le paradis ou l’enfer…
Toute sa vie, l’abbé LE NEVE mena une existence des plus austères. Il ne dormait guère, même la nuit, la passant en prières ou assis sur une chaise de paille lorsque le sommeil l’accablait. Et on a cent fois remarqué que lorsqu’on venait le chercher pour les malades, il paraissait à l’instant même tout habillé, et en état de porter aussitôt les secours nécessaires.
Ses repas, qu’il prenait ordinairement assez tard, demeurant souvent avec son confessionnal jusqu’à deux ou trois heures de l’après-midi, et toujours à jeun, consistaient en une mauvaise soupe de choux ou de quelques autres légumes grossier. Jamais ni viande, ni poisson, ni vin, malgré qu’il en avait, et qu’il était même jaloux qu’il fut si bon ; mais c’était pour servir aux étrangers qui le venaient voir, et pour fortifier les malades à qui il en portait chaque jour.
Ainsi arriva-t-il aux portes de la mort. Epuisé de fatigues et de privations il tomba malade une première fois en 1746, et se rétablit jamais complètement. A peine commençait-il à se sentir un peu mieux qu’il redoublait d’entrain et de courses d’une extrémité à l’autre de sa paroisse. Pendant sa messe, vers les derniers temps il défaillit plusieurs dois tant il était exténué. Une attaque de paralysie le retint définitivement à sa chambre et il se lamentait d’être inutile et à la charge de tous. Quatre mois il agonisa, exemple vivant de résignation et d’humilité. Le 20 novembre 1746 à onze heures du soir il rendait le dernier soupir à la veille de ses 73 ans.
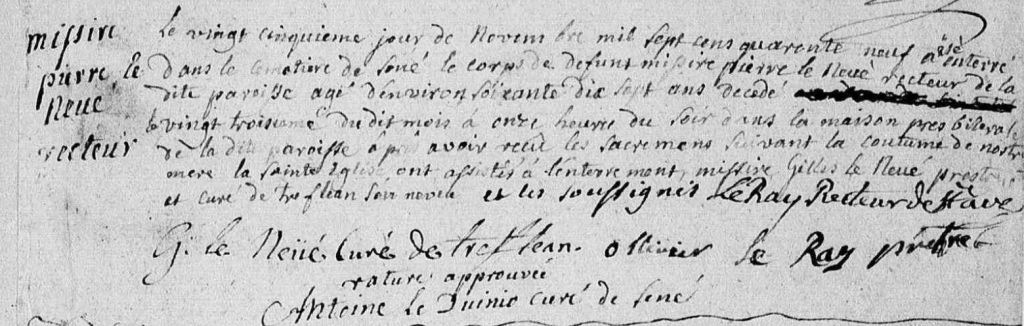
De toutes parts, on accourut à Séné, tant la sainte réputation du défunt était grande. La foule était si dense qu’après des peines infinies pour parvenir jusqu’au presbytère, une personne respectable assura qu’elle avait été forcée de demeurer trois quarts d’heure jusqu’au pied de l’escalier sans pouvoir gravir une marche. Tous voulaient des reliques, on lui coupa les cheveux, les sourcils, la soutane, jusqu’aux habits sacerdotaux dont il était revêtu.
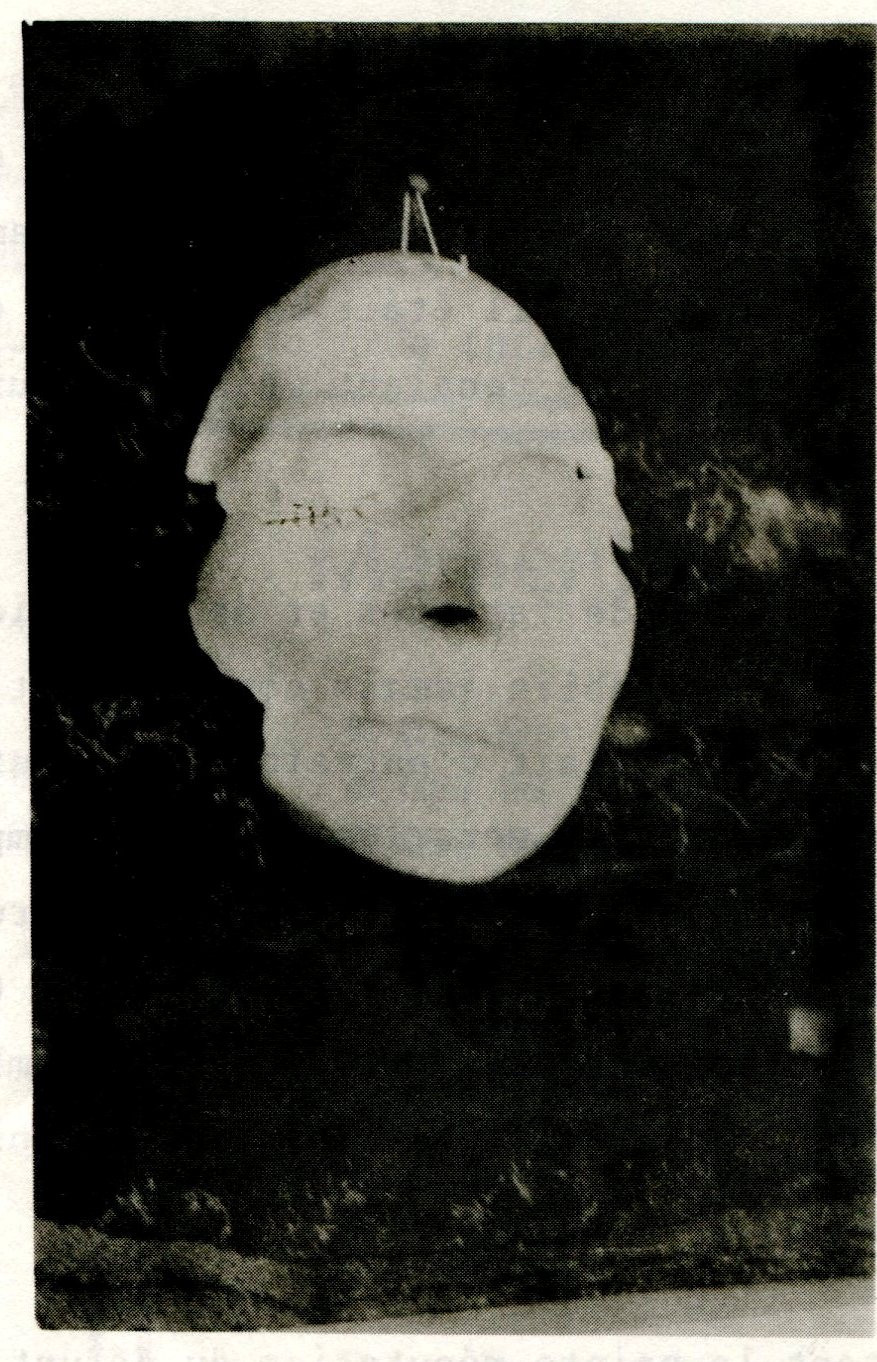
Masque mortuaire en cire de l'abbé Le Névé.
Pour satisfaire à la dévotion publique, on dut le porter à l’église, toutes les portes demeurèrent ouvertes et du jeudi au mardi elle ne se désemplit pas. C’était à qui trouverait à ses funérailles, non pour l’assister de prières, mais pour implorer le secours des siennes.
A deux siècles de distances bientôt, la mémoire de l’abbé LE NEVE n’est pas éteinte. Plus d’un foyer à Séné conserve pieusement l’image de ce « pasteur exemplaire, pieux et charitable, lumière du peuple, père des pauvres et des misérables’ dit l’épitaphe gravé sur son tombeau.
Son souvenir le plus rare, c’est encore « l’abrégé de sa vie », d’auteur anonyme mais que l’on sait être un vicaire de saint-Patern qui le dédia "à Messieurs les Recteurs du Diocèse ».
C’est une petite plaquette de 60 pages imprimée « avec approbation et permission » en l’an de grâce 1751 « à Vannes chez veuve de Guillaume Le Sieur imprimeur de Monseigneur l’Evêque, du Clergé et du Collège près la Retraite ». Sur la page de garde, une image du vénérable curé « gravée par J. Bonleu à Vannes ».
(Extrait de la très intéressante brochure de Michel de Galzain : MARE NOSTRUM)
Suit un extrait de l'Histoire du Diocèse de Vannes par le chanoine MENE :
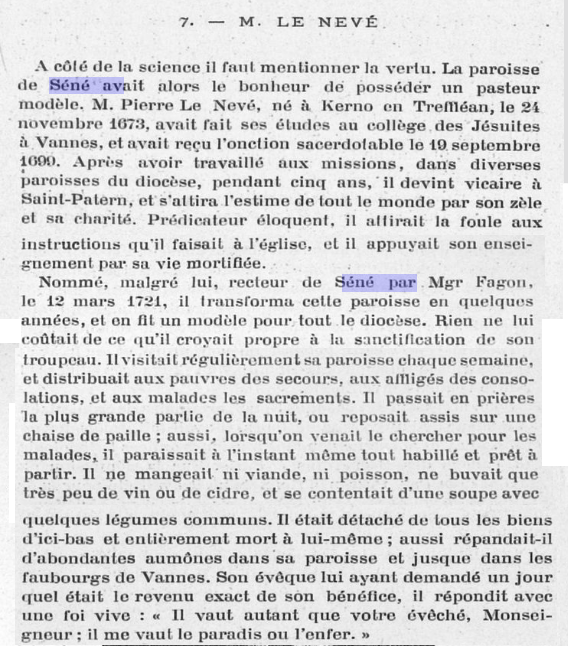
Lors de la reconstruction de l'église de saint Patern au bourg, le vieux cimetière qui entourait l'ancien édifice fut réformé. Les autorités religieuses et civiles de l'époque transférerent symboliquement la tombe de Pierre LE NEVE dans le nouveau cimetière.

Vitalien LAURENT, prêtre érudit (1896-1973)
En consultant la base "Persee" qui répertorie des études scientifiques, en tapant Séné comme mot clef de recherche, on découvre un tas de publications d'un homme d'église né à Séné, le père Vitalien LAURENT, de son vrai nom, Louis Olivier Philippe LAURENT.
En regardant bien sur wikipedia, la page de Séné, parmi les personnalistés attachées à notre commune figure Vitalien LAURENT;
On est intrigué et on poursuit les recherches pour vérifier l'identité de la personne. Il s'agit bien du fils de Louis Joseph Adolphe LAURENT, laboureur à Kernipitur et qui fut maire de Séné de 1901 à 1907, comme nous l'indique son acte de naissance et l'extrait du dénombrment de de 1901.
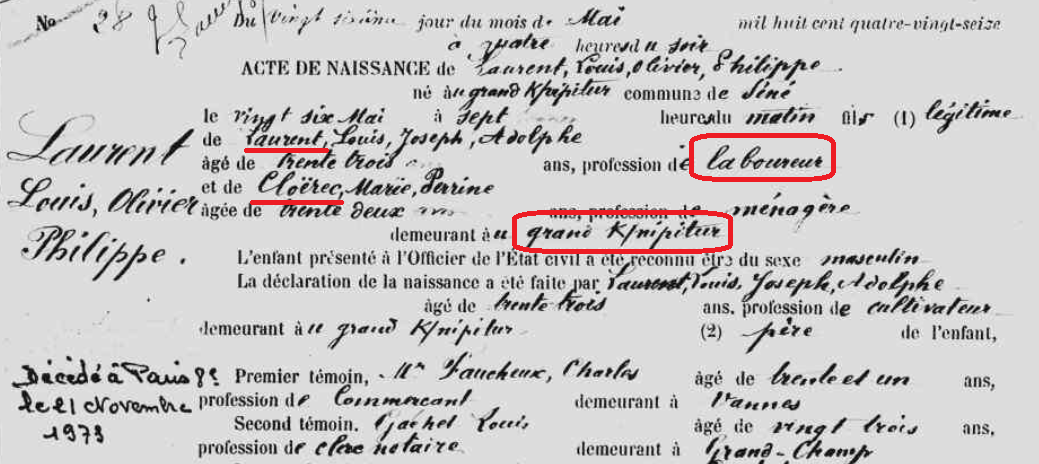
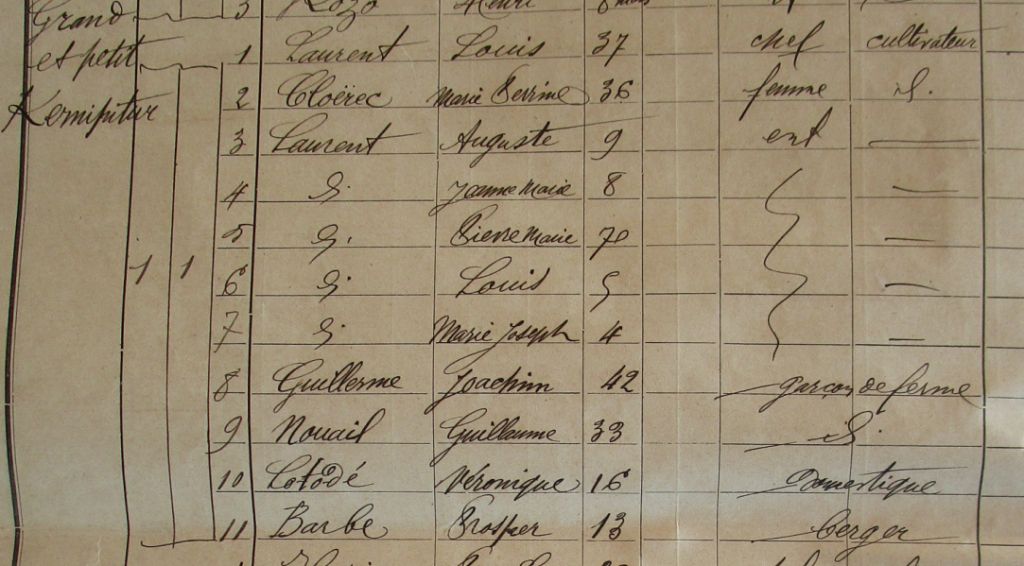
Qui était ce chercheur, cet historien auteur d'autant de publications et natif de Séné ?
Notre commune compte peu de "gens célèbre" pour qu'on ne s'attarde pas sur lui.
Article repris du site : www.assomption.org/fr complété et illustré.
Vitalien (Louis-Olivier-Philippe) LAURENT - 1896-1973
Dans la mêlée, 1947. « J'ai rencontré pour la première fois le Père Vitalien LAURENT au début de 1947, lorsqu’il put sortir de Bucarest pour reprendre contact avec les centres. Pendant que j'allais prendre la faction avec le Père Janin, il séjourna quelques mois en France. Un rapport daté du 5 juin 1947, après son retour à Bucarest, évoque la possibilité d'établir en Roumanie une Faculté de Théologie, voire une Université Ecclésiastique. Dans ces vues généreuses et ces vastes perspectives transparaît le contact d'une reprise de contacts avec le Père Gervais Quenard, toujours ouvert aux projets optimistes. Hélas! la roche Tarpéienne était toute proche et précipita les trois byzantins dans les caves du Ministère de l'Intérieur, en attendant leur expulsion 'volontaire' du sol roumain. La veille venait d'arriver le Père Emile Jean qui tomba juste à temps pour garder la maison avec le frère Petru. Disons aussi que deux jours auparavant, les commissions d'armistice occidentales venaient de quitter la Roumanie et que nous étions donc à la merci des indispensables recyclages démocratiques. Témoignage du Père Jean Darrouzès sur le P. Vitalien.
Biographie Religieux de la Province dite de France (exO.C.F).
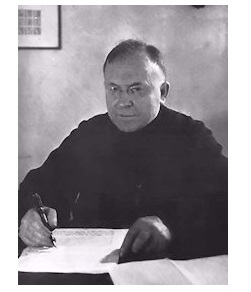
Une Formation entravée par la première guerre mondiale.
Né le 26 mai 1896 à Séné (Morbihan), Louis- Olivier-Philippe LAURENT, après ses classes primaires à Saint-Joseph de Landernau (1905-1909), entre à l'alumnat du Bizet, en Belgique, en 1909, puis à Taintegnies en 1912. La guerre le bloque au Luxembourg de 1915 à 1918.
[La famille Laurent place le jeune Louis en pensionnant à l'âge de 10 ans à Landerneau. Son père Jospeh Laurent, décèdera à Séné en 1907]
Ayant pris l'habit à Limpertsberg, le 14 septembre 1913, sous le nom de Frère Vitalien, il y étudie la philosophie à défaut de pouvoir faire un noviciat canonique.
[Choisit-il le prénom de Vitalien en souvenir de la chapelle Saint-VitaI sur l'île de Boëd, dont il ne reste que la statue?]
l rejoint Louvain en 1918 où son admission dans la Congrégation est enregistrée le 11 février; après un séjour de trois mois à la caserne de Saint-Malo, il passe l'année 1919-1920 à Taintegnies où il est reçu à la première profession, le 23 octobre 1919. Profès perpétuel à Louvain le 6 janvier 1923, il y étudie la théologie (1920-1923), termine sa formation à Kadi- Keui (1923-1924) et est ordonné prêtre, le 27 juin 1924 à Istanbul.
Il est envoyé à Rome, à l'institut pontifical oriental (1924-1926) où il commence la rédaction d'une thèse sur le patriarche Jean Beccos, du XIIIème siècle, qui reste inachevée et ne peut être présentée au jury. Son peu d'empressement à cueillir des lauriers universitaires montre que dès cette époque le Père Vitalien se considère moins comme un simple élève que comme déjà un brillant chercheur et un érudit spécialisé très au fait de questions très pointues sur l'histoire chrétienne en Orient: études des documents grecs du concile de Lyon (1274), intention de rééditer l'oeuvre de Pachymère. Ses premiers compte-rendus critiques, dans les Echos d'Orient, dénotent une agressivité juvénile incontestable et une maîtrise de l'information peu commune. Ses relations avec Mercati et les religieux de la première équipe des Echos d'Orient, Vailhé, Petit, Jugie, Souarn, sa pratique assidue des manuscrits et des bibliothèques, une intelligence pénétrante jointe à une capacité de travail redoutable valent au Père Vitalien une notoriété incontestée dans de nombreux domaines: sources littéraires, épigraphie, sigillographie.
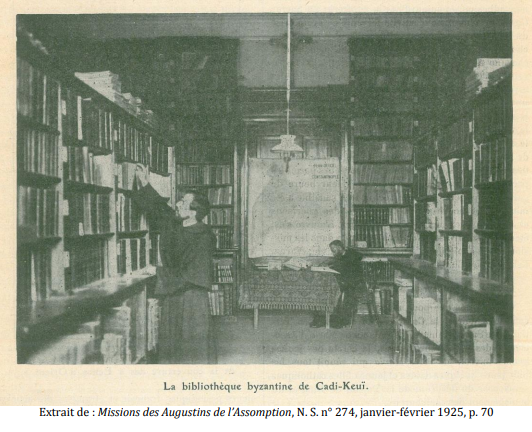
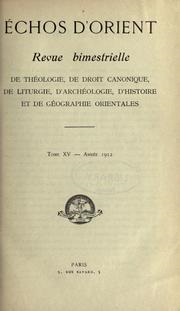
Une vie consacrée à la recherche, perturbée par la seconde guerre mondiale.
A partir de 1926, à Kadi-Keuï, la vie du P. Vitalien se confond avec celle de l'oeuvre des Echos d'Orient, devenue en 1938, à Bucarest, l'institut français d'Etudes byzantines. A trente ans, il assume la direction de l'entreprise et lui infuse une nouvelle vie. D'une grande acuité pour définir clairement les travaux et la méthode, le P. Vitalien est la riouvelle comète qui se lève sur l'horizon byzantin. La simple lecture de ses travaux d'érudition, sa participation à divers enseignements, ses conférences de haut vol, ses relations avec le monde universitaire en Roumanie, ne peuvent que susciter l'admiration de ses pairs, impressionnés par la qualité et la quantité d'un travail intellectuel conduit en autodidacte. Astreint à des tàches administratives par nécessité qui le surchargent, le P. Vitalien joue un rôle de résistant en Roumanie pendant la guerre au point d'être surnommé 'le chef des Gaullistes en Roumanie'. Il ouvre sa porte aux services anglais de renseignement après la fermeture de la Légation de Grande-Bretagne (1941), conserve un code de décryptage pour ses archives personnelles, prête un concours aussi discret qu'efficace à des activités d'un genre éloigné des préoccupations byzantines. Son bureau est celui de l'intelligence Service qui draine les informations sur les régions balkaniques en direction d'Istanbul: rapports, relevés de plans cartes militaires, tout est microfilmé par ses mains et expédié dans des boites d'allumettes à double fond, des paquets de cigarettes et des pots de crème de beauté pour lesquels il a un faible. On peut estimer que le régime d'Antonesco, allié du Reich pour récupérer la Bessarabie et la Bukovine, témoigne volontairement d'une grande mansuétude et ferme les yeux sur les activités d'ordre politique du P. Vitalien.
Expulsé du sol roumain en 1947 avec les PP. Grumel et Janin, l'Institut et son Directeur retrouvent pied à Paris. Les services des affaires étrangères français ramènent à Paris la précieuse bibliothèque byzantine (230 caisses). Maître (1958), puis Directeur de recherches au C.N.R.S. (1962), le P. Vitalien peut réaliser sa grande oeuvre, le Corpus de sigillographie, qui fait de lui le spécialiste incontesté de la numismastique byzantine.

La sigillographie est une science auxiliaire de l'histoire dont l'objet est l'étude des sceaux (en latin sigillum) et de leur emploi.
Compte tenu de la pénurie des ressources, de la rareté des collaborateurs, de deux déménagements (1938, 1947», on ne peut qu'être admiratif pour une oeuvre qui passe le temps. Peu porté au travail pastoral qui ne cadre pas avec les activités de la recherche, le P. Vitalien admet pour lui-même et pour ses collaborateurs des formes d'apostolat discret et personnel. Sa conviction est de réaliser sa vocation de religieux et de prêtre en se consacrant intégralement à une activité intellectuelle aux prolongements Oecuméniques prometteurs.
Le P. Vitalien meurt à Paris, dans la nuit du 20 au 21 novembre 1973. Il est inhumé au cimetière parisien de Montparnasse, dans le caveau de l'Assomption.
Bibliographie Bibliographie et documentation: B.O.A. mars 1975, p. 267. L'Assomption et ses (Euvres, 1974, n° 577, p. 14. Nouvelles de la Province de France, n° 22, janvier 1974, p. 25-28; n° 23, 23-27 et n° 24, 23-27. Catholicisme, VII, col 54-55. Revue des Etudes byzantines, t. XXXII, V-XIV (Renseignements sur l'oeuvre, les publications et l'activité du P. Vitalien comme Directeur des Echos d'Orient, puis de la Revue des Etudes byzantines et de l'Institut). Dans les ACR, du P. Vitalien Laurent, rapports sur l'Institut (1947-1964), les Echos d'Orient (1927-1935), correspondances (1919-1970).
1887, Ainsi se forge une légende !
Jean RICHARD, mémoire étourdissante de Séné, raconte dans son ouvrage intitulé "Au Pays des Sinagots" les mille et une péripéties judiciaires et maritimes des Sinagots pris souvent en flagrant déli de pêches non autorisée.
Parmi ces faits divers de pêches frauduleuses, celle du 25 mars 1887 est à marquer d'une croix par la conséquence judiciaire qu'elle eut à l'époque et parce quelle participa à cette légende de marins insoumis, fraudeurs et roublards vivant au pays des "voiles rouges et des choux pommés".
Lisez donc TOUTES ces coupures de presse d'époque. Les journalistes relatent avec bien plus de talent d'écriture que votre humble serviteur.
Bonne lecture.
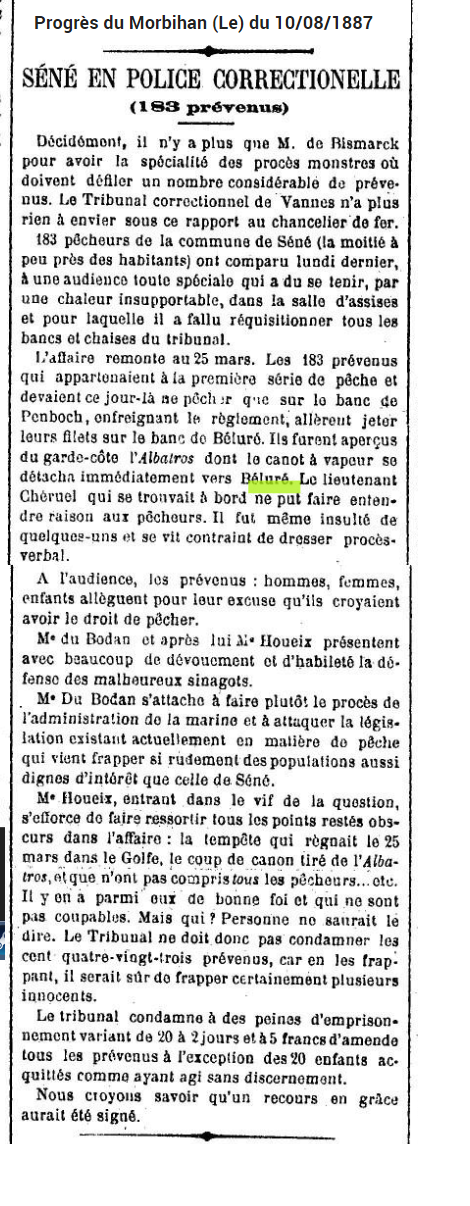
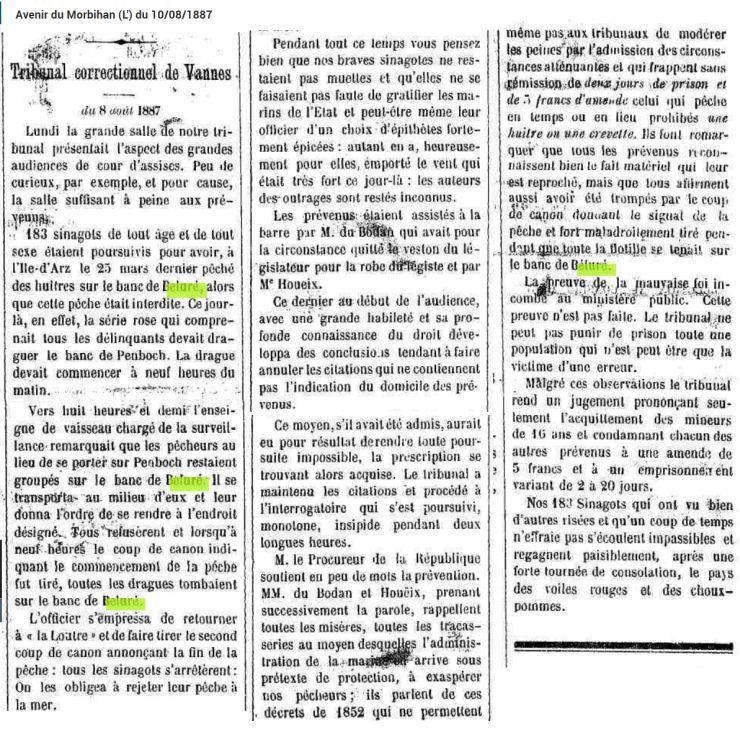
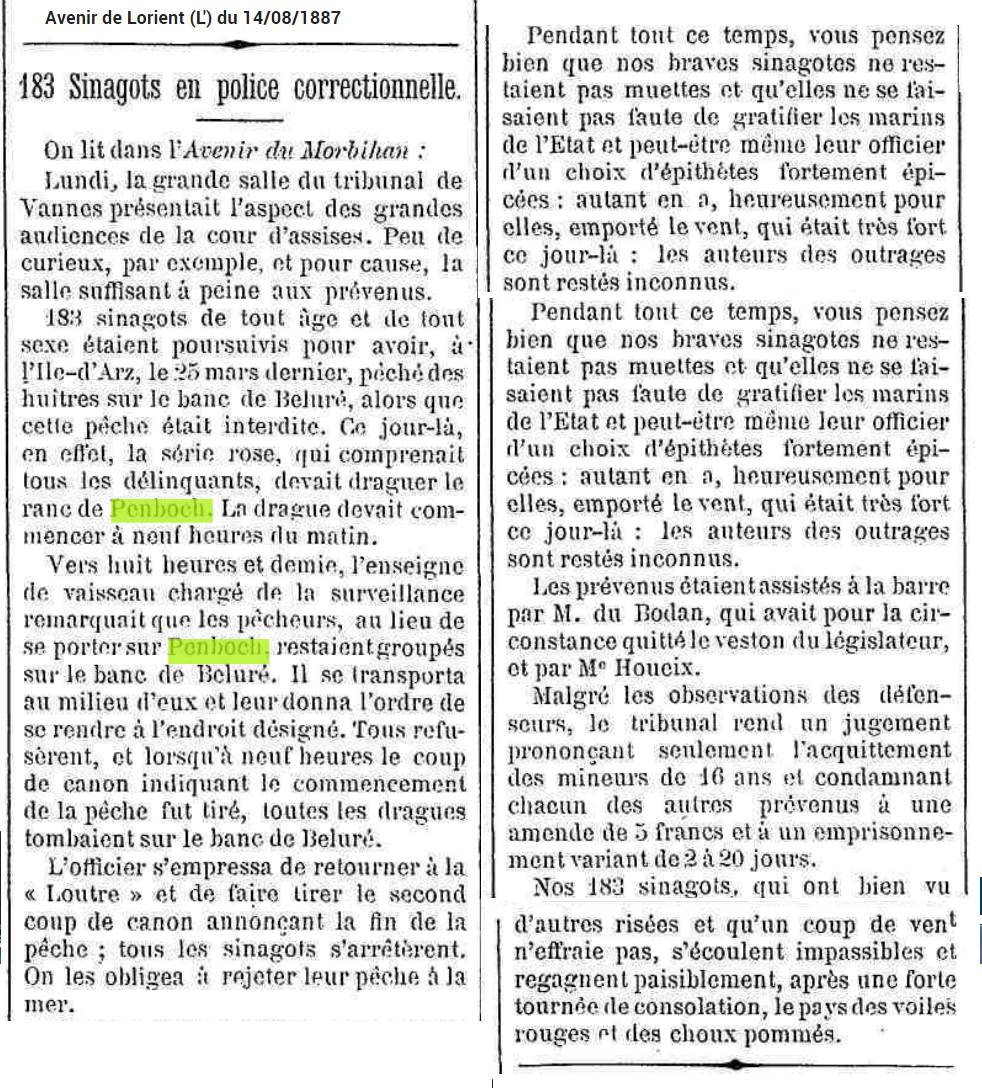
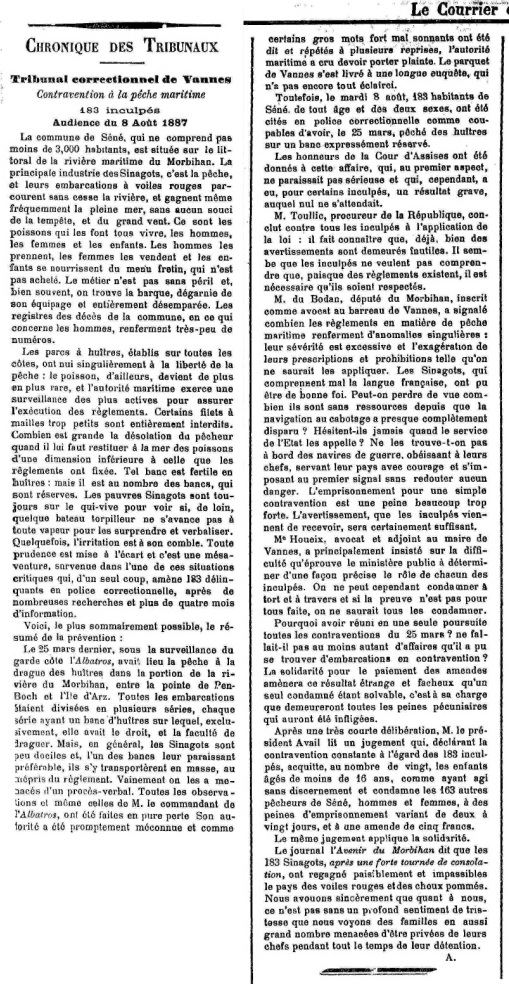
Cimetière : visite guidée
Un cimetière accumule des tombes comme autant de points finaux à des vies. Il n'y a pas que le Père Lachaise, célèbre cimetière parisien, à receler derrière une pierre tombale ou un caveau, une histoire ou un destin à raconter.
Notre cimetière communal date des années 1880, quand celui qui entourait la vieille église fut déplacé, pour laisser place à la future Eglise de l'architecte Deperthes. Ces plus vieilles tombes dates de cette période.
Légèrement surélevé par rapport à la rue de la Fontaine, on y accède sur son entrée principale, solennellement, par quelques marches et un portail en fer forgé. Le visiteur est rapidement surpris par l'étroitesse des lieux. Des allées étroites, des rangs serrés.
Avant les derniers travaux de l'hiver 2018, le visiteur ne pouvait pas manquer la croix monumentale adossée au premier mur de cloture, avant la première extension. Le goudron récent témoigne de son ancien emplacement.
Cette croix a été repertoriée par la DRAC de Bretagne. Durant l'hiver 2018, elle a été déplacée dans la plus récente partie ouest du cimetière derrière le colombarium. La pierre a été (trop) nettoyée et ce manque de "patine" enlève un peu de charme à cette croix et à son autel. Laissons faire le temps et la pluie qui lui redonneront dans quelques années son aspect "rustique".

Le visiteur qui fréquente quelques autres cimetières, notera l'absence de caveaux en hauteur ou de mausolées comme on peut en trouver par exemple au cimetière de Boismoreau de Vannes. A Séné, village de cultivateurs humbles et modestes pêcheurs, on se serre et dans un esprit grégaire, on ne construit que des caveaux enterrés n'offrant aucune prise au suroît, et parfois quelques tombes dans la terre, pour les moins fortunés des paroissiens...
Au fur et à mesure des reprises de concessions funéraires, les vieilles tombes disparaissent. Les morts d'hier sont oubliés et laissent place aux morts d'aujourd'hui. Pourtant, le visiteur attentif remarque quelques tombes particulières dont la pierre a été patinée par le temps et les inscriptions difficiles à lire.
Qui se cachent derrière ces tombes singulières ?
Quelles familles enterrèrent avec obstentation les êtres chers disparus ?
Les Rondouin, de Carentoir à Séné.
Trois tombes de pierre, tels des coffres posés, attirent le regard du visiteur. Quand on se penche, on lit difficilement le nom de Rondouin.
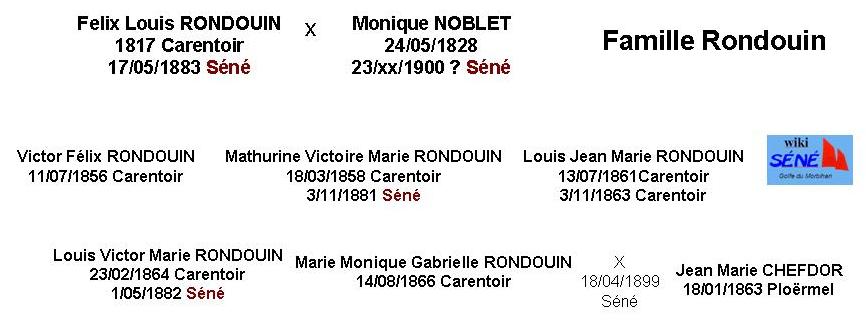
Quelques clics sur le site des archives du Morbihan et on établit la généalogie de la famille Rondouin, originaire de Carentoir. Le père Félix, fut buraliste au bourg de Séné comme nous l'indique son acte de décès. Au dénombrement de 1883, le buraliste a laissé une rentière, Mme Noblet et leur fille Marie Monique Gabrielle.
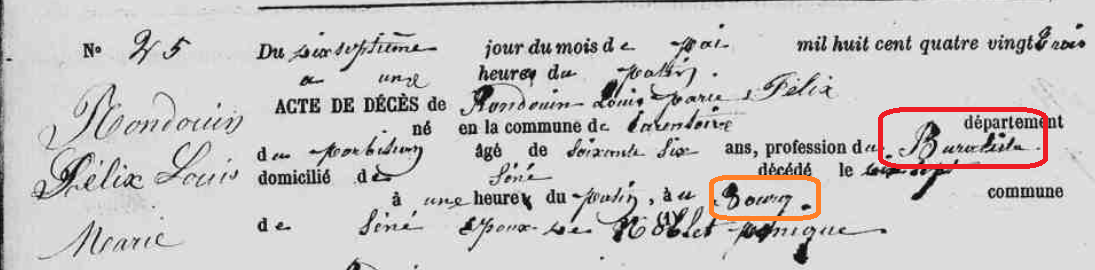
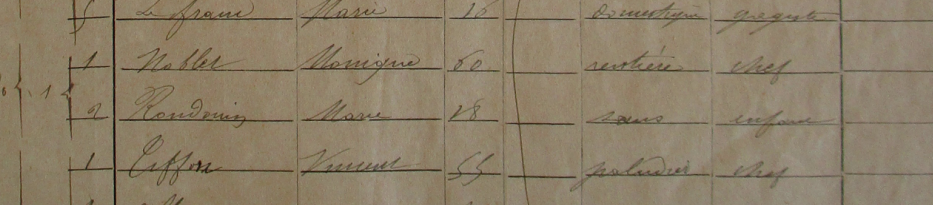
Propriétaires à Carentoir, qu'elles raisons poussèrent les Rondouin à venir s'établir à Séné pour occuper l'emploi de buraliste. Arrivés à Séné, les Rondouin furent meurtris par la mort de leur fille, Mathurine en 1881, à l'âge de 23 ans, puis par celle de leur fils Louis Victor à l'âge de 18 ans en 1882. Le père décéda en 1883. La famille choisit l'entreprise Lepinard, marbrier récemment installé à Vannes pour réaliser les sarcophages des enfants et ensuite du père.
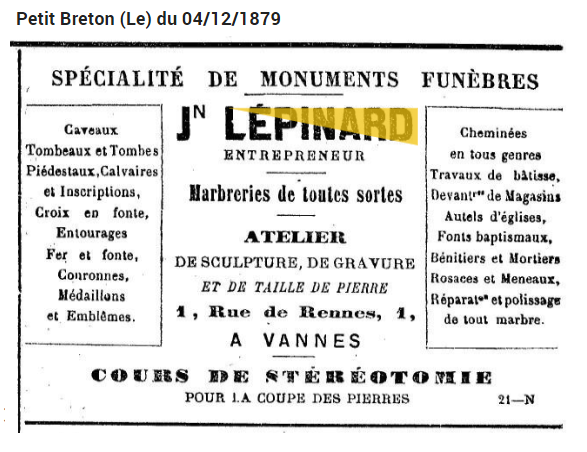
La veuve Rondouin put marier sa fille Marie Monique en 1899. Elle décèdera vers 1900 et repose auprès de son époux. Etrange et triste destinée que celle des Rondouin.
De Castillan, propriétaire du château de Bot Spernem.(lire histoire du château)
Louis Marie Joseph de Castillan naquit à Quintin, Côtes du Nord et mourut à Séné, sans descendance le 11 août 1891. Il a légué au cimetière une belle tombe qui parle encore de lui....
Les Chanu de Limur.
La famille Chanu de Limur arriva à Séné par mariage avec les descendants du Sieur Bourgeois. Lire article sur le château de Limur. Cette généalogie retrace les derniers membres de la famille ayant vécu à Séné. L'observation des pierres tombales et les recherches d'actes d'état civil permettent de confirmer que plusieurs membres de la famille Chanu de Limur choisirent Séné pour leur dernier repos.
En premier lieu, Jean François Marie Chanu de Limur, dont la Musée de la Cohue détient le portrait. Son premier fils, Charles achètera un hotel à Vannes, le futur Hotel de Limur. Son second fils, Paul Marie Dominique Maximilien et sa femme, Thomase Louise Augustine L'Héritier, demeurèrent sans doute à Séné, au château de Limur. Les époux reposent au cimetière de Séné avec leur fille, Pauline Marie Charlotte, dernière Chanu ayant vécu à Séné, comme nous l'indique le dénombrement de 1891.
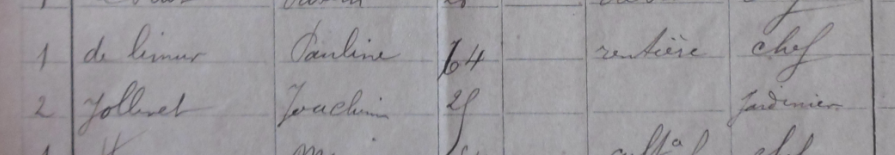
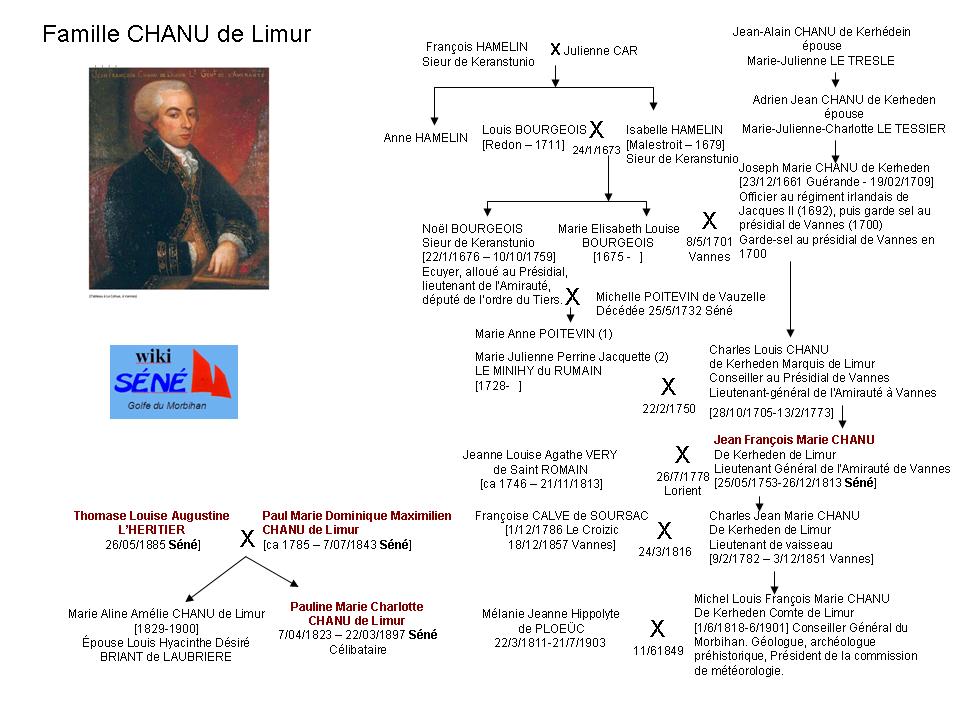 Des recteurs de Séné
Des recteurs de Séné
Aux côtés de ces familles issues de la noblesse d'ancien régime, on pourra également observer les tombes de trois recteurs de Séné. Celle de Pierre Le Névé [1721-1749], qui recueillit la dépouille du recteur François Marie Poezivara [1932-1956] et la tombe de Georges Le Buon [1877-1901],(Lire histoire des Recteurs de Séné), qui accueillit la dépouille d'Aimé Cappé, célèbre instituteur à bicyclette et défenseur acharné de l'école libre". (Lire histoire des Ecoles). Le dernière tombe, dont on lit difficilement le nom, est celle de Anne Marguerite Le Buon, soeur et dévouée servante de son frère, décédée le 18/09/1903 à Séné.

Des maires de Séné.
Enfin, le promeneur tachera de repérer dans l'entrelas de tombes, des personnalités liées à Séné.
Notre cimetière abrite les tombes de trois maires de Séné, Surzur, Le Derf et Uguen. Lire article sur les maires de Séné.
Des soldats de la Grande Guerre Morts pour la France.
Jean Marie Le Hay [7/07/1880 - 9/07/1917] et Eugène Marie Savary [27/04/1883 - 25/12/1917], deux Poilus natifs de Séné, décédés des suite de la tuberculose après la Guerre de 14-18, conservent encore leur tombes.
Armel Joseph Jean GIRARD
Il faut avoir l'oeil "patrimonial" pour trouver la plaque d'Armel GIRARD, soldat mort pour la France en 1916. Que fait cette plaque là au flanc de la tombe de la famille Girard?
Une recherche sur le site "Mémoire des Hommes" permet de retouver sa date de naissance et de décès.
De fil en aiguille, en surfant sur le site des archives du Morbihan et un site de genealogie, on finit par établir l"arbre généalogique dela famille Girard.
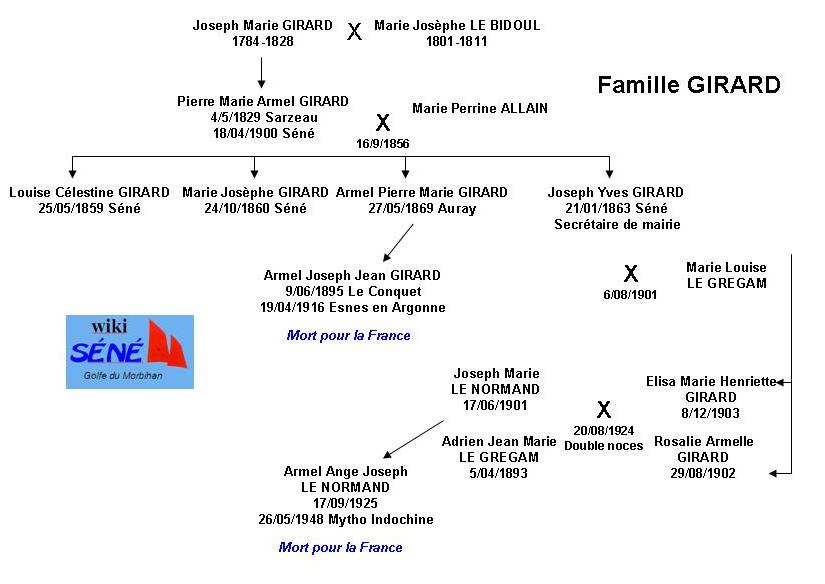
Ainsi, Pierre Marie Girard, douanier en retraite est venu finir ses jours à Séné, où il avait été en fonction autour des années 1859-1863, comme en témoigne le lieu de naissance de 3 de ses enfants. A Séné où vit son fils, Joseph Yves Girard, qui occupe le poste de secrétaire de mairie.
Le père de notre Poilu Armel Joseph Jean, Armel Pierre Marie était né à Auray. Sa fiche de matricule nous indique qu'il fut d'abord serrurier, avant de s'engager dans l'armée. Au retour à la vie civile, il est dans les Douanes à Brest, ce qui explique que son fils soit né au Conquet. Il est ensuite muté en Loire Atlantique où il vit vers 1910. Ce qui explique que l'acte de décès de son fils fut retranscrit à Pornic et que son nom figure au Monument aux Morts de Pornic.
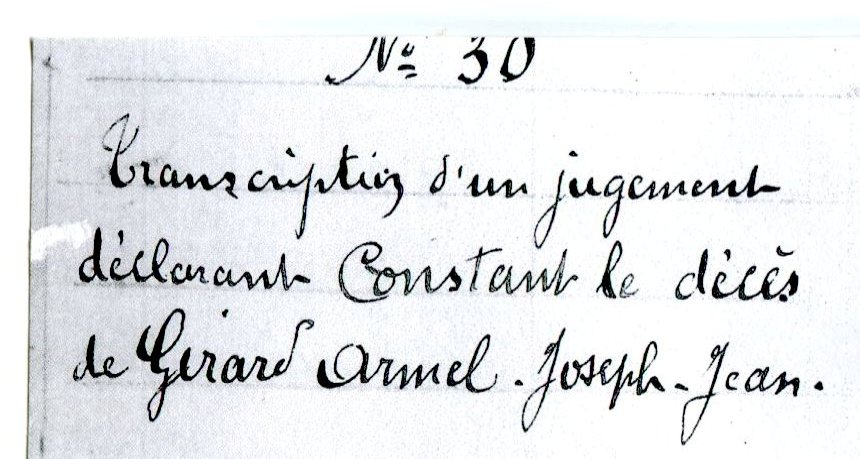
La fiche "Mémoire des Hommes" comme l'acte de décès de Pornic, parle d'un jugement du Tribunal de Paimbeuf du 5 avril 1922, déclarant"Constant" le décès de Girard Armel Joseph Jean.
Vraisemblablement, le soldat Armel GIRARD, a été "tué à l'ennemi" à Esnes sur Meuse (Esne en Argonne), sans que son corps ne soit retrouvé. La famille Girard, aura souhaité déposer "discrètement" cette plaque sur la face latérale de la tombe, pour honorer leur enfant "Mort pour la France".
Des sodlats décédés pendant la 2de Guerre Mondiale et la Guerre d'Algérie.
Les soldats Crolas, Pierre et Lacroix, morts pour la France lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Les résistants FFI, Roger et Jean Le Gregam et la mère de Louis et Anne Marie Enizan, déportés à Mathausen.
Les militaires Le Cam et Le Clerecq, morts pour la France en Algérie.
D'autres Sinagots au destin particulier.
La passé martime de Séné a laissé des traces au cimetière avec les tombes de Le Doriol mort lors de la catastrophe du Iéna (1907); les marins Le Bourvelec et Le Veut décédés lors de l'incendie du Port Manech (1965); la tombe du Petit Passeur, Jean Marie Le Guil et sa femme Pascaline Miran celle du regretté Lucien Le Quentrec tué en 1976 dans la salle des fêtes de Séné.
D'autres tombes restent sans doute à mettre en relief à cause de l'histoire singulière de leur occupant. Pour les Sinagots, notre cimetière, lieu de repos de nos disparus, est aussi notre "Père Lachaise" à nous.
AVLEJ Mousterian (Montsarac)
Dans les années 1960-70, pour accueillir de nouvelles populations sur Vannes, on créait de grands ensembles de logements à Kercado et Ménimur.
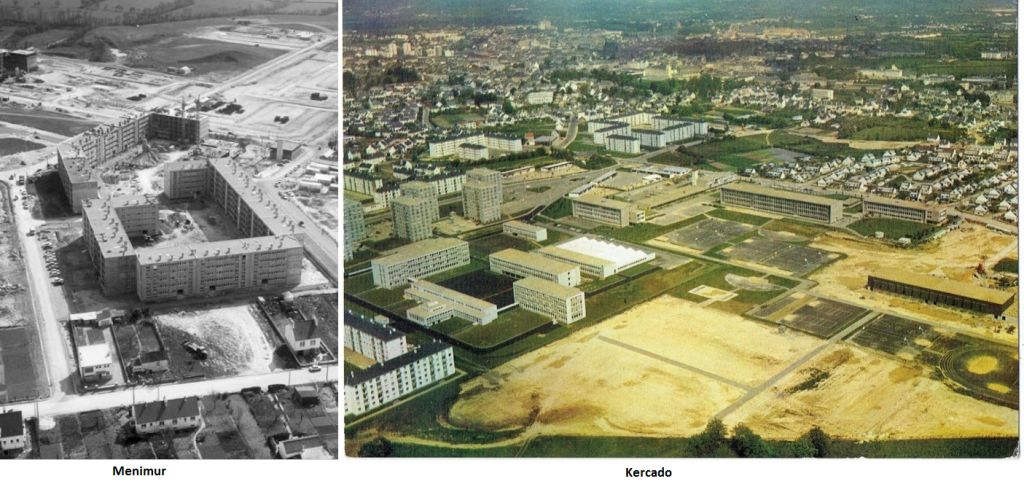

Dès les années 1965, L'Abbé Francis Brohan [xxx - 1997 Ile'd'Arz ] à l'époque aumonier auprès des écoles Saint-Joesph à Vannes, s'émeut de voir beaucoup d'enfants désoeuvrés à ne rien faire au bas de leur immeubles...
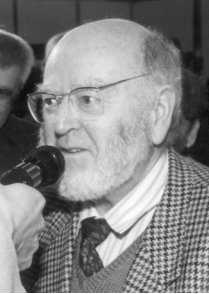
Avec l'aide de l'industriel Jean GUYOMARC'H [1923-8/12/1996], propriétaire de l'ancienne ferme du Traire, derrière le château de Bot Spernen, plus connue sous le nom de ferme de la Villeneuve, ils créent un centre de loisirs, géré par une association : Association Vannetaise pour les Loisirs Educatifs des Jeunes, l'AVLEJ.
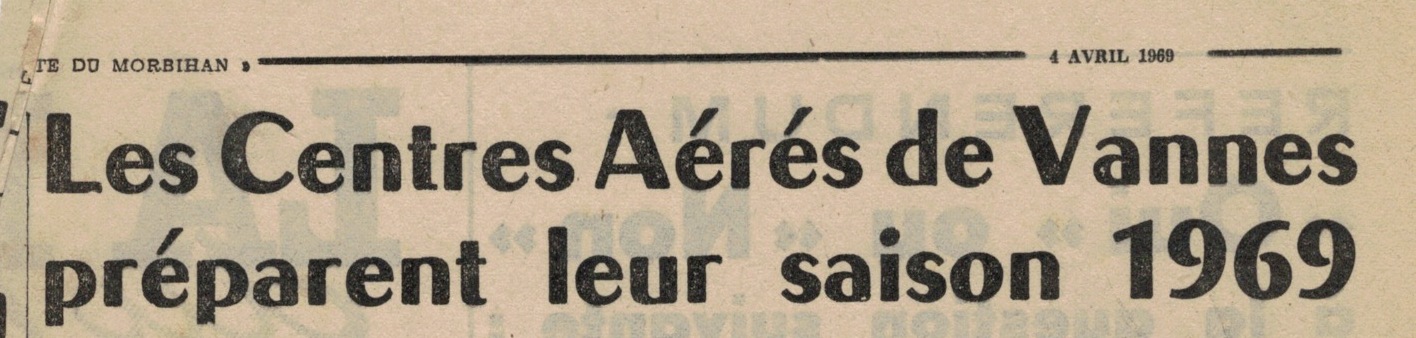

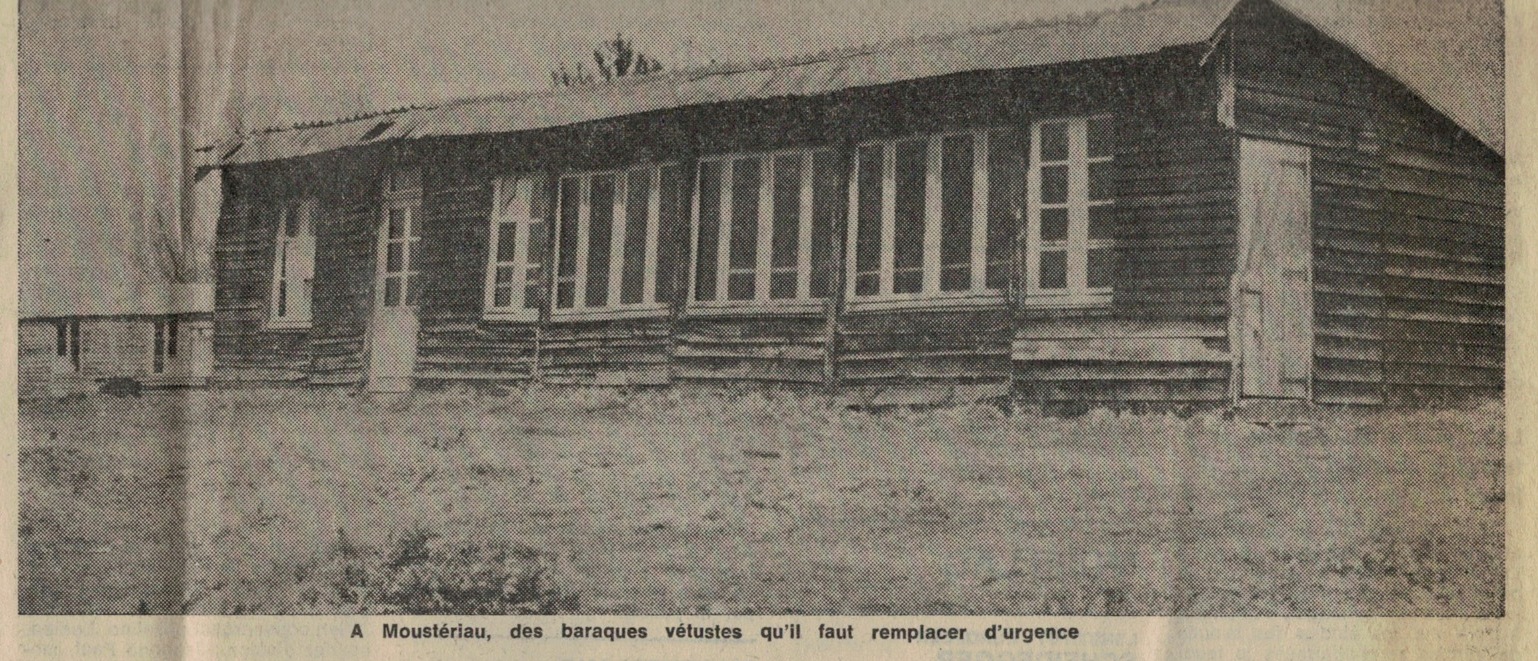
Ils aménage cette ancienne ferme près de Montsarrac et en 1965 et l'association, dont la présidente n'est autre que l'épouse de M. Guyomarc'h, Mme Emma Marcelle CHARLET, devient propriétaire d'un terrain près du village de Mousterian, acheté à Mme Marie Joseph JOUAN épouse MORIO du Morboul pour 17.000 Frs. Sur ce terrain de 11 ares73 ca, on construit un premier barraquement mais très vite, face au succès auprès des enfants, de nouveaux bâtiments plus "modernes" seront réservés aux filles. En 1965, le centre de loisir accueillit 200 enfants et en 1970, 800 répartis en 6637 journées pour les filles à Mousterian et 7777 journées pour les garçons à Montsarrac où est créé le toute première école de voiles de Séné.

Ces photographies aériennes montre l'évolution de bâti sur cette parcelle de Moustérian:


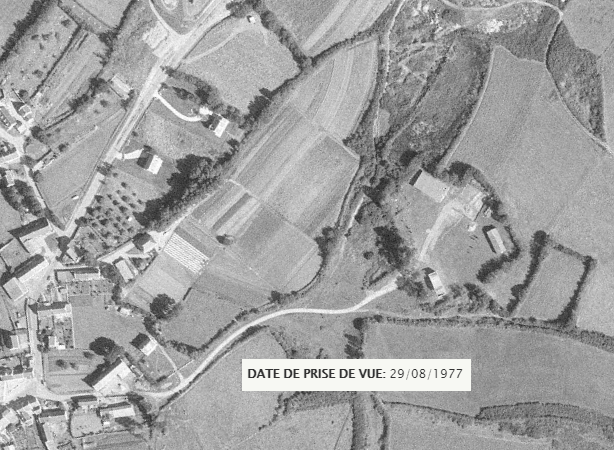

Rapidement, aux côtés de l'abbé Brohan, M. Jean KERVICHE [1910-1975], du Secours Catholique et Soeur Jeanne font tourner l'association. Le professeur de sciences naturelle, Mme Solange RABADE, du lycée de Menimur, rejoindra également les bénévoles de l'AVLEJ. On organise un rammassage des enfants avec des autocars. Le 20 janvier 1976, l'abbé Brohan recevait la médaille de la Jeunesse et des Sport et ce jour-là, il fut décidé de donner au Centre de Loisirs le nom de Jean Kerviche décédé un an plus tôt. Nom qui sera repris ensuite pa rla commune de Séné pour nommer la rue qui va du village de Moustérian au centre de loisir.


Quant à Soeur Jeanne, elle demeurera active pendant une vingtaine d'années. Le recteur de Séné, Joseph LE ROCH, en "bon reporter de sa paroisse", restituait dans le bulletin LE SINAGOT, la cérémonie de départ de Soeur Jeanne.
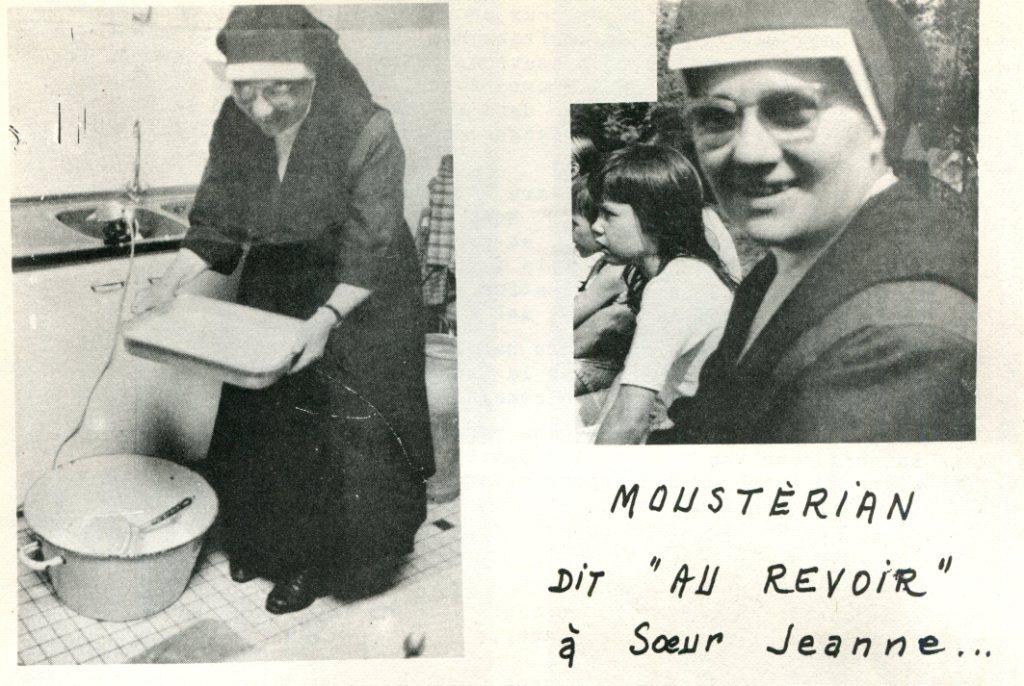
Le 19 septembre, en soirée, le Conseil d'Administration de l'AVLEJ, les Amis de Moustérian, autour de l'Abbé Brohan, en présence de Mr Chazard, Conseiller Général, de Mr Rivière représentant Mr Chapal député-maire de Vannes, se sont réunis au Centre Aéré pour dire "au revoir" à celle qui fut pendant 20 ans infatigable animatrice des "Vacances vannetaises en Pays Sinagot" : elle quitte la côte bretonne pour la côte normande.
A cette occasion, l'Abbé Brohan se faisant l'interprète de l'Association Vannetaise pour les loisirs éducatifs des Jeunes, prononça ces quelques mots: "Votre discrétion et votre modestie ne peuvent m'empêcher de parler...D'autres vous diront "au revoir" ailleurs et autrement (ceux du 3ème Age); mais il se devait qu'ici se retrouvent tous ceux que nous représentons: .Association, parents, animateurs...et surtout ces nombreux petits (et plus grandes) que vous avez vu passer...Merci pour votre bonté! Parler de "Bonne Soeur"; à notre époque, a une résonnànce un peu péjorative, mais pas quand on vous connait. Car la BONTE a rayonné ici depuis ces débuts héroiques du Moustérian des anciennes baraques junqu'à cette résidence d'été, devenue un peu votre résidence secondaire, où le tandem Soeur Jeanne-Solange (bien connu du voisinage) aura passé des vacances inoubliables, malgré les soucis et les fatigues...des genoux. Mais c'était pour le bonheur des enfants et des jeunes...et on le sait, jamais pour un quelconque profit. C'est à Solange Rabade que reviendrait le droit de rappeler ces quelques vingt ans de souvenirs communs. Elle a préféré, je le sais, vous le dire en particulier.
Mais l'AVLEJ vous doit tellement d'avoir Até accueillante, intendante, patiente, souriante, soignante, consolante à. l'occasion. Elle veut vous le manifester par quelques modestes souvenirs que vous aurez bien le loisir de regarder de la Bretagne à la Normandie, il n'y a qu'un pas; on veut vous donner l'occasion de comparer les beautés de deux provinces voisines et soeurs (vous y trouverez bien quelques sujets de méditation). Dans la collection des diapositives prises depuis 15 ans que nous oeuvrons ensemble, vous retrouverez le souvenir, de ce qui fut beau et bon à Moustérian...et vous le ferez découvrir aux Normands. De loin nous le porterons dans le souvenir et dans la prière. Et si on s'est aussi intéressé à vos.bagages, c'est bien pour faciliter un " Aller-Retour" ...quand vous voudrez.
A un MERCI qui mériterait d'être écrit non loin du nom de "Jean KERVICHE", j'ajouterais volontiers: "PARDON" Soeur Jeanne, de vous avoir souvent taquinée, quelquefois beaucoup demandé, et parfois un peu bousculée.: pendant que vous voyiez toujours l'"ENFANT" et la famille modeste qui vous le confiait, je voyais peut-être surtout une organisation à faire fonctionner et réussir... en fin de compte, on n'a pas eu trop de mal à se comprendre.
Merci d'avoir toujours répondu par le sourire d'une "BONNE-SOEUR", et d'avoir été parmi nous une "Fille de la Charité" que reconnait sür-ement Saint Vincent de Paul que vous célébrerez la semaine prochaine sur la côté normande.
En vous voyant partir, non sans regret, je vous entends nous dire à tous "Mais laissez donc venir à moi les petits enfants...ne les empêchez pas". Vous en trouverez d'autres sur d'autres rivages. Mais ils continueront à venir ici, de Vannes et sa banlieue, et il y aura, j'en suis sür, une autre "Soeur Jeanne" pour les accueillir et prendre la relève. Ce n'est jamais du temps perdu que de s'intéresser à l'ENFANT !
Alors, pardon un peu, merci. beaucoup, et au revoir seulement...Vous savez que Moustérian accueille en toutes saisons...si vous avez quelques vacances, Solange vous trouvera une place..."
A.V.L.E.J.
Monsieur Chapal, Maire àe Vannes, retenu au Conseil Régional, faisait offrir â Soeur Jeanne un três bel ouvrage sur le Morbihan. Monsieur le Recteur de Séné joignait son Merci au nom des familles de Sêné.
Mr Guyomard, Maire de Séné, retenu au jury des Assises, s'était fait excuser.
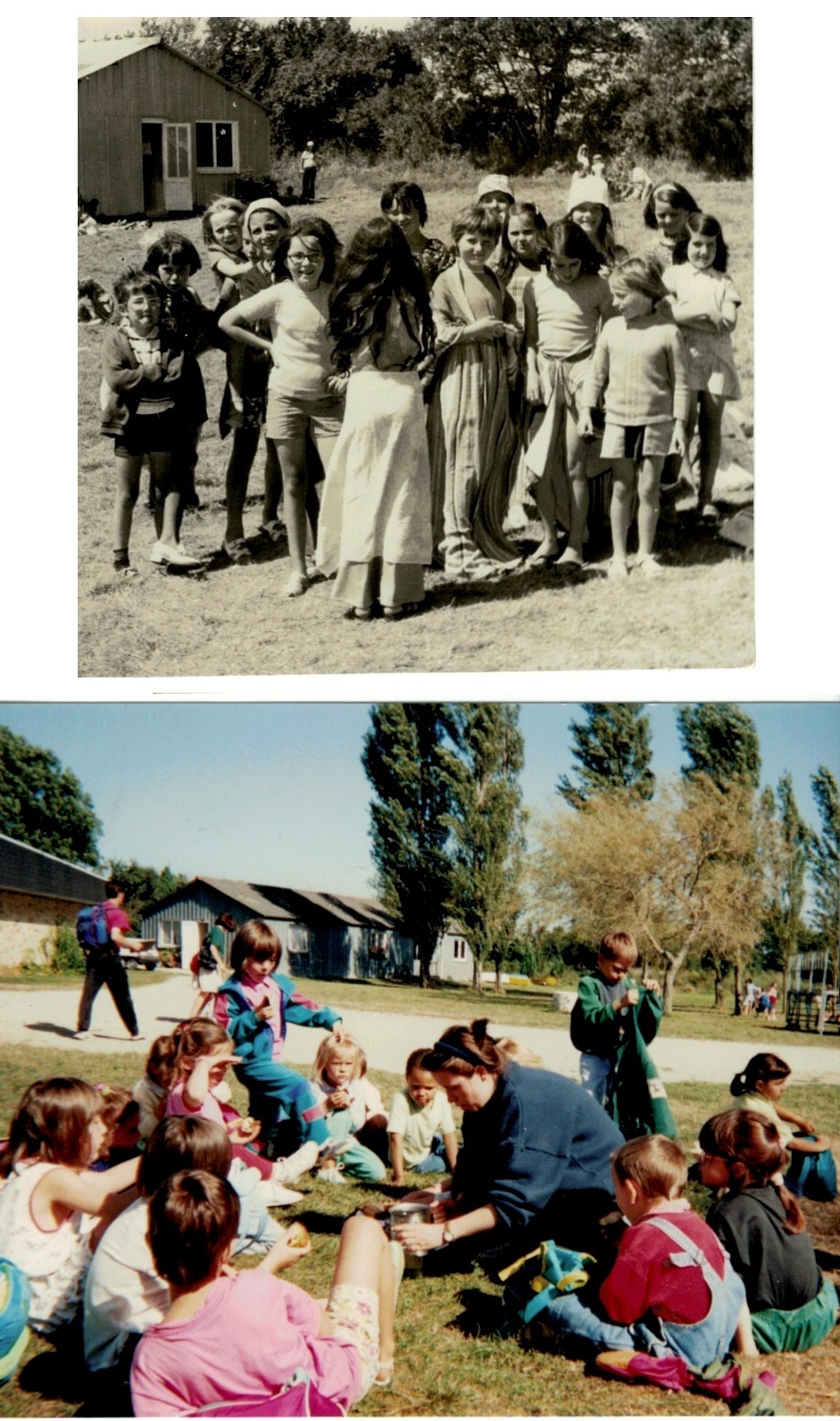
Le centre de loisirs va fonctionner encore pendant toute la fin du XX°siècle. Il abandonnera les locaux de la ferme de Villeneuve pour se recentrer sur Moustérian..
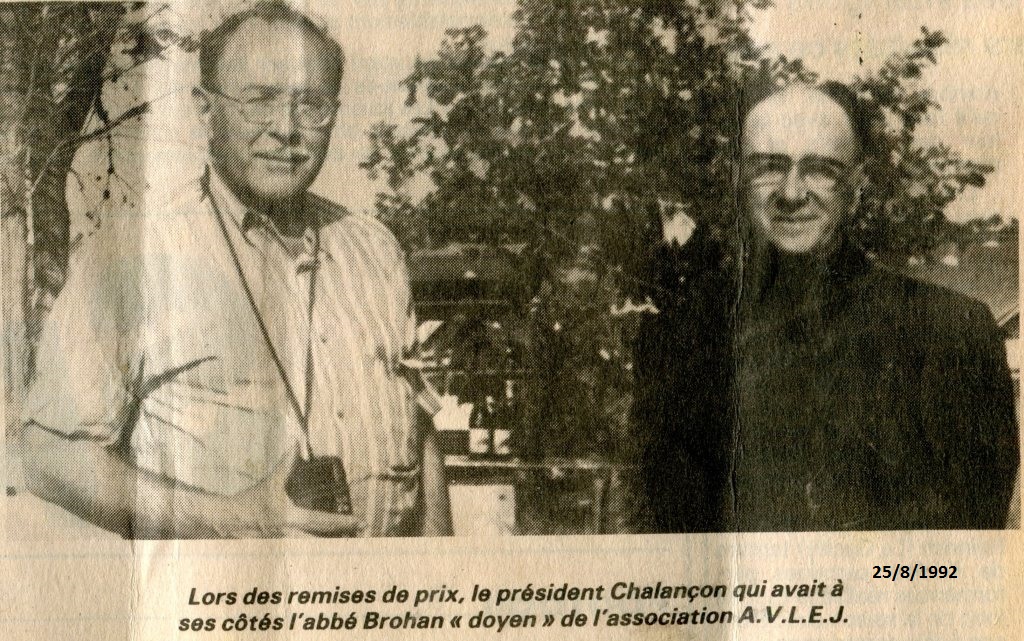

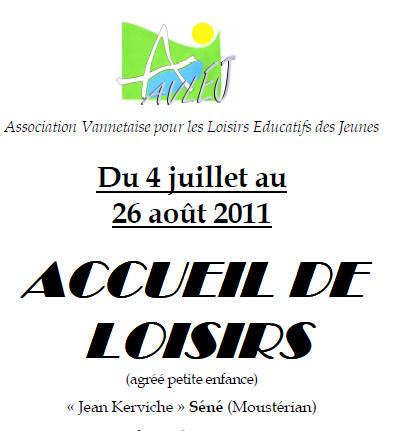
Il sera vendu vers 2012 à des investisseurs, qui proposent aujourd'hui, à Porh Kerviche, la location des salles et bâtiments pour des mariages, associations sportives ou salons professionnels.
La ferme de Villeneuve
Tant que l'anse de Mancel était recouverte à marée haute par les eaux du Golfe, les ilots de Bot Spernem et de Viac Cornec restaient isolés, peu accessibles aux Sinagots.

Le projet d’assèchement du Golfe datait du XVIII° siècle, mais il fallut attendre 1830 pour que le Nantais, Edouard Lorois, devenu Préfet du Morbihan, obtînt finalement la concession et réalisa son endiguement. La nouvelle digue fut dénommée le « Pont Bras » et constitua un nouvel accès entre Moustérian et Montsarrac.(Lire Histoire de l'anse de Mancel).
Dès lors, les nouvelles terres agricoles du polder présentaient un intérêt agricole et localiser une ferme au plus près prenait du sens. Cependant, il fallut attendre ledébut du XX°siècle pour qu'une ferme voit le jour sur l'ancienne île de Viac Cornec.
D'abord nommée, la ferme du Traire, la ferme de Villeneuve apparaît pour la première fois sur une carte en 1912, ce n’est qu’en 1927 qu’il est dénommé sur un plan comme la « ferme neuve ». A cette époque, le corps de ferme semble finit sur ses plus grandes dimensions à l'image des grandes fermes du nord de la France. On parle, dans les années trente à Montsarrac, de la Villeneuve comme la ferme modèle de Fleury, son propriétaire, boucher à Vannes.
Il avait acquis environ 8 ha à M. BROUARD, marchand de bois, qui avait acquis une vingtaine d'ha à Henry François Joseph BOUAN du Chef de Bos, lui même l'yant acquise de Auguste Marie SEPTLIVRES, agronome, membre de la Société d'Agriculture de Vannes, qui la détenait de M. LOROIS, qui avait asséché le marais de Mancel pour y créer un polder. [lire histoire de Mancel]..
Avant la première guerre mondiale, M Fleury développe un élevage de moutons et de chevaux de boucherie. Il cèdera la ferme vers 1935 à M. LE BOLEIS. Comme la ferme de Bilheron, la ferme de la Villeneuve va subir les deux ruptures de la digue de Mancel.
En décembre 1925, une première tempête ouvre une brèche de 20m dans la digue. M. Rohling, propriétaire de l'autre ferme qui exploite le polder, la ferme de Bilherbon, refuse de prendre en charge les frais occasionnés par le colmatage effectué par les riverains. S’ensuit alors un contentieux qui aboutit à la vente sur saisie de la propriété en 1934, qui sera acquise par Pierre LE PELVE, alors fermier. La digue est réparée.
En 1937, une violente tempête coïncidente avec une marée d’équinoxe provoqua un mini raz-de-marée et creusa une énorme brèche dans la digue.Les exploitants agricoles n’obtinrent aucun dédommagement et depuis l’anse de Bilherbon est devenue « domaine maritime ». Après guerre, l'exode rural et la mécanisation agricole renda moins nécessaire le gain de terres agricoles.
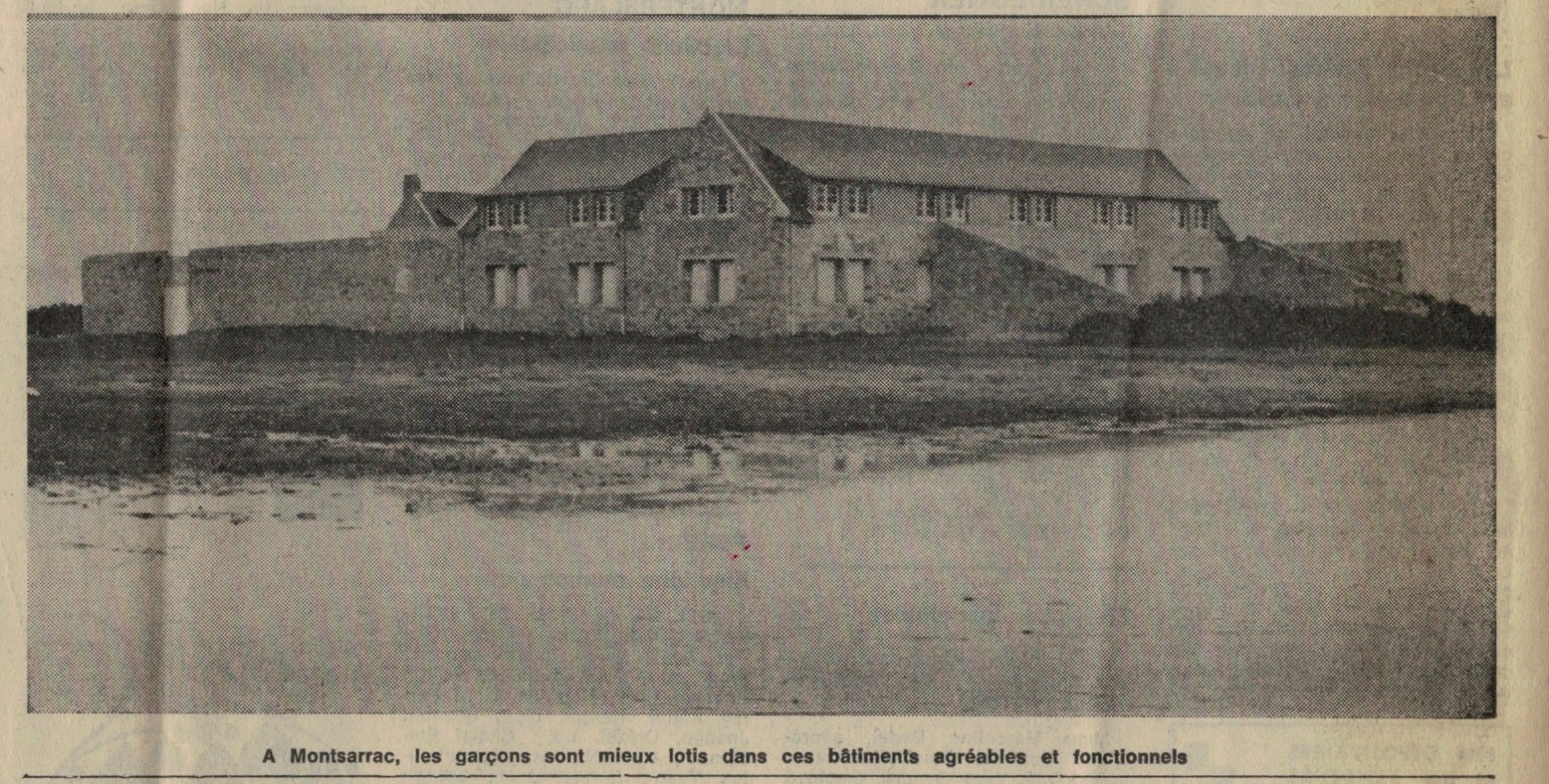
Puis la ferme de la Villeneuve devient la propriété de M. Guyomar'ch, patron de l’entreprise agro-alimentaire basée sur Saint-Nolff. Durant cette période les bâtiments sont transformés pour accueillir des colonies de vacances [Lire histoire de l'AVLEJ]. Enfin la ferme devient la propriété du Conseil Général au titre de la TDENS (Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles).
Le Conseil Départemental du Morbihan y loge l'association Voiles & Patrimoine qui y restaure des bateaux et des yoles.
L'amer Saint-Antoine à Boëdic, 1865
Dans son livre "Séné d'Hier et d'Aujourd'hui", Camille Rollando évoque l'origine de la statue qui repose sur l'estran à la pointe ouest de l'île de Boëd, bien connue des plaisanciers et des kayakistes qui longent l'île.
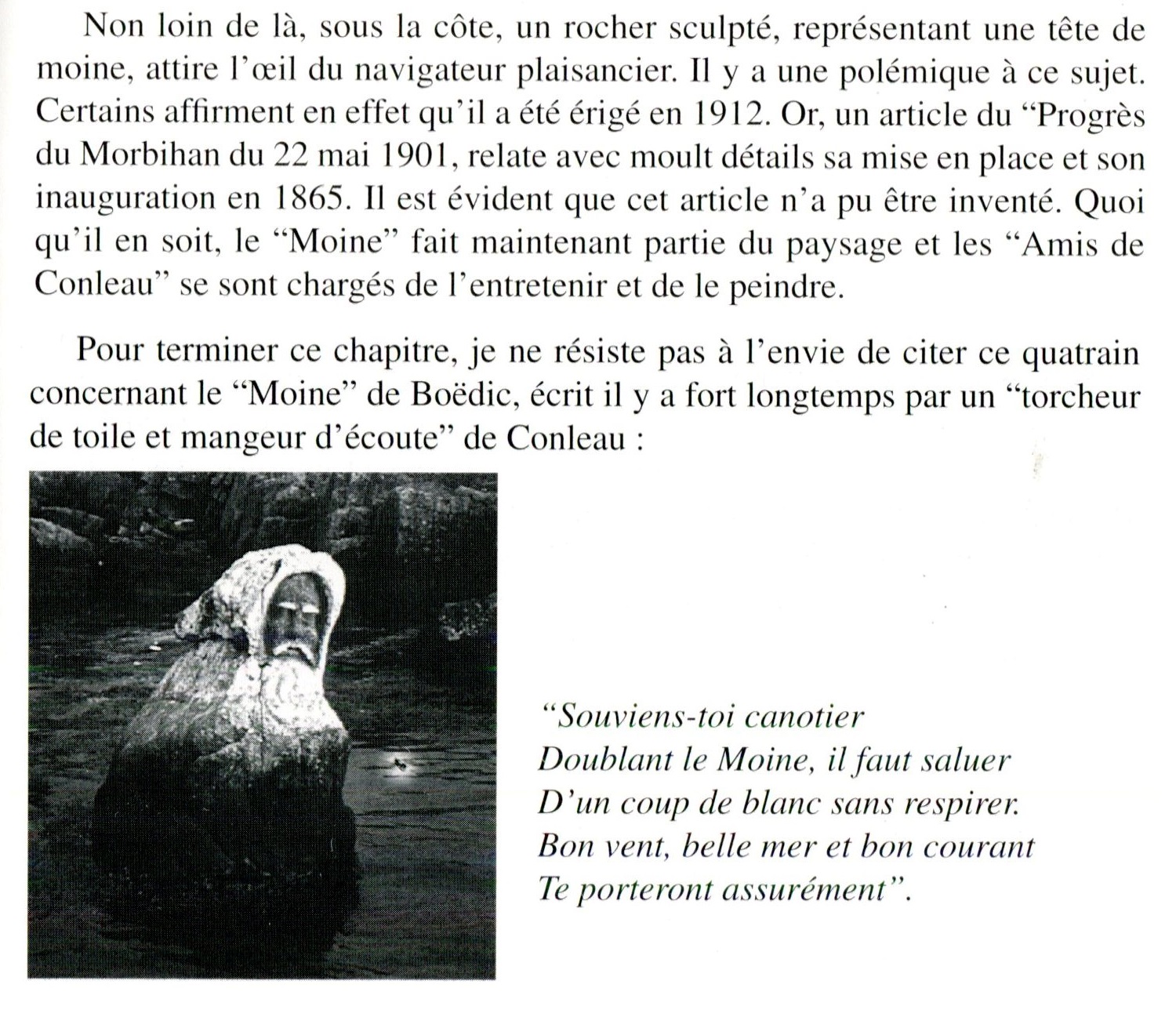
On apprend à la lecture de cet extrait qu'une explication est avancée dans un article de journal du "Progrès du Morbihan" en date du 22 mai 1901.
Grâce aux archives en ligne du Morbihan, on peut retrouver facilement l'article de presse en question. Le journaliste du Progrès du Morbihan, un certain THEO, y nous donne le palmarès des régates de Conleau où on reconnait le nom de marins de Séné qui se sont distingués dans la catégorie : bateau de pêche dit Sinagots.
En introduction, il écrit"
Jeudi, jour de l'Ascension, avaient lieu à l'île les régates que mes compagnons de jeunesse et moi fondâmes après avoir, avec le concours d'Amossé, un des sculpteurs du fronyon de la Préfecture actuelle, de Charles Normand, et d'autres, sculpté la figure qui se voit toujours à la pointe ouest de l'île de Boëdic, bien connue des canotiers du golfes. Une fois la figure taillée dans le rocher, qui se nommait alors le "bigorneau", Hildebrand peintre-photographe, né "Tans le Bedit Tuché de Padé" et qui faisait partie de notre bande joyeuse, peignit le visage de cette oeuvre taillée dans le granit, Antoine Dérémy, en fut leparrain avec une jeune fille, soeur d'un de nos camarades. Saint-Antoine fut baptisé en grande pompe avec une ...bouteille de vin blanc, au grand scandale des bigotes de l'ïle d'Arz."
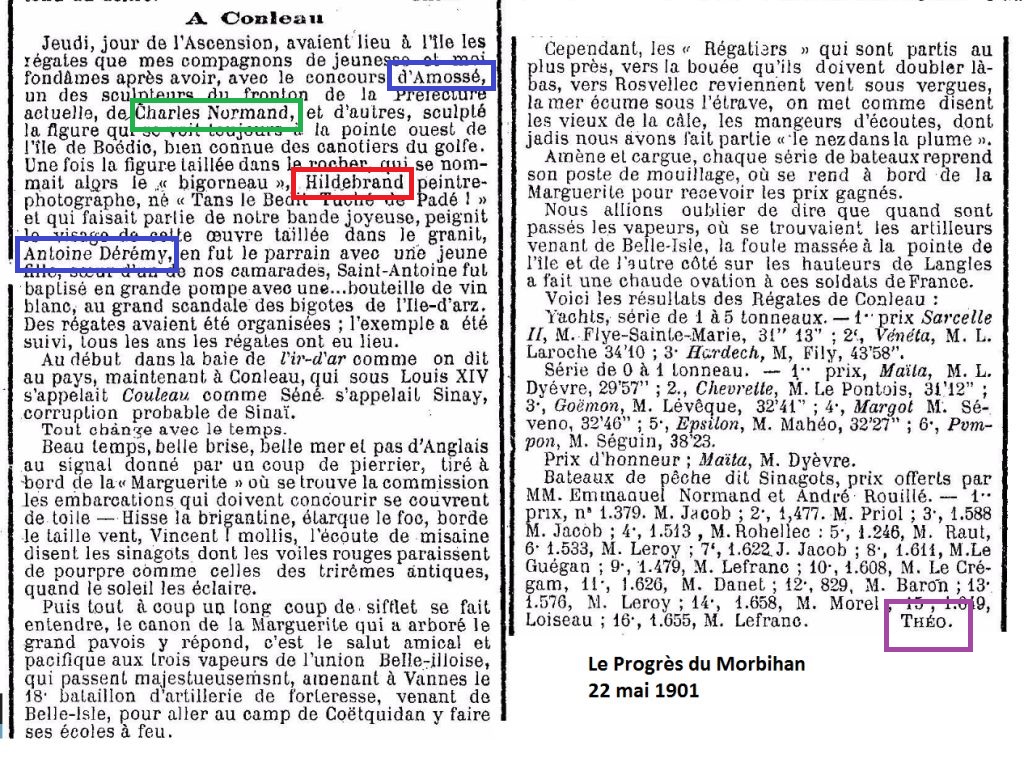
On comprend qu'une bande de copains qui se retrouvent pour des sorties en mer, on ne disait pas encore plaisanciers mais canotiers, est à l'origine de la transformation du rocher le "bigorneau" en statue du moine Saint Antoine.
Cet article nous précise les circonstances dans lesquelles le rocher fut sculpté. C'est l'un des sculpteurs travaillant à la construction de la préfecture de Vannes qui se chargea de l'ouvrage. On sait que les frontons de la nouvelle préfecture furent sculptés en 1864 et les bâtiments inaugurés par le préfet le 23 août 1865. Cette indication permet de dater entre 1864 et 1865 l'érection de la statue de Saint-Antoine à Boëdic, date reprise par Camille Rollando.
Mais qui étaient ces joyeux lurons qui nous ont légué cette sculpture maritime ?
On connait au moins cinq noms de ce groupe de canotiers : AMOSSE, HILDEBRAND, Antoine DEREMY, Charles NORMAND et THEO.
1-Alexandre Julien AMOSSE
Grace à un site de genéalogie on retrouve l'identité du sculpteur Amossé. Il s'agit d'Alexandre Julien AMOSSE [11/06/1829- xx/06/1898]. Le journaliste ajoute qu'il fut un des sculpteurs du fronton de la Préfecture à Vannes [à vérifier].
Alexandre Julien AMOSSE
Né le 11 juin 1829 (jeudi) - Nantes, Loire-Atlantique,
Décédé avant juin 1898 - Paris; Sculpteur
Parents
Julien Amossé 1800-
Marguerite Etienne 1795-
Union(s) et enfant(s)
Marié avec Henriette Jeanne Marie Even †
Marié le 25 octobre 1865 (mercredi), 1er canton - Nantes,44, avec Reine Marie Victorine Audouis 1846-1898/ dont
F Amélie Jeanne Marie Amossé 1870-1949
H Louis Jean Marie Amossé 1871-1871
F Jeanne Blanche Amossé 1873-
F Eugénie Marie Amossé 1876-
F Louise Amélie Amossé 1884-1958
Frères et sœurs
H Auguste Amossé 1824-
H Julien Saturnin Amossé 1825-
H Joseph Hyppolite Amossé 1827-
F Marie Louise Amossé 1832-
La recherche sur la presse numérisée du Morbihan avec le mot clef AMOSSE, permet de trouver un article de la revue Caprice-Revue daté de juin 1892, dans lequel quelques années plus tôt, le même Théo raconte ce même souvenir.
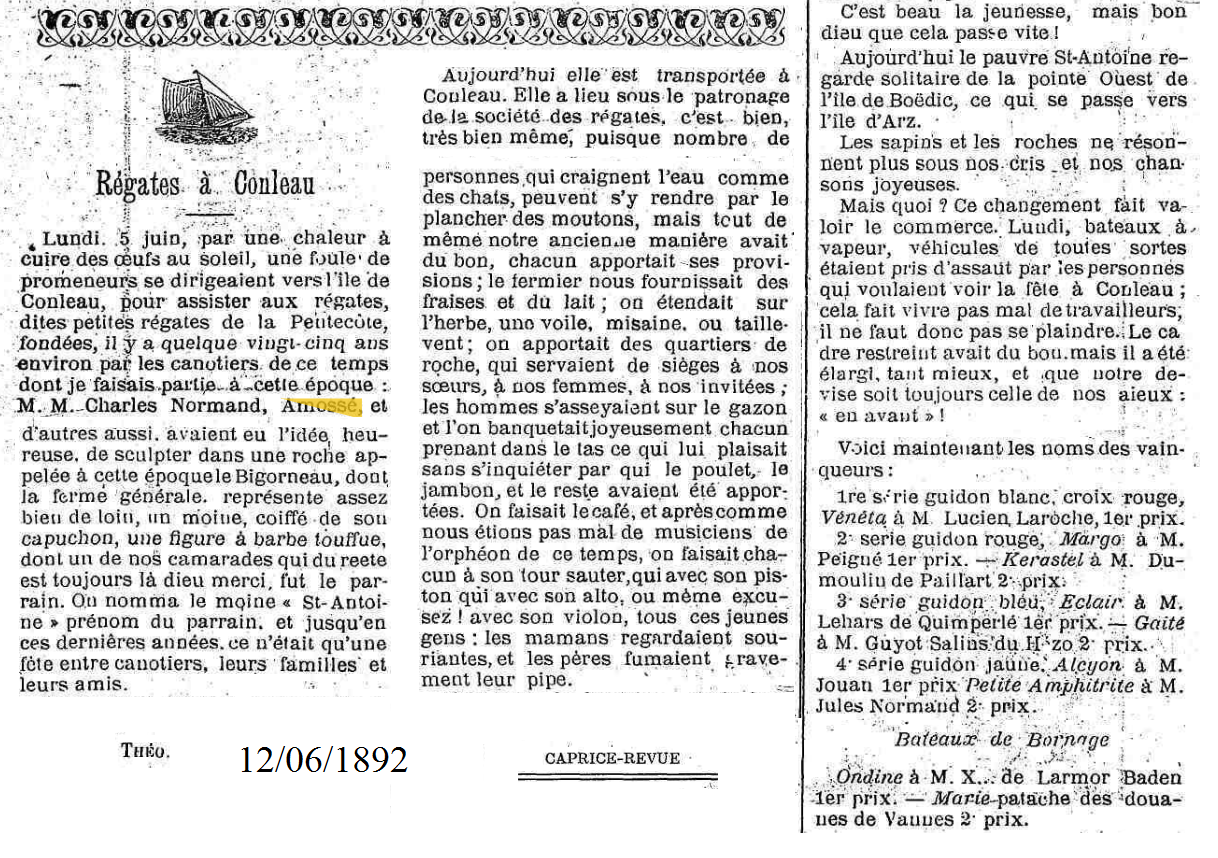
2-Joseph HILDEBRAND
On peut retrouver l'identité du peintre Hildebrand sur un site de genealogie. Le nom n'est pas commun dans le Morbihan. Parmi les fiches, celle d'un Joseph HILDEBRAND dont la profession est artiste lithographe est surement la bonne. La date de naissance en fait un comptemporain du sculpteur Amossé. Il a vécu à Vannes, il n'y plus plus de doute sur la personne.
Né le 1er avril 1822 - KIECHLINSBERGEN - Grand Duché de Bade (Allemagne)
Artiste lithographe en 1856>62 à VANNES rue du Port, en 1865 rue des douves de la Garenne, en 1874 place Napoléon (Morbihan), graveur lithographe en 1886>88 à PARIS 17 rue du Val de Gràce (1)
Parents
Léopold HILDEBRAND
Catherine RUESCH
Union(s) et enfant(s)
Marié le 28 juillet 1856, VANNES (Morbihan), avec Marie Julienne CHRETIEN 1836-1897 (témoins : Jacques Marie LE LUDEC ca 1828 , Julien LE PENVEN ca 1822 , Pierre Marie CONAN ca 1809 , Isaïe PRAUD ca 1798 ) (voir note) dont
F Marie Léopoldine HILDEBRAND 1857-1891
F Berthe Marie Augustine Francine HILDEBRAND 1862
F Eléonore Elisabeth Marie HILDEBRAND 1865-1865
F Madeleine Cécile Léopoldine Joséphine HILDEBRAND 1874-1960
Des recherches sur le site des Archives du Morbihan permettent de trouver quelques coupures de presse qui authentifient l'intéressé.
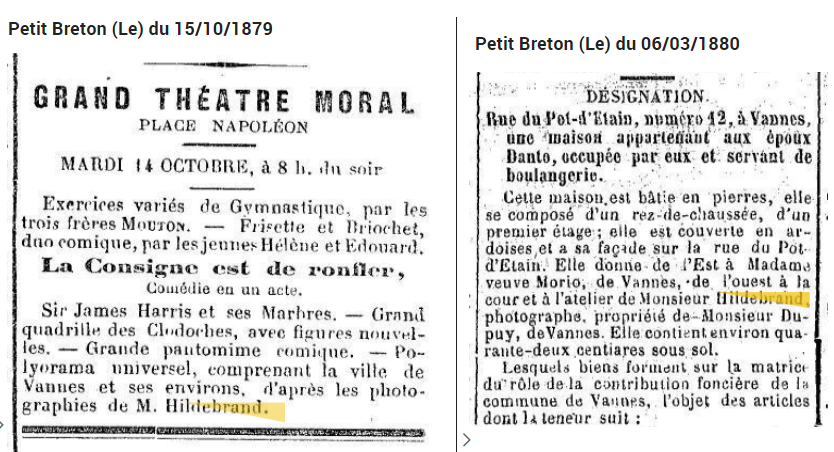
3-Antoine Louis Marie DEREMY
En utilisant les site de genealogie et le nom de famille DEREMY, pas très fréquent en Bretagne, on ai aiquillé vers les archives du Morbihan et leur base contenant les fiches de matricule des soldats de 14-18. Il y a bien des soldats au nom de DEREMY et avec un prénom contenant Antoine. Cependant, ils sont trop jeunes, mais se sont les fils d'un certain Antoine Louis Marie DEREMY [Redon 24/08/1837 - 18/12/1897 Vannes]. Son acte de mariage nous dit qu'il était conducteur aux Ponts & Chaussées. C'est sans doute la personne qui a donné son prénom à la statue.
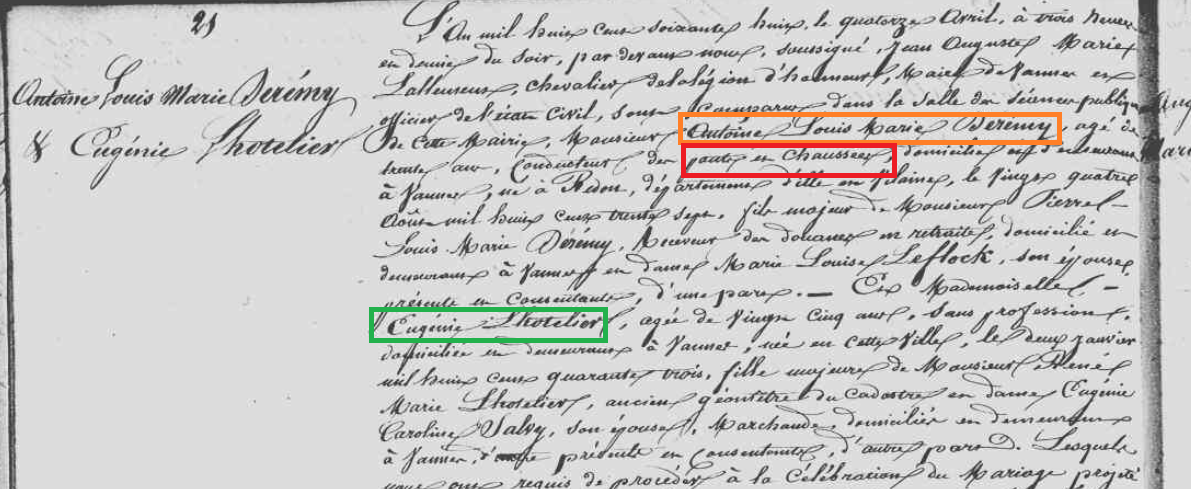
On retrouve un certain DEREMY qui participe aux régates de Boëdic avec son bateau le Neptune. Il faudra toutefois affiner les recherches pour être sûr qu'il s'agit bien du parrain de la statue du moine Saint Antoine. Ildécèdera des suites d'un banal accident sur sa concession.
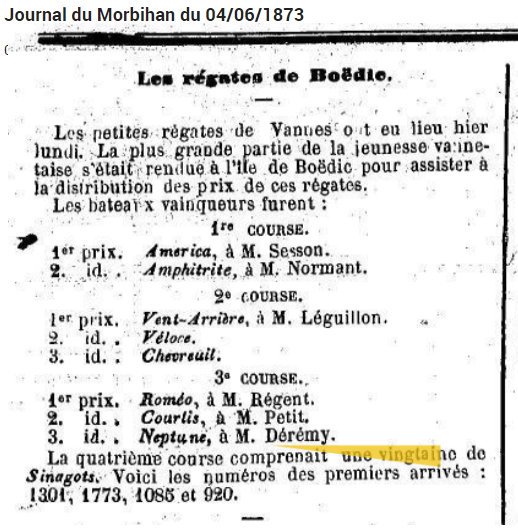
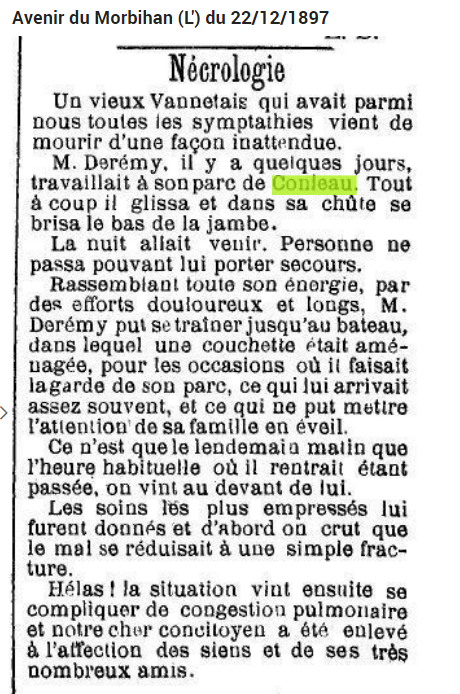
4-Julien Marie NORMAND
On note aussi le nom de NORMAN, propriétaire du bateau Amphitrite. Dans le livre YACHTING en MORBIHAN, les auteurs font le portait de la famille NORMAND dont Julien [1841-1897] fit construire ce bateau. La famille Normand comptait également Charles Julien Marie NORMAND né en 1847. C'est sans doute la personne du "Groupe de Saint-Antoine". Julien Marie, dit Jules NORMAND, [6/12/1841-21/11/1901 Auray], Vice-Président. Originaire de Redon, entrepreneur en travaux publics à Vannes, meurt lors d'un accident de train en gare d'Auray
Mais qui était le Théo, journaliste à la revue Caprices et ensuite au Progrès du Morbihan.
5-Théophile BAUDOUX
Une recherche sur la presse en ligne me met sur la trace d'un certain Théophile BAUDOUX [désolé mais pris dans mes recherches je ne sais plus quel est cet article], qui participe à l'Association des Hospitaliers Sauveteurs de Vannes. Je flaire le bon "candidat" en lien avec la mer, un peu notable, tout à fait apte à avoir parmi ses amis quelques artistes et autres canotiers.
Je reprends patiemment mes recherches en ligne, depuis 1867 à [1892-25= 1867] année suposée de l'érection de la statue, en quête d'indice sur ce Théophile Baudoux.
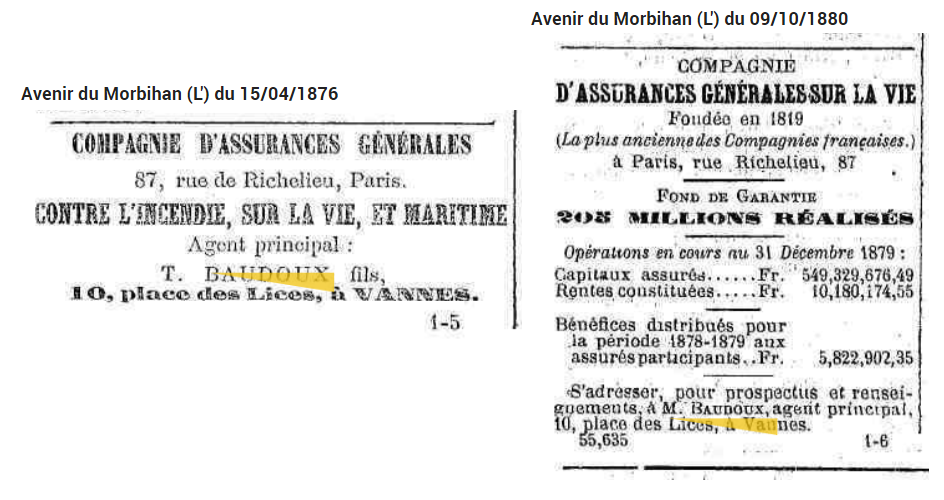
Je trouve d'abord en 1873 un courtier en assurance qui signe sa réclame, avec des bureaux Place des Lices à Vannes. Je le retrouve encore en 1880 dans les assurances. En 1891, il est toujours membre des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, l'ancêtre de la SNSM.
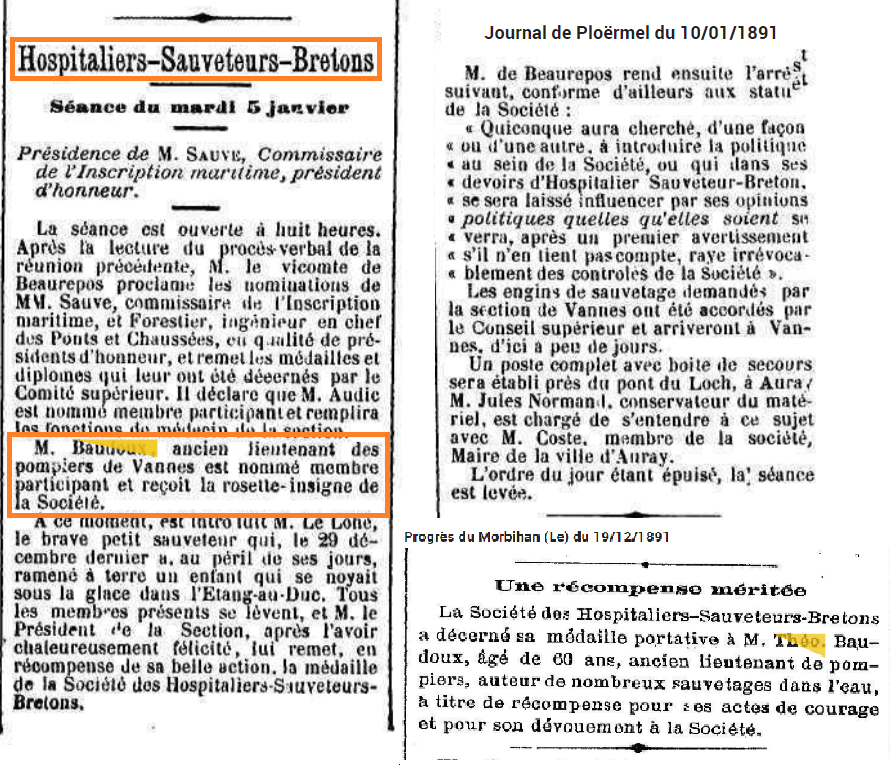
En 1892, on comprend qu'il s'est reconverti dans le dessin de broderie en collaboration avec un membre de sa famille qui tient une boutique de vêtements.
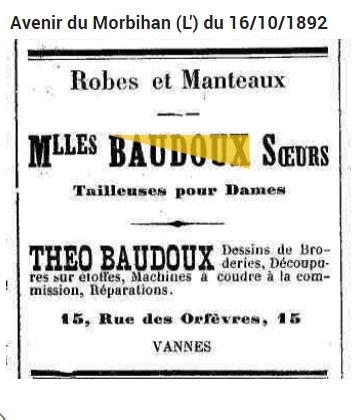
En 1894, il est juré au tribunal et son identité de journaliste ne fait plus aucun doute.
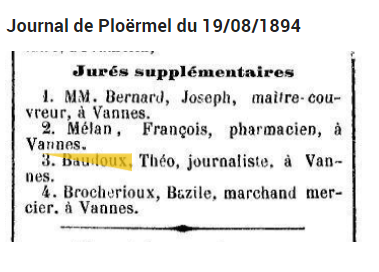
En 1899, il signe un article de son nom complet avec son titre dans le corps des pompiers. Sa nécrologie de 1904, confirme qu'il est bien l'auteur des deux articles qui relatent la "fondation" de la statue de Saint Antoine à Boëdic.
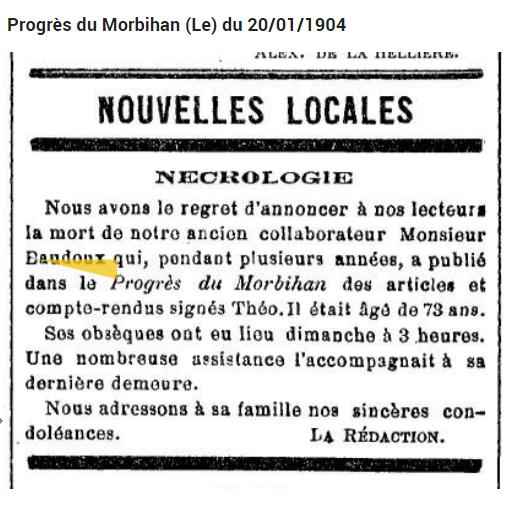
Théophile François Louis BAUDOUX, né à Vannes le 9/12/1831, fils de pâtissier décédé le 16/01/1904, courtier d'assurance, dessinateur de broderie, lieutenant des pompiers de Vannes, journaliste et canotiers à ses heures est à l'origine avec d'autres canotiers de l'amer de Saint-Antoine à Boëdic.
Les régates de Boëdic :
A l'époque d'or des canotiers, la Société des Régates de vannes organisait sur le plan d'eau en l'Île de Boëdic et l'ïle d'Arz, des régates le lundi de Pentecôte, sorte d'entrée en matière avant les régates de Vannes de l'ïle aux Moines et de Port-Navalo.
On retrouve des articles de presse de 1886, année de rétablissement de la Société des Régates de Vannes, jusqu'aux années 1890.
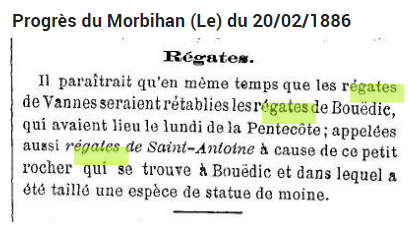
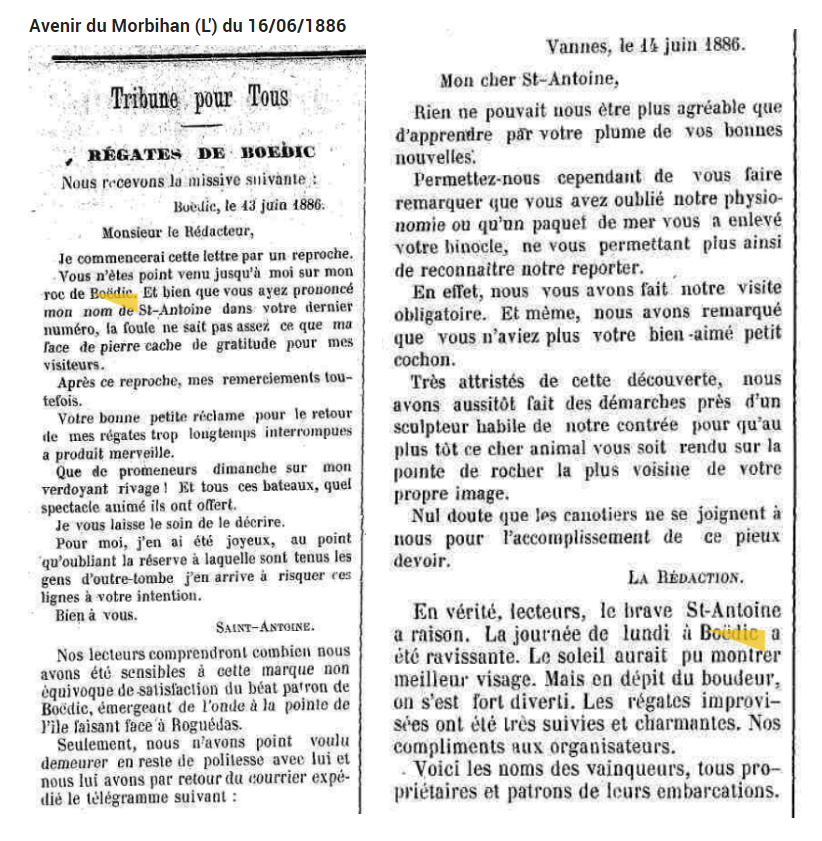
Epilogue :
Jean Richard nous rappelle que la statue fut renversée lors d'un tremblement de terre du 22 novembre 1956 et fut ensuite redressée et bétonnée.
Elle est devenue un amer, près de Boëdic que les kayakistes peuvent approcher au plus près et que les plaisanciers aperçoivent de leur bateau.
Aujourd'hui, Les Amis de Port Anna veillent à lui reprendre régulièrement la tête.
KERIO, Léonie et leur triplées 1927
La presse numérisée des Archives du Morbihan recèle des informations intéressantes sur le passé de Séné. La recherche par des mots clefs judicieux permet de trouver des articles qui illustrent la vie des Sinagots au siècle dernier. Ainsi, cet article de l'Avenir du Morbihan daté du 11 décembre 1926.
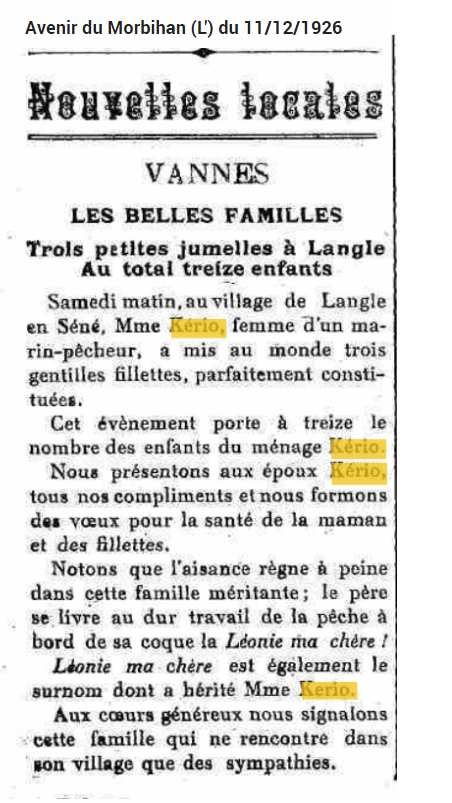
Il nous apprend la naissance de triplés chez la famille Kério du village de Langle à Séné.
Le journaliste indique que la famille compte désormais 13 enfants. Le bonheur semble régner au sein de cette famille nombreuse, dont le chef vit de la pêche, comme la plupart des habitants de Langle de l'entre deux guerre...
Marie Hyacinthe KERIO, est né à Plumergat le 5/06/1886. Les Kério sont originaires de Grand Champ et se sont établis à Séné à la fin du XIX°siècle. Ses parents étaient agriculteurs à Gornevez, comme nous l'indique le dénombrement de 1901.
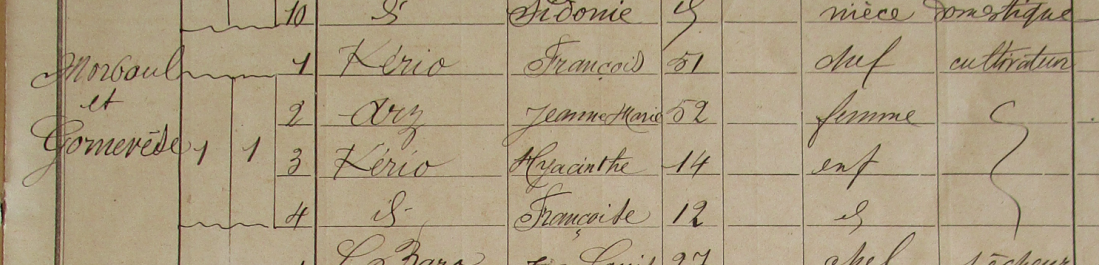
Après l'école, le jeune Hyacinthe choisira de devenir pêcheur. Il débute mousse le 24 mai 1902 sur son premir canot la "Belle Rose" puis le canot St Patern et le canot St Cado. Il devient novice sur le "Margarita" et enfin matelot en juin 1905 sur le Rouanez er Mor. Il effectue sa concription de juin 1906 à avril1910. Il passe par les 3° et 5° Dépôts et officie sur le Couronne, le Charles martel et le Henri IV. A son retour il s'établie au village de Cadouarn.
A Séné, il est patron de la chaloupe Fleur de Marie.
Léonie LE DORIOL nait à Cadouarn le 21/09/1887. Comme nous l'indique le dénombrement de 1911, c'est l'ainée d'une famille de 8 enfants. Son père est marin pêcheur et sa mère marchande de poissons. A la veille de son mariage, âgée de 24 ans, elle aide sa mère comme son frère ainée travaille avec son père à la pêche.
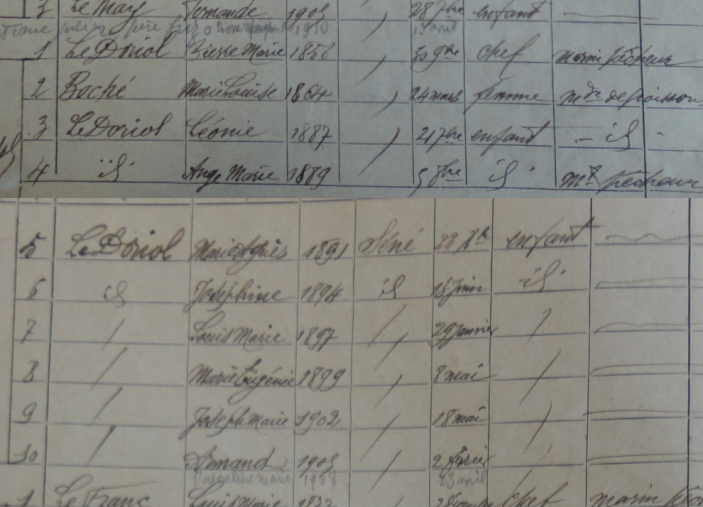
A son retour du service militaire, Hyacinthe épouse Léonie à Séné le 9 mai 1911. Le jeune couple fonde une famille. Les registres de l'état civil et les sites de généalogie nous indiquent que la famille KERIO a cependant perdu deux enfants en bas âge, pendant la guerre de 14-18 : Hyacinthe [1915-1915] et Ferdinand [1916-1917]. Son statut de père lui évite sans doute des postes très exposés pendant la guerre. Il est affecté dans les Bataillon des Patrouilles de la Loire et de la Bretagne et il est démobilisé en juillet 1919.

Léonie Le Doriol
La famille KERIO apparait au complet au dénombrement de 1926 établie au village de Langle. En 1925, Hyacinthe fait construire un nouveau bateau de pêche auquel il donne le nom de "Léonie ma chère"!
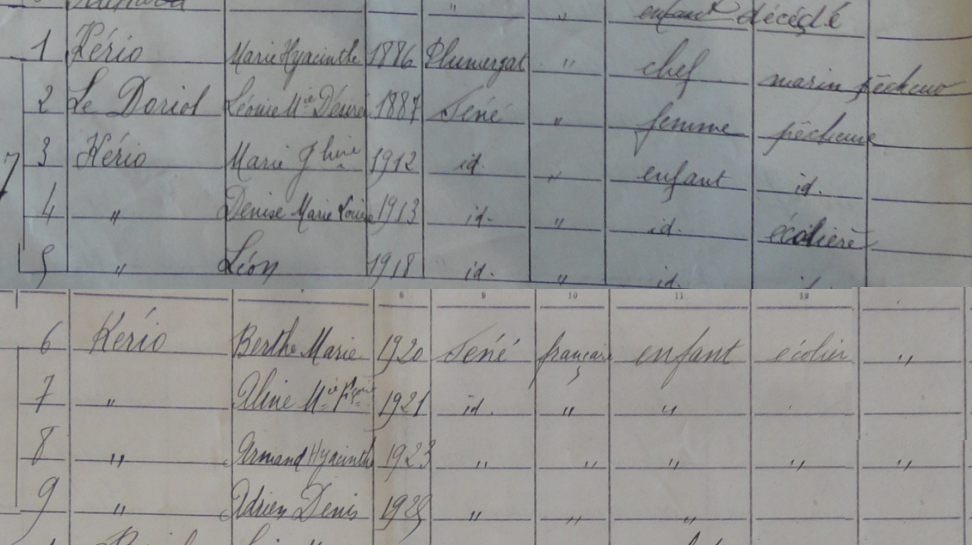
A la veille de la naissance des 3 jumelles, la famille compte déjà 7 enfants et non 10 comme le rapporte le journal. Les autres enfants sont sans doute des domestiques. La situation particulière de cette famille nombreuse interpelle une lectrice abonnée au Nouvelliste. A la veille de Noël, la Baronne de Lagatinerie adresse un courrier au journal que celui-ci relaie avec un gros titre mobilisateur :
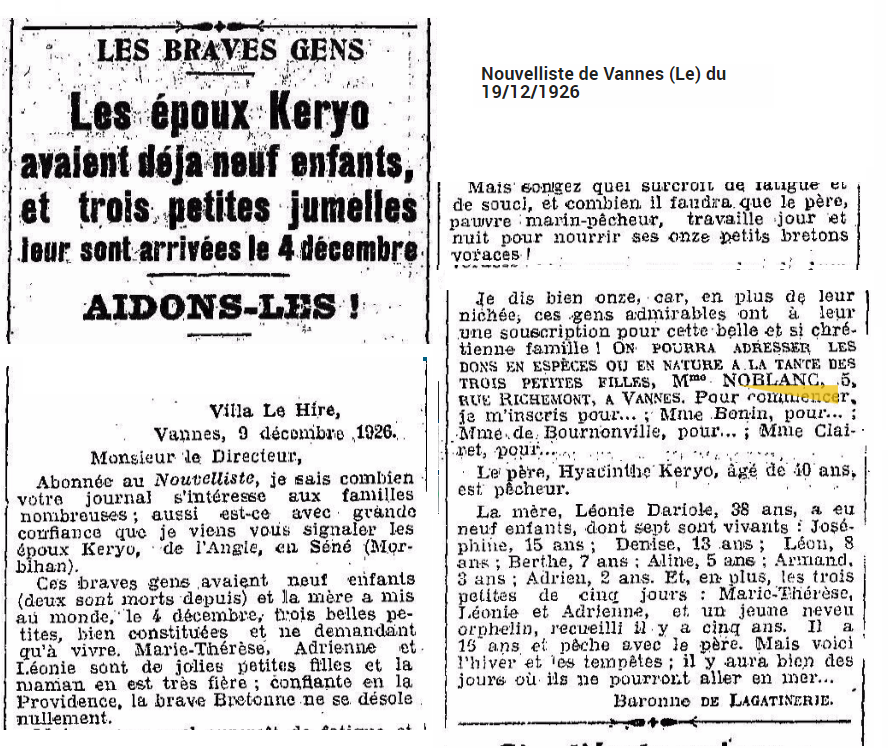
En effet, cette naissance de triplés n'est pas anodine pour l'époque. Avant les progrès de l'hygiène et de la médecine, il arrivait souvent que les jumeaux ne survivent pas où qu'un seul d'entre eux arrive à l^'age adulte. Quel sera le devenir des trois jumelles Kerio ?
Mais le bonheur familial des KERIO va être terni par un drame quelques semaines plus tard...
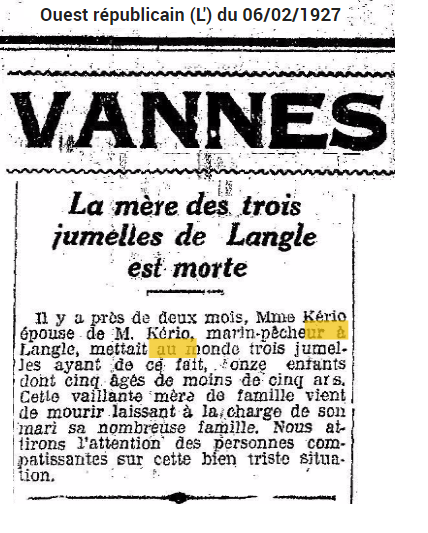
"Après le joyeux carillon du baptême des trois jumelles, ce fut le glas funèbre qui tomba sur la campagne de Séné" Ouest Républicain
Cet autre article du Ouest-Républicain, nous apprend la mort de Mme KERIO. Léonie, la mère courage, qui a accouché 10 fois entre 1912 et 1926, ne se remets pas de la naisance de ses 3 dernières petites filles. Epuisée d'avoir tant donner la vie, elle décède le 2 février 1927 à l'âge de 40 ans !
Comment le pêcheur KERIO, devenu veuf à 41 ans, va-t-il faire pour concilier la pêche et s'occuper de ses 10 enfants ?
La grand-mère Le Doriol est mise à contribution. La solidarité familiale va prendre le relai mais pas qu'elle !
Cette situation familiale ne laisse pas insensible le journal Ouest Républicain qui lance une souscription auprès de ses lecteurs, comme nous l'indique l'article suivant qui nous apprend que la famille KERIO, non seulement éleve ses enfants, mais a accueilli également un neveu orphelin ! Le jeune Ange PIERRE [1910-1992] a perdu son père en mer [lire le récit des marins charbonnier PIERRE] et sa mère, Marie Julienne KERIO, la soeur de Hyacinthe.
L'article est bien écrit et le résultat ne se fait pas attendre. Les dons affluent d'un peu partout dans le Morbihan. Le 12 mars 1927, L'Ouest Républicain rend compte à ses lecteurs du résultat de la souscription qui rapporte 2479 francs.
Mais je journal ne s'arrête pas là !

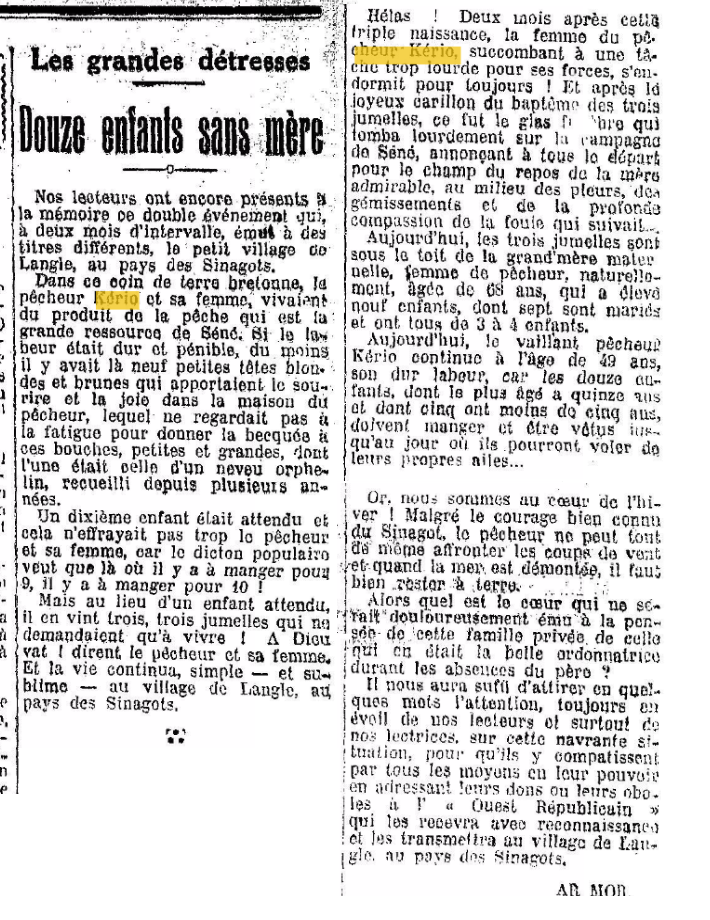
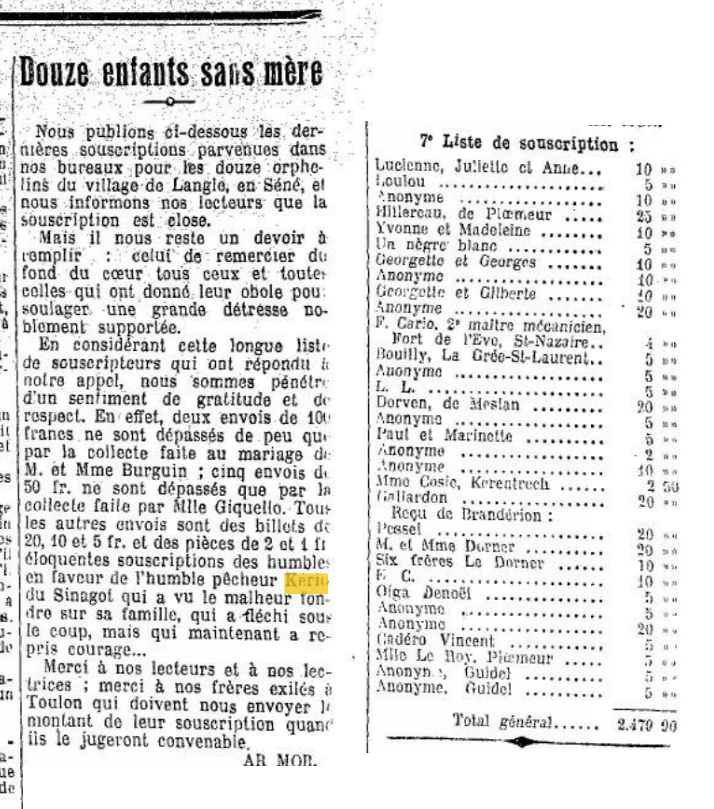
Le 7 avril 1927, dans ces colonnes, le journal relate une viste faite aux orphelins KERIO.
Lire l'article complet ci-dessous qui décrit très bien le quotidien d'une famille de pêcheurs à Langle.
Le journaliste revient voir la famille KERIO pour informer les donateurs du "bon usage" qu'a été fait de leur argent.
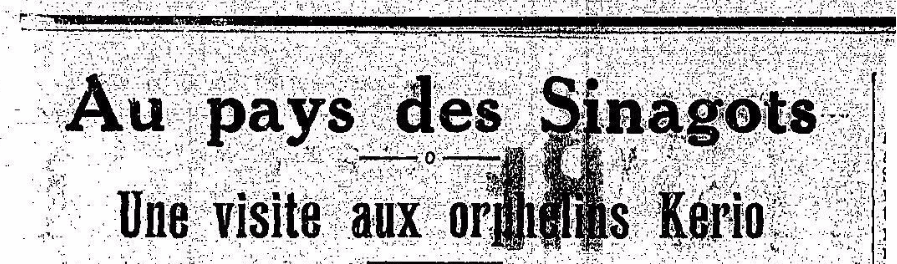
A la faveur de cet article Marie Hyacinthe KERIO remercie les donateurs :
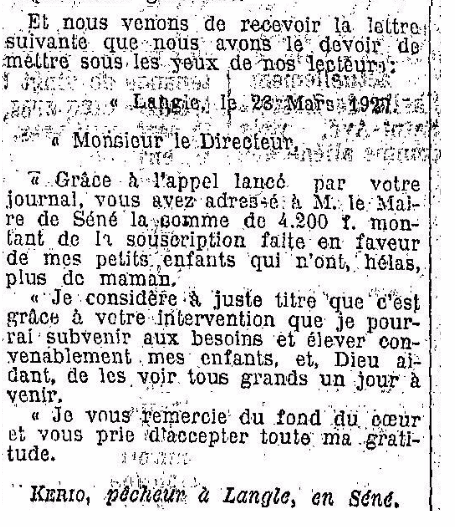
"Et Dieu aidant, de les voir tous grands un jour à venir".
Les années ont passées. Le sort des jumelles KERIO est tombé dans l'oubli. Que sont-elles devenues. Le bon lait acheté pour les allaiter a-t-il fait d'elles des enfants en bonne santé, arrivés à l'âge adulte ? Que sont devenues les trois jumelles de Léonie ?
Les registres d'état civil de Séné,on l'espère, vont nous donner des indications sur leur vie ? Leurs naissances sont bien inscrites : trois KERIO à la queue leu leu, nées le 4 décembre 1926.
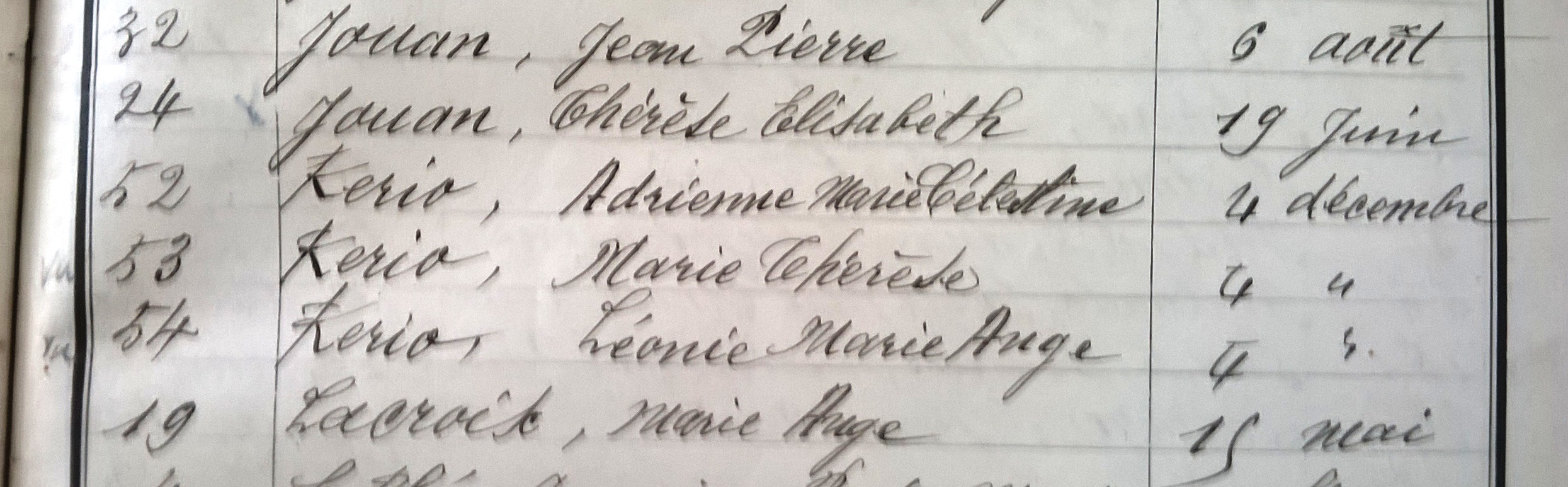
Les extraits de naissance comportent bien des mentions marginales. Elles ont vécu. Toutes sont arrivées à l'âge adulte. Les dons des souscripteurs, la mobilisation de Ouest Républicain, la solidarité familiale, le labeur de Hyacinthe KERIO ont bien oeuvré.

On ne sait si l'ordre d'inscription à l'état civil respecte leur venue au monde...
Adrienne Marie Célestine s'est mariée à Pluneret, le 18 août 1947, avec Albert Louis LE LAN et par la suite elle a été adoptée par la famille Bauché de Sainte Anne d'Auray le 22/07/1953.
Marie Thérèse s'est mariée à Pierrefitte, département de la Seine (aujourd'hui Seine-Saint-Denis), le 16 avril 1950 avec André Aristide René MAURICE.
Léonie Marie Ange a épousé à Vannes, le 11 avril 1947, Guy Jean ALKERMANN.
Quant à Hyacinthe KERIO, son souhait de voir grandir ses enfants a été exaucé, Le marin veuf se remariera le 14 mai 1955 avec Anne Louise METAIRIE. Il décèdera le 25 avril 1970 à Dangam, à l'âge de 84 ans.
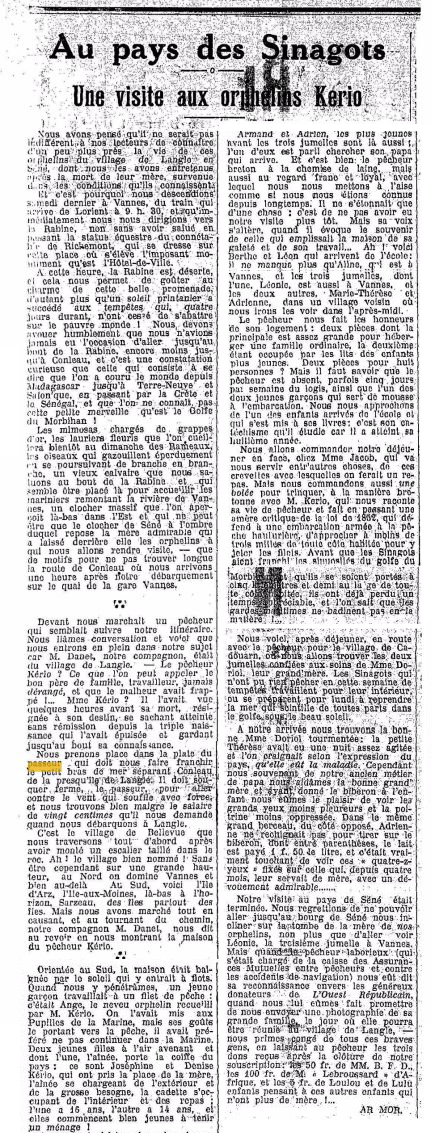
Les maires de Séné de la Révolution à 1870
Maire de Séné de la Révolution à 1870
Sous l’ancien régime, à Séné, le recteur était l’officier de l’état civil qui enregistrait les baptêmes, les mariages et les sépultures dans sa paroisse. Après la Révolution, le gouvernement a repris ces fonctions qui ont été dévolues aux maires des nouvelles communes.
Le recteur en poste à Séné avant la Révolution était Guillaume JALLAY :
« Guillaume Jally, de Saint Patern, heureux au concours du 10 février 1750, fut pourvu par le pape,le 23 mars et pris possession de sa cure le 11 mai. Décédé au presbytère à l’âge de 73 ans, le 14 décembre 1789, il fut inhumé le 15 dans le cimetière, auprès de son prédécesseur (Pierre Le Nevé). Jusqu’à la construction de l’église, on voyait encore sa tombe. »
Source Camille Rollando.
Jallay assure une dernière sépulture le 28 décembre 1788. Avant la nomination d’un nouveau recteur à Séné, plusieurs curés ou prêtres assurent l’intérim, si on se réfère aux signatures en bas des registres paroissiaux. On note les noms de LE BAIL, MOGUEN, LE PRIOL et LE GUEZEL .
A partir de janvier 1790, le nom de Pierre COLENO apparaît en tant que recteur.
«Pierre Coléno, de Billers et curé de Plescop. pourvu par l’évêque le 17 décembre 1789, il en prit possession le 18. Sans que nous sachions ce qu’il devint pendant les mauvais jours, il disparut en septembre 1792. Maintenu à la tête de sa paroisse après le Concordat, il prêta serment entre les mains du Préfet le 15 octobre 1802. Il mourut en 1822. »
Source Camille Rollando.
Les signatures en bas des actes paroissiaux indiquent que Pierre Coléno est assisté d’autres ecclésiastiques comme Le Bail, Tual, Le Toullec.
Le 2 août 1792, Pierre Coléno est encore recteur.
Le 30 Août un certain Julien Le Dû, qui deviendra maire, et Pierre Coléno signent ensemble un acte d’état civil.
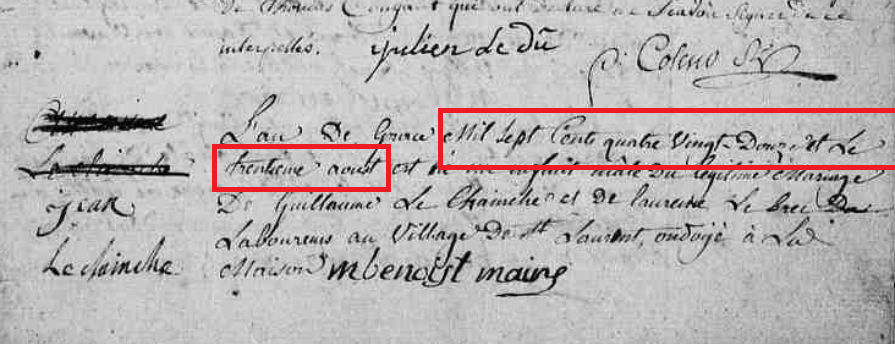
Le 30 août 1792 on note que Marc BENOIST signe un acte en tant que maire de Séné.
LISTE DES MAIRES DE SENE DE 1792 à 1870
Marc BENOIST : 9/1792 – 12/1792 [8/10/1750 - 20/06/1813] Laboureur - Moustérian
Julien LE DU : 1/1793 à 7/1800 [ 27/05/1749 - 26/08/1826] Laboureur - Bourg.
Vincent LE LUHERNE : 7/1800-9/1804 [5/04/1759 Kerbiscon - 18/05/1832 Surzur] Laboureur - Kerbiscon
Gervais EVENO : 11/1804 – 6/1807 [15/07/1754 - ] Laboureur - Kernipitur
Guillaume LE CLAINCHE : 7/1807 – 12/1814 [3/10/1763 Elven - 30/11/1814 Séné] Laboureur - Saint-Laurent
Vincent MAIGRO – 1/1815-9/1815 [28/01/1773 - 5/8/1849 Vannes ] Aubergiste - négociant - Brigadier
Hyacinthe LAURENT : 9/1815-4/1824 [6/03/1778 - 24/04/1823] Laboureur à Kernipitur.
Joseph LE RAY : 1/1825-9/1830 [19/09/1768 - 29/12/1849] Laboureur Michotte
François CALO 9/1830 – 2/1835 [25/09/1789 - 25/08/1856] Paludier. Kerfontaine
Vincent ROZO : 2/1835 – 3/1844 [ 25/07/1796 - 19/03/1844] fournier (boulanger). Cariel
Pierre LE DOUARIN : 5/1844 – 8/1848 [1/07/1806 - 14/02/1854 ] Gouavert - Laboureur
Mathurin LE DOUARIN 8/1848 – 5/1871 - [6/01/1803 - 2/05/1871] Laboureur - Ozon

La Révolution - 1ère République - Directoire
Une histoire des maires et des municipalités ne peut vraiment commencer qu’avec la Révolution, puisque c’est le 14 décembre 1789 que la première loi municipale est votée. Désormais, toutes les assemblées d’habitants, quelle que soit leur importance, ont la même organisation municipale, avec un maire et des conseillers élus à leur tête. Le 22 décembre, 44 000 municipalités sont mises en place en France (autant que de paroisses). En 2017, on répertorie 35416 communes en France dont 126 outre-mer.
Certains dirigeants révolutionnaires (les constituants) auraient préféré des regroupements de communes, cependant, les représentants des communautés villageoises les obligèrent à respecter chacune des anciennes paroisses. On doit parler désormais de « communauté d’habitants » et non de paroisse, mais les habitudes étant là, l’usage du nouveau terme fut certainement long à être tout à fait adopté. La nouvelle législation consacre la démocratisation des nouvelles municipalités, certes limitée par les règles étroites du suffrage censitaire* qui reste de règle, car pour être électeur, il faut payer un impôt au moins égal à trois journées de travail (soit environ 3 livres). Les plus pauvres sont, par conséquent, écartés : autant dire que les électeurs ne sont pas nombreux dans les communes. L’électeur est déclaré « citoyen actif ». Les élus doivent payer un impôt au moins équivalent à dix journées de travail. Les membres du conseil étaient divisés en deux échelons : les notables, dont le nombre variait de 6 à 42 suivant la population de la commune, et les officiers municipaux, aux nombre de 3 à 21. Ces officiers composaient le corps municipal, élément actif et permanent du conseil général de la commune. L’agent municipal (ou maire) est, en principe, élu pour deux ans (les changements politiques étant souvent répercutés automatiquement jusque dans les communes) et il ne pourra être réélu qu’après une attente de deux ans. Il existait aussi un procureur de la commune, élu dans les mêmes conditions que le maire, chargé de requérir l’exécution des lois. Le corps municipal pouvait siéger en tribunal de simple police : dans ce cas, le procureur syndic remplissait les fonctions d’accusateur public. Il avait, par ailleurs, voix consultative dans toutes les affaires. Cette organisation fonctionna jusqu’en 1795.
Pendant la Terreur, les conseils municipaux comme les districts se montrèrent les organes actifs du gouvernement révolutionnaire, aussi la constitution de l’an III les supprima-t-elle et ne laissa, dans chaque commune rurale, qu’un agent municipal avec son adjoint.
1790 : Les premières élections municipales eurent lieu en février 1790. Le maire fut ensuite immédiatement installé après le grand rite de la prestation de serment. La loi du 19 avril de 1790 stipule : « Lorsque le maire et les officiers municipaux* seront en fonction, ils porteront pour marque distinctive, par dessus leur habit, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc, attachée d’un nœud, et ornée d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, et violette pour le procureur de la commune ». En 1791, les gardes champêtres font leur apparition, et à partir de cette date, et au moins jusqu’en 1851, maires et officiers de la garde nationale feront régner la loi - bien souvent « leur loi »
Le maire est un roturier, les nobles se cachent à l’étranger, et ceux qui sont restés sur leurs terres cherchent à se faire oublier. Les bourgeois prennent maintenant leur place. La « maison commune », où « mairie », n’existe pas vraiment encore dans les villages et il faudra attendre 1884 pour qu’elle soit obligatoire. Le lieu de réunion et de délibération du conseil municipal est le plus souvent l’auberge.
21 juin 1791 La fuite de Louis XVI s’arrête à Varennes.
1791 : Le premier renouvellement des municipalités a lieu en novembre 1791.
Avec les dangers extérieurs et intérieurs, un nouveau régime s’installe et la révolution se radicalise en septembre 1792 ; le roi est déchu et la république proclamée.
1792 : Le second renouvellement a lieu en novembre 1792, le suffrage universel* est désormais la règle. Le serment est le suivant : « Je jure d’être fidèle à la nation et de maintenir de tout mon pouvoir la liberté, l’égalité ou de mourir à mon poste ». Le maire prend de plus en plus de pouvoir : délivrance de « certificats de civisme », de « certificat d’indigence » permettant d’échapper à certains impôts, mais il est très rare qu’il meure à son poste... De ce fait, il est respecté, il est obéi, mais soulève parfois la colère et la haine. C’est lui qui lit les textes de loi, soit en chaire à l’église, juste avant la messe, soit devant la porte de l’église à la sortie de la messe. Ses rapports avec le curé se dégradent au moment de planter l’arbre de la liberté, celui-ci prenant bien souvent l’emplacement d’une croix....


xxxxxx VVVVVVV : 02/1790-8/1792
????
Marc BENOIST : [8/10/1750 - 20/06/1813] Moustérian - Laboureur 9/1792 – 12/1792 = 3 mois
Marc BENOIST qui signe un acte d'état civil et appose la mention "maire" en septembre 1792. Il est le fils d'un charpentier de marine de Moustérian. Il épouse à Saint-Patern à Vannes le 20/10/1787 Marguerite OILLIC. Sur son acte de décès, il est mentionné la profession de laboureur et une demeure à Moustérian. Son arrière petit-fils, Eugène BENOIT, sera également maire de Séné à la Libération.
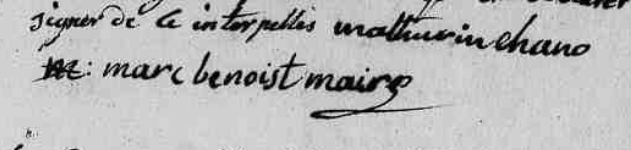
Un renouvellement a lieu durant l'An II, soit fin 1793.
En décembre 1793 (frimaire an II suivant le calendrier républicain*), un décret rend l’école obligatoire, gratuite et laïque dans chaque commune. Néanmoins, les petites communes ne sont pas suffisamment riches pour acheter ou construire une maison pour l’école, comme pour la mairie d’ailleurs. Les « communautés d’habitants » deviennent désormais « communes » et un « agent national » est nommé par le gouvernement pour surveiller les élus. Cette charge d’agent national restera jusqu’en avril 1795.
Début 1795 (an III de la République), le renouvellement des municipalités suit la chute des conventionnels et l’arrivée des thermidoriens. Ces derniers, par la constitution qu’ils instaurent le 22 août (5 fructidor) de la même année, enlèvent toute influence des municipalités en les regroupant dans des municipalités cantonales. Chaque commune élit dorénavant un agent municipal qui participera à la municipalité cantonale. Les maires passent dorénavant sous l’autorité des « présidents des municipalités cantonales», les seconds étant élus par l’ensemble des hommes du canton. Le président des municipalités cantonales est assisté d’un «commissaire du Directoire », nommé par le pouvoir central. Les parents d’émigrés sont exclus du pouvoir local.
Julien LE DU : [ 27/05/1749 - 26/08/1826] Laboureur - Bourg. 1/1793 à 7/1800 = 7 ans
Le premier acte de Julien LE DU est daté du 16 nivôse An I, soit le 5 janvier 1793. Il signe en tant qu’Officier Public de la Municipalité de Séné.
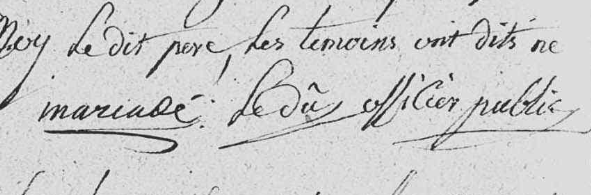
Par la suite sa signature évolue pour adopter les terme de Secrétaire et greffier à partir de mai 1800.
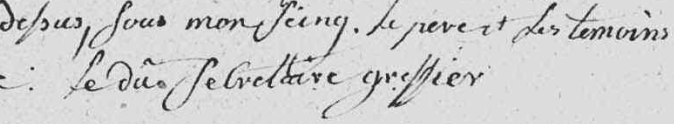
Julien LE DU est né le 27 mai 1749 au bourg de Séné. Il se marie le 17 février 1784 à Noyalo avec Françoise Le Lagadec. Il décède au bourg de Séné en 1826.
Consulat et 1er Empire 1799-1815
Le coup d’état du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) amène Bonaparte au pouvoir. Celui-ci maintient provisoirement les municipalités de canton et les élus doivent prêter un nouveau serment : « Je jure d’être fidèle à la République une et indivisible, fondée sur la liberté, l’égalité et le système représentatif ». Cependant, trois mois plus tard (le 28 pluviôse an VIII = 17 février 1800) une nouvelle loi municipale est instaurée et change complètement le système d’instauration des maires. Cette nouvelle loi allait dans le sens de ce que réclamaient les paysans qui tenaient à avoir dans leur commune leur propre conseil municipal et leur maire, mais elle devenait beaucoup moins démocratique puisque l’élection du maire, appliquée en 1790, était supprimée à partir de la constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), celui-ci est dorénavant nommé. Maires et conseillers deviennent donc des fonctionnaires de fait (sans rétribution), choisis sur une « liste de confiance », par le Premier consul* pour les communes de plus de 5 000 habitants, par le préfet pour les autres. La « liste de confiance » est établie dans chaque commune par élection. Elle comprend le dixième des électeurs. C’est le retour des notables : la « liste de confiance » devient d’ailleurs très vite une « liste de notabilité ». Cependant, dans les petites communes, au-dessous de 1 000 habitants, ce sont en majorité des paysans, bien que les notaires soient recherchés par les préfets pour leurs capacités à la rédaction et à l’élocution. Néanmoins, le maire ne peut pas être totalement ignorant et doit au moins savoir lire et signer.
La seconde grande loi municipale (celle du 28 pluviôse = 17 février 1800) classe les communes en cinq catégories : au-dessous de 2 500 habitants, de 2 500 à 5 000 habitants, de 5 000 à 10 000 habitants, de 10 000 à 20 000 habitants, au-dessus de 20 000 habitants. L’appellation de maire revient, il remplace celui d’agent municipal*. Le maire est assisté d’un adjoint. Les officiers municipaux* deviennent des conseillers municipaux.
Le 17 ventôse an VIII (8 mars 1800) un arrêté oblige les municipalités en place à faire l’état du mobilier et des registres communaux. En mai-juin, maires et conseils municipaux des entités communales de moins de 5 000 habitants sont nommés par le préfet. Le maire, nommé pour trois ans, prête serment devant l’ancien agent municipal* et l’adjoint prête serment devant le maire.
À compter du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801) le maire est chargé seul de l’administration de la commune et les conseillers ne sont consultés que lorsqu’il le juge utile. Le maire exerce ce pouvoir absolu jusqu’en 1867.
Vincent LE LUHERNE : [5/04/1759 Kerbiscon - 18/05/1832 Surzur] Laboureur - 7/1800-9/1804 = 4 ans
Vincent Le LUHERNE signe un premier acte le 9 juillet 1800, soit le 20 messidor de l’An VII.
A partir du 4 brumaire de l’An XII, soit le 26 octobre 1804, son adjoint Le Bras signe les actes.
Il est né le 5/04/1759 à Kerbiscon à Séné où son père est laboureur. Il se marie à Saint-Avé le 9/02/1781 avec Perrine LE BERRIGAUT. Il décède à Surzur au village de Lambré le 18/05/1832.

Gervais EVENO : [15/07/1754 - ] Laboureur - Kernipitur - 11/1804 – 6/1807 = 3 ans
Gervais EVENO signe un premier acte en tant que maire de Séné le 17 brumaire de l’An XII, soit le 8 novembre 1804. Il restera en poste jusqu’en juin 1807. Il nait au village de Kernipitur et son père est laboureur. Il se marie le 24/02/1778 avec Françoise LE CLAINCHE.
(acte de décès pas trouvé !)
Guillaume LE CLAINCHE:[3/10/1763 Elven - 30/11/1814 Séné] Laboureur - St-Laurent - 7/1807 – 12/1814 = 7 ans
Guillaume LE CLAINCHE succède à Eveno. Natif d'Elven, il devient Sinagot par mariage avec Laurence Le Brec le 18/08/1789. Il décède le 30 novembre 1814 à l’âge de 51 ans. « L’adjoint faisant pour le maire », Vincent LE LAN assure l’intérim.
Vincent MAIGRO – 1/1815-9/1815 [28/01/1773 - 5/8/1849 Vannes ] - 1/1815-9/1815 = 8 mois
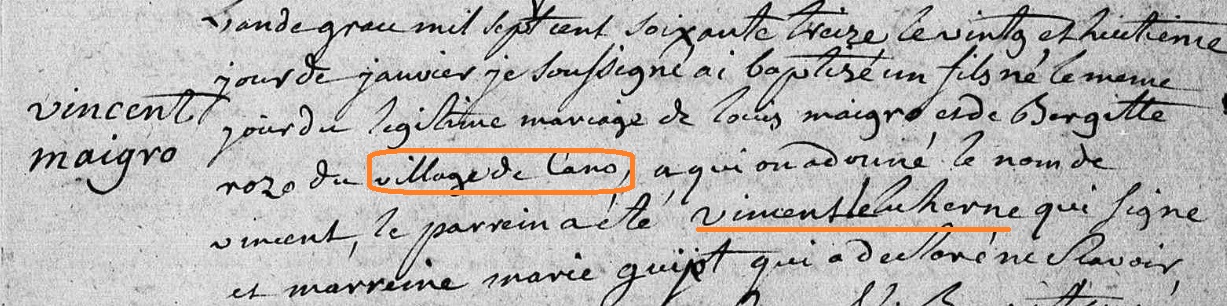
Il est né au sein d'une famille de cultivateurs de Cano comme nous le confirme son acte de naissance qui indique que son parrain était Vincent LE LUHERNE, ancien maire de Séné . Les registres de l'état civil montrent que Vincent MAIGRO commence à signer des actes en janvier 1815 jusqu'en septembre 1815. Il sera le dernier maire de Séné sous le règne de Napoléon.
Il se marie avec la Vannetaise Marie France Le THIESE [20/11/1793-14/1/1830] dont il aura plusieurs enfants. Lors de la naissance de Felix Victor (19/1/1812-28/10/1838) qui deviendra brigadier au 11° régiment de Chasseurs à Bourbon Vendée (La Roche sur Yon), il déclare la profession d'aubergiste au bourg. Quand nait son fils Philippe (25/5/1814), il déclare la profession de négociant en vin et en tabac et réside au bourg. Puis viendra Vincent (14/4/1818) et Anne Marie (12/10/1824). Il est alors cabaretier au Poulfanc, puis Marie [ca 1829 -25/6/1850]. Quand son épouse décèede en 1930, il est brigadier aux Ponts & Chaussées. Lors du mariage de sa fille Elisabeth en 1840, il déclare être retraité militaire; A son décès il est mentionné qu'il est sous-officier en retraite.
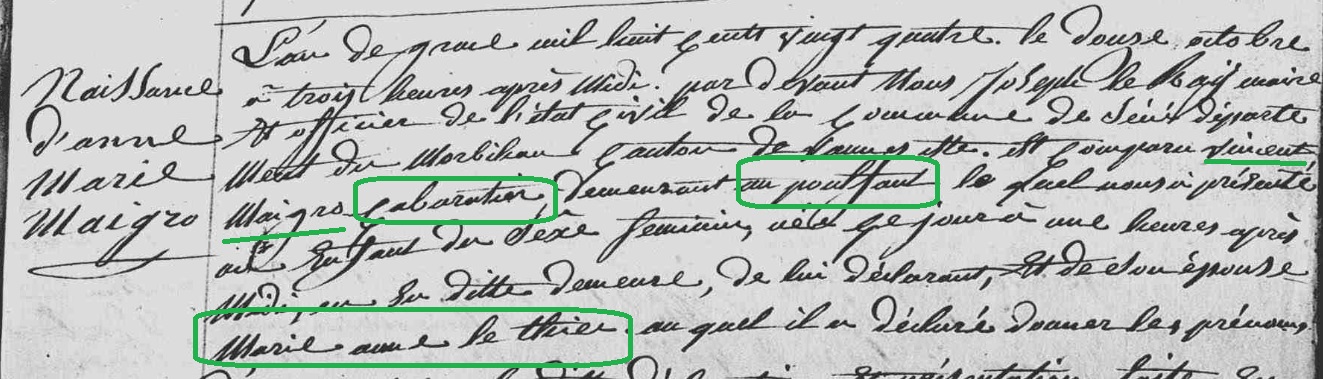
La Restauration 1815-1830
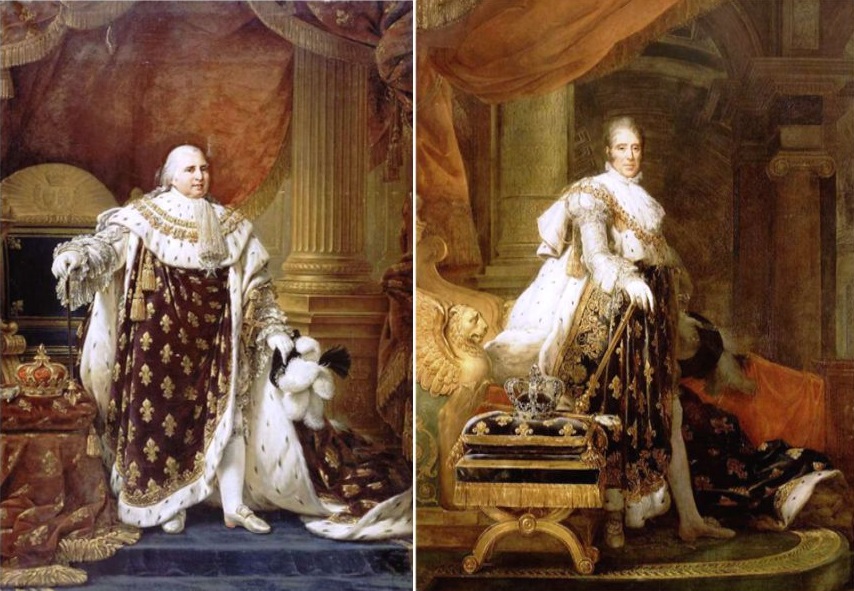
Lors de la première Restauration* (avant le retour de Napoléon de l’île d’Elbe, le 1er mars 1815), Louis XVIII ne touche pas à l’institution municipale napoléonienne. Les nouveaux préfets s’empressent de désigner des maires royalistes. Cependant, avec le retour à l’Empire (les Cent-Jours*), paraît le 20 avril 1815 un décret réinstituant, pour les communes de moins de 5 000 habitants, la vieille loi de décembre 1789, c’est-à-dire l’élection au suffrage censitaire* des maires et des conseillers. Les élections ont lieu en mai 1815 et les maires, ainsi élus, n’auront que quelques jours de pouvoir puisque le mois suivant voit la défaite de la Grande Armée à Waterloo, l’exil de Napoléon à Sainte-Hélène et le retour de Louis XVIII.
C’est le début de la seconde Restauration*. Les maires écartés en mai sont rétablis dans leur fonction, mais le renouvellement est fixé à l’année suivante : 1816. Le pouvoir instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux. L'entrée en charge donne lieu à une cérémonie d'installation
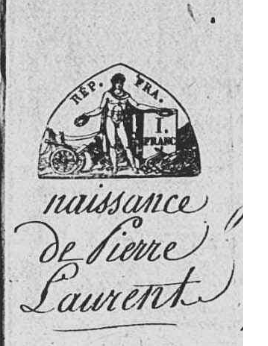
Hyacinthe LAURENT : [6/03/1778 - 24/04/1823] Laboureur à Kernipitur - 9/1815-4/1824 = 9 ans
Hyacinthe LAURENT est nommé maire de Séné. Son acte de mariage daté du 26 pluviose An X (16/02/1802) nous indique qu'il est laboureur à Kernipitur, sa femme Marie Jeanne Boursicaut est du village de Saint-Laurent. Il décède le 24/04/1823 à Kernipitur et l’adjoint Dagoral assure l’intérim.
Son père Mathurin était natif de Locminé et s'est établi à Séné où tous ses enfants sont nés. La famille Laurent donnera par trois fois un maire à Séné.
Joseph LE RAY : [19/09/1768 - 29/12/1849] Laboureur Michotte - 1/1825-9/1830 = 5 ans et 8 mois
Joseph Guillaume LE RAY nait dans une famille de laboureur à Michot. Pendant le mandat de Vincent LE LUHERNE, il est son adjoint. Ses premiers actes d’état civil en tant que maire apparaissent en janvier 1825. Il s'est marié le 22 Vendimaire de l'an VI soit le 17 octobre 1797 avec Marie lE ROUX. Son dernier acte de décès est daté du 24/09/1830.
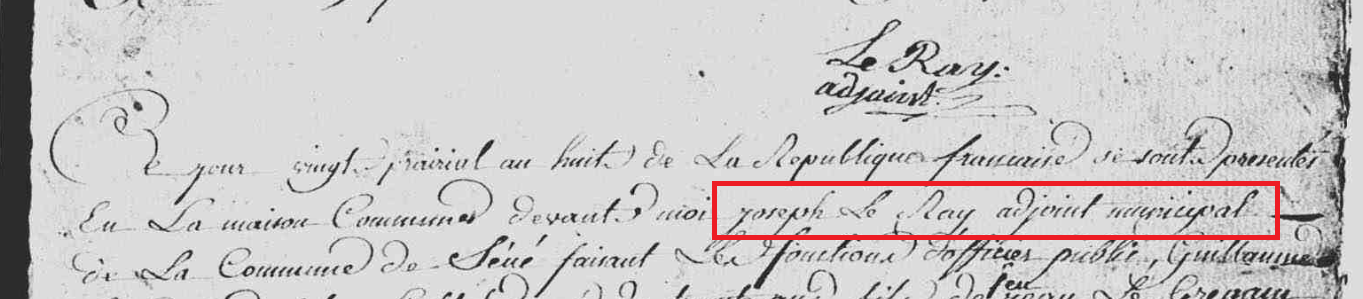
Révolution de 1830 - Monarchie de Juillet 1830-1848
En effet, la Révolution de 1830 s'accompagne d'une épuration massive. Le nouveau régime craint de ne pouvoir compter sur le dévouement d'hommes liés à la Restauration. Ainsi, des préfets et des sous-préfets sont destitués. Le ministre de l'Intérieur, envoie des commissaires dans les départements. Ils reçoivent l'ordre de remplacer provisoirement tous les maires.

François CALO [25/09/1789 - 25/08/1856] Paludier - Kerfontaine - 9/1830 – 2/1835 = 4 ans et 5 mois
François CALO est nommé par le préfet dans l'attente des nouvelles élections. Ses premiers actes signés datent de fin septembre 1830. Qui est-il ?
Les archives du Morbihan nous apprennent que François CALO ou Caloch est né au bourg le 25 septembre 1789. Son père Pierre et sa mère Marie PALUD sont paludiers. Il se marie le 18 février 1813 à l'âge de 24 ans avec Marie Richard, fille de paludier installée à Michot. Lors de son décès à l'âge de 68 ans le 25/08/1856, il etait toujours paludier à Kerfontaine.
La loi sur l'organisation municipale du 21 mars 1831 transforme profondément la vie politique communale : les conseillers municipaux sont désormais élus. Le conseil municipal est renouvelé par moitié tous les trois ans. A titre transitoire, pour les élections municipales de 1834, le sort désigne la moitié des conseillers sortants.
Pour voter aux élections municipales, il faut être âgé d'au moins 21 ans et faire partie des contribuables les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune. La liste des électeurs est dressée par le maire, assisté du percepteur et des commissaires répartiteurs et mise à jour, chaque année, entre le 1er janvier et le 31 mars. Les contribuables sont inscrits par ordre décroissant en fonction du montant de leur imposition. La liste est affichée. Les conseillers municipaux sont choisis parmi les électeurs communaux et doivent être âgés d'au moins 25 ans. Ils sont élus pour six ans.
Cependant, le nouveau régime monarchique prévoit que le maire et l'adjoint des communes de moins de 3000 habitants sont nommés par le préfet au nom du roi. Ils sont obligatoirement choisis parmi les membres du conseil municipal. Ils doivent être âgés d'au moins 25 ans et résider dans la commune, ils sont nommés pour trois ans.

1831 : Lors des premières élections municipales de la Monarchie de Juillet, qui ont lieu en novembre 1831, François CALO reste maire de Séné.
1834 : Aux élections de1834, une moitié de conseillés, tirés au sort parmi ceux élus en 1831, sont renoluvelés. François CALO est à nouveau désigné maire.
Quelle décision prend le préfet en février 1835 ? Vincent ROZO succède à François CALO qui décèdera en 1854 au village de Kerfontaine.
Vincent ROZO : [ 25/07/1796 - 19/03/1844] fournier (boulanger). Cariel - 2/1835 – 3/1844 = 9 ans et 1 mois
Vincent marie ROZO nait au village de Cariel. Son père est fournier, c'est à dire boulanger. Lors de son mariage avec la fille du charpentier Mlle ROZO, il est également fournier à Cariel.
1837 : Elections d'une moitié de conseillés, Vincent ROZO est reconduit par le Préfet dans sa fonction de maire.
La loi sur l'administration municipale du 18 juillet 1837 définit les attributions des maires et des conseils municipaux. Le maire administre seul la commune. Il agit sous l'autorité, sous la surveillance de l'administration préfectorale. Il propose le budget. Il gère les propriétés de la commune. Il souscrit les actes de vente et d'acquisition. Il passe les adjudications des travaux communaux. Il dirige les travaux communaux. Le maire est chargé de la police dans sa commune et peut prendre des arrêtés et nomme, avec l'approbation du conseil municipal, le garde champêtre. Le conseil municipal vote le budget. L'achat, la vente, l'entretien et l'affectation des propriétés communales doivent faire l'objet de délibérations. Même chose pour les travaux à entreprendre : démolitions, grosses réparations, constructions. Le conseil municipal examine chaque année les comptes du maire. Il donne en outre son avis sur les questions relatives au culte et à la bienfaisance. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques. Les délibérations se prennent à la majorité des voix. Elles sont inscrites, par ordre chronologique, dans un registre coté et paraphé par le sous-préfet et sont signées par tous les conseillers présents à la séance. Les délibérations sont contrôlées par l'administration préfectorale.
1840 : Elections d'une moitié de conseillés. Le Préfet reconduit Vincent ROZO.
1843 : Elections d'une moitié de conseillés. Le Préfet reconduit Vincent ROZO qui décède le 19 mars 1844. Son adjoint René Marie Simon assure l'intérim de mars à mai 1844, date des prochaines élections. Sur son acte de décès, on peut lire que sa fonction de maire a été inscrite par son adjoint.
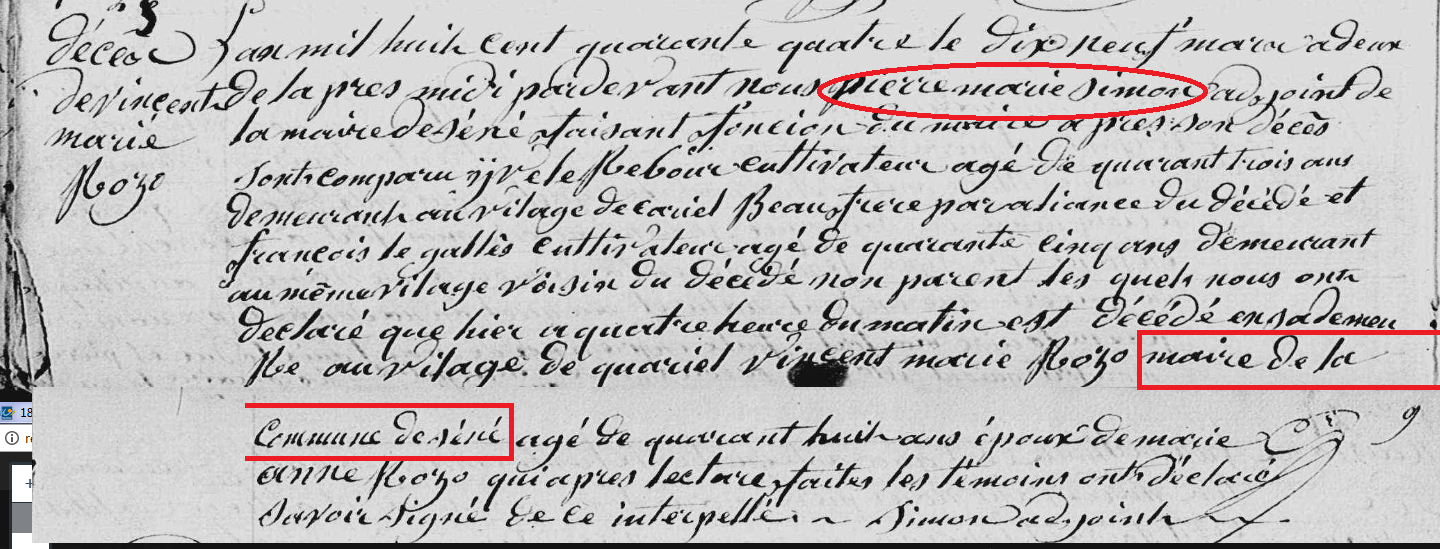
Pierre LE DOUARIN : [1/07/1806 - 14/02/1854 ] Laboureur - 5/1844 – 8/1848
Pierre LE DOUARIN est nommé par le Préfet et signe ses premiers actes dès mai 1844. Il nait en 1806 au village de Gressignan, il se marie le 7/10/1828 avec Marie COURET et décèdera au village de Gouavert en 1854.
1846 Elections municipales en 1846 pour la moitié des conseillers. Pierre LE DOUARIN est reconduit par la Préfet.
Révolution de 1848 - 2° République 1848-1852 - Second Empire : 1852-1870
La II° République est proclamée le le 25 févier 1848. Le décret du 3 juillet 1848 ordonne le renouvellement intégral de tous les conseils municipaux. Pour voter, il faut avoir 21 ans et être domicilié depuis au moins six mois dans la commune. Pour être élu conseiller, il faut avoir 25 ans et être domicilié dans la commune ou, à défaut, y payer des impôts. Les dimanches 30 juillet et 6 août 1848 ont lieu les premières élections municipales au suffrage universel. Le maire et l'adjoint ne sont plus nommés par le préfet mais choisis par le conseil municipal et pris en son sein.

Mathurin LE DOUARIN 8/1848 – 5/1871 - [6/01/1803 - 2/05/1871] Laboureur - Ozon
1848 Après les élections d'août 1848, Mathurin LE DOUARIN est élu par le Conseil Municipal. C'est le demi-frère de Pierre LE DOUARIN, l'ancien maire.
Que sait-on de lui ?
Il nait le 17 nivôse de l’An XI, soit le 6 janvier 1803 à Séné comme nous l'indique son acte de naissance. Son père est sa famille sont laboureurs au village d'Auzon.
Au cours de son mandat, un fait divers tragique nous rappelle qu'il y avait un moulin à vent à Cadouarn. On peut lire sur cet article que le jeune Félix Terrrien, dont l'acte de décès figure bien au régistre de Séné, a succombé à ses blessures en jouant près du moulin de Cadouarn en ce mois de juin 1851.
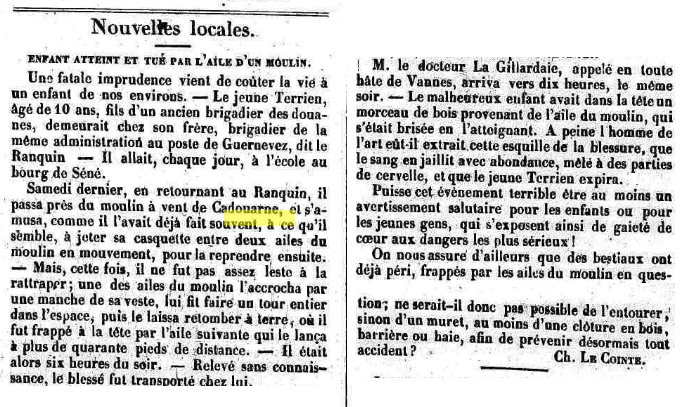
Mathruin LE DOUARIN restera maire pendant la très courte II° République [24/02/1848 - 2/12/1852]. Il sera maire de Séné lorqu''est organisée la première élection du Président de la République au suffrage universel direct. Louis Napoléon Bonaparte est élu lors du scrutin des 10 et 11 décembre 1848 dès le premier tour. Mathruin LE DOUARIN restera maire de Séné pendant toute la durée du Second Empire proclamée le 2 décembre 1852.

1851 Les élections municipales de 1851 ont été ajournées. La loi du 7 juillet 1852 ordonne le renouvellement intégral de tous les conseils municipaux. Le maire et l'adjoint ne sont plus élus par le conseil municipal mais nommés par le préfet qui peut les choisir en dehors du conseil municipal. La Deuxième République avait fait des maires et adjoints des représentants du peuple, ils redeviennent des fonctionnaires, des agents de l'Etat. En les nommant, le régime entend mieux les contrôler et les soumettre à son autorité.
1852 Les élections municipales ont lieu en août 1852. Dans les communes qui comptent moins de 2500 habitants, le scrutin se déroule sur une journée, un dimanche. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel. Chaque conseiller jure, en levant la main droite, d'être fidèle au président et d'obéir à la Constitution.
La loi sur l’organisation municipale du 5 mai 1855 abroge la loi du 21 mars 1831, le décret du 3 juillet 1848 et la loi du 7 juillet 1852. Dans les communes de moins de 3000 habitants, le maire et l’adjoint sont nommés par le préfet, au nom de l’empereur. Ils doivent avoir au moins 25 ans et être inscrits, dans la commune, au rôle de l’une des quatre contributions directes, c’est-à-dire qu’ils doivent être imposables. Ils ne perçoivent aucune rémunération. Le maire et l’adjoint peuvent être pris en dehors du conseil municipal. Ils sont nommés pour cinq ans.
Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel. Ils doivent avoir au moins 25 ans. Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les cinq ans. Les élections municipales se font au scrutin de liste. Il s'ensuit des élection à l'été 1855.
1855 : nouvelles élections
1860 : nouvelles élections
1865 : nouvelles élections :
En novembre 1870, après la défaite de Sedan et la proclamation de la III° République, Pierre Marie LAURENT, petit-fils de Hyacinthe Laurent lui succède.
Mathurin LE DOUARIN décèdera Séné au village d'Ozon le 28/05/1871.
Les maires de Séné sous la III° République
Histoire des maires de Séné sous la III° République.
Le maire tel que nous le connaissons aujourd’hui est le résultat d’une lente « maturation » législative. Au fil du temps, son mandat s’est allongé en même temps que ses fonctions ont évolué de simple administrateur local, relais du Préfet et de l’Etat à celui de véritable élu local autonome.
Aujourd’hui, un maire est avant tout un urbaniste qui adopte un Plan Local d’Urbanisme. Le « PLU » est la loi « fondamentale » locale qui sert de fil conducteur à l’action municipale. L’autre rôle important du maire est d’être un animateur local en charge du « vivre ensemble » au travers des associations subventionnées et des services publics locaux dédiés à l’enfance, à la jeunesse et aux seniors.
Bien sûr, il reste un aménageur qui décide des équipements et des investissements dans les réseaux.
Hier, les chemins vicinaux puis l’adduction d’eau potable, puis l’électrification et l’assainissement. Aujourd’hui l’ADSL et la fibre optique.
Avant guerre les premières écoles, la premières mairies, puis viendront les équipements sportifs et culturels…
A la révolution, il s’est substitué au clergé pour gérer l’état civil et avec l’instauration du suffrage universel, les premières listes électorales, et avec le service militaire, les listes de conscrits. Il a reçu des pouvoirs de police pour nommer, hier, un garde champêtre et aujourd’hui gérer un effectif de policiers municipaux.
Avec l'essor de l'intercommunalité, son périmètre d'action va encore évoluer...

A partir des registres d’état civil, des dénombrements et de la presse d’époque que peut-on apprendre sur les maires de Séné de la III° République ?
Un tas de choses sur les péripéties de la vie municipale à Séné. Je vous laisse les découvrir. Lire également les articles consacrés à Jean Marie GACHET, Joseph LE MOUELLIC à Ferdinant ROBERT.
LISTE DES MAIRES DE SENE pendant la III° République 1870 - 1945
Pierre Marie LAURENT :1870 - 1871 et de 1876-1881 - Laboureur [20/10/1836 - Kernipitur - 7/04/1886 Vannes]
Séné compte 2702 habitants en 1871.
Vincent Pierre LE GALLES : 1871 -1876 - Cultivateur [3/09/1821 Cariel - 3/05/1893 Cadouarn]
Séné compte 2849 habitants en 1876.
François SURZUR :1881-1894 - Gendarme en retraite - Propriétaire [29/11/1813 Surzur - 18/01/1896 Séné]
Séné compte 2918 habitants en 1891.
Jean Marie LE REBOURS : 1894 1896 - Cultivateur [3/03/1836 Cariel - 6/09/1896 Cariel ]
Séné compte 2703 habitants en 1896.
Jean Marie GACHET : 1896 - 1901 - Meunier [7/05/1836 Saint Nolff - 19*/03/1901 Séné]
Séné compte 2742 habitants en 1901.
Louis LAURENT : 1901 - 1907 - Cultivateur [4/04/1863 - Kernipitur - 1/03/1907 Kernipitur]
Séné compte 2860 habitants en 1906.
Joseph LE MOUELLIC : 1907 - 1919 - Négociant en cidre, ancien brigadier de gendarmerie
[30/11/1866 Saint Aignan Pontivy - 16/09/1933 Poulfanc]
Séné compte 2820 habitants en 1911 et 2440 après la 1ère guerre mondiale en 1921..
Ferdinand ROBERT : 1919 - 1928 - Retraité des Douanes [23/01/1850 Quiberon - 30/03/1937 Moustérian]
Séné compte 2540 habitants en 1924.
Patern LE CORVEC : 1928 - 1929 - Serrurier - Commerçant [8/02/1880 Bourg - ]
Henri MENARD : 1929 - 1941 et 1944 - 1945 - Cuisinier, Hotelier [20/05/1887 Caen - 20/01/1946 Villers sur Marne ]
Séné compte 2091 habitants en 1936.
René FAYET : 1941 - 1944 - Ingénieur - Ancien Combattant [21/01/1888 Brest - 29/11/1967 Séné ]
Séné compte 2029 habitants en 1946.
La 3° République commence après la défaite de Napoléon III à Sedan et s’achève à la Libération en 1944.
Après la proclamation de la République le 4 septembre 1870, succède le Gouvernement de Défense Nationale. Cependant, la période révolutionnaire de la « Commune de Paris » oblige les Autorités à organiser des élections municipales qui ont lieu en novembre 1870, alors même que la guerre continue et que le siège de Paris par les Prussiens a commencé. Le décret du 24 septembre 1870, donne aux préfets de la III° République le soin de nommer les maires parmi les conseillers municipaux élus.
1870
A Séné, en novembre 1870, LAURENT Pierre Marie est nommé par la Préfet et succède à Mathrurin LE DOUARIN maire en poste depuis 22 ans, soit depuis la Révolution de 1848 !
En pleines négociations d’armistice avec la Prusse, la République naissante cherche ses institutions. L'Assemblée élue à Bordeaux en février 1871 discute rapidement un projet de loi municipale. La loi du 4 avril 1871 prévoit que les maires (sauf dans les grandes villes) seront élus pour 3 ans par les conseils municipaux et non plus nommés par les préfets.
1871
Aux élections municipales des 30 avril et 15 mai 1871, LE GALLES Vincent Pierre est élu maire pour 3 ans. Il va construire une mairie et une nouvelle église.
Vincent LE GALLES [3/09/1821 – 3/05/1893] est né à Cariel au sein d’une famille d’agriculteurs. Il restera célibataire jusqu’à son décès à Cadouarn en 1893. Son foyer est recensé au dénombrement de 1886. Il vit entouré de 3 domestiques.
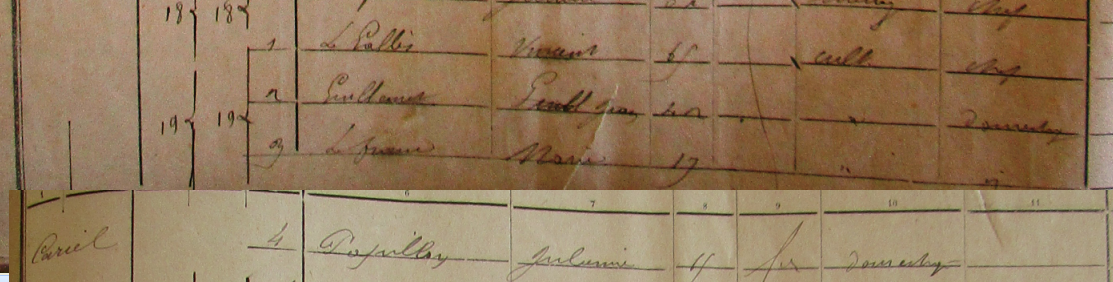
"En 1871, un nouveau cimetière est créé, qui libère un vaste espace autour de l'église. Le conseil de la fabrique (instance de gestion des biens de l'église à Séné), autour du recteur François Jourdan et du maire Vincent Pierre Le Gallès, est d'accord pour ébaucher un projet de reconstruction." (Source Camille Rollando).
Selon le rapport du 9 novembre 1873, la première mairie de Séné est batie pour la somme de 9.000 frcs. (Source Emile MORIN). Elle était sise à l'emplacement de l'actuelle salle des fêtes.
Le 24 mai 1873, les députés retirent leur confiance à Adolphe Thiers. Les Royalistes portent au pourvoir le maréchal Mac-Mahon. La loi du 20 janiver 1874 redonne au pouvoir le droit de nommer tous les maires, sans obligation de les choisir parmi les conseillers municipaux. Les majorités au parlement vacillent. Les élections municipales, fixées au mois d’avril 1874, sont reportées à l’automne 1874 et les préfets sont invités à « changer autant de maires qu’ils le jugeront utile ».
En juillet 1874 le premier projet de nouvelle église proposé par l'architecte du département Maigné est rejeté par le conseil.(Source Camille Rolando).
1874
Aux élections municipales des 22 et 29 novembre 1874, LE GALLES Vincent Pierre est réélu.
En 1876, le second projet de nouvelle église porté par l'architecte du Fretay est approuvé mais n'aboutit pas.
Le 5 mai 1876, une circulaire ministérielle prescrit le retour des maires évincés en 1874. En attendant le vote d’une loi définitive, les députés annulent celle de 1874 et rétablissent la loi d’avril 1871. La loi du 12 août 1876 rétablit des élections des maires et adjoints dans toutes les communes sauf les chefs-lieux de département, arrondissement, cantons où ils étaient nommés par le Président de la République et choisis dans le conseil municipal.
Les prochaines élections normalement prévues en novembre 1877 seront repoussées à janvier 1878.
En 1877 la maire démolit l'ancienne église. (Source camille Rollando). En août 1877, l'architecte parisien Deperthe, contacté par le recteur Georges Le Buon, propose à l'évêché un nouveau projet. En décembre 1877 le marché est conclu.
1878
Aux élections municipales des 6 et 13 janvier 1878 LAURENT Pierre Marie est élu pour 3 ans.
Pierre Marie LAURENT [20/10/1836 Kernipitur – 7/04/1886 Vannes], tient sa "revanche" électorale. Il avait été nommé en 1870 comme maire. Cette fois, il est élu au sein du conseil municipal.
La famille Laurent est établie depuis plusieurs générations à Kernipitur. Son grand-père Hyacinthe Laurent a été maire de Séné pendant la restauration de septembre 1815 à avril 1824. L'acte de naissance de Pierre Marie nous indique qu'il nait lui aussi à la ferme de Kernipitur. Au dénombrement de 1886, on note que que la famille Laurent semble aisée avec sous son toit, 3 domestiques et le filleul.
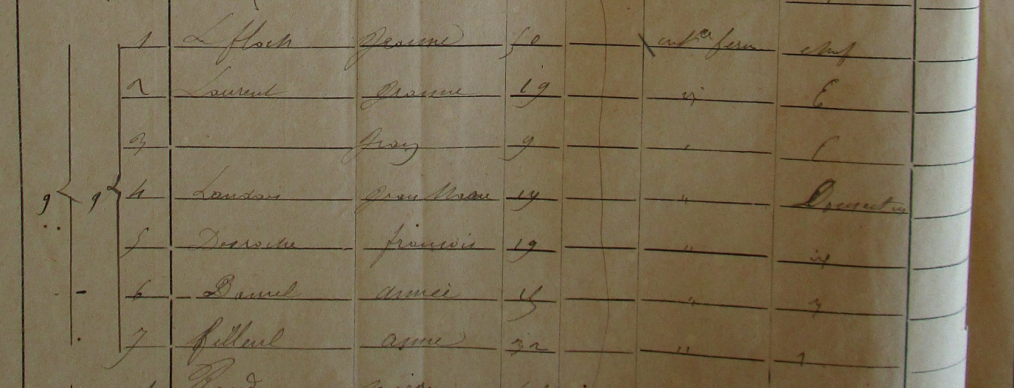
En mars 1878, a lieu la pose de la première pierre de la nouvelle église.
Le 30 janvier 1879 le président mis en minorité démissionne. Jules Grévy est nommé Président de la République par l'Assemblée Nationale (Sénat et Chambre des Députés).
1881
Aux élections municipales du 23 Mai 1881, le candidat républicain, François SURZUR est élu.
François SURZUR n'est pas natif de Séné mais de ...Surzur au sein d'une famille de laboureurs. Son acte de mariage avec Marguerite Langle à Séné en 1844 nous indique qu'il est alors gendarme à Bignan. Il sera maire de Séné pendant 13 ans ! Au dénombrement de 1886, la famille de François SURZUR est établie à Séné. M. le maire est à la retraite de gendarme, sa femme est ménagère et le foyer loge la belle-mère, un "gagiste" et un domestique.
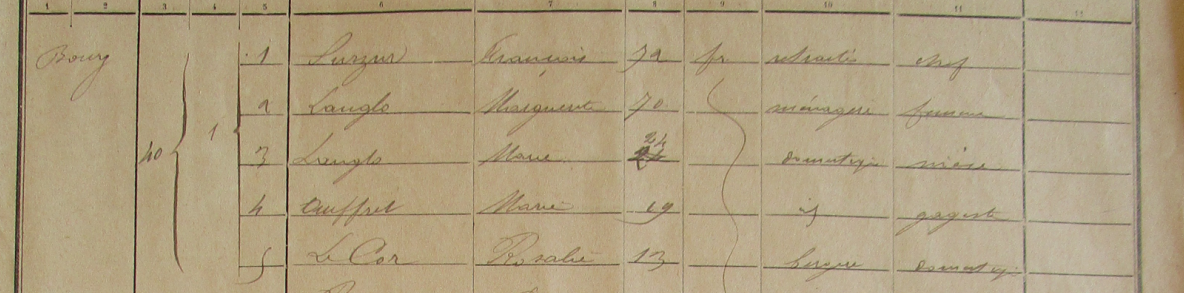
En juillet de 1881, l'usine chimique de la Garenne, anciennement les Ets La Gilardaie, devenus la société Ouizille, cessent leurs activités, comme nous le rapporte cet article de presse.
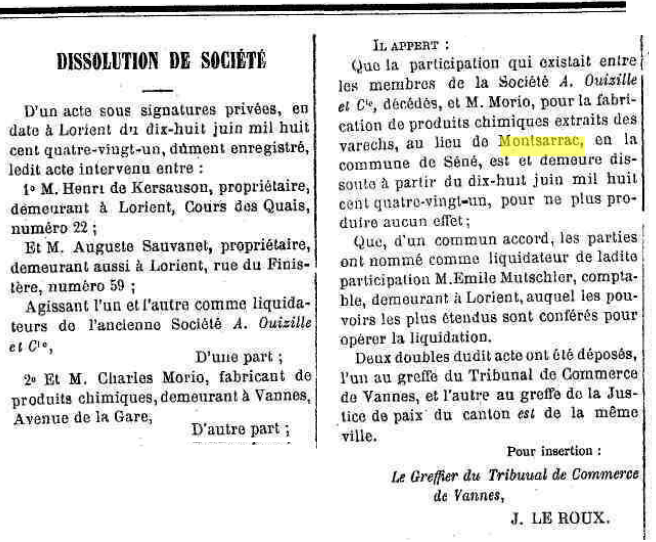
Cette activité de production de potasse et d'iode à partir du varech récolté en mer avait fait la prospérité du quartier de la Garenne et Kerarden. On avait aménagé une cale à La Garenne pour faciliter l'activité de l'entreprise.
Pendant son premier mandat de maire, la loi du 28 mars 1882 introduit l’élection des maires et des adjoints par le conseil municipal (sauf pour Paris, le maire ne sera élu qu’à partir de 1977). Le mandat est fixé à quatre ans.
La loi du 5 avril 1884 sera la la loi dite « la grande charte républicaine de la liberté municipale » qui constitua une véritable charte de l’organisation municipale dont plusieurs éléments existent encore aujourd’hui. Cette loi affirme le principe de l’élection des maires par le conseil municipal et reconnaît l’autonomie communale. L’article 61 de la loi précise : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Communes et départements acquièrent ainsi le statut de collectivité territoriale. De plus, la loi du 5 avril 1884 favorisa la construction de mairies-écoles. Les communes doivent désormais fournir le logement des maîtres et le matériel scolaire. Les crucifix disparaissent des locaux scolaires.
1884 - 1888 - 1892
En 1884, aux élections municipales des 4 et 11 mai, ces nouvelles dispositions entrent en vigueur. A Séné François SURZUR est réélu pour 4 ans. Aux élections municipales des 6 et 13 mai 1882, François SURZUR est à nouveau réélu.
En septembre 1887, a lieu la consécration de la nouvelle église par l'évêque, le recteur Georges Le Buon en présence du maire François Suzur et de l'architecte Desperthes (Source Emile Morin).

Aux élections municipales des 1er et 8 mai 1892, François SURZUR est réélu pour son 4° mandat. En France c'est la ras de marée du camp républicain qui contrôle les 2/3 des municipalités.
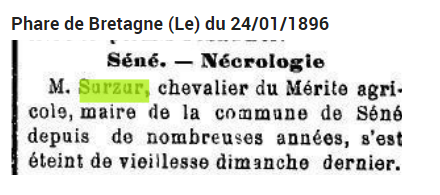
Cependant, il tombe malade et décède le 18/01/1896. Etrangement, sa tombe existe toujours au cimetière communal. En fin mandat, il est remplacé par son adjoint, en janvier 1894.
Jean Marie LE REBOURS.[3/03/1836 Cariel - 6/9/1896]
Durant son mandat,la cale de Barrarach est construite. Cet aménagement rendra de nombreux services aux Sinagots et permettra l'essor des "petits" passeurs.
La cale de Barrarach : Eléments d'historique (Inventaire région Bretagne)
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Datation(s) en années : 1895
Justification de la (des) datation(s) : daté par source
Commentaire historique : Un rapport des Ponts et Chaussées de 1885 signale l´existence à la Pointe de Barrarac´h d´une mauvaise cale en pierres sèches construite par les habitants. Deux inscrits maritimes assurent la traversée et entretiennent sommairement l´ouvrage pour le passage des piétons de la presqu´île de Séné vers l´île de Conleau et Vannes.
En 1895, la cale est entièrement remaniée et restaurée pour une dépense totale de 3 900 francs, dont les deux tiers financés par l'Etat, 1 000 francs par le département et 300 francs par la commune, et prend alors sa forme actuelle. En 1968, afin de permettre le chargement du fret vers l´île d´Arz, le service des Ponts-et-Chaussées construit une nouvelle infrastructure quelques dizaines de mètres plus à l´est, et abandonne cette cale.
Source photo Emile MORIN
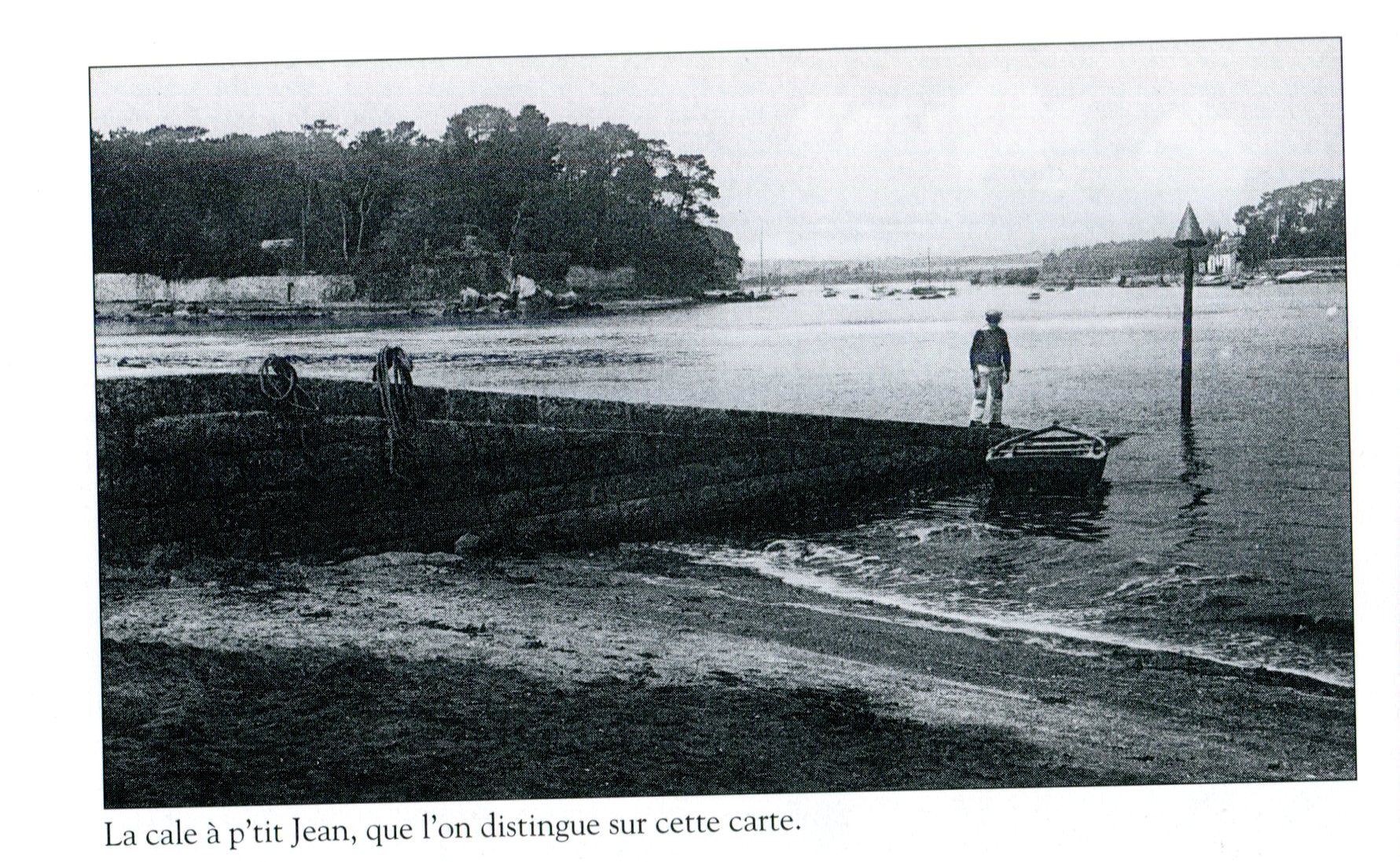
1896 - 1900
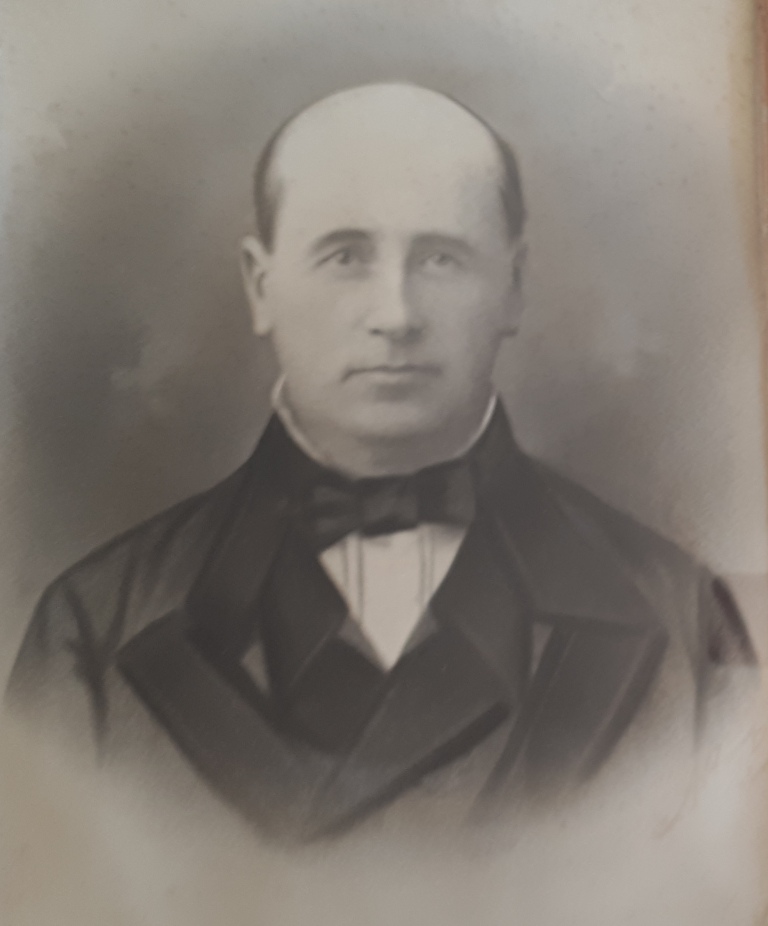
Aux élections municipales des 3 et 10 mai 1896, Jean Marie GACHET, est élu. Natif de Saint Nolff, meunier au moulin de Cantizac, Gachet gagne la confiance des Sinagots. Il est réélu au cours d'une campagne électorale singulière face au trésorier buraliste Mathurin SEVIN Lire article qui lui est consacré.
Au niveau national, en 1900, on dénombre 24 832 municipalités républicaines, 153 nationalistes, 8 519 conservatrices. Les républicains gagnent plus de 1 000 municipalités. A Paris, la tendance est inverse puisque les nationalistes dominent. A Séné également puisque la liste Gachet est réélue.
http://www.wiki-sene.fr/histoire-de-sene/chroniques/item/388-gachet-sevin-adversaires-jusqu-a-la-mort-1901.html
Cependant, Jean Marie GACHET décède le 19 mars 1901. Son adjoint ALLAIRE assure l'intérim de mars à mai 1901. Lors de ce scrutin partiel, Louis LAURENT, fils de l’ancien maire, Pierre Marie LAURENT, remplace Jean Marie GACHET pour les 3 ans restant.
Louis LAURENT est installé à Kernipitur avec sa famille de 5 enfants qui emploie deux garçons de ferme et un domestique.
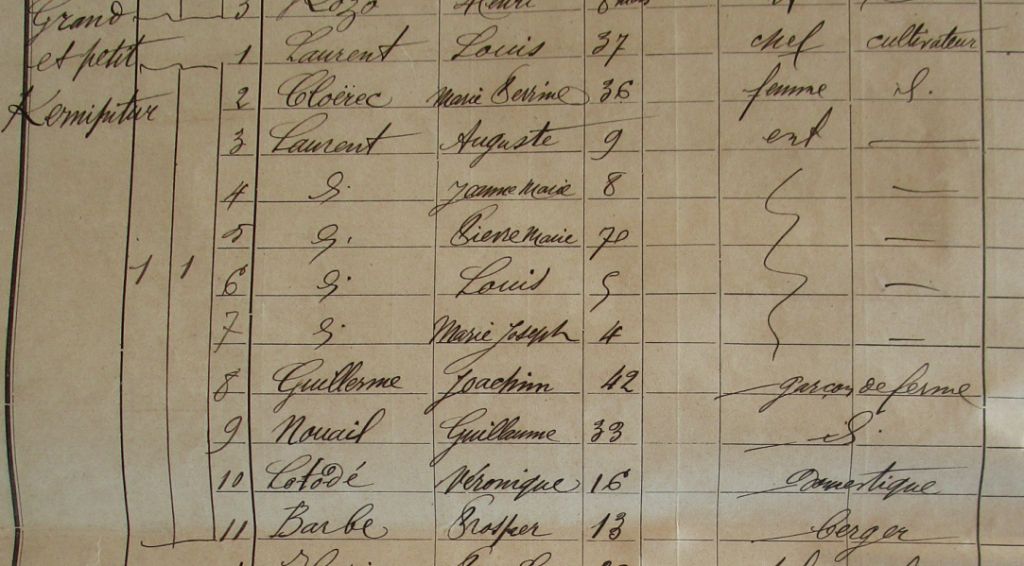
Cet article de presse nous livre la composition du conseil municipal élu dès le premier tour. Elle permet de se rendre compte que la liste balaye les principales professions à Séné. Sur 21 noms, il y a 7 cultivateurs, un charpentier, deux propriétaires (fonciers), un marchand de sel et un paludier, un boulanger, un courtier en bestiaux, deux marins dont un retraité et un maître de cabotage. Le fils du maire décédé, Jean Marie Désiré GACHET a rejoint la liste conservatrice.
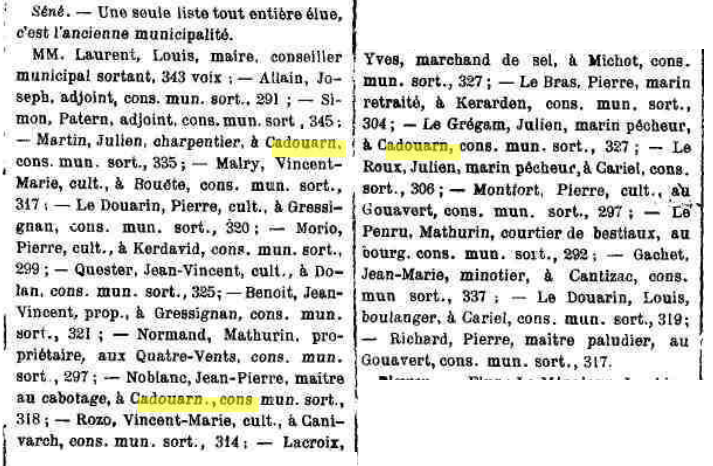
Sous son mandat, le conseil municipal refuse l'ouverture d'une école publique de filles. Le Prefet passe outre et l'école ouvre à Moustérian comme nous l'indique cet article de presse d'octobre 1902.
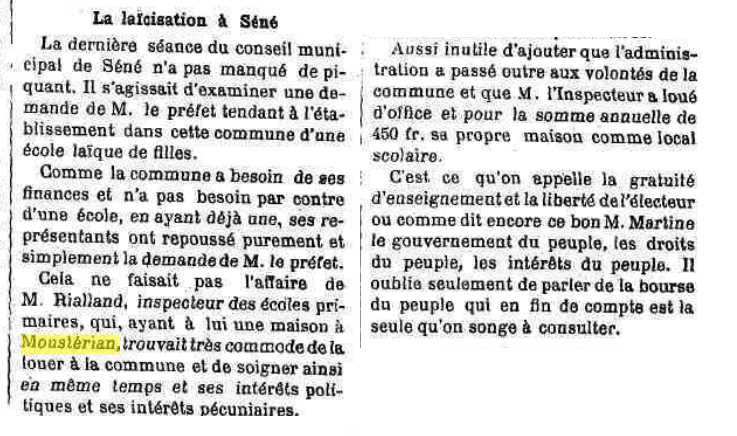
1904 - 1907
En décembre 1904, une loi attribue à la municipalité le service des pompes funèbres : transport du corps, fourniture du cercueil, des tentures et du personnel chargé de l’inhumation : les attributions civiles du curé étant définitivement supprimées. Les seules ressources de la municipalité sont les impôts locaux, directs ou indirects : centimes additionnels, taxes… Restent les subventions du conseil général ou de l’État. Le maire dénombre les habitants, les électeurs, les conscrits, les étrangers et les pigeons-voyageurs…
(Source http://blisetborn.free.fr).
Sous la mandat de LAURENT est réalisé la cale au Badel.
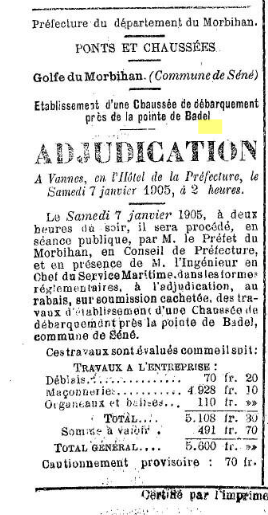
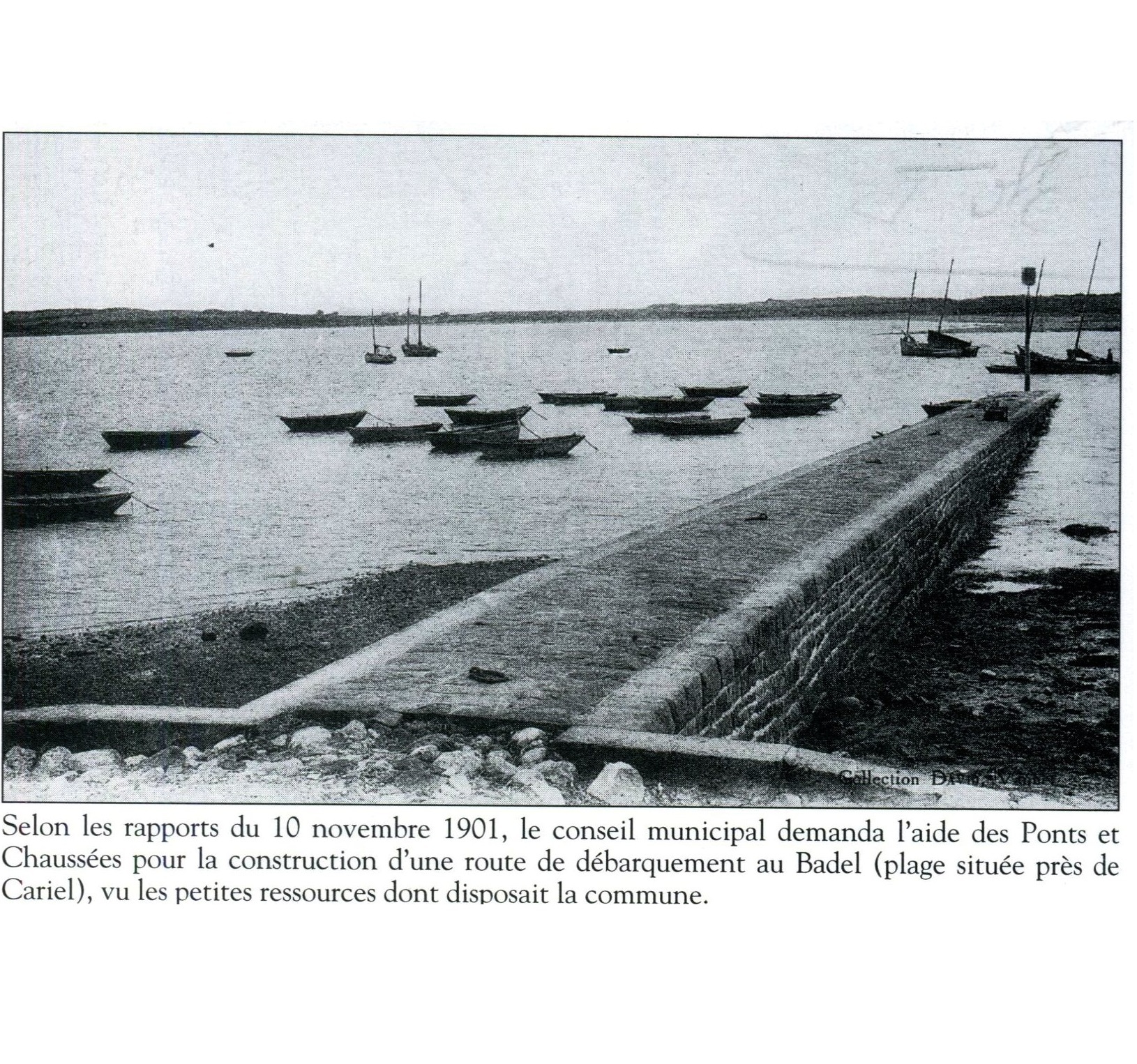
Aux élections municipales des 1er et 8 mai 1904, Louis LAURENT est réélu. Cependant il décède en mars 1907 tout comme son conseiller Vincent Marie ROZO. Selon le journal L'Arvor, plus de 2.000 personnes assistèrent à leurs funérailles!
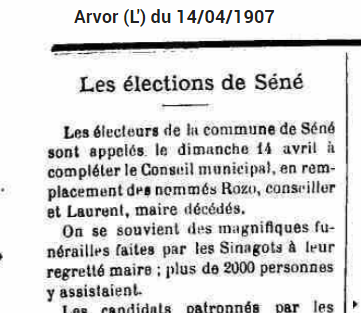
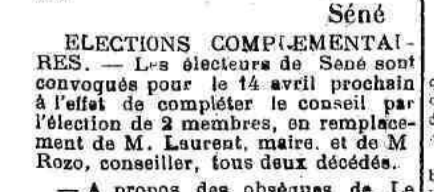
Une élection partielle a lieu et l'ancien gendarme, Joseph LE MOUELLIC est élu le 14 avril 1907.
En 1906, entre en vigueur la loi de séparation de l’Église et de l’État.
Pendant l'intérim assuré semble-t-il par l'adjoint Patern SIMON, eu lieu l'inhumation au cimetière de Séné du marin LE DORIOL tué lors de la catastrophe du IENA.
1907 - 1908 - 1912 -1916
Aux élections municipales des 3 et 10 mai 1908, Joseph MOUELLIC est réélu pour la première fois. Le négociant de cidre qu'il est devenu, installé au Poulfanc le sera une deuxième fois aux élections du 5 et 12 mai 1912. Il sera le maire des Sinagots et des Sinagotes pendant toute la durée de la Première Guerre Mondiale. En 1916, les élections municpales n'ont pas lieu et les maires sont reconduits. Après l'armistice, les nouvelles élections sont anticipés en novembre 1919.
En août 1910 est inauguré l'école primaire laïque rue Principale au bourg, bâtiment occupé aujourd'hui par l'ecomusée. Lire article sur LE MOUELLIC Joseph.
1919 - 1925 - 1929
A peine sortie de 4 ans de guerre, le pouvoir s'attache a revoir les règles des élections. La loi du 18/10/1919 fixe un calendrier des élections municipales, cantonales et sénatoriales. Les conseils municipaux seront élus jusqu’en mai 1925. Les scrutins sont fixés pour les 30 novembre et 7 décembre 1919.
Ferdinand ROBERT est élu pour 6 ans. Le brigadier des douanes en retraite à Moustérian avait déjà affronté LE MOUELLIC en 1912. Il sera réélu aux élections les 3 et 10 mai 1925 pour un mandat ramené à 4 ans Cependant, Ferdinand ROBERT démissionne en 1928 sans doute pour des raisons de santé
1928
Une élection partielle est organisée en 1928 et Patern LE CORVEC est élu pour un an.
Patern LE CORVEC connait bien la vie municipale à Séné. Il est né à Séné le 8/02/1880 et il déclare à ses 20 ans sur sa fiche de matricule la profession de serrurier. Malgré sa classe, il sera mobilisé lors de la campagne contre l'Allemagne en 1917 et 1918. Voisin des SEVIN, il se marie le 15/11/1904 avec la fille du regreté candidat radical, Mathurin SEVIN, noyé à Cantizac. Sa femme devient épicière et lui cabaretier. Il a pour beau-frère, Jospeh SEVIN, candidat malheureux contre le maire LE MOUELLIC aux élections partielles de 1907.
Par ailleurs, comme nous l'indique le dénombrement de 1906, il a vécu près de la soeur de l'ancien maire Vincent LE GALLES, C'est tout naturellement qu'il figure sur la liste de Ferdinand ROBERT et après la démission de ROBERT, qu'il est élu maire.
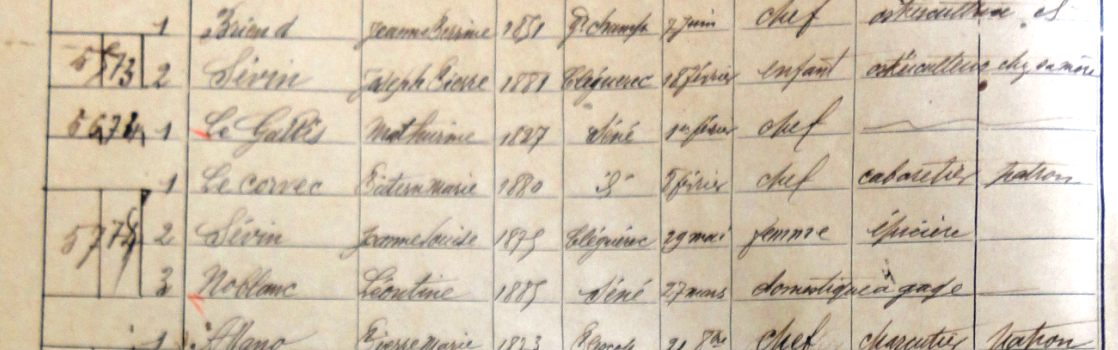
Nous disposons d'une photo de Patern LE CORVEC qui assiste comme de nombreux convives aux noces mémorables de Xavier LE PENRU et Lucienne BENOIT le 2 septembre 1930.
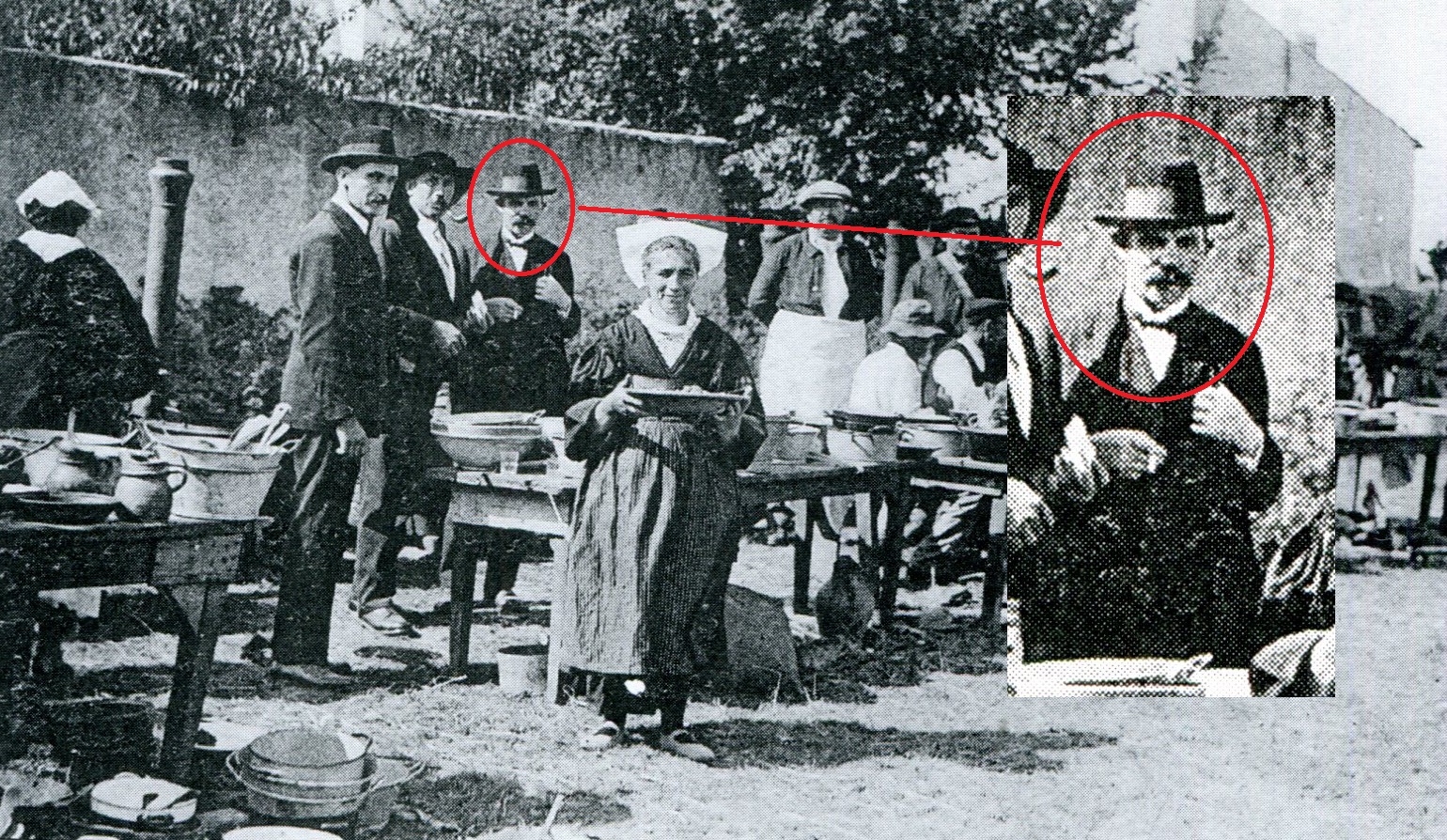
En 1928, Patern LE CORVEC inaugure la nouvelle mairie voulu par son prédécesseur. Soucieux des marins de la presqu'île il fait réaliser avec ses propres deniers une petite digue dite "Pont Corvec" qui relie le village de cariel à la cale du Badel, toutjours visible de nos jours.
A l'approche des prochaines élections en 1929, le legislateur qui a "vu les avantages" d'un mandat de 6 ans entre 1919 et 1925, porte la durée d'un mandat de maire à 6 ans, durée toujours en vigueur de nos jours.
1929 : Henri MENARD, un maire moderne à Séné
Le nom d'Henni MENARD apparait dans le livre de Camille ROLLANDO "Séné d'Hier et Aujourd'h'ui ". On lit également son nom en bas des actes de décès sur le régistre d'état civil de Séné. Il y a bien eu un maire au nom de Henri MENARD, dont la patronyme ne sonne pourtant pas breton...
On en déduit qu'il remporte les élections du 5 et 12 mai 1929 et est élu pour un mandat porté à 6 ans. Il sera réélu en 1935, lors des élection des 5 et 12 mai comme en témoigne cet article de presse. Il s'est entouré de l'ancien maire Patern LE CORVEC.
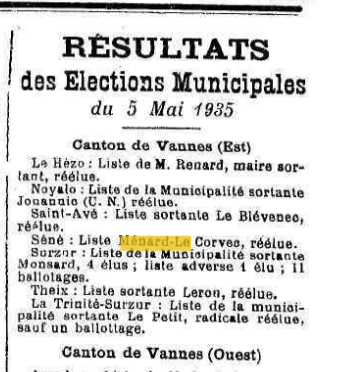 Un autre article de presse des archives du Morbihan daté de juillet 1932 permet de mieux identifier notre "homme"..
Un autre article de presse des archives du Morbihan daté de juillet 1932 permet de mieux identifier notre "homme"..
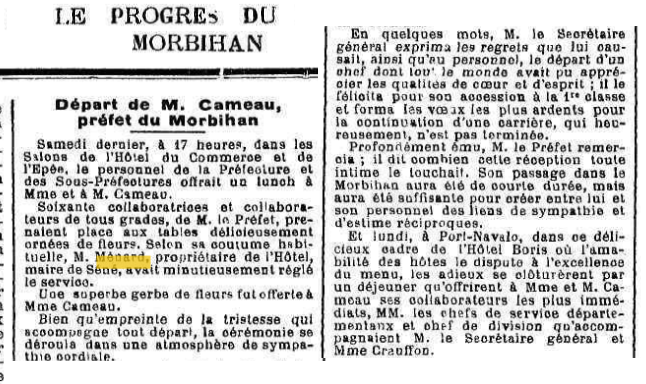
On y apprend que le marie de Séné est bien Henri MENARD, qu'il est aussi propriétaire de l'hotel du Commerce et de l'Epée à Vannes rue du Mené. C'est une personnalité locale, un notable qui accueille dans son établissement la cérémonie pour le départ du Prefet.
Cette information est corroborée par un autre article de presse daté de juillet 1937 qu nous apprend que l'hotelier a fait faillite et nous donne le nom de son épouse Germaine Louise BRIARD.
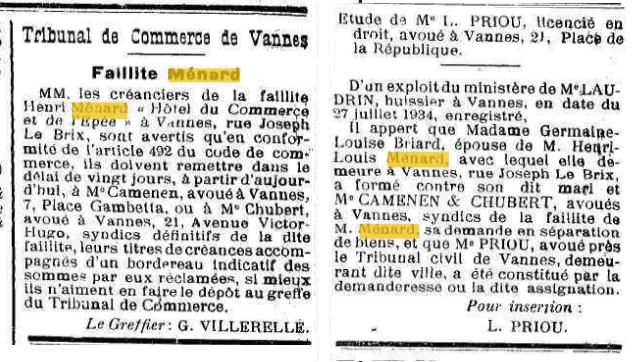
Tout laisse à penser que Henri MENARD vivait à Vannes, puisque son nom n'apparait pas dans les dénombrement de Séné de 1926. La consultation des registres du dénombrement à Vannes pour 1926 (ici reproduit) et 1931 nous en donne la confirmation.
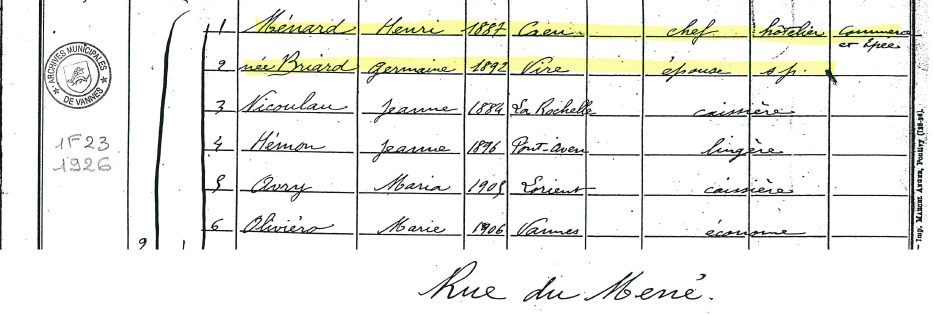
La consultation des archives du Calvados permet de retrouver l'acte de naissance de Henri MENARD et sa fiche de matricule. Il nait à Caen le 20 mai 1887 et son père est cuisinier. Sa fiche de matricule classe 1907 nous apprend qu'il choisit égalment le métier de cuisinier qui le conduira à devenir hotelier.
On y lit qu'à l'âge d'accomplir sa conscription est vit à New-York !
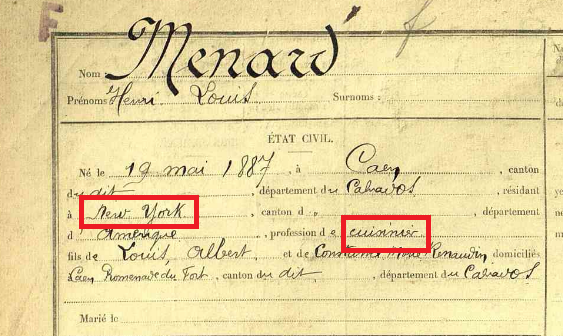
Henri MENARD s'est donc lancé dans l'hotellerie ce qui le conduira à la tête de l'hotel du Commerce et de l'Epée à Vannes.
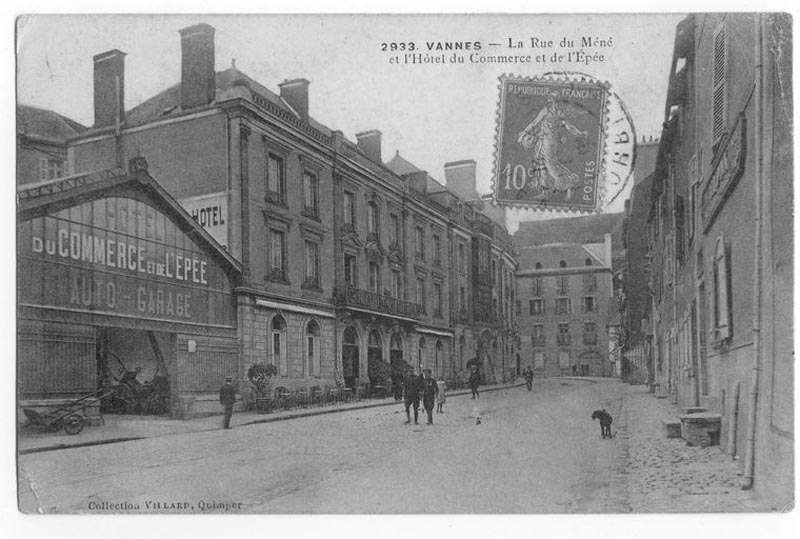
Cet établissement à quelques pas de la mairie de Vannes est sans doute un lieu où les notables du département se réunissent. Il a certainement tissé des liens avec des "électeurs sénatoriaux" du Morbihan. Comment est-il arrivé à briguer le mandat de maire de Séné ? Il est certain que cette aura locale séduira les agriculteurs, les marins pêcheurs et la majorité des électeurs de Séné puis qu'ils voteront majoritairement pour lui à 2 reprises.
L'annuaire téléphonique de 1932 nous indique qu'il réside bien à Séné au château de Saint-Laurent.
Cependant, Henri MENARD ne saura pas concilier vie publique et bonne gestion d'un hôtel. Il est en faillite en 1937. Sa femme demande une séparation de bien et son acte de naissance mentionne un 2° mariage. Si il n'est pas heureux pour sa propre union, en tant que maire il en célèbre d'autres et notamment, il marie en 1930 Xavier LE PENRU à Louis BENOIT et pose pour une photo lors de ces noces mémorables.


Ces quelques articles de presse donnent un aperçu de l'action d'Henri MENARD pendant ces années d'entre deux guerre. Le premier nous indique de la mairtie de Séné, décidé par Ferdinand ROBERT en 1924 sera inauguré en 1930 et que cette même année la fée électricité arrive à Séné; le second relate un meeting aérien à l'hippodrome de Cano; le troisième nous décrit la fête de Séné en août 1932 et le tdernier montre que Henri Ménard avait soin de faire rayonner sa commune avec par exemple l'organisation d'une conférence agricole en février 1937.
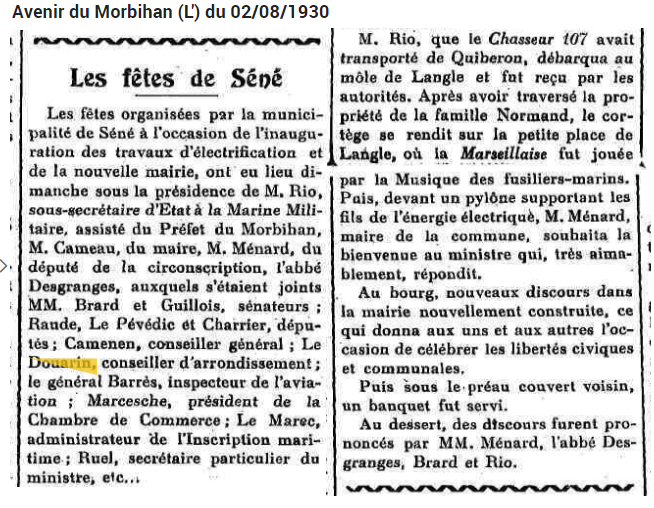

Sur cette photo datée de 1930 [Collection J. Danielo] l'ensemble des employés municpaux posent aux côtés du maire Henri MENARD, deuxième en partant de la gauche.
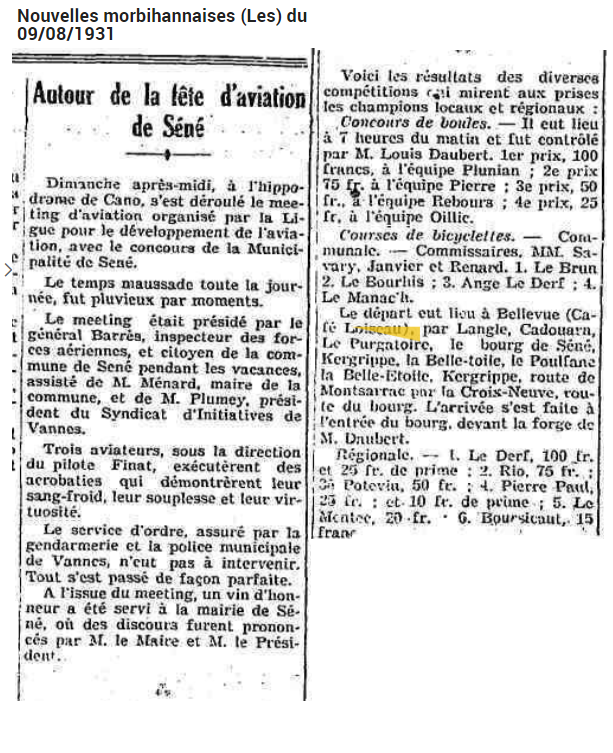
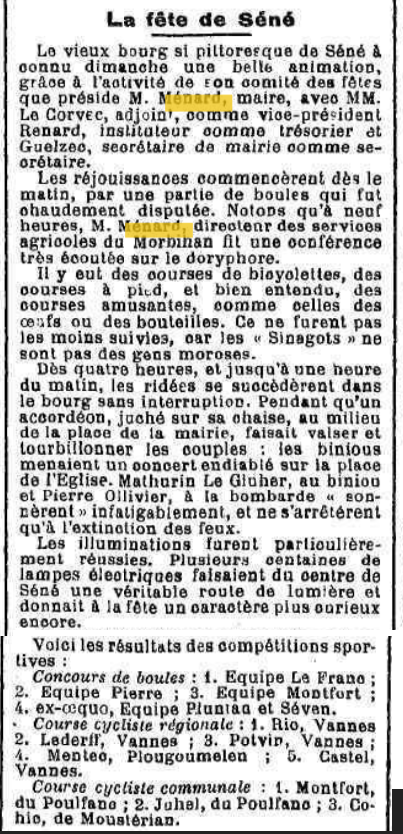
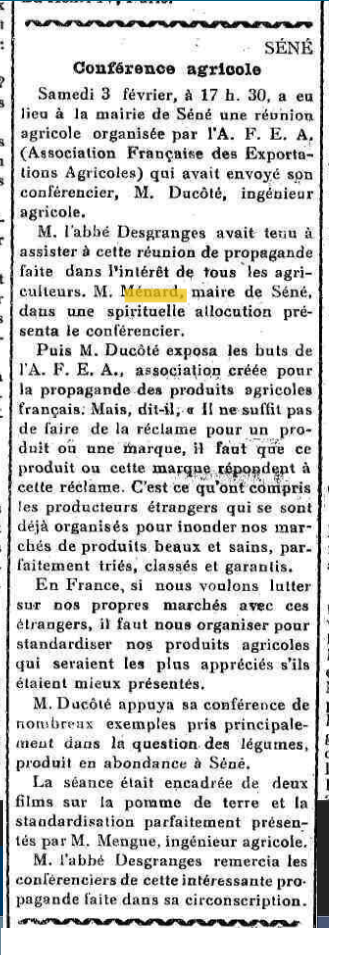
En mars 1933, Henri MENARD est promu Chevalier de la Légion d'Honneur.
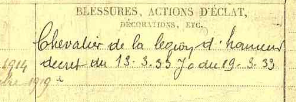
Au mérite aussi de la municipalité dirigé par Henri Ménard, la poursuite de l'électrification, comme nous le rappelle Camille Rollando : "Tout d'abord l'électrification du village 'de Montsarrac) vers 1934. Jusque là, l'éclairage se faisait à l abougie, la lampe "pigeon" et les lampes à pétrole (à pied ou à suspension). Tout à basculé d'un seul coup. Il suffisait de tourner un bouton et tout resplendissait".
Au cours de 1937 a lieu la deuxième rupture de la digue Lorois. Les terres autour de l'ile Mancel sont innodées. Le temps de réfléchir à sa reconstruction et se fut la guerre. A la Libération, le projet ne sera pas repris.
Durant la magistrature de Henri MENARD, la route vers Vannes passant sur la digue de Cantizac est construite (Source Emile MORIN).

Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne qui vient d'envahir la Pologne....
Le 26 septembre 1939, le gouvernement Daladier substitue, par décret, l’autorité du préfet à celle du maire. En novembre, il dissout les conseils municipaux communistes et révoque leur maire. Un an plus tard, le gouvernement dirigé par le maréchal Pétain, modifie autoritairement les institutions et décide, le 16 novembre 1940, que les maires seront nommés dans les communes de plus de 2 000 habitants et qu’ils choisiront eux-mêmes leurs conseillers municipaux, confirmés ensuite par le préfet. Séné est concerné par ce retour au système de 1815…
C’est en 1942 qu’une indemnité est accordée au maire, indemnité réclamée depuis 1891 par les socialistes. A Séné,le Préfet du Morbihan choisit René François FAYET, né à Brest le 21/01/1888.
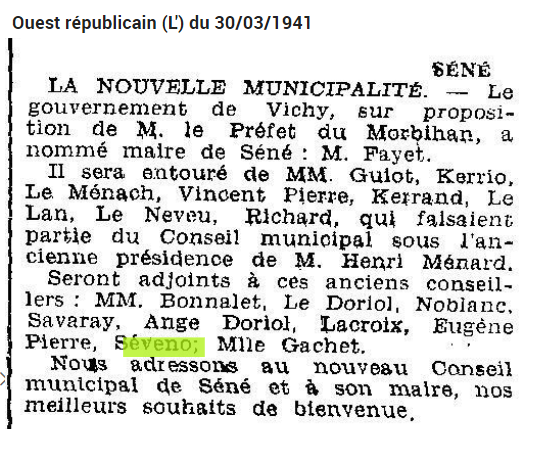
C'est un ancien combattant de la grande Guerre, ingénieur de fomation, cité pour son courage pendant la campagne contre l'Allemagne. Il finira ces jours à Séné, le 29/11/1967. Sa nomination fait réagir les Sinagots. Dans son ouvrage, "Les maires du Morbihan" (1929-1959), le professeur Christophe RIVIERE écrit :
'Lorsque l’on analyse la carrière politique des maires nommés sous Vichy, on peut constater que 29,56 % de ces derniers sont révoqués ou démissionnent avant la fin de leur mandat. Il est intéressant de relever ici que parfois, les populations contestent la légitimité de ces notables imposés par Vichy et réaffirment leur soutien aux élus désignés par le suffrage universel. Par exemple, à Séné, dans l’arrondissement de Vannes, Henri Ménard, maire radical élu en 1929, est remplacé sur ordre de la préfecture en mars 1941. L’installation de son successeur, René Fayet se passe mal car, lors de la première séance, 4 conseillers municipaux émissionnent en protestant contre la façon dont les nouvelles nominations ont été faites. L’ensemble du Conseil municipal, à majorité radicale, est en effet remanié au profit d’une très nette majorité de républicains URD. Un article du Nouvelliste de Bretagne souligne même que des groupes de Synagots se rassemblent pour exprimer leur mécontentement."
En 1944 à la Libération, Henri MENARD est rétabli dans ses fonctions. Il finira par quitter le Morbihan et finira ces jours à Villers sur Marne le 20/01/1946.
A suivre : Les maires de Séné depuis la Libération.
GACHET & SEVIN, funestes adversaires1901
Depuis la Révolutiion, 35 maires se sont succédés pour des mandats plus ou moins longs et des fortunes diverses....
Sous la III° République à cheval entre le XIX° siècle et le XX°siècle, le maire de Séné était Jean Marie GACHET, premier magistrat de 1896 à 1901.
Jean Marie GACHET est né à Saint Nolff le 7 mai 1836 où son père tient le Moulin de Quaradec. Il se marie avec Marie Louise MARTIN et vient s'établir à Séné où il reprend le moulin de Cantizac, pratiquement détruit par un incendie. Gachet reconstruit le moulin et l'équipe d'une chaudière à vapeur dans la maisonnette attenante. Ainsi, le moulin n'est plus tributaire des marées, d'autant que l'étang de Cantizac commence à s'envaser....
Son fils aîné, Jean Marie Désirée nait à Cantizac en 1867 et on peut ainsi dater son arrivée au bord du Golfe à cette époque. A la mort de son père, il reprendra un temps le moulin mais fera faillite en 1907.
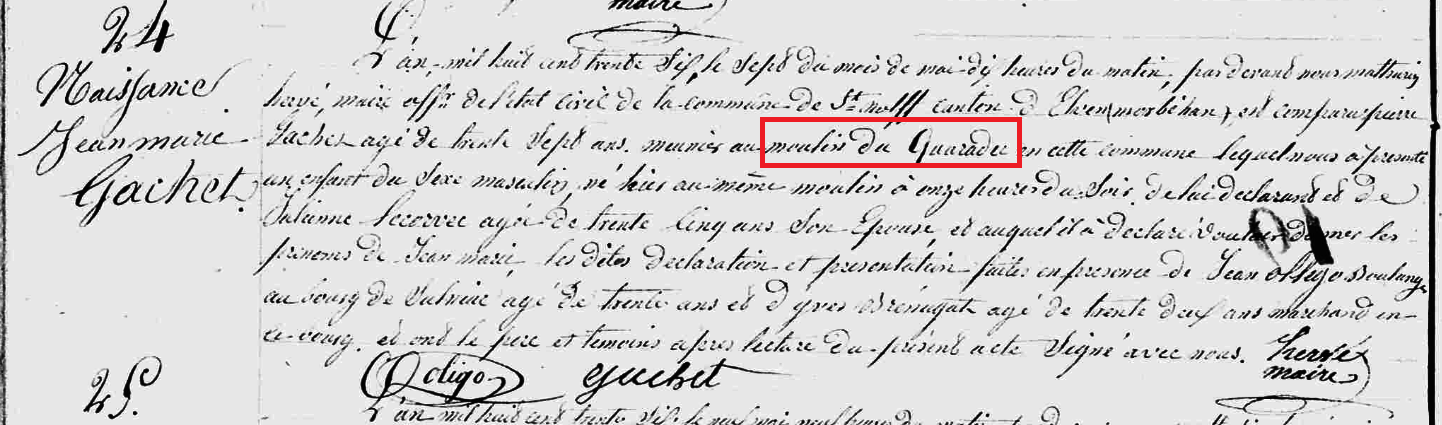
Moudre la farine des cultivateurs de Séné; produire la farine de sarrasin; écraser le grain pour les bestiaux; ces activités permettent à GACHET de tisser des liens avec les cultivateurs, les éleveurs, les boulangers et la population de Séné.
La famille GACHET ne vit pas au moulin, la maisonnette sert de chaufferie, mais sa famille est installée à Keravelo comme nous l'indique le dénombrement de 1896 et emploie trois domestiques.
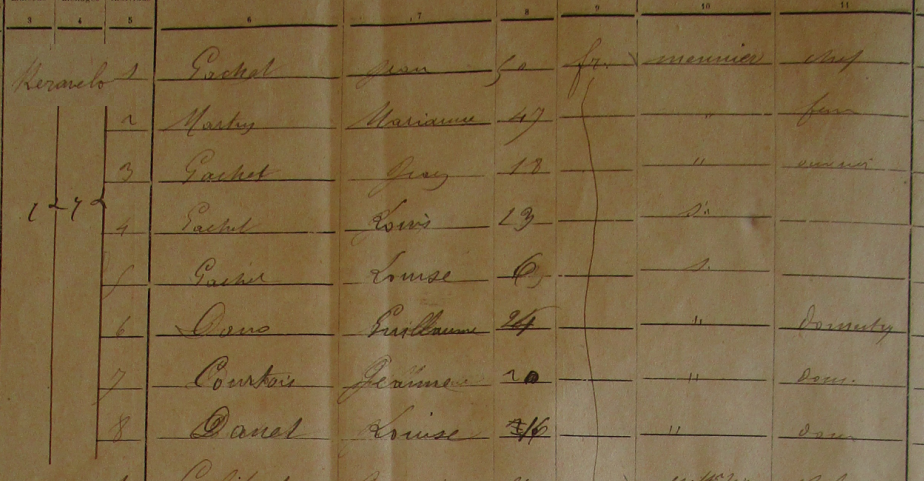
Les affaires tournent bien et la famille a déménagé au bourg comme nous le rapporte le dénombrement de 1901. Elle a acquis des terrains à la Fabrique de Séné (paroisse) et a fait bâtir une belle demeure toujours visible place Coffornic.
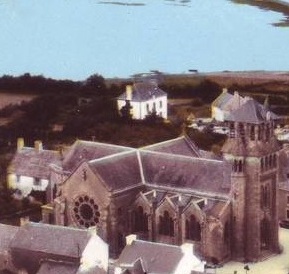
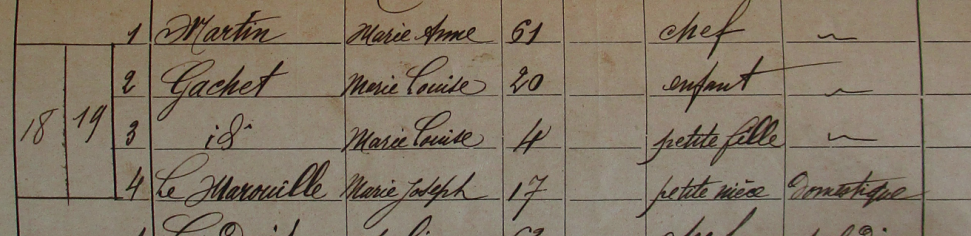
Son moulin construit sur la digue de Cantizac est un raccourci pour aller à Vannes, emprunté par grand nombre des administrés.
Aux élections municipales de du 3 et 10 mai 1896, Jean Marie GACHET se lance dans les municipales. Son frère cadet Mathruin [10/12/1844-31/12/1880] n'a-t-il pas été maire de Saint-Nolff de 1878 à son décès ? Candidat sur la liste conservatrice, il est élu maire pour 4 ans. Pendant ce mandat, GACHET réalise de nombreux travaux largement subventionnés par le Conseil Génréal du Morbihan. C'est fort justement que M. le maire met en avant son bilan dans la presse en mai 1900, à la veille des élections où il brigue un second mandat. (Article complet enpièce jointe)
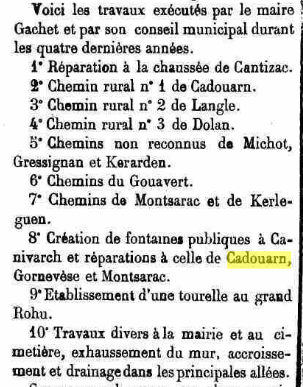
Avec la réparation et l'élargissement de la chaussée de Cantizac, il change la physionomie de Séné. Peu à peu, ce nouvel axe va être privilégié dans la relation avec Vannes au détriment de la route historique qui passe par le Pont d'Argent, Keravelo, Kernipitur et sa croix pour descendre la rue de Séné (actuelle rue Monseigneur Tréhiou) vers le port de Vannes. On le lit, Gachet s'attache à améliorer la voirie de Séné mais également à pouvoir en eau les villages de la commune et soigne ses électeurs pêcheurs qui constituent la majorité de la population de Séné.
Le candidat de l'autre camp est Mathurin SEVIN, trésorier buraliste. Lui non plus n'est pas natif de Séné mais d'Arradon où il nait le 21/12/1838, son père est cordonnier. Le dénombrement de 1896 nous présente sa famille. Il est marié et a deux enfants et l'aîné est étudiant, chose remarquable pour l'époque. Lui aussi de part ses fonctions est au contact avec la population de Séné.
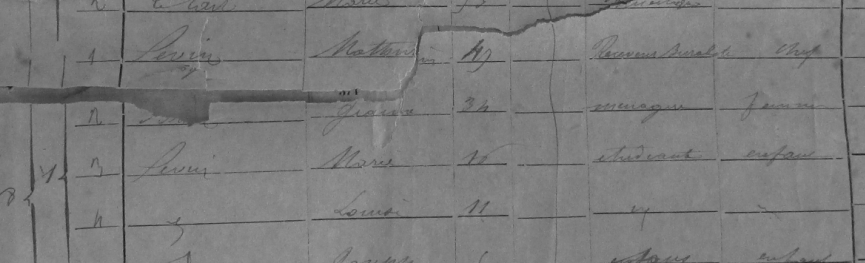
Mathurin SEVIN a un curriculum vitae pour défendre le camp radical et républicain. Ancien Soldat, SEVIN a participé à la conquête ratée du Mexique par Napoléon III. Il devint gendarme en poste à Cléguérec où ses enfants naîtront. Il fut mis à la retraite anticipée comme on peut le lire dans cet extrait de journal pour avoir participé à une réunion républicaine en civil!
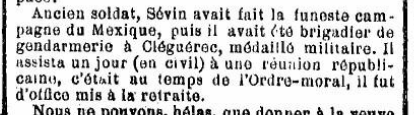
Les deux candidats sont en fait "étrangers" à la commune pour reprendre un terme méprisant aujourd'hui mais utilisé à l'époque....Séné montrera dans l'histoire sa capacité à élire à plusieurs reprises un maire non natif de la commune....
Un bon clivage gauche-droite se met en place entre un entrepreneur et un employé. Le duel électoral s'intensifie avec le concours de la presse. L'Arvor soutien Gachet et le Progrès du Morbihan, Sevin. Ces coupures de presse d'époque nous montrent que le combat est rude et tous les coups semblent permis pour égratigner la réputation et nuire à son adversaire. Les lois de diffamation viendront plus tard. Le contexte national de l'Affaire Dreyffus exacerbe le débat local.(Lire l'article en vitrine)
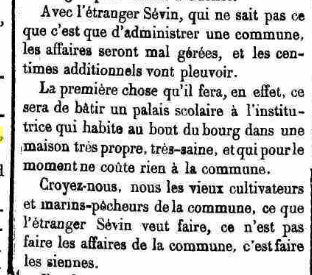
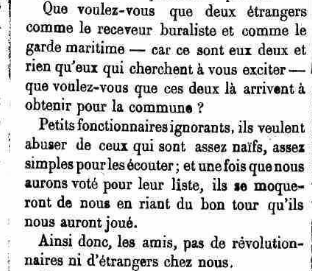
Au terme d'une campagne intense, Jean Marie GACHET est élu au premier tour de ce scrutin majoritaire à deux tours. Certains de ces co-listiers sont en ballotage.
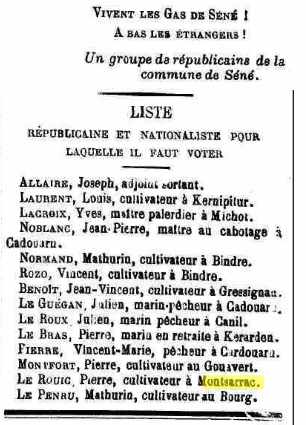
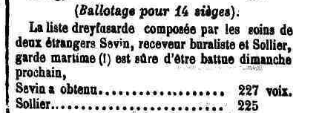
Mathurin SEVIN ne sera pas maire de Séné, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jean Marie GACHET décède la première année de son second mandat le 19 mars 1901. Son adjoint Joseph ALLAIRE assure un intérim comme le montre les actes de décès signés sur le registre de l'état civil. Aux élections partielles de mai 1901, Louis LAURENT, fils de l'ancien maire, Pierre Marie LAURENT, cultivateur à Kernipitur est élu maire, sur sa liste un certain Jean Marie Désirée GACHET, le fils du meunier et maire.
En décembre de cette même année 1901, un fait divers tragique, clos définitivement le combat GACHET-SEVIN.
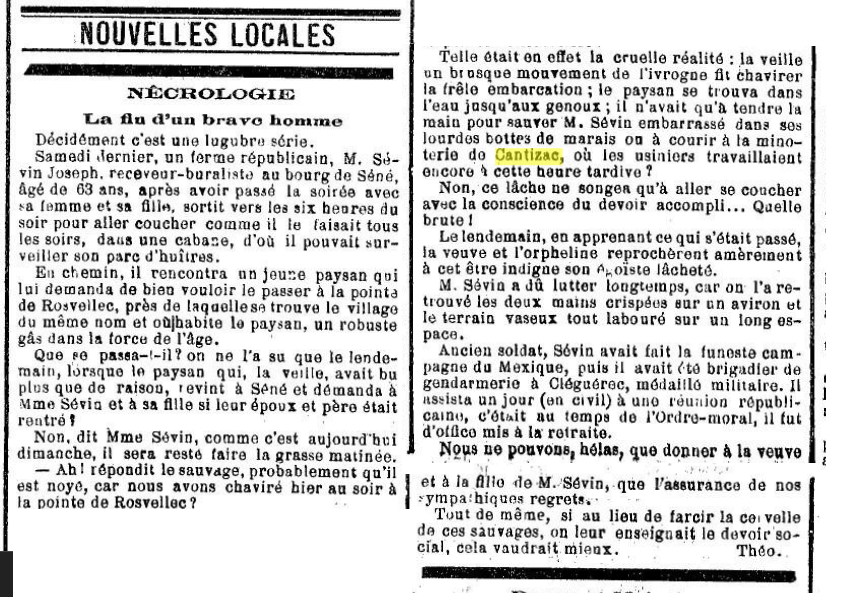
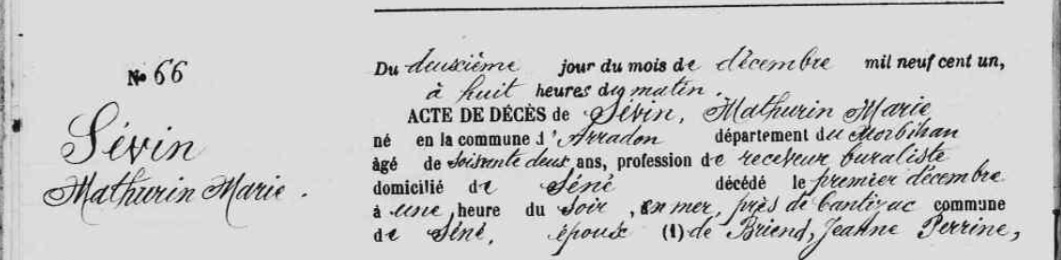
Selon cette coupure de presse et son acte de décès, on comprend que l'ancien gendarme, devenu buraliste, a réussi à acheter des concessions d'huîtres. Mathurin SEVIN, alors âgé de 61 ans, sort dans la nuit du dimanche 1er décembre 1901 et se dirige vers Cantizac où il possède une cabane depuis laquelle il surveille sa concession.
A une heure tardive, un individu ivre lui demande de l'aider à passer sur Vannes sur la pointe de Rosvellec. SEVIN le monte sur sa barque et tous les deux tombent à l'eau. Le soudard s'en tirera sain et sauf mais SEVIN se noye. Sa femme deviendra ostréicultrice pour subvenir au foyer.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là son fils et sa fille continueront le combat de leur père.....
Revenir àla page sur les maires de Séné sous la III° république :
Mlle MARTIN victime des Batignolles 1921
Les archives en ligne du Morbihan permettent de mener des recherches dans la presse d'avant guerre qui a été numérisée. Le choix judicieux de mot clef permet de retrouver des articles de presse parlant de l'actualité de Séné.
Ainsi, en tappant le mot "POULFANC", très corrélé à notre commune, et avec un peu de patiente et d'attention, ont peut tomber sur des articles de presse comme celui-ci, daté du 22 novembre 1921.
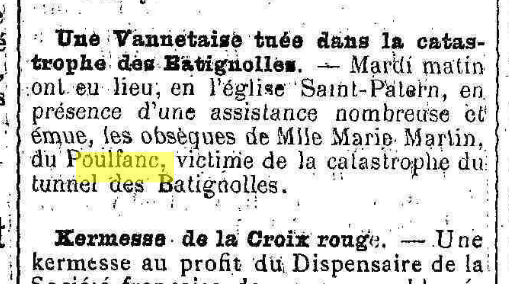
Mlle Martin suppose une jeune fille non encore mariée; le Poulfanc sous-tend qu'elle habitait sans doute au Poulfanc à Séné; la catastrophe des Batignolles nous indqiue que la demoiselle Martin est morte lors de cet accident ferrovière.
Qui était Mlle Martin, comment a-t-elle disparu et qu'allait-elle faire à Paris ?
L'article de presse nous conduit à vérifier son inhumation à la paroisse de saint Patern de Vannes. Le registre nous indique qu'une certaine Anastasie MARTIN décédée le 6/10/1921 a été inhumée le 17/10/1921 à Saint-Patern. 12 jours d'écart, le temps de rappatrier le corps.. Son père s'appelle Louis Martin et sa mère Marie DUVAL. Le registre mentionne que la personne est âgée de 22 ans, soit une année de naissance en 1899.
Le courrier de Pontivy dans son édition du 9 octobre 1921 annonce cette terrible catastrophe qui s'est produite le 5 octobre 1921. Les informations concordent.
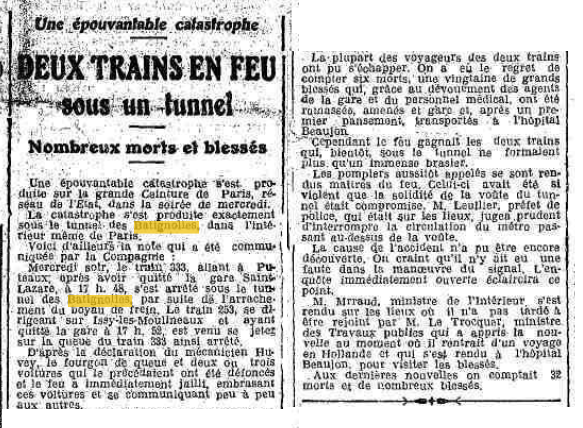
La consultation méthodique du dénombrement de 1921 permet d'identifier un certain Louis Marie MARTIN établi comme aubergiste au Poulfanc à Séné.
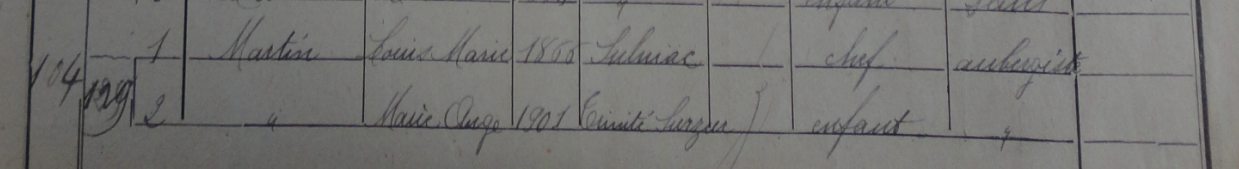
On n'y voit point de Anastasie mais une Marie Ange née à La Trinité Surzur. La consultation des registres de naissance de cette commune permet d'identifier le nom de sa mère.
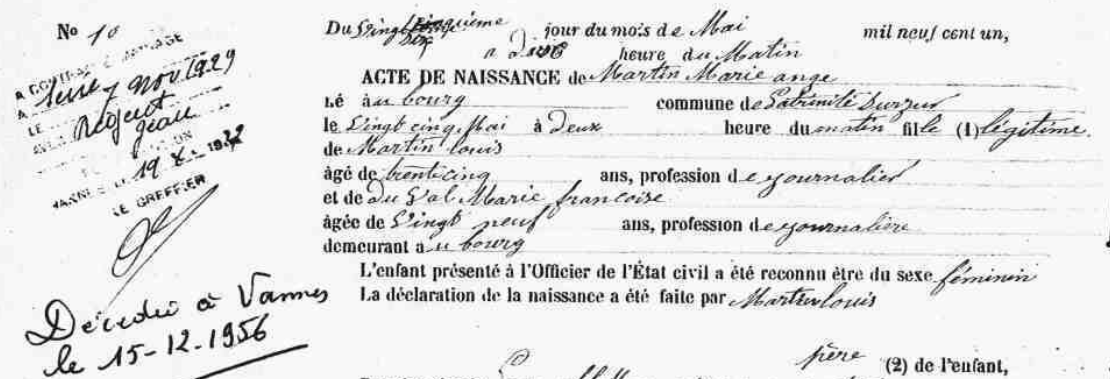
Il s'agit de Marie Françoise DUVAL. Il pourrait s'agir de la bonne famille car le patronyme "Duval" n'est pas très commun en Bretagne. Cette Marie Ange est née en 1901. S'agirait-il de la soeur cadette de la victime? On poursuit la consultation des registres de naissance pour décourvir une Anastasie née en 1899!
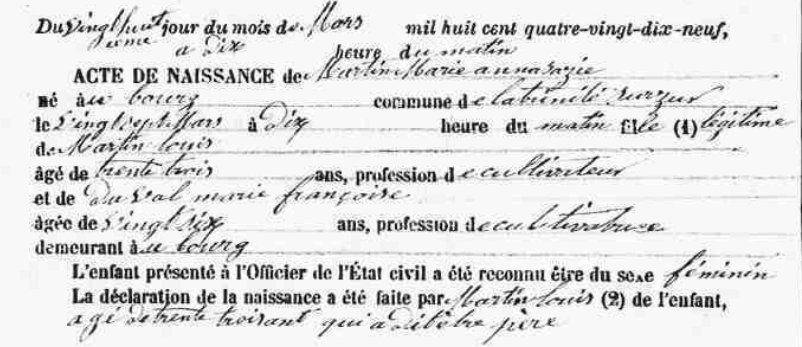
Ainsi Marie Anastasie MARTIN, fille de Louis Marie MARTIN (Sulniac 5/02/1866) et de Marie Françoise DUVAL (11/06/1872 Surzur) est née à La Trinité Surzur le 28/03/1899, a vécu à Séné au Poulfanc et est décédée lors de la catastrophe des Batignolles le 5 octobre 1921, officiellement le 6 octobre 1921.
Ces parents, tous deux cultivateurs au village de Kerbossen en Surzur, s'étaient unis à Surzur le 9/05/1894 où leur fille aînée est née le 5/10/1894. La petite Joséphine apparait au dénombrement de 1911 à Séné. Anastasie et Marie Ange ainsi que leur père n'y figurent pas. Leur mère décède le 8 juin 1913 à l'hôpital mlixte 1 rue de la Loi à Vannes et son décès sera retranscrit sur Séné.
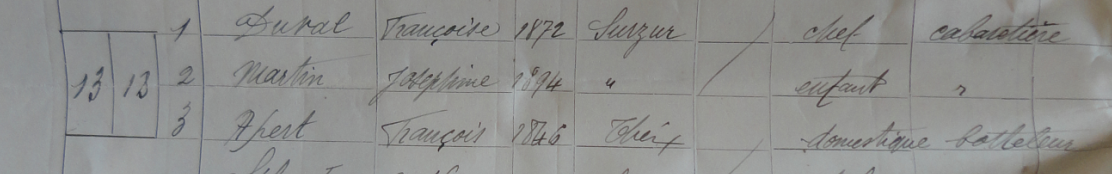
On ne retrouve pas les Martin au dénombrement de 1906. La famille s'est sans doute établie au Poulfanc entre 1906 et 1911 comme caberetière et aubergiste comme l'indique les autres dénombrements.
Quand Louis Marie MARTIN perd sa fille Marie Anastasie, il est déjà veuf depuis 1913. Il mariera à Séné ses deux autres filles, Joséphine, le 20/01/1920 avec un certain Louis Marie PERRIGAUD, gendarme et Marie Ange, le 8/10/1929 avec Ange Marie RIDAN, pêcheur au village du Ranquin.
On le retrouve encore au dénombrement de 1926, vivant seul et aubergiste au Poulfanc. Il tenait l'auberge de la Villambois, aujourd'hui, le bar le Suroit..
![]()
Qu'allait faire Anastasie MARTIN à Paris en ce mois d'octobre 1921 ?
Allait-elle voir un parent établit en région parisienne ? Est-elle allé chercher du travail en région parisienne ? Allait-elle voir son fiancé ?
Son extrait d'acte de décès communiqué par la ville de Paris nous éclaire un peu.
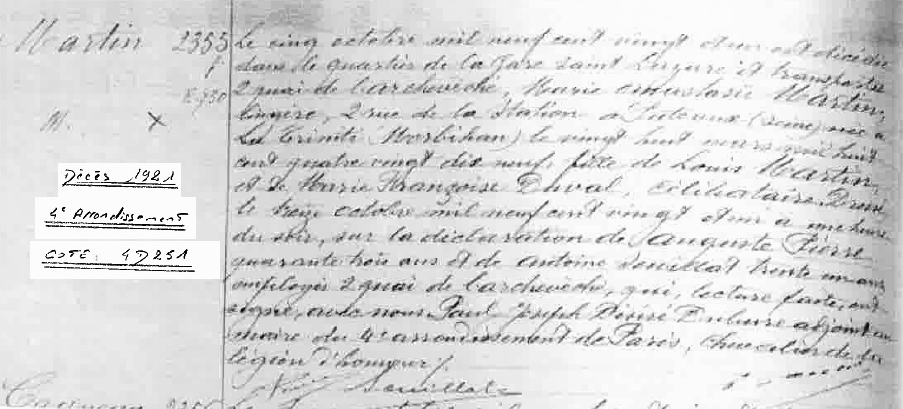
Sa lecture est difficile, mais on arrive à lire que Marie Anastasie MARTIN est déclarée décédée le 13 octobre par des employés du 2 Quai de l'Archevéché à Paris. Il y avait à l'époque une morgue derrière la cathédrale Notre Dame. Fermée avant guerre, elle semble donc avoir été réouverte pour héberger les corps de la catastrophe des Batignolles.

On apprend de son acte de décès, que Marie MARTIN exerçait la profession de lingère et résidait au 2 rue de la Station à Puteaux. Elle rentrait donc chez elle ce mercredi 5 octobre 1921, sans doute après son travail de lingère quelque part dans Paris....
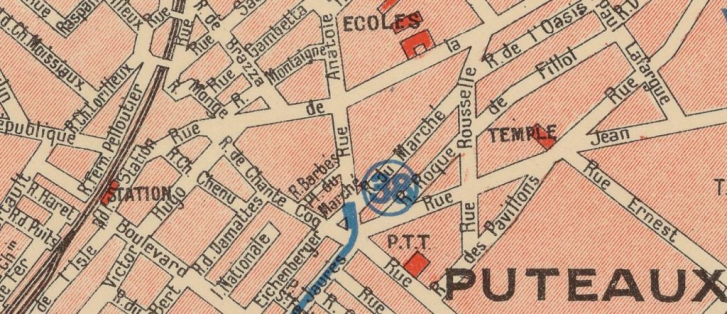
Les articles de presse nous indiquent que le train n°332 de 17H48 au départ de Saint-Lazare pour Versailles Rive Droite a été tamponné sous le tunnel par le train n°253 qui se dirigeait vers la gare de Moulineaux (aujourd'hui la ligne de tram-way T2). Cependant ces deux lignes passaient par Puteaux, si bien qu'on ne sait dans quel train Anastasie MARTIN était montée.
La catastrophe des Batignolles aura un grand retentissement en France. Des obsèques nationales auront lieu à Paris.
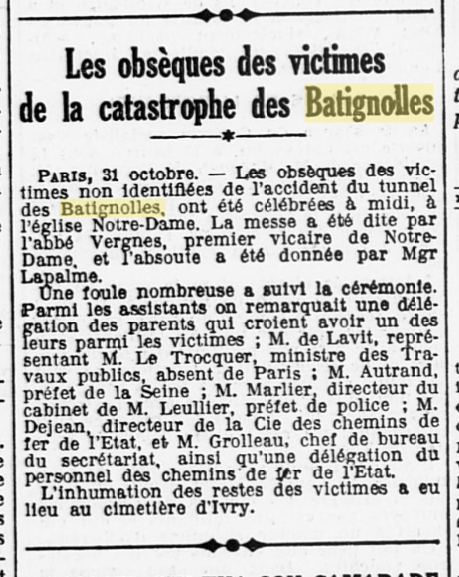
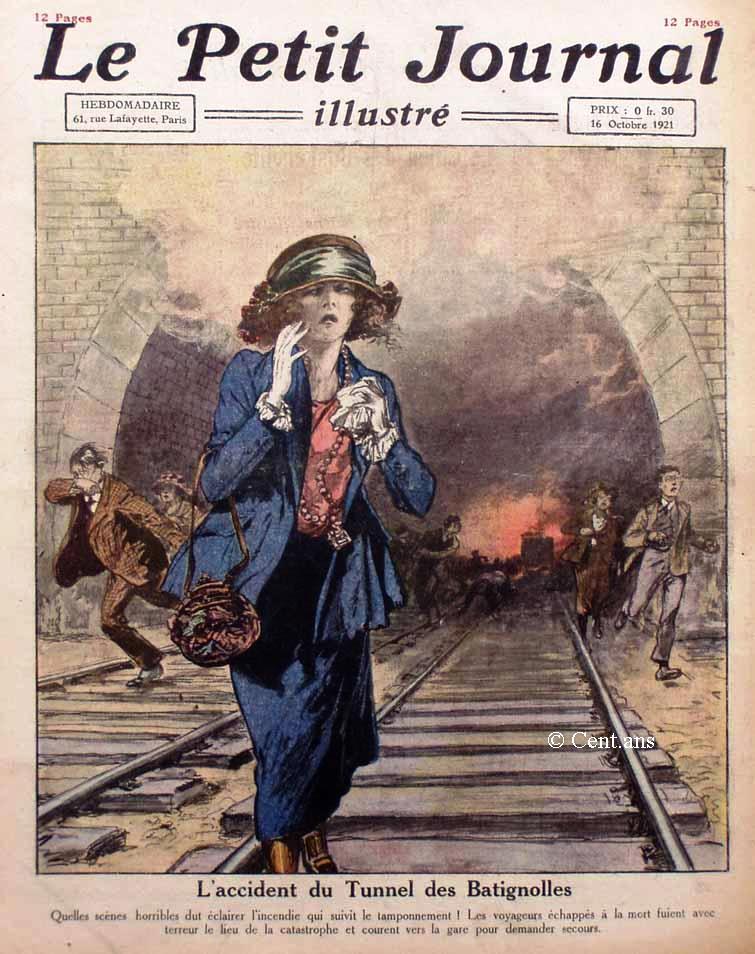
Comme le relate très bien l'article du Ouest Eclair en pièce jointe, un train au départ de la gare Saint-Lazare s'est immobilisé sur la voie dans le tunnel pour réparer une rupture d'accouplement. Un second train a emprunté la même voie et a tamponné le train à l'arrêt et crevé la réserve de gaz qui allimente l'éclairage du train. On dénombra une trentaine de morts dont un enfant et Marie Anastasie MARTIN, domiciliée à Séné.
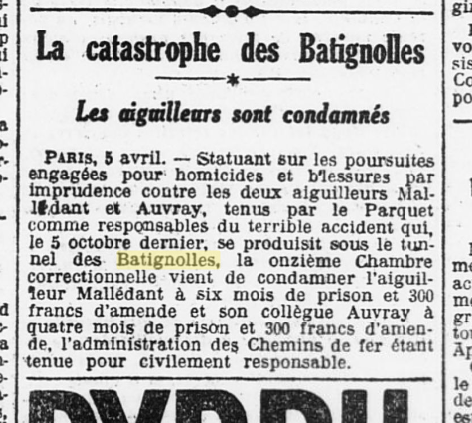
Le procès aboutira à inculper deux employées des cheimns de fers. Les autorités décideront d'éliminer des trains la présence de gaz et on décidera de supprimer le tunnel des Batignolles. Encore aujourd'hui, on peut voir en contre-bas de la rue de l'Europe les voix de chemins de fer à l'air libre partant de la gare Saint-Lazare.

ALLANIOUX tue sa Désirée 1924
La presse, en ce mois de novembre 1924, fait les gros titres avec ce meurtre, rue de la Garenne, à Vannes, non loin de la porte Prison...
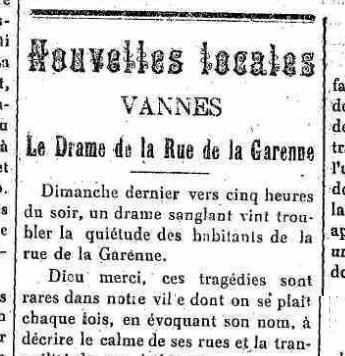
L'Avenir du Morbihan relate ce fait-divers : Le drame de la Rue de la Garenne.
Dimanche dernier vers cinq heures du soir, un drame sanglant vint troubler la quiétude des habitants de la rue de la Garrenne. Dieu merci, ces tragédies sont rares dans notre ville dont on se plait chaque fois, en évoquant son nom, à décrire le calme de ses rues et la tranquilité de ses habitants.
Dans ces conditions il n'est pas difficile d'imaginer l'émotion qui s'empare de tous lorsque, au hasard de la vie et des rencontres, le revolver ou le couteau entrent en jeu et lorsque, surtout, ils laissent des traces sanglantes qui, comme dimanche, mettent le point final à de jeunes existences arrivées presque, au seuil du bonheur.
La reconstitution du drame
Dans l'après-midi de Lundi, le juge d'instruction, M. Le Meur, accompagné de M. le commissaire de police Bourdon, s'est rendu rue de la Garenne, pour reconnaître les endroits où le drame s'est déroulé.
C'est près des magasins de M. Josse, à deux pas de la grille d'entrée de l'habitation de Mme Normand, chez qui était en service Désirée Rolland, que les coups de revolver furent tirés.
Désirée Rolland arrivait chez sa patronne venant de la rue des Vierges. Joseph Allanioux, sachant sa rentrée imminente, arrivait à sa rencontre par la rue de la Garenne. Quelques paroles furent prononcées; puis, trois détonations retentirent successivement et les deux corps s'affaissèrent sur le trottoir.
L'autopsie de la victime
L'autopsie de Désirée Rolland a été faire dans l'après-midi à l'amphithéâtre de l'hôpital mixte. Les deux coups de revolver qu'elle a reçus lui avaient traversé le corps de part en part et l'un avait atteint le coeur. La mort a donc été foudroyante. Dans la soirée, la mise en bière du cadavre eut lieu après de nombreuses visites que reçut une dernière fois la malheureuse domestique.
L'enquête
D'après les premières déclarations du meurtrier, il se serait agit d'un drame passionnel; les deux fiancés ne pouvant être unis, la tante de la jeune fille s'y opposant. Mais on ne pouvait se défendre d'un certain scepticisme quant à leur exactitude et nous étions finalement conduits à nous demander s'il disait réellement la vérité et si, plutôt, il ne s'agissait pas non d'un double suicide mais d'un crime. Nous le laissons entendre en écrivant qu'il y avait eu des propos assez vifs échangés entre les deux jeune sgens, ce qui n'est pas le fait d'amoureux qui ont l'intention de se donner leur suprême baiser dans la mort. Nous le laissons également entendre en nous étonnant du lieu choisi: la voie publique.
Nous étions dans le vrai et , hier, Joseph Allanioux devant le magistrat instructeur a reconnu qu'il n'était plus l'amoureux rêvant aux étoiles, ni le romanesque fascinateur de sa fiancée qu'il aurait décidé d'accompagner dans la mort, mais bien le vif assassin d'une fiancée que sa famille se refusait à marier. Alors il a raconté sa journée et celle de la victime.
Désirée Rolland ayant obtenu un congé de la journée, s'en fut le passer à Bellevue chez sa tante. Allanioux vraisemblablement, devait être au courant de ce congé. Il se rendit dans ces parages. Il fut un peu désappointé en voyant sa fiancée en compagnie de quelques jeunes filles des villages voisins. Il la croyait seule et comptait probablement obtenir d'elle des promesses relatives à un mariage que sa tante ne voulait pas.
Avec d'autres personnes, le canot qui assure le passage, les transporta à Conleau et il y aurait eu, parait-il, des propos assez vifs échangés, ceux auxquels nous faisons allusion et - pour y couper court - Désiré Rolland prit rapidmeent le chemin de Vannes, suivie d'Allanioux. Pour arriver chez sa patronne, la jeune fille passa directment par la place des Lices et la rue des Vierges. Le jeune homme monta la rue de la Garenne. Tous deux se retrouvèrent où nous l'avons dit. On sait le reste.
Allanioux a ajouté que sa fiancée ne l'avait jamais abandonné; que c'était seulement sa tante qui s'opposait au mariage. Ceci est contredit par plusieurs amies de la jeune fille.
La victime
Originaire de l'Ile aux Moines, Désirée Rolland était une belle et forte fille, éprouvée de bonnes heures par la mort de ses parents, survenue au cours de la guerre, dans un torpillage de bateau. Elle jouissait de l'estime de tous ceux qui la connaissaient.
La préméditaioin
M. Thiphaigne, oncle de la victime, a fait des déclarations très graves, qui démontrèrent nettement que l'assassin avait prémédtié son crime; "Ma nièce, a déclaré Mathurin Thiphaigne, retraité des Douanes, s'était fiancée il y a trois semaines à Joseph Allanioux, employé des chemins de fer dans la Ruhr, puis affecté au Bourget. Le jour des fiançailles, il s'est montré d'un caractère jaloux et emporté avec sa fiancée, lui cherchant dispute et lui disant qu'elle n'était qu'une imbécile comme son oncle et sa tante. Il ajouta qu'une fois mariée, il l'empêcherait d'écrire à sa tante et à moi-même.
Craignant que leur nièce ne soit malheureuse avec Allanioux, M. et Mme Thiphaigne lui conseillèrent de reompre les fiançailles. Désiré Rolland se montra affectée, puis par la suite, elle prit son parti de rompre.
Lorque Allanioux a connu la rupture, a déclaré M. Thiphaigne, il a déclaré devant lui, sa femme et sa soeur Eugnéie, qu'elle ne vivrait pas longtemps.
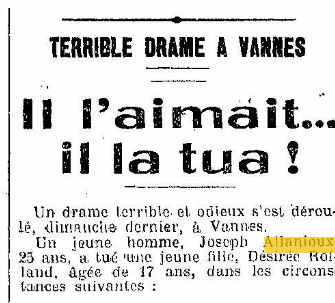
TERRIBLE DRAME A VANNES
Il l'aimait, il la tua !
Un drame terrible et odieux 'est déroulé dimanche dernier à Vannes.
Un jeune homme, Joseph Allanioux, 25 ans, a tué une jeune fille, Désirée Rolland, âgée de 17 ans dans les circonstances suivantes :
Allanioux s'était fiancé il y a trois semaines avec Désirée Rolland, à Séné.
Le jour même sa tenue inconvenante et grossière révolta la jeune fille qui déclara que tout était rompu.
Depuis, il poursuivait Désirée de ses assuidités et essayait de la faire revenir sur sa décision. Dimanche, le jour du crime, Désirée Rolland était allée seule rendre visite à son oncle et à sa tante. M. et Mme Thiphaigne à Bellevue en Séné. Le soir venu vers cinq heures, elle repris le chemin de Vannes, accompagnée de sa tante qui s'embarqua avec elle sur le bateau du passeur de l'Angle à Conleau et la conduisit jusq'ua bois.
Des amies parmi lesquelles Mlle Marie Doridor, l'ayant aperçue l'attendirent pour faire route avec elle. Elle spartirnet donc ensemble. Toutes étannt en place, elles se hâtèrent pour rentrer chez leurs maître. En une demi-heure, elles firent le trajet, de 4 kilomètres. Pour s'entrainer, elles chantaient gaiement.
Désirée avait aperçu, au moment de quitter Conleau, son ex-fiancé Allanioux qui montait dans l'autocar pour venir à Vannes. Elle en fit la remarque à ses camarades. Arrivée à Vannes, Désirée quitta sa cousine qui l'accompagnait à la hauteur de lla Porte-Prison. C'est à ce moment que le drame s'est produit. Le meurtrier attendait sa victime. Des témoins ont entendu le bruit d'une discussion et, aussitôt après, les coups de revolver.
Un portrait de Désirée
La maîtresse de Désirée a déclaré que la jeune fille avait une conduite parfaite: "C'était une fleur d'une délicatesse rare. Education excellente. Certainement Allanioux n'était pas le mari qui lui convneait. Elle l'aurait cependant agréé, sans la scène qui se passa le jour des fiançailles".
D'autres personnes qui l'ont eue à leur service, ont fait l'éloge sans réserve de la malheureuse jeune fille.
Sa tante, Mme Thiphaigen avait comme un pressentiment de la fin tragique de sa nièce.
Le père de Désirée, qui était douanier et ses deux frères snt morts noyés accidentellement. Elle était la dernière de cete famillle si éprouvée. Sa famille est de splus honoables. Deux de ses cousins sont capitaines d'infanterie; ses oncles sont officiers des douanes.
Elevés ensemble
Joseph Allanioux et Désiré Rolland aaient été élevés ensemble à Bellevue où le père Allanioux avait sa ferme et où habitait la famille Thiphaigne. Allanioux père était le fermier de Mme Normand. Il était connu dans le pays sous le nom de "Le croquant".
Désirée, à la suite de la mort de ses parents et de sa grand -mère avait été accueillie par M. et Mme Thiphaigne, voisins d'Allanioux.
La préméditation
Tous semble indiquer la préméditation. Allanioux avait voulu acheter ces jours drniers un pistolet automatique chez Daniel, armurier à Vannes, qui avait refusé de lui en vendre un. Il a dû se procurer son arme dans une autre ville. Le meurtrier passait pour un exalté, un demi-fou.
L'INSTRUCTION
Lundi à 16h15, M. Le Meur, juge d'instruction, accompagné de M. Bourdon, commissaire de policve et de M. Penfournis, commis greffier, s'est trnasporté à l'hôpital mixte pour interroger Allanioux.
Le meurtrier de Désirée Rolland avait quitté son lit et les attendait dans son cabinet. Il parraissait abattu.
Les aveux
Allanioux a avoué s'être rendu dimanche à Séné où il savait que son ex-fiancée était allée voir sa tante. Il l'a suivit et quand elle reprit le chemin de vannes, il était arrivé rue de la Garenne, quelques minutes avant elle. Après avoir échangé quelques paroles et lui avoior reproché brièvement la rupture de leurs fiançailles, il tira sur elle trois coups de révolver et aussitôt après tourna son arme contre lui-même et tomba sur le sol à côté de sa victime.
Il a reconnu en outre qu'ayant perdu son revolver, il avait essayé d'en acheter un chez M. l'armurier Daniel qui refusa de lui en livrer.
Vendredi il avait retrouvé le revolver perdu. A la fin de l'interrogatoire, Allanioux a exprimé ses regrets.
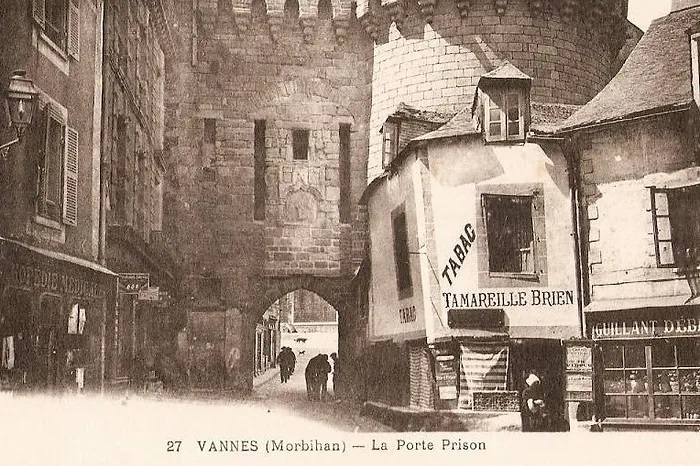
Sur les lieux du drame.
Avant de se rendre à l'hôpital, le juge d'instruction se rendit rue de la Garenne sur les lieux mêmes où le drame s'était déroulé la veille; Il a interrogé divers témoins qui ont confirmé la brève discussion qui avait eu lieu entre Désiré et son meurtrier. Quand ils sont accourus au bruit des détonations, ils ont trouvé les corps du meurtrier et de sa victime étendus côtes à côte sans mouvement. Ils ont été aussitôt chercher après avoir transporté Désirée Rolland et Allanioux au débit Guillant, le docteur Franco, médecin légiste, qui a pratiqué lundi après-mdi l'autopsie de la victime et a constaté qu'une balle de revolver l'avait frappée au thorax, sans pénétrer; une seconde balle avait perforé le poumon droit et la troisièùe traversé le coeur. La mort a dû être instantanée. L'émotion est toujours très grande à Vannes.
Tout avait pourtant bien commencé car les jeunes fiancés depuis le 12 octobre devaient se marier comme l'indique cette coupure de presse.
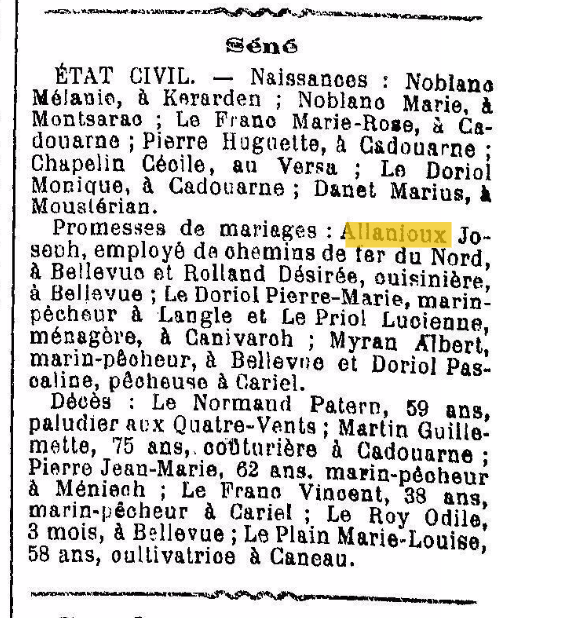
On y apprend que Joseph ALLANIOUX est employé des chemins de fer du Nord et vit à Bellevue, qu'il doit se marier avec Désirée ROLLAND, jeune cuisinière, dont la famille vit à Bellevue à Séné. On sait qu'elle travaille chez Mme Le Nornand à Vannes et que ce dimanche 11 novembre elle a pris sa journée pour rendre visite a ses tuteurs M et Mme Tiphaigne. Ce sont les parents de Lucien Tiphaigne, soldat mort pour la France en aout 1914.
On retrouve bien le couple de fiancés sinagots dans les registres de l'état civil et au dénombrement de 1921.
Joseph ALLANIOUX (05/01/1899) est le fils de Marie françoise Jacob et d'Yves Louis Allanioux, cultivateur fermier sur les terres des Tiphaigne. Sa famille a été endeuillée pendant la Première Guerre Mondiale par deux fois.L'ainée des garçons, Honoré Patern Marie, est mort pour la France en héros au Mesnil les Hurlus en 1917. Son beau-frère, Armel Le Bourvelec, époux de sa soeur Honorine, atteint de tuberculose contractée en mer, est mort pour la France à Séné en mars 1920.
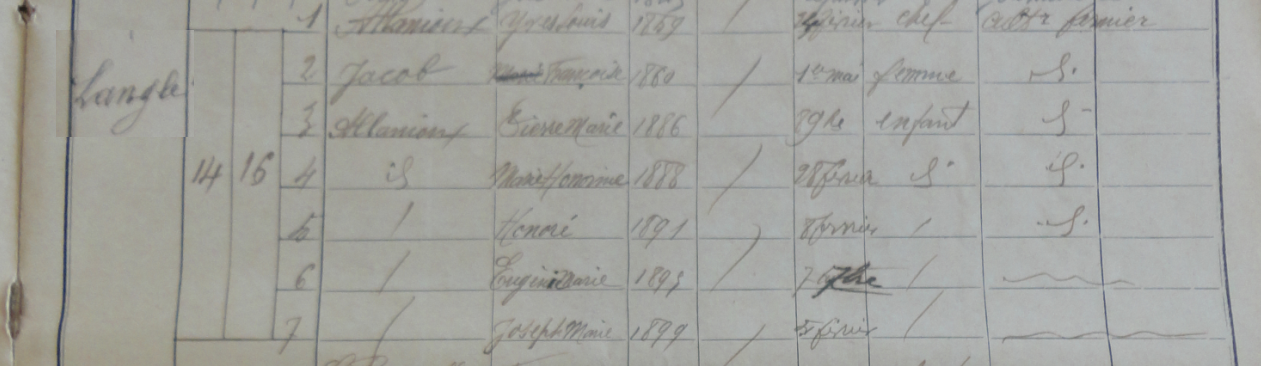
La fiche de matricule de Joseph Allanioux nous indique qu'il fut mobilisé en juin 1918 jusqu'en octobre 1919. Ensuite, il participa aux opérations en mer Noire avant d'être démobilisé en mai 1921. C'est de retour au pays que le jeune Allanioux fréquente sa jeune voisine, qui deviendra sa fiancée avant de devenir sa victime, tuée par 3 des balles de revolver.
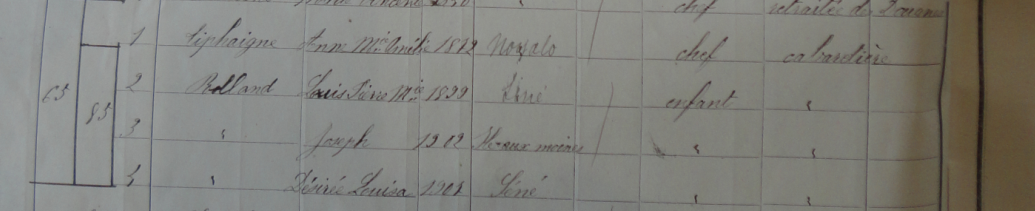
Quant à Désirée ROLLAND (26/06/1907) c'est la fille d'un matelot des douanes, Louis Marie Rolland et de Anne Marie Amélie Tiphaigne. Cette famille Tiphaigne-Rolland a également été endeuillée en perdant deux jeunes gars à la guerre, Lucien Tiphaigne à Doncourt en 1914 et Louis Pierre Marie, marin, disparu lors du torpillage du Saint-Georges, navire charbonnier coulé par un U-Bolt allemand en juillet 1918.
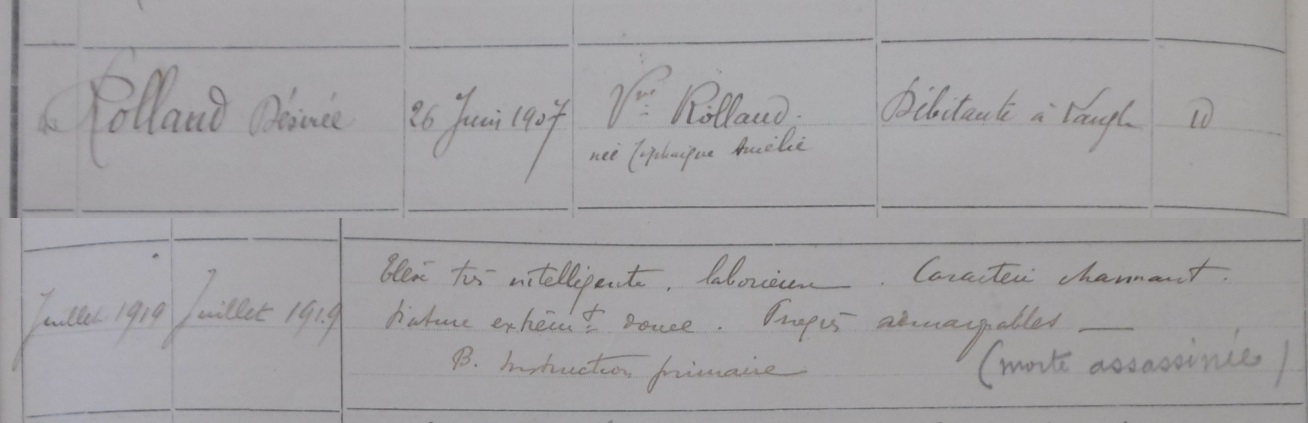
La généalogie suivante montre leurs liens de parenté.
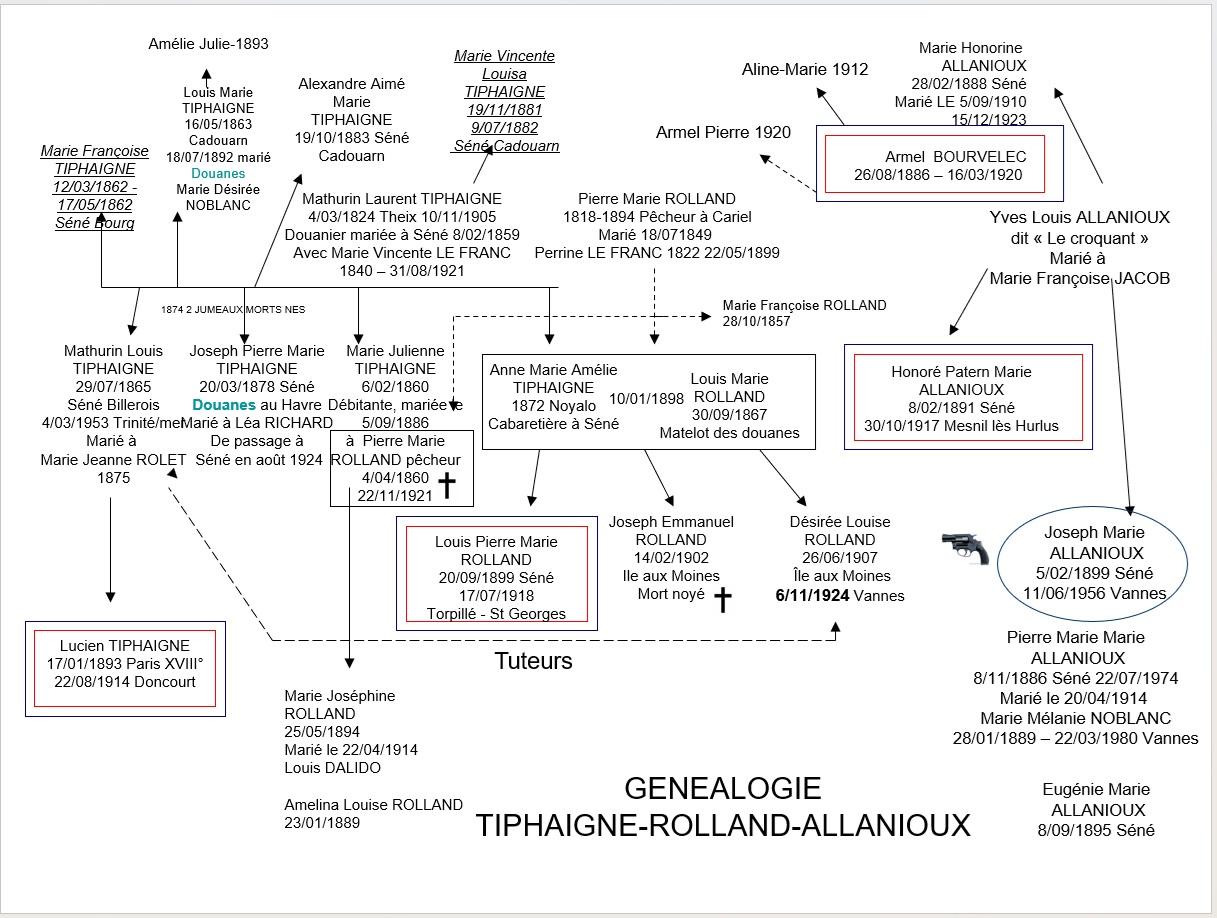
Les deux fiancés étaient voisins au quartier de Bellevue sur la presqu'île. Joseph à 25 ans et Désirée seulement 17 ans. Ils se connaissaient depuis l'enfance.
Le dénombrement de 1926 nous indique que la mère, Marie Françoise née Jacob, vit encore à Bellevue avec sa fille Eugénie et un petit-fils Armel Pierre. Au mois de novembre, Joseph ALLANIOUX vient de démissionner de la Compagnie de Chemin de Fer et revient à Séné sans doute chez sa mère.
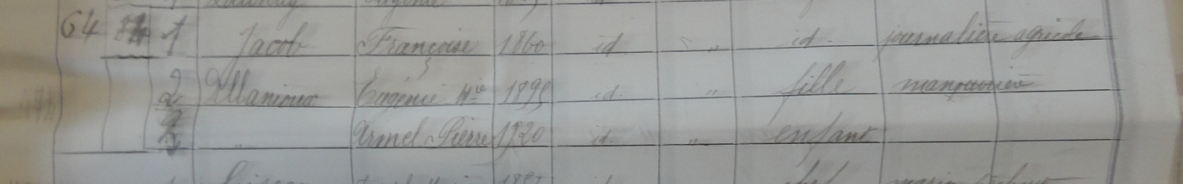
Le dimanche 11 novembre 1924, Désirée rentre sur Vannes en preneur le passeur à Barrarach et ensuite gagne le centre ville de Vannes à pied. Joseph Allanioux, qui on l'apprendra vient de démissionner des chemins de fer, est arrivé à Séné. Cette fin de dimanche, il prend l'autocar de Langle jusqu'à Vannes. Il retrouve sa "Désirée" à hauteur de la porte prison le long des remparts, rue de la Garenne. Il la tue de trois coups de revolver avant de retourner l'arme contre lui. Il n'est que blessé et après sa sortie de l'hôpital mixte de Vannes il sera interrogé par la police.
Allanioux n'a pas supporté que la jeune fille change d'opinion suite à son comportement à son égard. Le jeune fiancé éconduit a préféré tuer sa promise que de la perdre !
Désirée ROLLAND sera inhumée à Séné.
L'article de presse présenté résume très bien les faits mais ne donne pas le dénoument du procès ou Joseph ALLANIOUX est défendu par Maître MARCHAIS, avocat et député de Vannes.
La consultations des comptes rendus judiciaires aux Archives du Morbihan nous indique que Allanioux Joseph échappe à l'échaffaud et est condamné le 11 juin 1925 par les Assises du Morbihan à 10 ans de travaux forcés.
Mention reprise dans sa fiche de matricule.
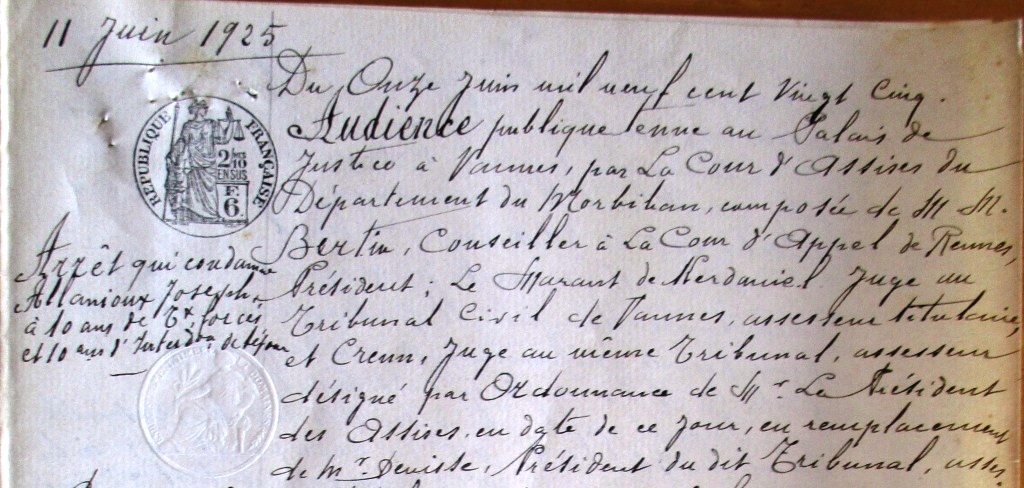
Il est conduit à la prison de Vannes mais on ne sait si il y a purgé toute sa peine...
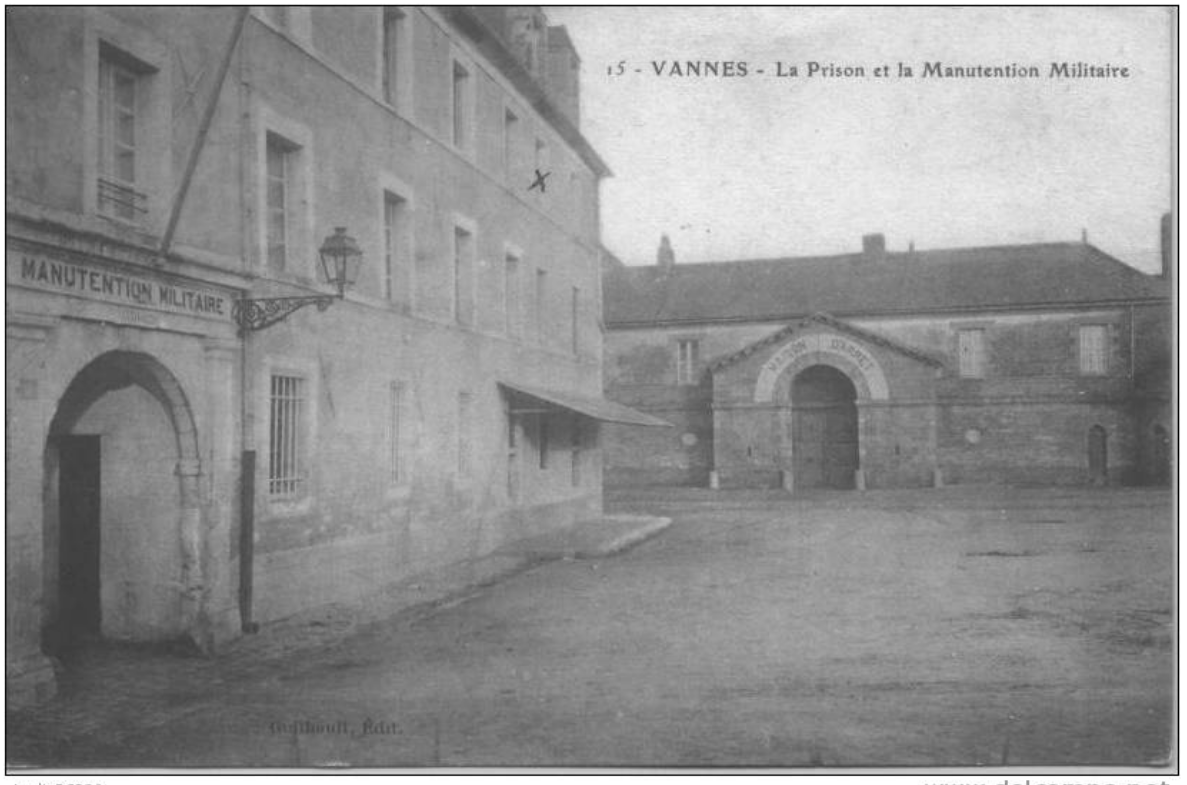
A sa sortie de prison il finit par entrer dans le corps des douanes. Il décède à Vannes le 11 juin 1956.
Ivresses lapidaires à Cadouarn, 1929
Quand l'historien local discute avec les anciens de la presqu'île, à la recherche de vieux faits divers à raconter, on se rappelle l'histoire d'une rixe entre voisins qui a mal tourné dans les années 30. Un certain GREGAM ou LE GREGAM qui aurait été tué par un étranger à Séné en marge d'une beuverie familiale chez les ALLANIOUX. Il n'en faut pas plus pour partir à la recherche de documents pour authentifier ce récit et bien sûr le relater précisement.
En consultant la presse ancienne numérisée par les Archives du Morbihan, en utilisant les mots clefs "Allanioux" ou "Gregam", on finit par trouver des articles d'époque qui nous relatent la rixe qui survint à Cadouarn en 1929.
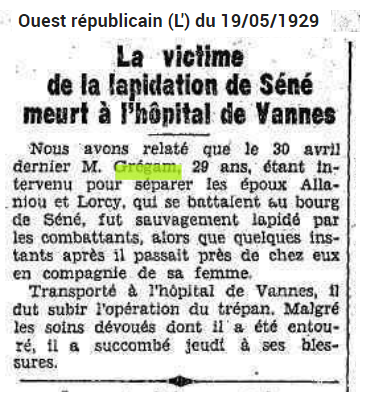
Cet autre article daté de juin 1929, nous livre d'autres détails sur les circonstances de la mort du Sinagot.
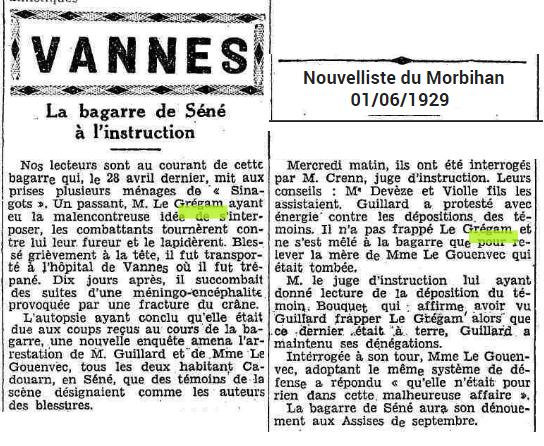
Enfin, cet article d'octobre nous donne un compte rendu du jugement au Tribunal de Vannes.
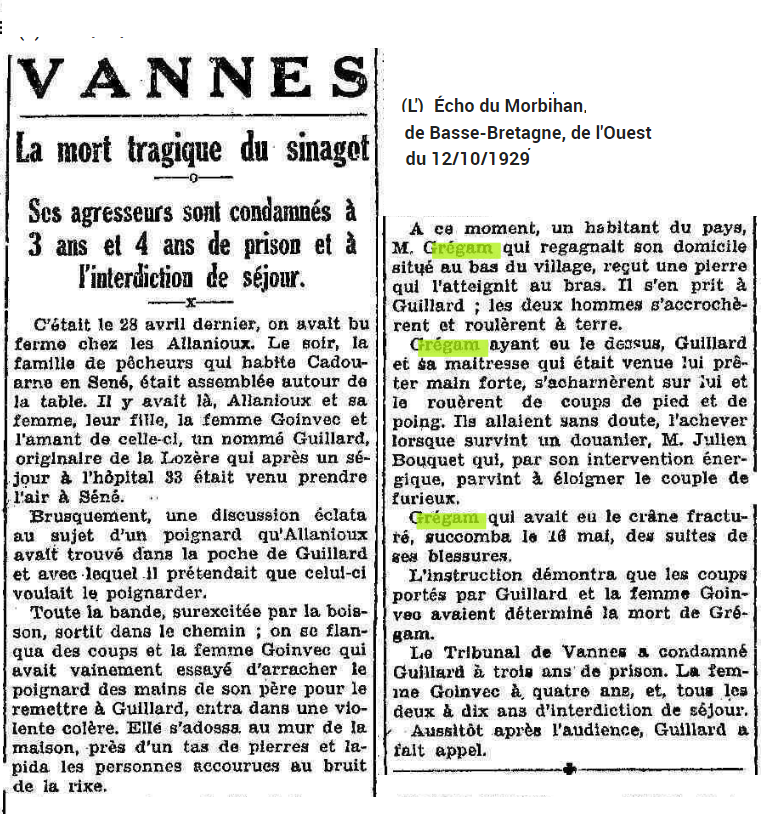
Afin de dresser le récit précis de cette mort tragique, on commence par établir l'identité des protagonistes en consultant les registres d'Etat Civil et on se déplace aux Archives du Morbihan pour consulter le compte rendu de l'audience du 9 octobre 1929.
Que nous apprennent ces documents ?
Le 28 avril 1929, un dimanche selon le calendrier, une réunion de famille a lieu chez Pierre Marie ALLANIOUX [13/01/1879-2/09/1933] et sa femme Angèle LE FRANC.
Les "ALLANIOUX" comme nous l'indique le dénombrement de 1921, sont un couple de pêcheurs qui vivent à Cadouarn et ont pour voisins la famille LE GREGAM et PIERRE, également pêcheurs.
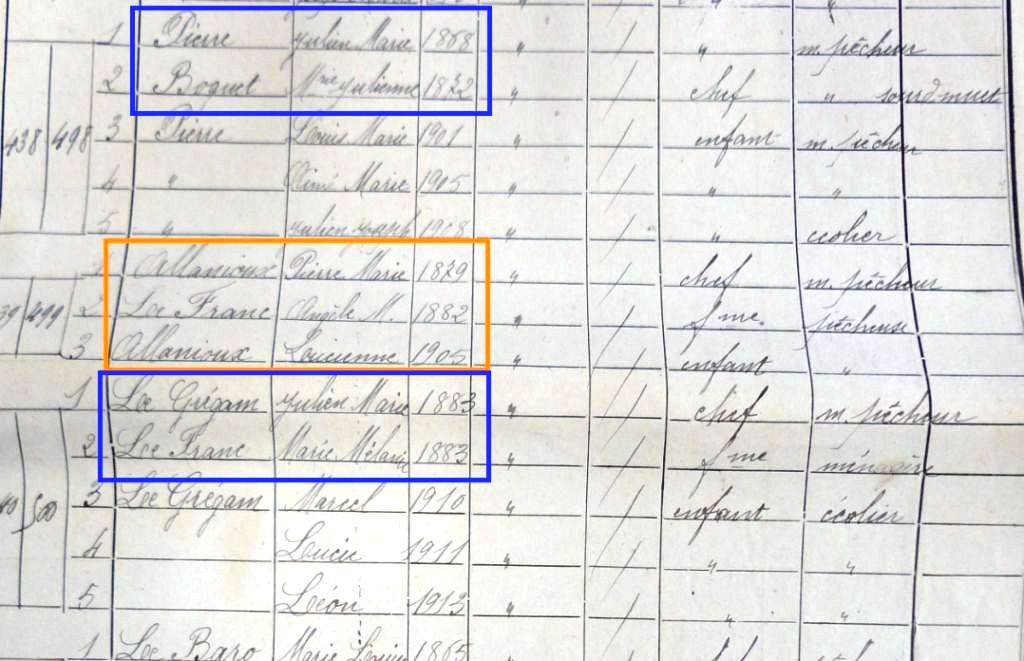
Leur fille Lucienne Marie ALLANIOUX, âgé de 24 ans, est revenue vivre chez ses parents. Elle s'est marié en 1924 à Séné, avec Maxime LE GOUEVEC, aussi tout au long de la procédure, est-elle appellée ALLANIOUX femme LE GOUEVEC, jusqu'au divorce obtenu par ce dernier le 23/01/1930. Maxime LE GOUEVEC, son époux, natif de Clichy, comme nous l'indique son acte de mariage, était alors livreur rue de Roulage à Vannes. Comment le couple s'est-il séparé?
Ce dimanche 28 avril 1929, Maxime n'est pas là. Lucienne ALLANIOUX, vit avec son amant, un certain André Julien GUILLARD, militaire, né le 9/02/1900, à Gravigny dans l'Eure, où il se marie le 29/06/1921 avec sa Madeleine Geneviève Saint-Gilles.
La fiche de matricule nous dit que André Julien GUILLARD, à l'âge de 20 ans, exerçait la profession de charretier. Durant sa conscription, il participe à la "Campagne en Pays Rhénans" (l'occupation de la Rhur par les Français). En janvier 1924, le soldat GUILLARD s'engage dans les armées et rejoint l'Indochine en novembre 1925 où il contracte une maladie. Il est réformé par le Commission de Réforme de Vannes en février 1929. Il perd son épouse le 21/04/1927.
Resté à Vannes, par hasard, le militaire, veuf, y fait la connaissance de Lucienne ALLANIOUX, dont le juge au cours du procès dira d'elle qu'elle est "une ivrognesse qui se livre à la prostitution".
Ce dimanche 28 avril 1929, les convives ont bu, un peu trop. ALLANIOUX, père, a trouvé un poignard dans la poche de GUILLARD et l'accuse de vouloir attenter à sa vie. Sa fille tente en vain de lui arracher le poignard. Les 3 protagonistes se retrouvent devant leur maison. Lucienne ALLANIOUX grandement éméchée, commence à jeter des pierres sur les voisins accourus, alertés par le bruit et les cris.
Julien Marie LE GREGAM [22/02/1883-15/05/1929], est marié à Marie Mélanie LE FRANC depuis 20 ans. Il est le père de 5 enfants, dont le dernier Paul.
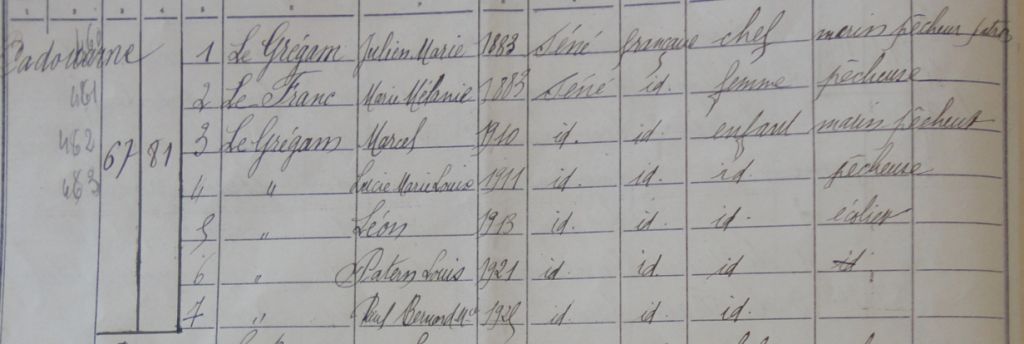
Il rentre chez lui et reçoit un projectile. Une bagarre éclate entre GUILLARD et LE GREGAM au cours de laquelle il est blessé par un coup de pierre sur le crane. Il décèdera selon le registre d'Etat Civil retranscrit à Séné, le 15 mai à l'Hôpital de Vannes, des suites d'une meningo-encephalite, infection de sa blesure au crane, selon l'autopsie pratiquée par le Docteur Monnier.
Le témoignage de Julien BOUQUET [25/02/1900-6/03/1971] qui parvint a stopper la rixe, sera accablant pour Lucienne ALLANIOUX. Comme nous l'indique sa fiche de matricule, BOUQUET est entré dans les Douanes après sa conscription dans la marine.
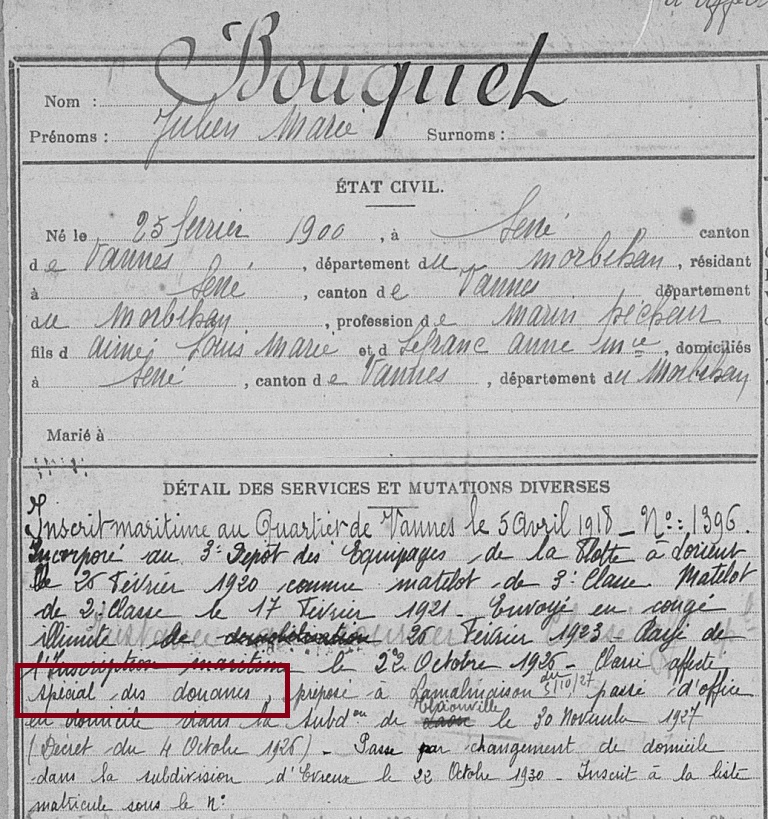
Il est ce jour-là sur Séné où réside sa soeur Marie Anne BOUQUET [29/04/1903 - ] qui s'est mariée à xxx Ange Marie LE GREGAM. Sa soeur fera partie des plaignants lors du procès.
Parmi les autres passants agressés par les couple ALLANIOUX-GUILLARD, figure leur voisin Julien PIERRE [2/11/1868- ]
Le Tribunal correctionnel de Vannes condammera Lucienne ALLANIOUX, femme LE GOUEVEC à 4 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour dans le Morbihan, peine qui sera confirmée en appel, où s'est pourvu André Julien GUILLARD.
Malgré le témoignage de BOUQUET, GUILLARD s''obstinait à ne pas reconnaitre les coups sur LE GREGAM. Sa peine fut ramené à 1 an d'emprisonnement et son interdiction de séjour fut levée. Etabli à Vannes, il se remarie le 16/07/1930 avec Mme Marie Philomène BUREL, veuve depuis 1929. Maxime LE GOUEVEC, une fois obtenu son divorce de Lucienne ALLANIOUX, seremariera en septembre 1930. Quant à Lucienne ALLANIOUX, elle refera sa vie en 1956.
Epilogue : en aout 1930, Pierre Marie ALLANIOUX sera condammé à 8 jours de prison pour avoir effrayé le petit orphelin, Paul LE GREGAM. Il aura une fin de vie tragique (lire article).
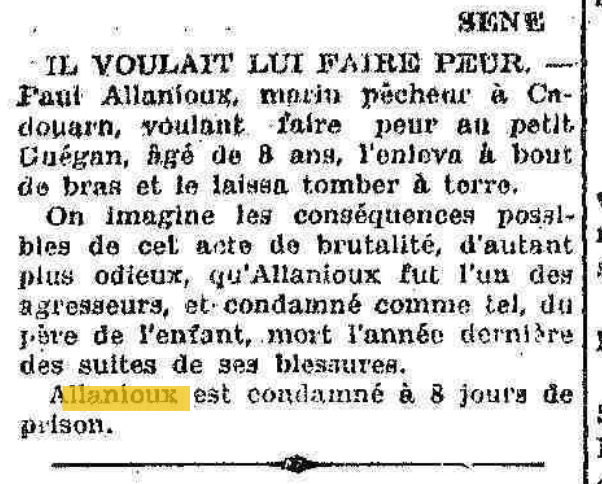
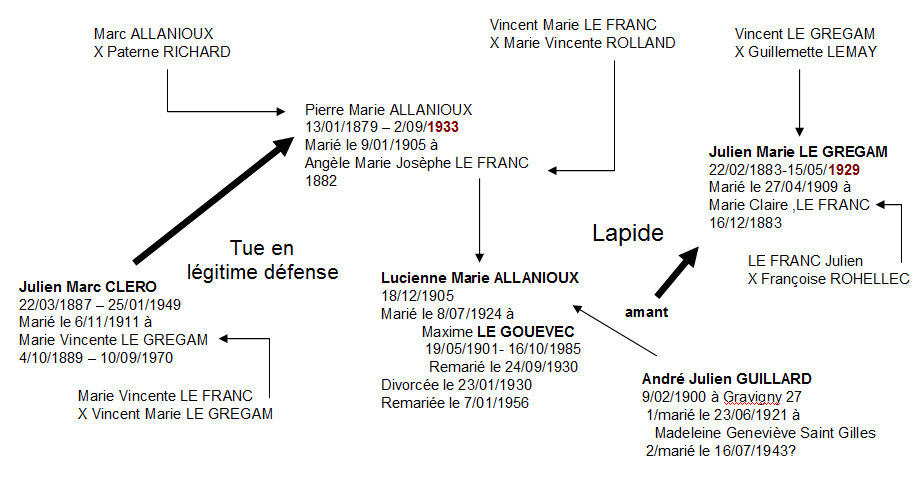
François QUESTER : 1er Centenaire de Séné 1919

En ce mois d'octobre 2016, Séné compte une centenaire de plus en la personne de Marie-Anne Le Touzo, née à Pennerm commune de Baden, en 1916.
Résidente au foyer logement du bourg de Séné, M. Le Maire s'est déplacé pour lui célébrer son anniversaire entouré des autres pensionnaires et de ses proches.
Au fait, combien il y a-t-il de centenaires à Séné ?
Qui fut le premier centenaire à Séné ?
A cette deuxième question on peut répondre, sans doute, le dénommé François QUESTER comme le raconte un article de presse de 1919.
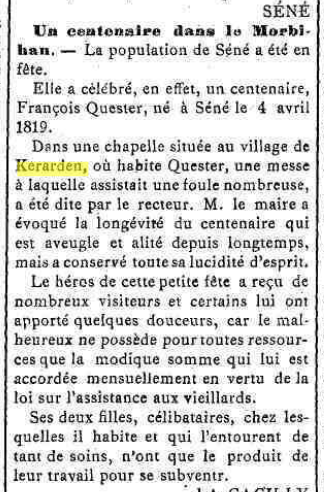
On peut lire qu'à l'époque le curé de Séné, Pierre Joseph OLLIER, avait donné une messe en son honneur en la chapelle de Kerarden, à laquelle une foule nombreuse assistait, dont M. le maire. La France était catholique, même si la loi de séparatiion de l'Eglise et de l'Etat est votée depuis 1905.
M. Quester était soigné par ses filles, ostréicultrices - on ne parlait pas encore "d'aidant" - et percevait une allocation d'assistance aux "vieillards" - on ne disait pas "senior".
La famille Quester apparaît bien au dénombrement de 1911 avant la guerre. On y constate que les filles Quester sont restées célibataires pour "soigner" leur père veuf.
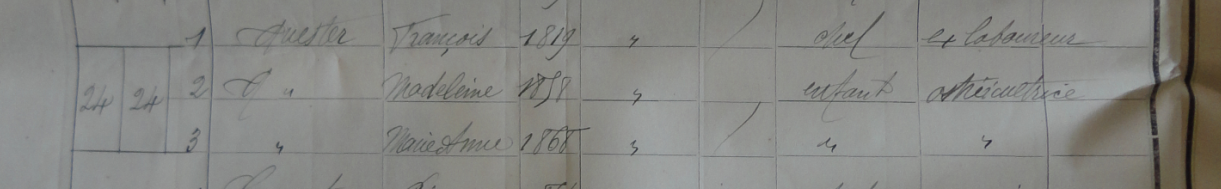
Au dénombrement de 1901 la famille Quester comptait au moins un garçon de plus. La site "Geneanet" nous renseigne sur la grande famille Quester. La descendance de François Quester sait-elle que leur aieul finit centenaire ?
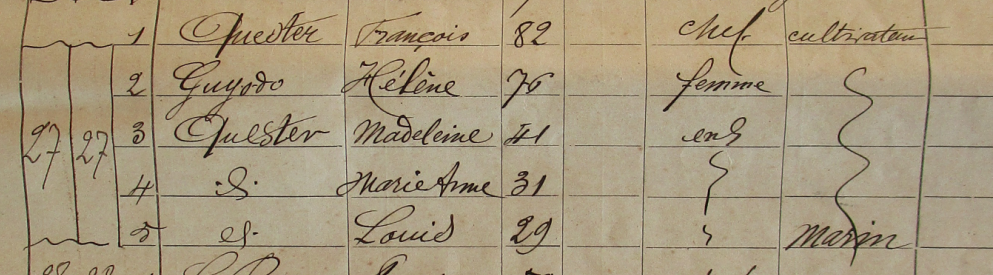
Aujourd'hui, il en va autrement. Mme Le Touzo réside dans un foyer adapté au grand âge. En 2016, la plupart des "ainés" touchent leur pension de retraite complétée éventuellement par le Fonds National de Solidarité.
Selon leur autonomie, une Allocation Personnalisée d'Autonomie, l'APA payée par le Département vient compléter leur revenu.
Le social a fait de larges progrès !
Hier, un tel évènement était exceptionnel. Aujourd'hui, il est devenu assez courant et dans quelques années, il deviendra sans doute banal tant le nombre de centenaires est amené à croître.
Les registres de l'état civil mentionnent bien la naissance de François QUESTER à Kerarden le 4 avril 1819 et son décès quelques semaines après son centenaire le 9 août 1919.
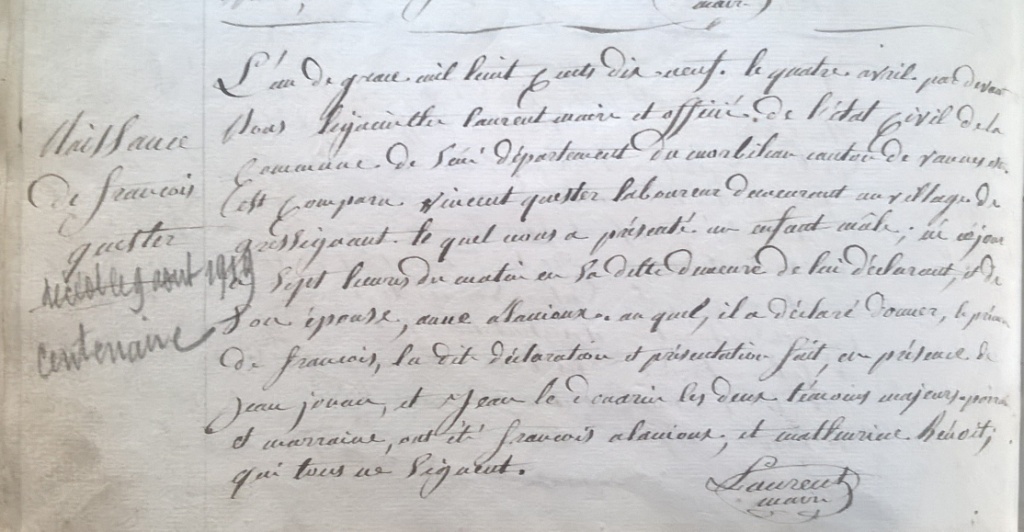
Séné a connu également un autre cen,tenaire célèbre en la personne de Marie Josèphe LE GREGAM. Né le 2 mars 1890 à Séné elle épousa Louis Marie LOISEAU avant la guerre le 20 avril 1914. Il était marin et passeur à Bellevue. Elle devint passeuse. Cette activité nautique la conduisit en bonne santé jusq'au "grand âge". Elle décéda le 2 août 1990 à la maison au foyer de personnes âgés de Séné comme nous l'indique Emile Morin dans son livre.
Lire article sur les passeurs.
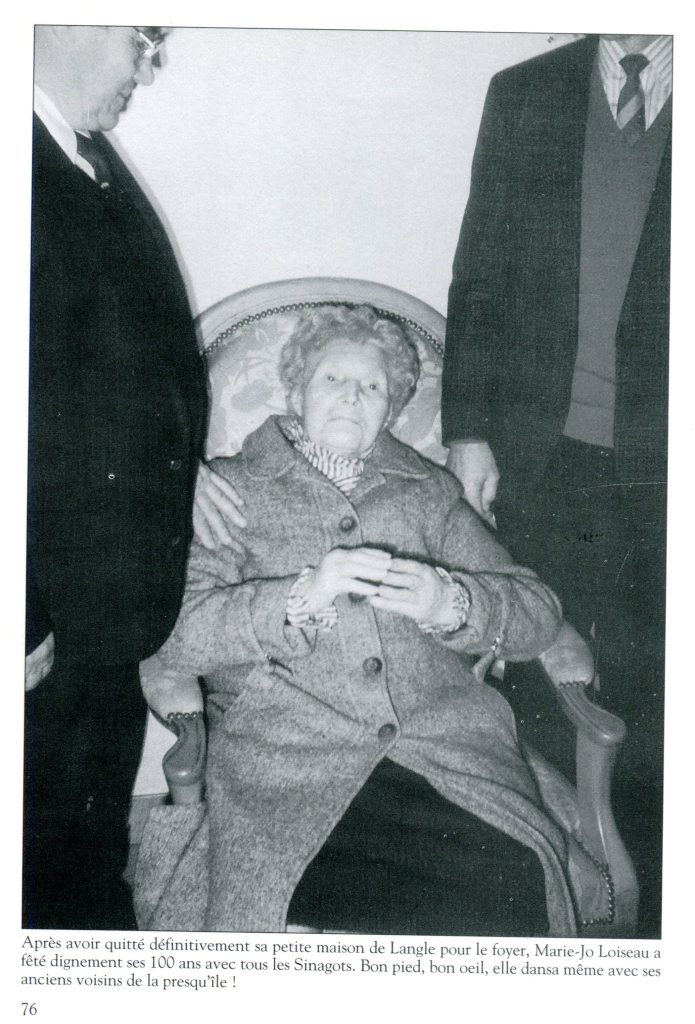
En mars 2000, notre commune célébrait les 100 ans de Marie LE DORIOL épouse Jouannic, alors résidente au foyer logement. Un article du télégramme dresse alors le parcours de la centenaire.
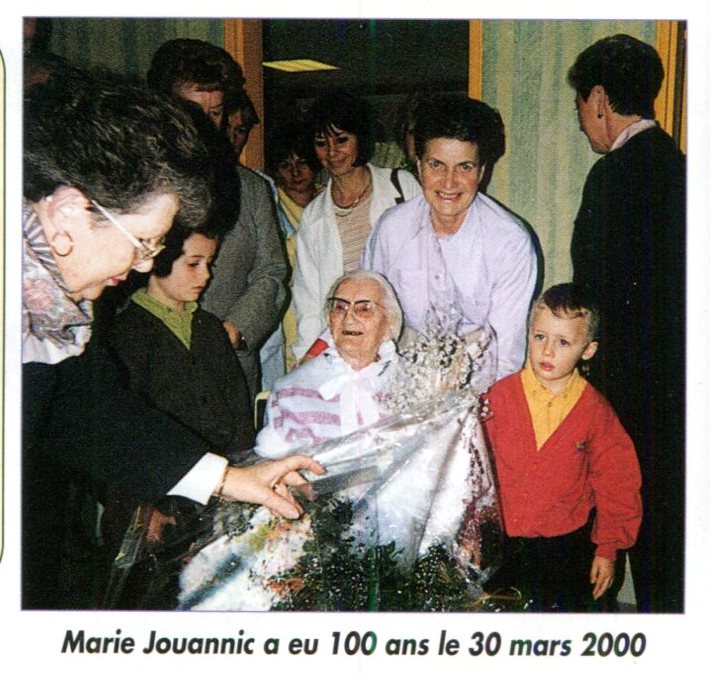
Marie Louise Jouannic, née Le Doriol, le 30 mars 1900 à Montserrac, son père absent est marin de commerce et mère ménagère. La jeune Marie perd son père, terre neuvier de profession. Elle sera élevée avec son frère chez les soeurs de La Garenne puis chez sa soeur. Plus tard, Marie exerce le métier de repasseuse jusqu'à son mariage, à l'âge de 33 ans. Elle ira vivre par la suite à Vannes, ruelle du recteur où elle vendra des articles funéraires. Marie Jouannic rejoint le foyer logement de Penhoët le 20 février 1995. Depuis, sa gentillesse et son sourire permanent affectionnent les résidents et résidentes du foyer. Nul ne connaît son secret de longévité mais, selon Marcel Carteau, «le cadre de vie et l'air marin du golfe du Morbihan sont signes de bonne santé ! »

Article publié dans le Télégramme que je remercie.
La commune compte une nouvelle centenaire dans ses rangs, en la personne de Célestine Le Penru, reçue hier à la mairie, en compagnie de sa famille et de ses amis.
23 août 1907-23 août 2007 : 100 ans jour pour jour, hier, pour Célestine LE PENRU, née BENOIT. « Un bon morceau de vie, une longue liste de situations vécues, difficiles ou heureuses que vous avez traversées avec sérieux et courage », félicitait le maire, Patrick Salic, lors de la cérémonie organisée en mairie pour son anniversaire.
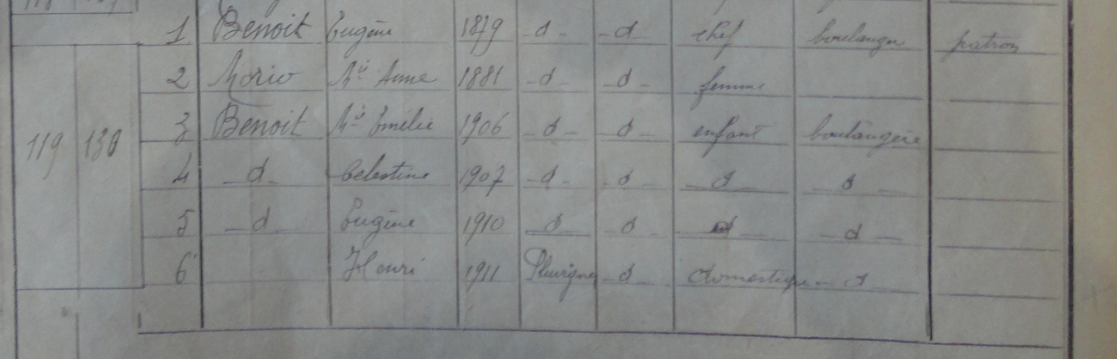
Un lieu que son père, Eugène Benoît, connaissait bien, puisqu'il a été maire de la commune entre 1945 et 1947. Née dans le village de Kérarden, c'est elle qui a conduit la première camionnette de la commune, peu après l'obtention du permis en 1926. Permis dont elle est toujours titulaire, et « avec tous ses points », s'amusait l'adjudant-chef Berlivet, commandant de la brigade de Theix.
Sinagote mais voyageuse
Livreuse de pain pour la boulangerie de ses parents, à Kérarden d'abord, puis à Cariel, elle a été contrainte d'interrompre cette activité après son mariage. En effet, le 5 avril 1932, elle épouse Louis-François Marie Le Penru, qui a fait carrière dans la gendarmerie. « À l'époque, les épouses de gendarmes n'avaient pas le droit de travailler », explique l'adjudant-chef Berlivet. Une interdiction aujourd'hui révolue. Avant de se retirer dans la maison familiale de Kérarden, à la retraite de son mari en 1950, Célestine a bien voyagé au gré de leurs affectations : Loire-Atlantique, Versailles, Ille-et-Vilaine et Normandie. Puis, c'est à Satory qu'il verra la fin de sa carrière en tant qu'adjudant-chef, après avoir été prisonnier de guerre en Autriche. De son mari, décédé en 1977, est né Jean Le Penru, également gendarme, mais aujourd'hui disparu.
Une santé de fer
Alerte et en bonne santé, la centenaire retrouve une bonne dose de jeunesse grâce à la compagnie de Bruno, Olivier et Anne-Laure, ses petits-enfants et Alexis, Elisa, et Laura, ses arrières petits-enfants. Ceux-ci peuvent même compter sur elle pour une bonne partie de jardinage, quelques pages de lecture, ou encore pour réciter les leçons grâce à « son excellente mémoire ». Jean-François Stéphan, président de l'Union départementale des personnels retraités de la Gendarmerie nationale a remis un bouquet de fleurs à Mme le Penru, qui a lu un court discours de remerciement au maire et à toutes les personnes présentes.
François QUESTER, centenaire en 1919, décédé en 1919.
Marie Josèphe LE GREGAM x LOISEAU, centenaire en 1990, décédée en 1990.
Marie Louise LE DORIOL x JOUANNIC centenaire en 2000, décédée en
Célestine BENOIT x LE PENRU, centenaire en 2007, décédée en octobre 2010.
Marie Anne LE TOUZO centenaire en 2016.
Germaine DUPONT centenaire en 2012, décédée à 102 ans en septembre 2014. Elle était arrivée à Séné pour passer sa retraite. Locataire d'une masion au Gorneveze, elle fut inhumée en région parisienne près de Saint-Denis.
Wiki-sene enquêtera pour recenser les "centenaires" de Séné.
A vérifier :
Marie Anne MAHEO x LE ROHELLEC décédée à 100 ans en décembre 2012
Agnès COUSSE x AMESTOY 11/4/1915-17/9/2015
LE MOUELLIC, maire pendant la guerre
Quand il accède au poste de maire en 1907, lors des élections partielles qui suivirent le décès de l'ancien maire Louis LAURENT, Joseph LE MOUELLIC ne savait pas que son mandat durerait 12 ans...
Comme d'autres maires de Séné, il n'était pas natif de la commune mais de Saint-Aignan près de Pontivy où il nait en 1866, au sein d'une famille de laboureurs. Sa fiche de matricule nous indique qu'il fit sa conscription en novembre 1887 pendant trois ans, au terme de laquelle il devint caporal instructeur, après avoir fait l'Ecole Militaire des Andelys.
Son acte de naissance mentionne la date de son mariage, à Theix, le 10/09/1901 avec Marie Cécile LE CORNO. Sur son acte de mariage, on lit sa profession de brigadier de gendarmerie en poste à Elven. Il a 34 ans.
Au dénombrement de 1906, il vit au Poulfanc en Séné avec sa femme et deux enfants nés à Elven en 1902 et à Vannes en 1904. L'examen des actes de naissance de ses enfants indique qu'il est toujours brigadier.de gendarmerie. Par contre, le dénombrement de 1906 reproduit ci-dessous, nous indique qu'arrivé à Séné, il s'emploie au négoce de cidre. La famille emploie une jeune domestique, Mlle ROZO.
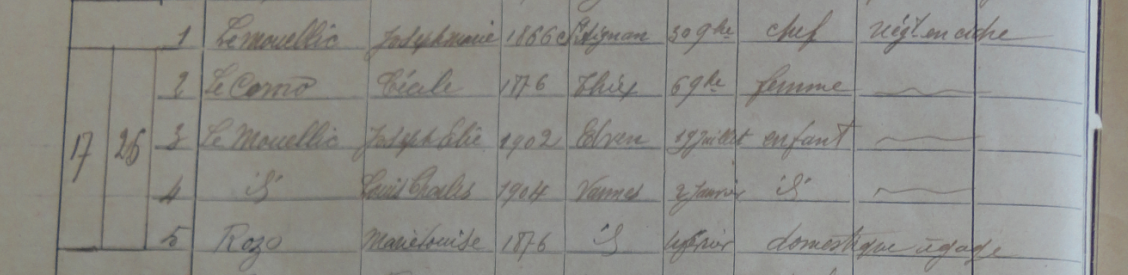
Joseph LE MOUELLIC a donc quitté la gendarmerie. Cette information est indiiquée dans sa fiche de matricule. Il est mis à la retraite proportionnelle le 12/05/1903. L'acte de naissance de son 2° garçon en 1904 mentionne bien qu'il quitté la gendarmerie et vit rue Saint Nicolas à Vannes.
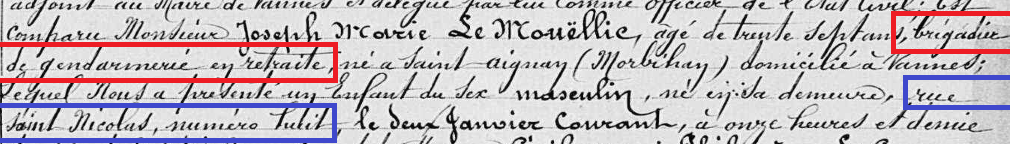
Un article daté de 1907, pendant la campagne électorale, nous donne les raisons de cette démission alors qu'il n'a que 47 ans. Joseph LE MOUELLIC a des convictions! Alors que la loi de 1905, dite de séparation de l'Eglise et de l'Etat, entre en vigueur, le brigadier Le Mouellic, catholique, ne se voyait pas expulser les "Congrégations".
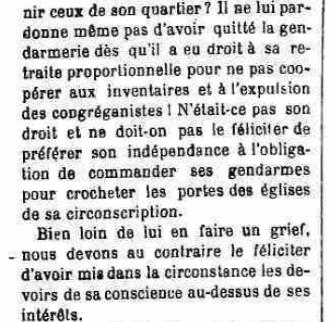

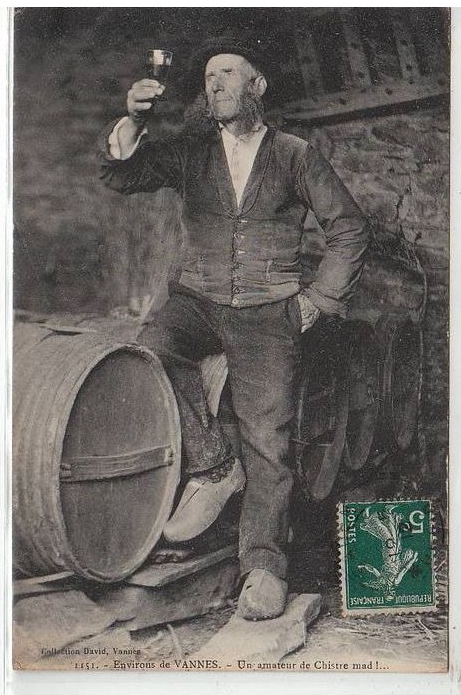
Il doit donc trouver une nouvelle activité pour compléter sa retraite. C'est à Séné, entre 1904 et 1906, qu'il s'établit négociant en cidre sur la route de Nantes au Poulfanc.Le Mouellic est un Sinagot fraichement installé loin du bourg et pourtant il va devenir maire !
Il bénéficiera lors de la campagne électorale du soutien affiché et revendiqué du journal L'Arvor" qui est fier d'avoir fait le maire, comme le montre cet article du dit journal.
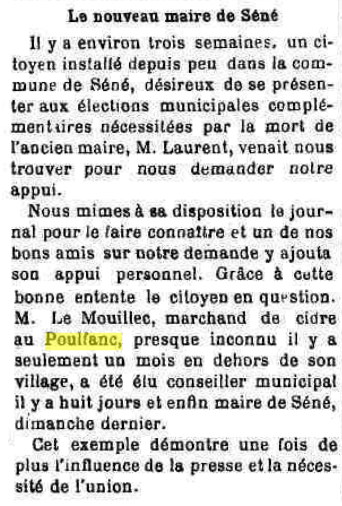
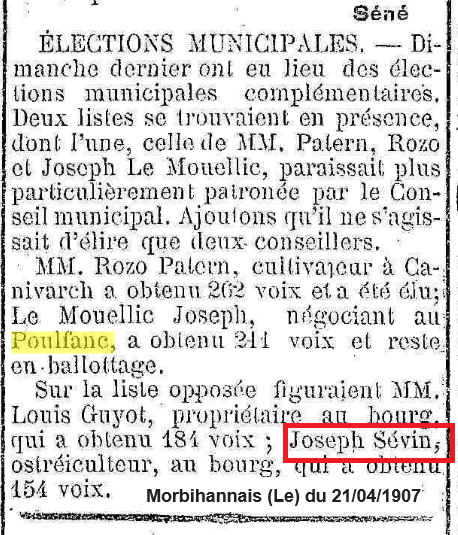
Avec le soutien de la presse, il vient de battre au scrutin majoritaire à deux tours, Joseph SEVIN, le fils du malheureux candidat battu par Gachet et décédé dans d'étranges conditions..(Lire article sur Gachet). Séné est un "petit village" et le fils SEVIN revait-il de revanche électorale ?
En avril 1907, avec le soutien de l'Arvor, Joseph LE MOUELLIC est élu conseiller muinicpal et devient maire de Séné. Aux élections municipales des 3 et 10 mai 1908, il est réélu.
Pendant ce mandat, une nouvelle école privée voit le jour, la future Ecole Sainte-Anne comme en témoigne cet article de presse daté de 1910.
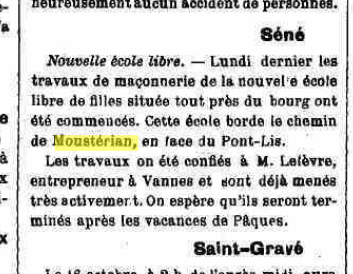
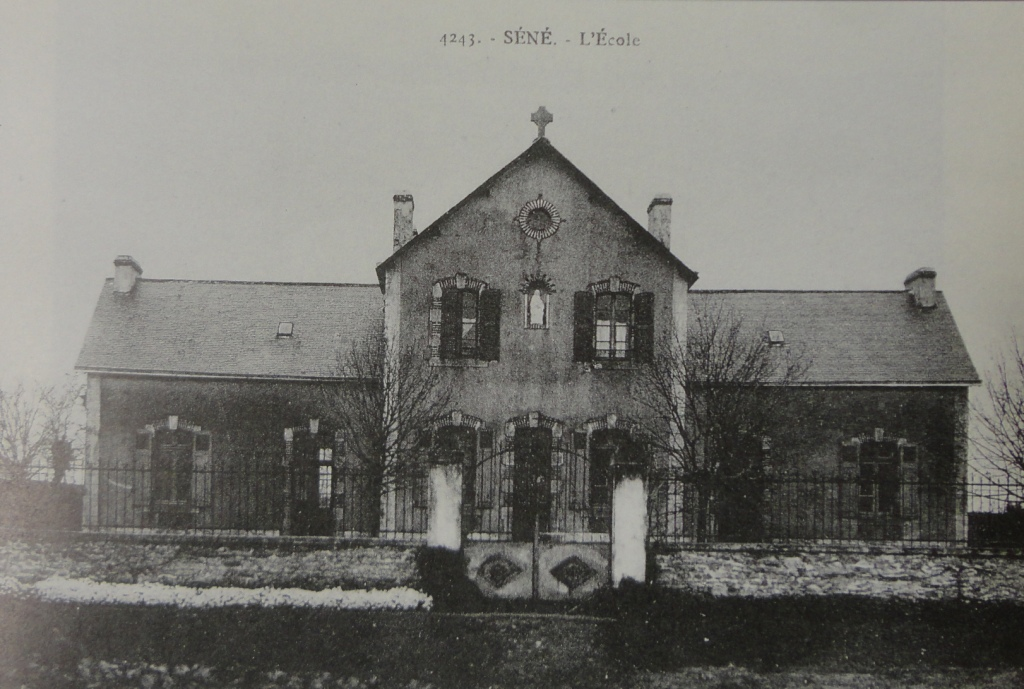
Aux élections municipales des 5 et 12 mai 1912, Joseph LEMOUELLIC est réélu.
Cet article de presse de décembre 1912 restitue quelques décisions prises en conseil municipal et l'actualité du moment.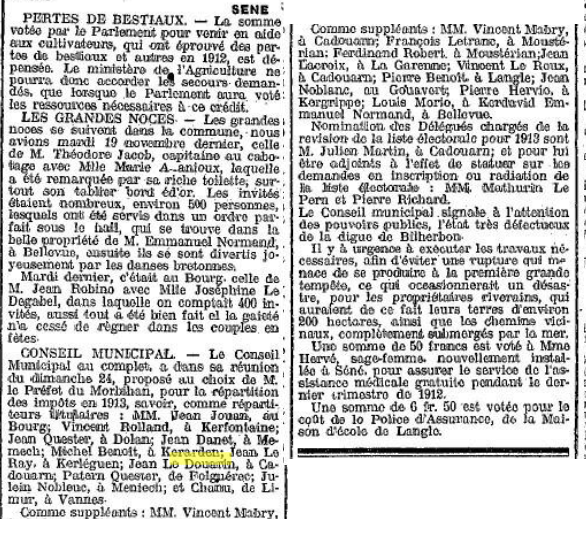
Perte de bestiaux : ce point laisse à penser à une épizzotie ou bien à une calamité agricole qui sévit en 1912.
Les Grandes Noces : elles rappellent que Séné eu pendant de longues années, à l'exceptiondes années de guerre, et jusqu'aux années 30, une tradition de grandes noces accompagnées de banquet.Lire article à ce sujet.
Conseil Muncipal : On choisit les répartiteurs des impôts. On révise les listes léectorales en vue des prochaines élections de 1916. Le conseil signale le mauvais état de la digue de Bilherbon. Cette digue qui délimitait un polder de terres agricoles, reliait la pointe du Bil à La Villeneuve et protégeait des terres aujourd'hui situées tout autour de l'ile Mancel. La digue se rompit 2 fois, en 1926 et 1937. On attribue une subvention à Mme Hervé, sage femme et on prend en charge l'assurance de l'Ecole de Langle.
La quiétude de Séné va être perturbé le 1er août 1914 avec l'Appel de la Mobilisation affiché en mairie. Lire les pages consacrées aux Poilus de 14-18.
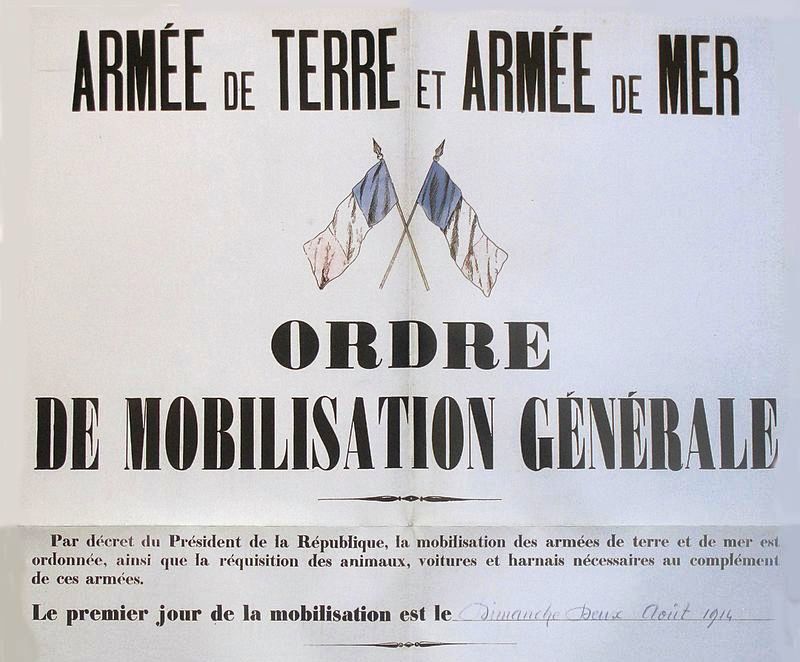
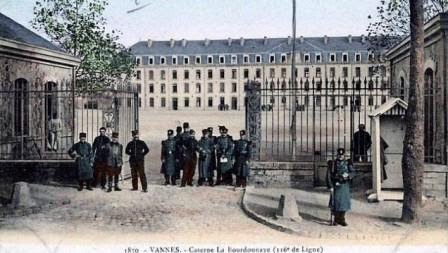
Les premières classes sont mobilisées et rejoignent leur casernes, notamment le 116°RI de Vannes ou leur dépot à Lorient. 118 soldats de Séné, natifs ou domiciliés à Séné perdront la vie au front, en mer ou à cause d'une maladie contractée pendant le service. Une trentaine de soldats sinagots seront inhumés à Séné. Il s'est agit de soldats atteints de tuberculose qui "eurent la chance" de finir leur jours chez eux.
Pendant ces années de guerre, LE MOUELLIC ne célébra que quelques noces donc celles de soldats du front rentrés au pays pour épouser leur fiancées.
En 1916, le Gouvenement reporte sine die les élections. Joseph LE MOUELLIC, ne récule pas devant ses responsabilités. Il est reconduit en tant que maire de Séné.
Le glas a du sonner plusieurs fois au clocher de l'église de Saint Patern. Les registres des décès ont recueillis les détails sur les disparitions des soldats morts au front. Actes de décès signés de Joseph LE MOUELLIC. Comment parvenait l'information aux familles ?
En fin de son dernier mandat, Joseph LE MOUELLIC qui avait célébré tant de mariages mémorables, avait inhumé tant de poilus "Morts pour la France" aura a célébrer le premier centenaire attesté à Séné, le sieur François QUESTER qui fêta en avril 1919 ces 100 ans. Lire article dédié.
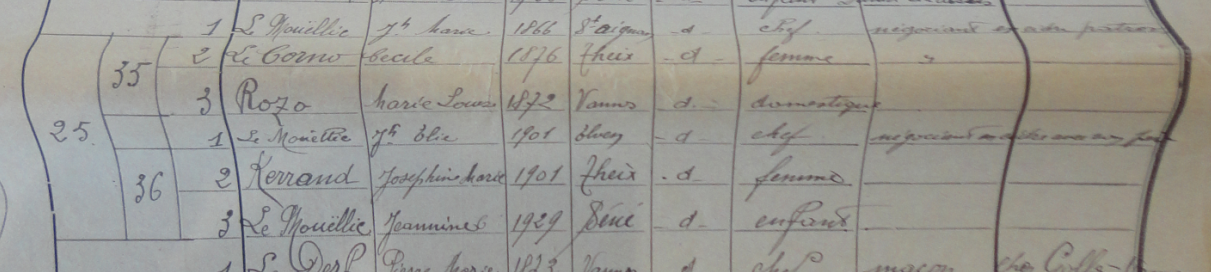
Retiré des affaires municipales, Joseph LE MOUELLIC continua avec ces enfants son négoce de cidre et il s'éteignit le 16 septembre 1933 au Poulfanc. Au dénombrement de 1931, on peut voir que sa fidèle domestique Mlle ROZO est toujours à son service.
ROBERT, maire de Séné 1919-1928
Dans leur livre respectif, Camille Rollando et Emile MORIN donne la liste des maires qui se sont succédés à Séné. Parmi les "Premiers Magistrats" de Séné, Ferdiand ROBERT n'était pas natif de la commune et pourtant il a su conquérir les suffrages des Sinagots et il a administré la commune pendant 9 ans, de 1919 à 1928.
Le 11 avril 1937, le Progrès du Morbihan relate la cérémonie qui eut lieu à Séné, pour ses obsèques, en présence de nombreux officiels,dont le maire de l'époque Henri Ménard..
Ferdinand Jean Vincent ROBERT nait à Quiberon le 18 janvier 1850. Son père est douanier et sa mère est cultivatrice. A l'âge adulte, il choisit lui aussi la carrière dans les douanes où il gravira les échelons jusqu'au grade de capitaine. Sa fiche de matricule nous indique qu'il est mobilisé lors de la guerre contre la Prusse en 1870.
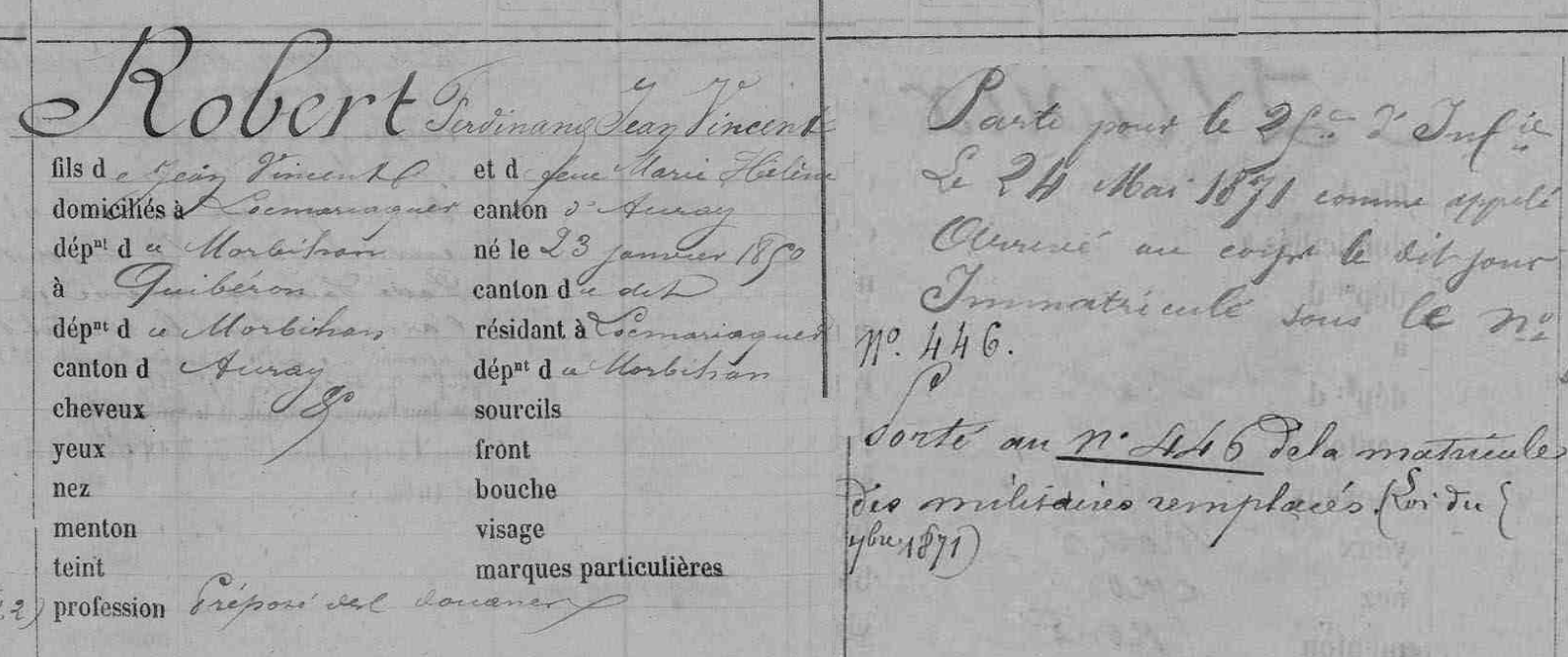
De poste en poste, il finit par arriver à la caserne des Quatre Vents à Séné.
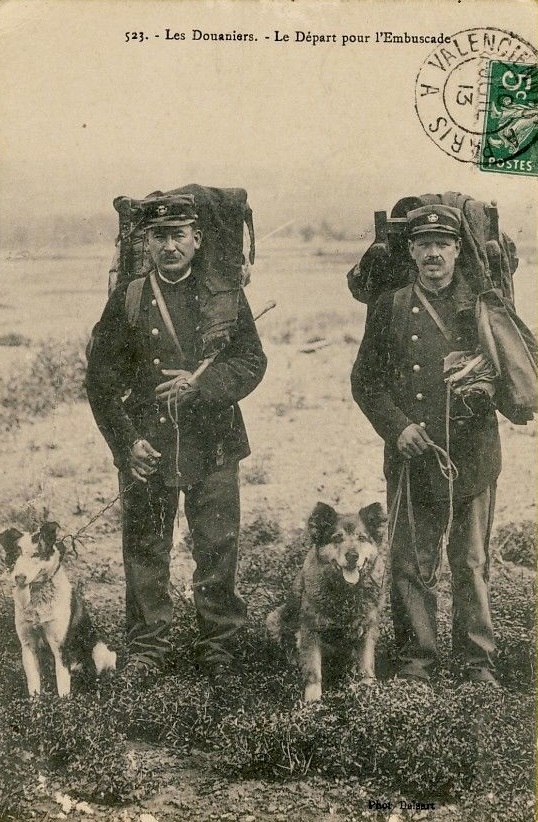
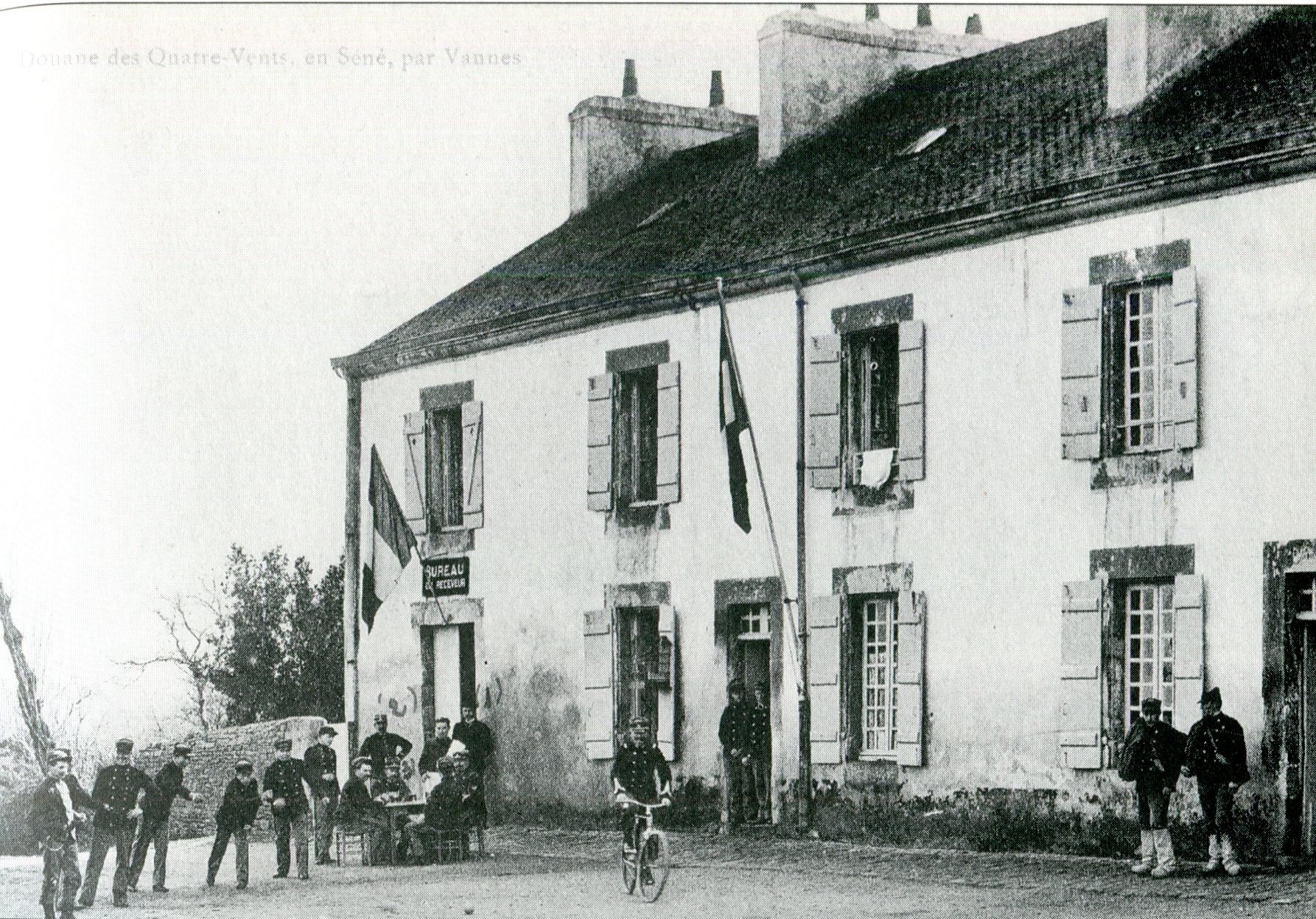
Là, il fait la connaissance de sa future femme, Marie QUESTER (né le 18/02/1861) et il l'épouse à Séné le 7 novembre 1882. Le jeune couple quitte Séné et ne reviendra qu'en 1909 au moment de la retraite du capitaine des douanes.
Au dénombrement de 1921, ils apparaissent au hameau de Moustérian. Selon l'article ci-joint, on déduit qu'il a eu au moins deux garçons, dont un décédé en 1937. La pérégrination du douanier ne permet pas de les voir au dénombrement à Séné.
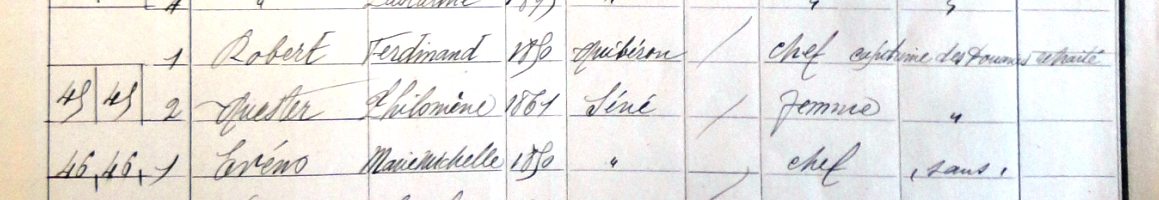
Ferdinand ROBERT se lance en politique lors des léections municipales de 1912. Cet article de presse rend compte qu'il a eu pour adversaire, Joseph LE MOUELLEIC, négociant en cidre, ancien gendarme, démissionnaire pour ne pas avoir à expulser les congrégations.
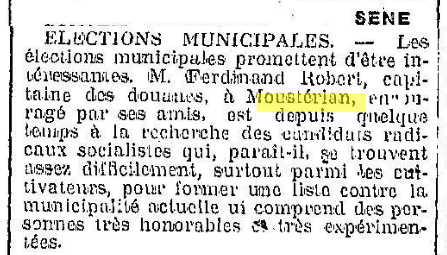
Après la Première Guerre Mondiale, et le mandat très long de LE MOUELLIC, Ferdiand ROBERT se représente et est élu.
Parmi les réalisations du qu'on lui doit, la nouvelle mairie est décidée qui sera toutefois inauguré qu'en 1930. La construction d'un monument aux morts prend moins de temps et sera inauguré en 1924. On décide de l'électrification comme en témoigne cette coupure de presse du 24/02/1924 mais la fée électricité arrive à Séné en 1930.
Sur cette vieille photo (Collection Emile MORIN) il apparait, en chapeau melon, devant l'épicerie de Mme Janvier rue Principale au bourg.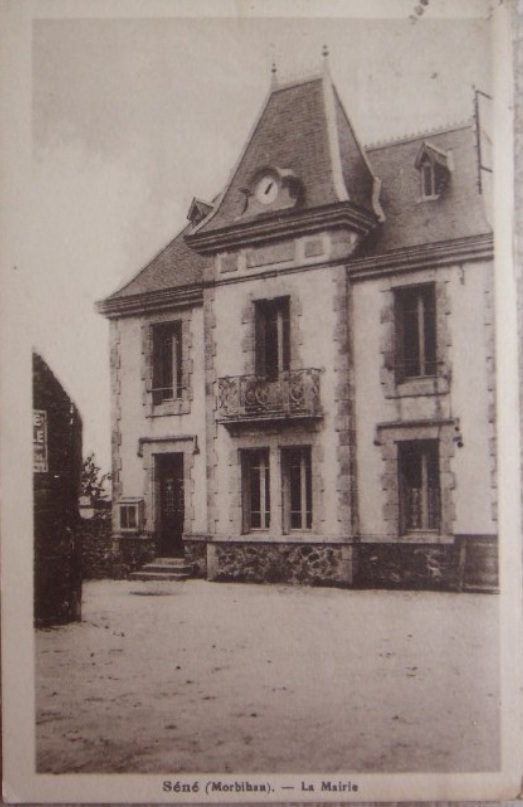
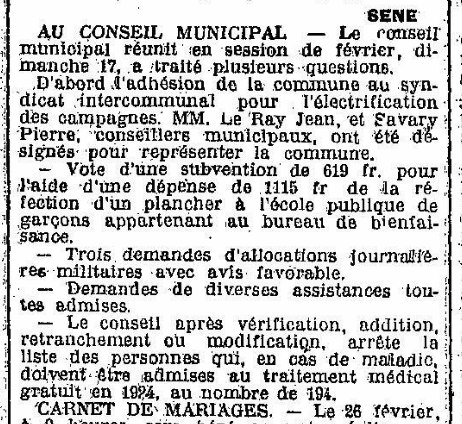
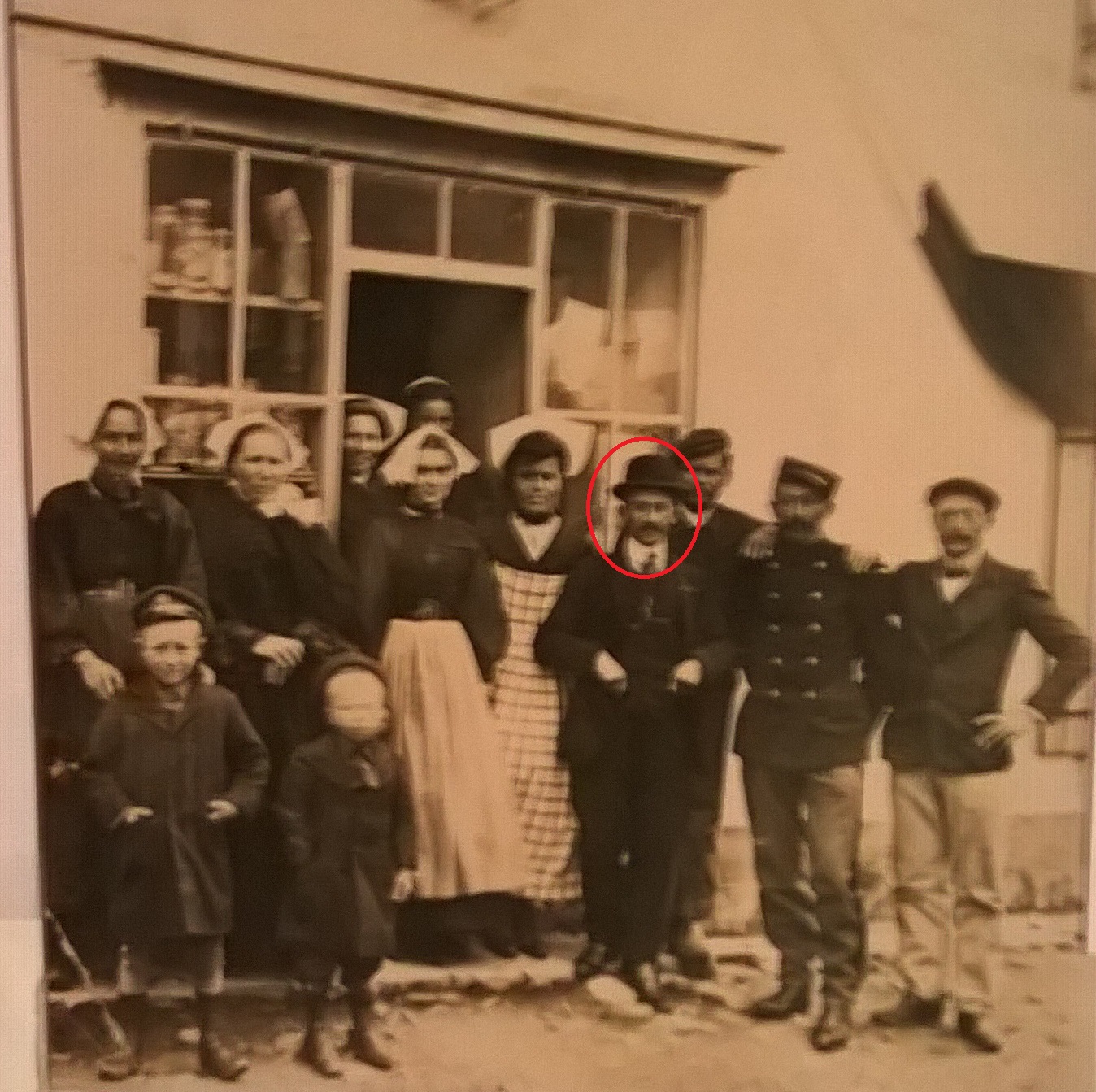
En août 1924, il a certainement célébré le double mariage des filles du secrétaire de mairie, dont on apprend par un article daté du 17/08/1924 qu'il était également le correspondant du journal Ouest Eclair.
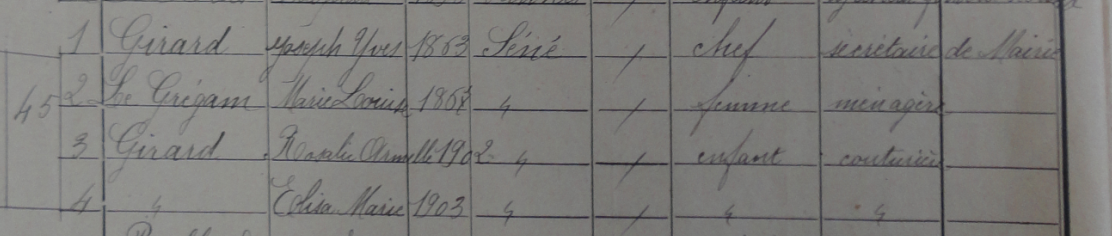
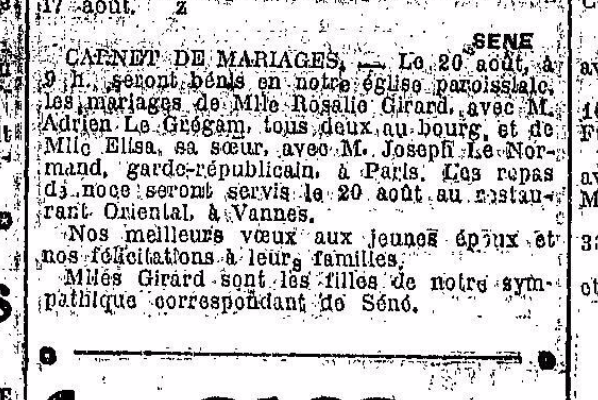
Le 22 Décembre 1925 : Une effroyable tempête ravagea les côtes morbihannaises causant d'immenses dégâts à terre comme en mer. A Bilherbon, une brèche de 20 mètres s'ouvrit dans la digue et la mer en furie s'engouffra, submergeant environ 130 hectares des terres basses cultivées.
C'est première fois que la digue Lorois se rompt et innonde les terres situées aujourd'hui tout autour de l'ile Mancel. (Source Le Sinagot).
En novembre 1927, Ferdinand ROBERT inaugure - enfin - le monument aux morts de Séné (lire article pages Centenaires).
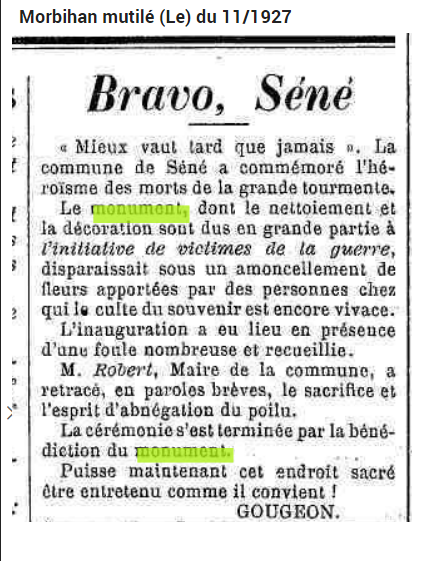
En 1928, âgé de 78 ans, il démissionne sans doute pour des raisons de santé.Patern LE CORVEC est élu par le conseil municpal maire de Séné. Il se retire dans sa demeure de Moustérian ou il décède le 30 mars 1937.
Revenir à la page sur L'Histoire des maires de Séné sous la 3° République
Les maires de Séné depuis la Libération 1945-80
Eugène BENOIT [4/10/1879 - ] mandat :1945-1947
Olivier TAMAREILLE [19/02/1899 - 25/09/1965] mandat :1947-1953
Alphonse LE DERF [5/01/1922 - 20/04/1967] mandat : 1953-1967
Louis UGUEN [2/06/1914 - 23/05/1984] mandant : 1967 1971
Albert GUYOMARD [ 27/06/1918-23/02/2008] mandat : 1971 - 1980
Eugène BENOIT [4/10/1899 - ] mandat :1945-1947

A la Libération, à quelques rares exceptions, les maires destitués en 1941 retrouvent leurs fonctions. C'est le cas à Séné avec Henri MENARD qui retouve son écharpe tricolore. Le Gouvernement provisoire souhaite tirer un trait sur les années d’occupation et clarifier la situation locale. Il convoque des élections municipales pour le 29 avril et le 13 mai 1945.
Le scrutin intervient alors que la France et les alliés sont encore en guerre : l’Allemagne capitule le 7 mai 1945. Pour la première fois les Françaises et les Sinagotes sont appelées à voter, ce qui double, par rapport à l’avant guerre, le corps électoral. Les vainqueurs du scrutin sont les partis politiques qui ont participé à la Résistance : communistes, socialistes, démocrates-chrétiens du MRP. Ces élections n'ont toutefois pas eu lieu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort, des combats trop récents ayant empêché la constitution des listes électorales. Elles y ont lieu au mois d'août.
Après la guerre comment se choisir un nouveau maire à Séné? Les conseillers municipaux élisent Eugène BENOIT.
Né le 4/10/1879 à Séné, il s'est marié le 9/09/1903 avec Marie Anne MORIO. Quand éclate la première guerre mondiale, ce père de famille de 4 enfants est enrolé comme boulanger dans les armées.
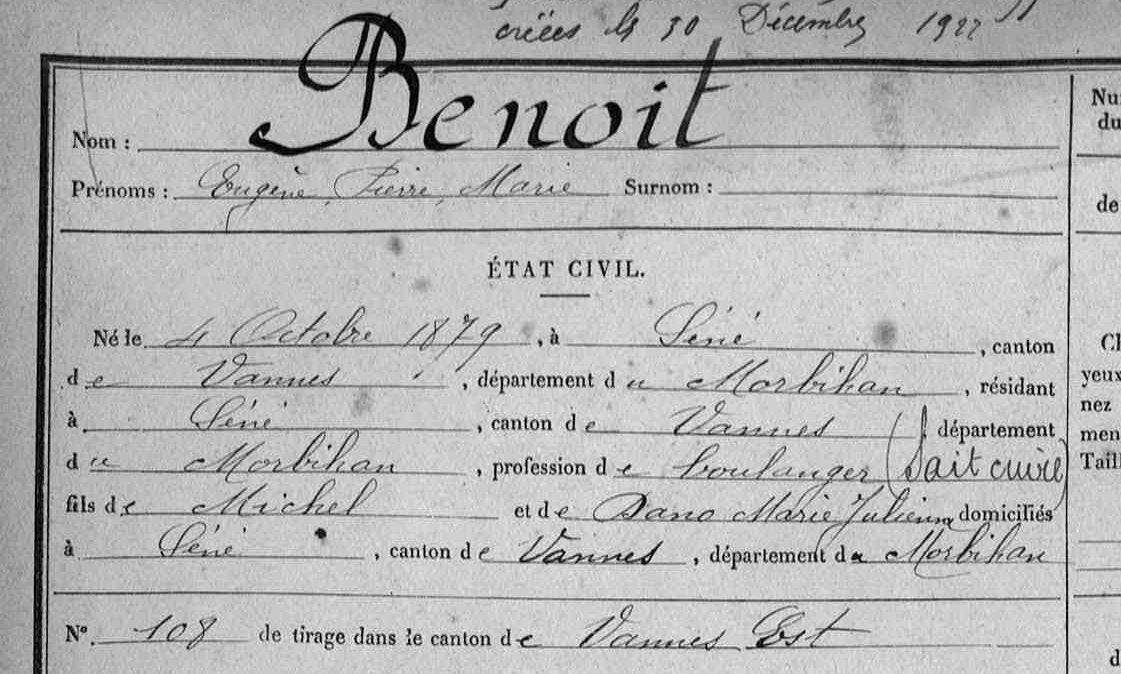
Au dénombrement de 1921, on retrouve sa famille établie à Kerarden.

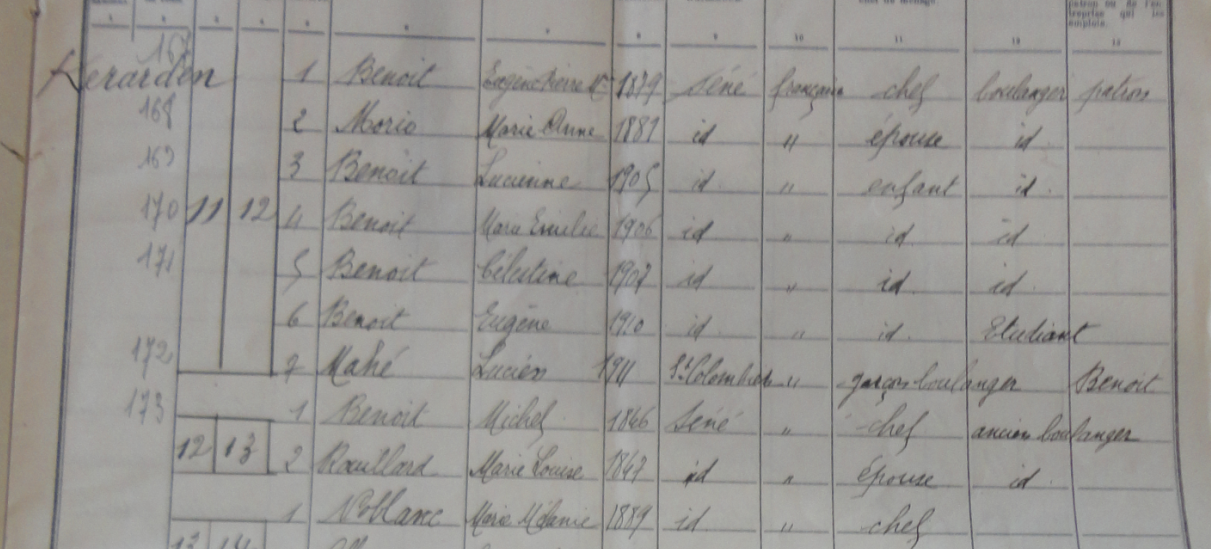
Quand surgit la seconde guerre mondiale, son seul garçon, Eugène est incorporé et il décède à Vatan en juin 1940. (Lire article sur la guerre 39-45).
Agé de 66 ans, Eugène BENOIT fait figure de sage et devient maire. Une photo immortalise l'équipe municipale de 1947 où apparaissent trois maires à Séné. En médaillon, Eugène BENOIT. Séné compte en 1946, 2029 habitants.
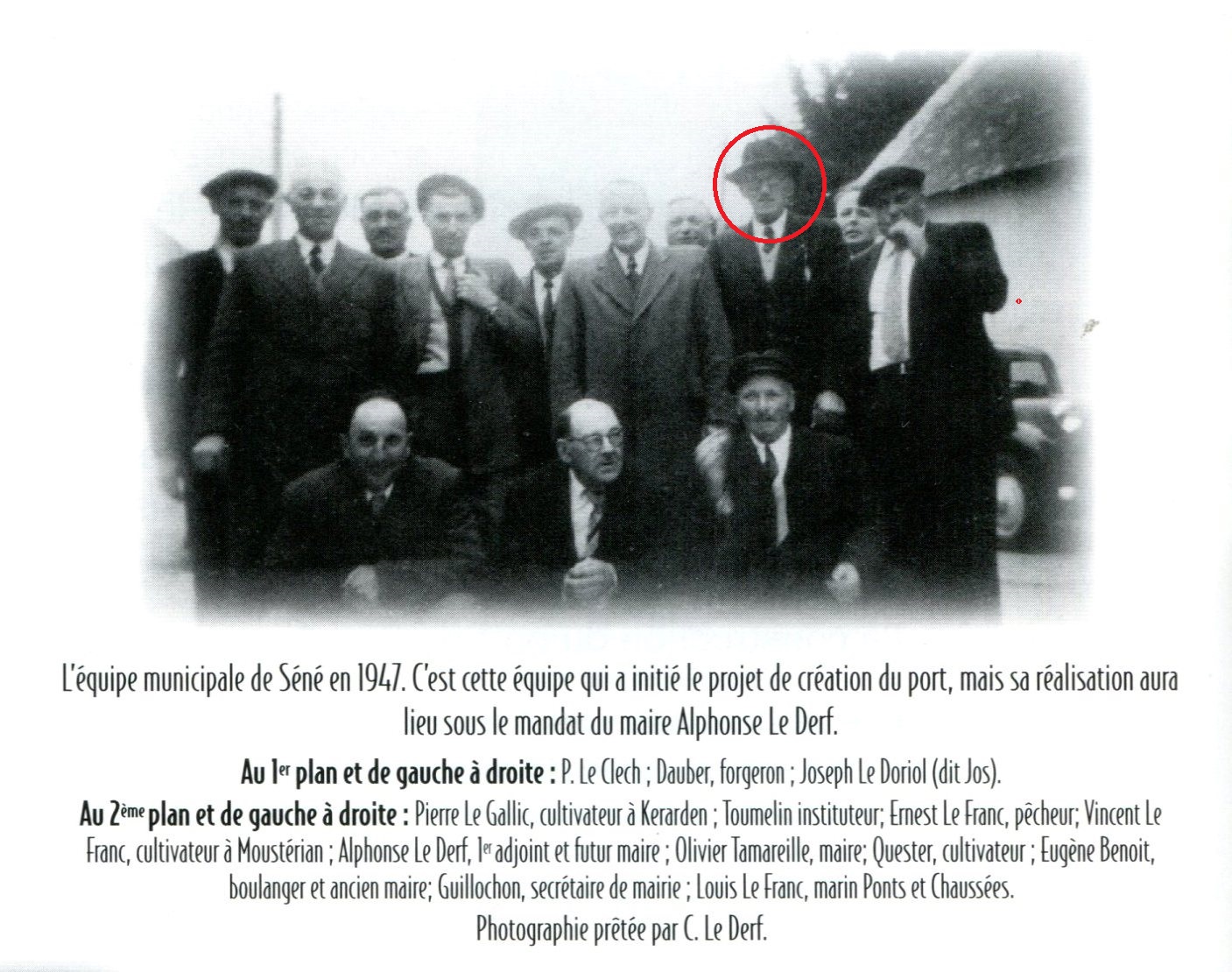
Olivier TAMAREILLE [19/02/1899 - 25/09/1965] mandat :1947-1953
Les élections municipales se déroulent les 19 et 26 octobre 1947.
Voilà un patronyme qui ne sonne pas breton. La famille Tamareille est d'origine périgourdine. Jean Gaston Tamareille, né à Brantôme au sein d'une famille de vignerons, est voyageur de commerce. Il épouse à Vannes le 14/06/1898, Marie BRIEN et s'établit à Vannes, rue du Roulage. De cet union nait, le 4 octobre 1899, Olivier TAMAREILLE.
Jean Tamareille s'implique dans la vie locale et aux élections de mai 1900, il figure dans la liste républicaine qui est battue par le maire de l'époque, Charles RIOU, qui est réelu.
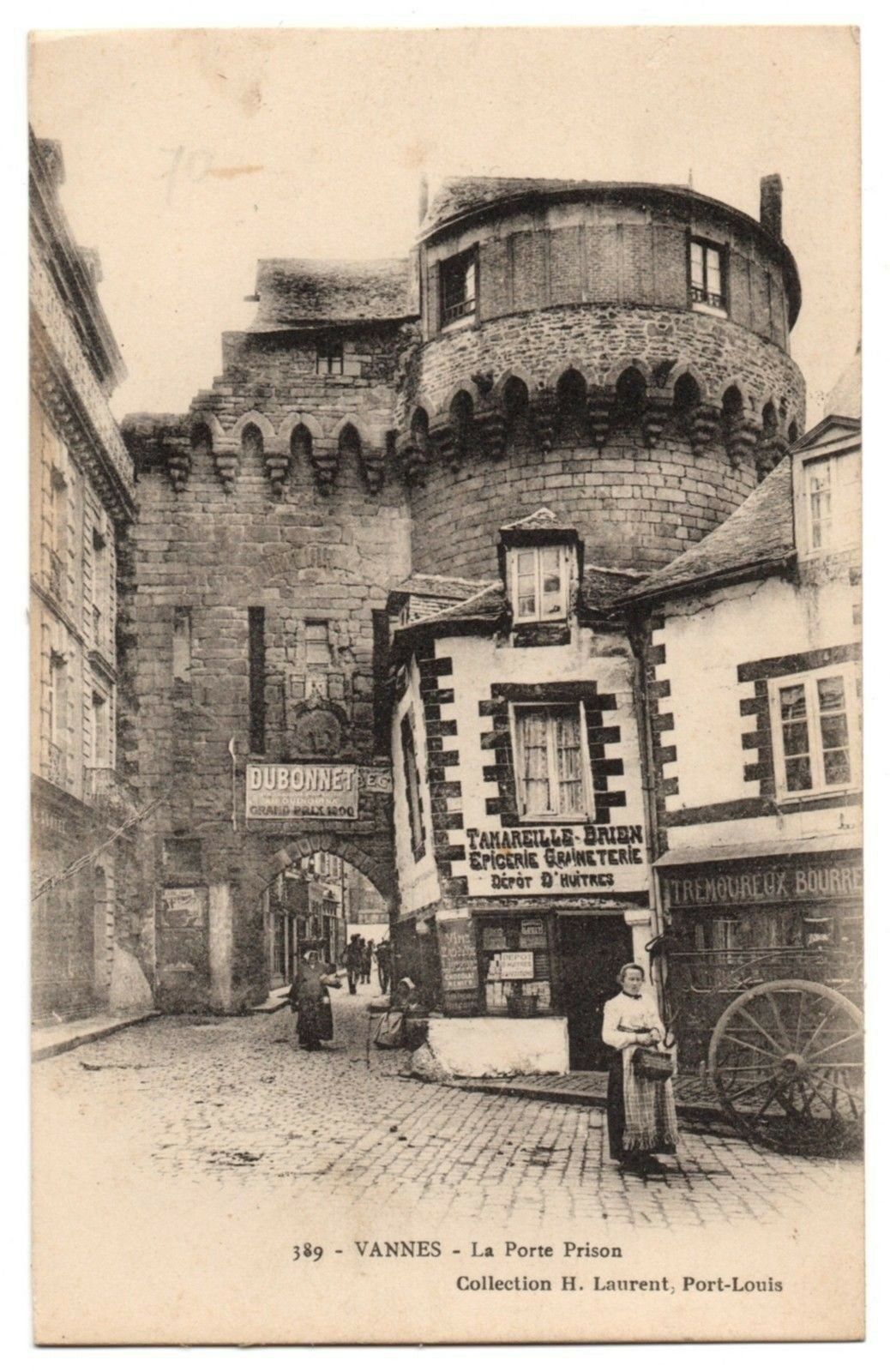
Il décède le 6/01/1904, laissant sa femme veuve avec son fils à charge. La famille tient alors un commerce, épicerie graineterie près de la porte Prison, édifice qui lui appartient et qu'elle cèdera à la ville de Vannes en 1912 avant de s'établir rue Clisson. Elle est recensée rue de la Garenne à Vannes en 1906.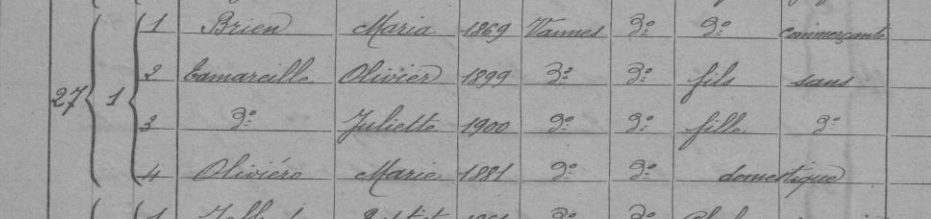
Le 5 juillet 1913, Mme veuve Tamareille participe à la Fête des Ecoles dans les jardins de la Préfecture où elle cotoie les "dames" de l'époque venues accompagner leur mari. Parmi ces notables, le juge Henri Mériel-Bussy.
Le commerce est parfois victime de vols comme le rapporte cet article de presse d'époque.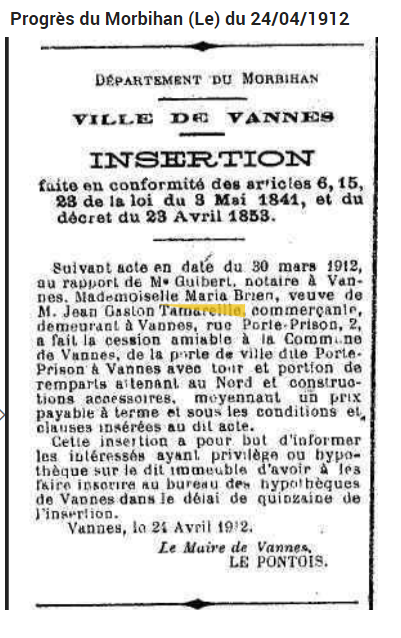
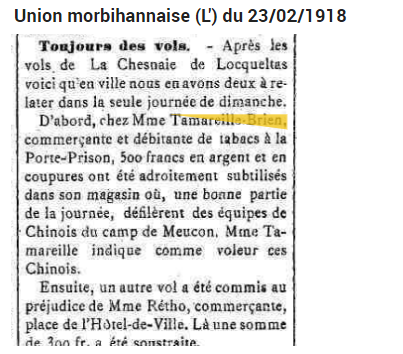
Après guerre, Mme veuve Tamareille gère son commerce.
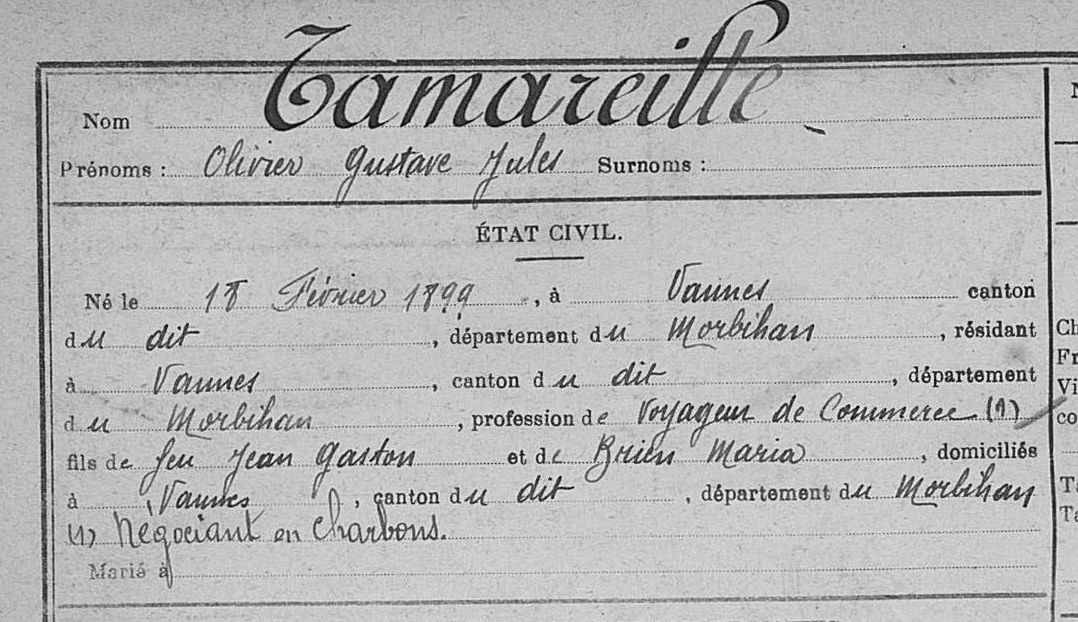
A l'âge de la conscription en 1919, Olivier TAMAREILLE déclare la profession de "voyageur de commerce". Il se marie à Lorient, le 6/04/1921, avec Renée Romieux, native de Groix. La famille essaie de vendre leur commerce Porte Prison en 1933. En mai 1940, le négociant Tamareille est réquisitionné pour mettre en place le rationnement des produits pétroliers.
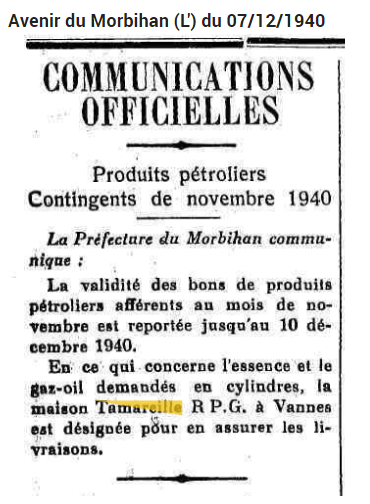

Photo : Olivier TAMAREILLE entouré sur sa gauche par Alphonse Le Derf et sa doite Eugène Benoit.
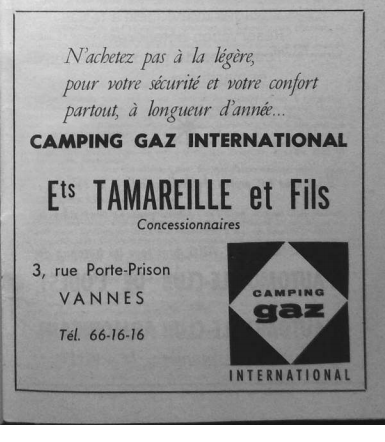 Comment fait-il, en tant que Vannetais, pour devenir maire de Séné après les élections municipales qui se déroulent les 19 et 26 octobre 1947 ?
Comment fait-il, en tant que Vannetais, pour devenir maire de Séné après les élections municipales qui se déroulent les 19 et 26 octobre 1947 ?
Ce sont les premières élections municipales de la Quatrième République. Elles sont marquées par l’isolement du Parti communiste qui a été exclu du gouvernement au printemps, et qui perd de nombreuses mairies, par la nette victoire des listes se réclamant du général de Gaulle (qui a quitté le pouvoir en janvier 1946) et de sa formation : le Rassemblement du peuple français.
A Séné la liste de gauche l'emporte et Olivier TAMAREILLE est élu maire pour 6 ans. En 1954, Séné compte 2017 habitants. L'exode rural limite la croissance démographique de la commune.
Olivier TAMAREILLE décèdera à Vannes le 25/09/1965. Sa tombe est toujours visible au cimetière de Boismoreau. Son fils, Jean-Pierre, âgé, vit dans la maison familiale rue de Clisson.
Alphonse LE DERF [5/01/1922 - 20/04/1967] mandat : 1953-1967
Le nom de Le Derf reste attaché au complexe sportif de Moustérian. Qui était Alphonse LE DERF qui sera maire de Séné pendant 14 ans, trois fois élu?

Les élections municipales se déroulent les 26 avril et 3 mai 1953. Au niveau national, c’est le retour sur la scène municipale, et gouvernementale, des Indépendants (droite libérale). Les partisans du général de Gaulle sont en très net recul et les communistes toujours isolés. Le scrutin de 1953 se caractérise par l’apparition d’alliances municipales entre socialistes et modérés qui perdureront jusque dans les années soixante-dix.
Les élections municipales se déroulent 8 mars et 15 mars1959.
Ce sont les premières élections municipales de la V° République, néanmoins les partisans du général de Gaulle n’arrivent pas au niveau local à atteindre les scores qu’ils obtiennent dans les élections nationales. Alphonse LE DERFF réélu en 1959.
Les élections municipales se déroulent 14 mars et 21 mars 1965.
Comme celles de 1959, elles sont décevantes pour les gaullistes bien qu’en légère progression. Le Parti communiste enregistre plusieurs succès et on assiste au commencement d’un rapprochement entre les partis de gauche qui profite alors essentiellement au PCF qui sort de son isolement.
Alphonse LE DERFF est réélu en 1965.
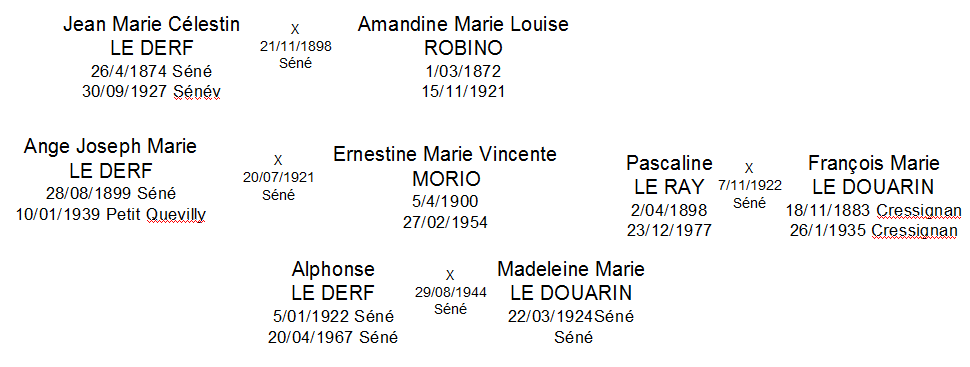

Alphonse LE DERF naquit à Séné en 1922. Son père, préposé puis brigadier des douanes, est muté au Petit Quevilly près de Rouen. Il décède prématurément en 1939 et la famille regagne Séné au village de Montsarrac. La seconde guerre mondiale éclate mais Alphonse est trop jeune pour être mobilisé. En 1944, il se marie avec Marie Madeleine LE DOUARIN. Dans les années 1950, son épouse tenait l'épicerie du bourg, ancienne épicerie Janvier, près de la marie et mitoyenne du bar-tabac, avec Pascaline LERAY, sa belle-mère. Ce commerce accueillera la première station service de Séné. (Lire Histoire des garagistes). L'épicerie sera reconstruite dans les années 1950 alors que la famile compte trois enfants. Ci-dessous l'épice en 1958.

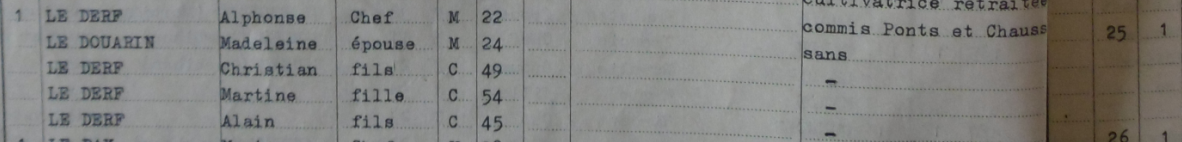
En 1953, alors âgé de 31 ans, il est élu maire de Séné tout en conservant son emploie aux Ponts & Chaussées. Le recensement de 1962 nous indique la composition de la famille. Il décède en 1967 d'une maladie foudroyante et il est inhumé au cimetière de Séné.
Alphonse LE DERF fut un maire visionnaire. Son fils Christian se rappelle: "notre famille vivait au bourg. On devait aller chercher l'eau à la fontaine de Saint Patern derrière le presbytère, près du rivage du Golfe". Dès 1955, le conseil muncipal dirigé par Alphonse LE DERF envisage d'aller capter l'eau des sinagots sur la commune de Saint-Nolff. En 1959, c'est chose faite.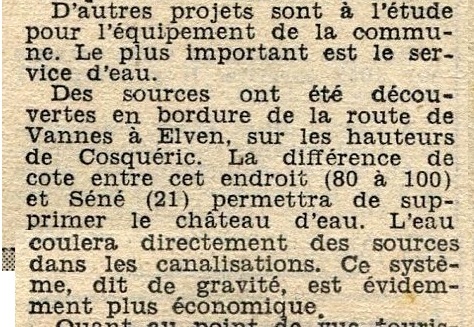

LE DERF est aussi à l'origine du premier éclairage public à Séné qui débutat au village de Cadouarn où fut installé le premier lampadaire. Il fut aussi à l'origine du premier stade sur el plateau de Mousterian qui allair devenir le complexe sportif Le Derf. On lui doit aussi le bois de la Pointe du Bil.
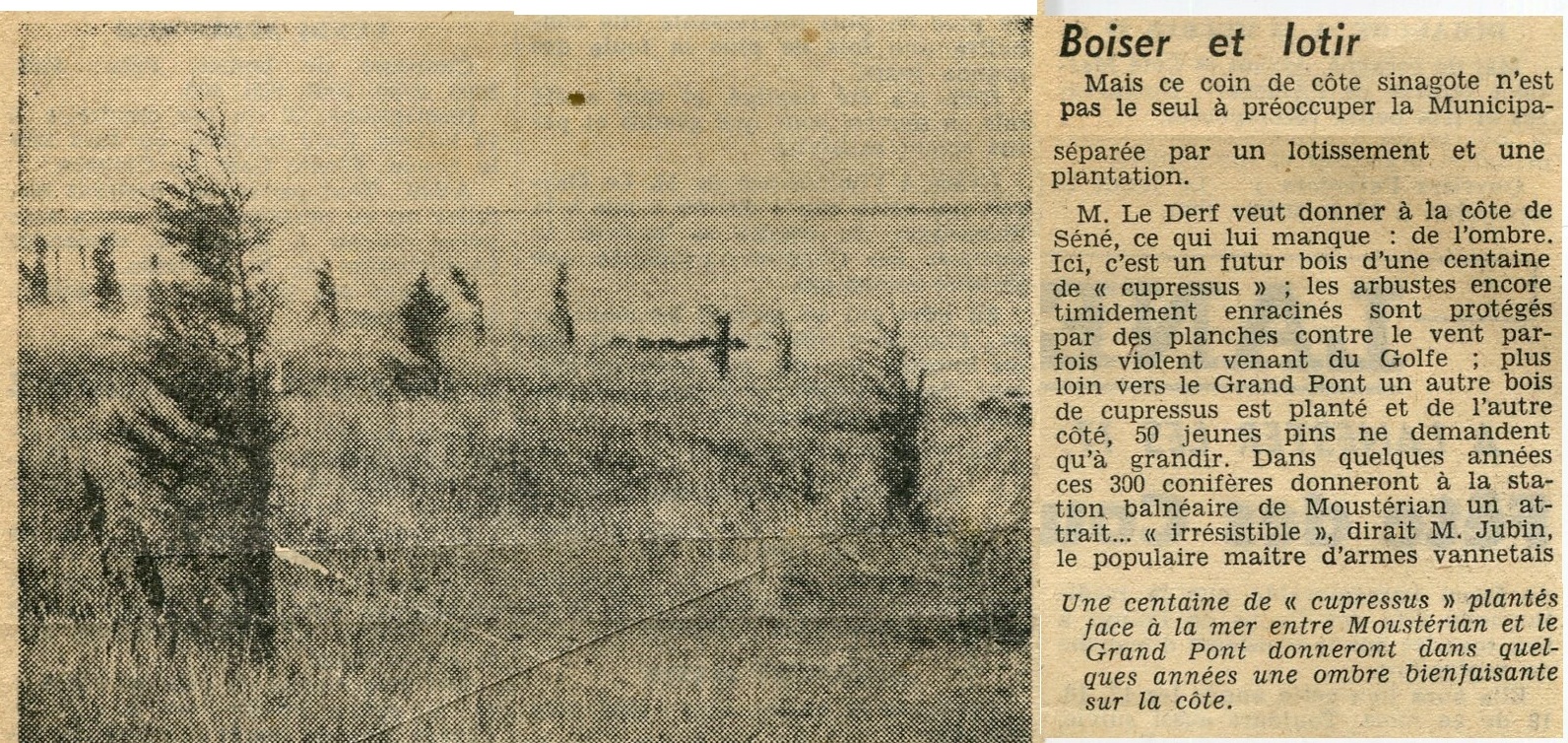
Bien sûr les mandats de LE DERF restent attachés à la réalisation de Port-Anna (lire article dédié).
Au recencement de 1968, Séné comptabilise 2744 habitants, soit le niveau d'avant la guerre de 14-18.
Louis UGUEN [2/06/1914 - 23/05/1984] mandant : 1967 1971
Au décès de Alphonse LE DERF, le conseil municipal élit Louis UGUEN comme nouveau maire. Né le 2 juin 1914 à Plouvien dans le Finistère,
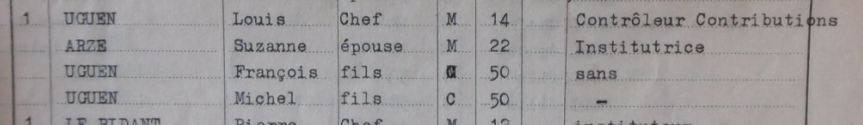
Les élections municipales se déroulent 14 mars et 21 mars 1971
Georges Pompidou est Président de la République depuis deux ans. Les gaullistes progressent notamment dans le Sud-ouest et les communistes dans le Nord et l’Est. A gauche, même si les socialistes, qui progressent à l’Ouest, administrent encore de nombreuses villes avec les modérés, la stratégie d’union avec les communistes se développe notamment par des désistements au second tour. La bipolarisation de la vie politique apparaît sur la scène locale.
Albert GUYOMARD [ 27/06/1918-23/02/2008] mandat : 1971 - 1980
Albert Guyomard fut maire de Séné de 1971 à 1980. Son nom reste attaché au groupe scolaire de la Grenouillère.
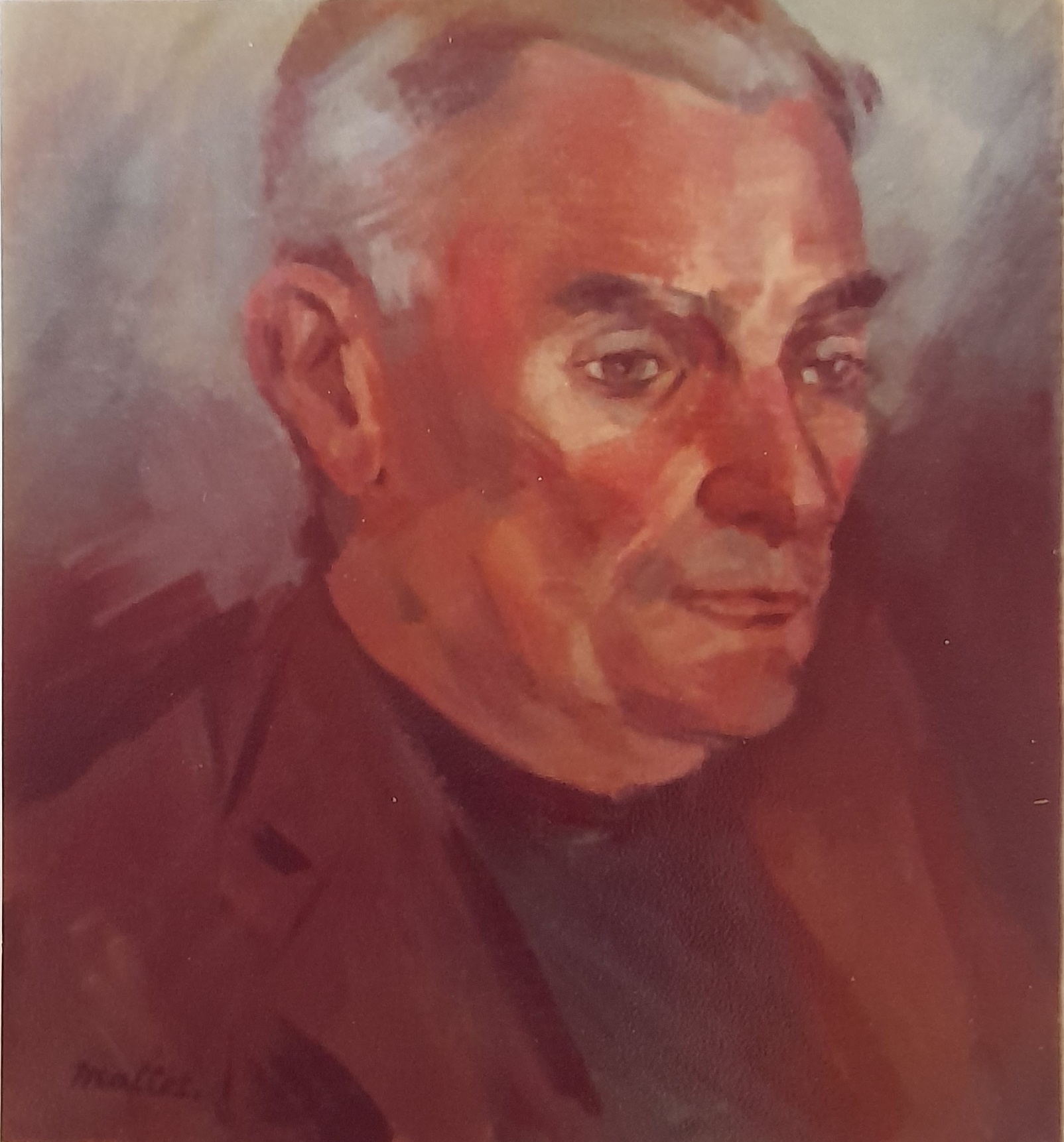
Albert Francis Augustin GUYOMARD nait le 27 juin 1918 dans la commune de Plomeur le 27/06/1918, comme le confirme son acte de naissance. Son père est marin de l'état, dans la fonction publique et sa mère, ménagère.
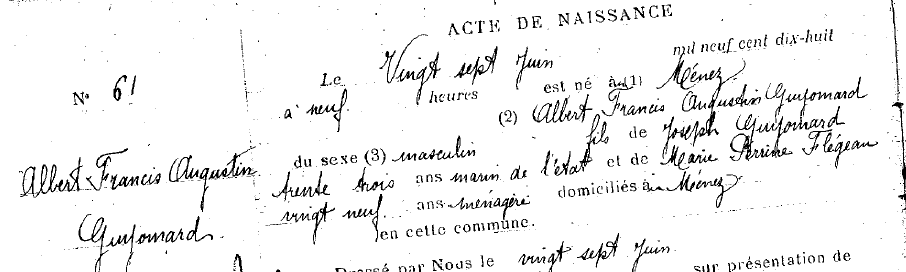
Il fait carrière dans l'enseignement et occupe le poste d'instituteur à Peillac dès 1941. Il se marie dans cette commune le 8/09/1942.
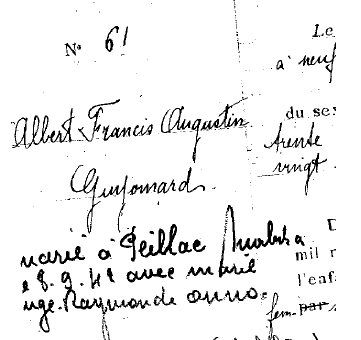
Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1943 à 1944 (capitaine de réserve), il intègre les FFI (Forces françaises de l'intérieur), tout en étant dans cette période instituteur à Peillac-Guerno et secrétaire de mairie.
Il continue son métier d'instituteur en Algérie, de 1949 à 1953, puis revient en France et poursuit sa carrière dans l'enseignement.
Il devient instituteur à Bignan de 1953 à 1956, instituteur et secrétaire de mairie à La Trinité-Surzur de 1956 à 1961, puis instituteur à Saint-Colombier de 1961 à 1964, enfin directeur des écoles Brizeux et Armorique, à Vannes, de 1964 à 1970.
Ce parcours de Républicain, le conduit à briguer le mandat de maire, à l'âge de 53 ans en 1971. Il habite alors la commune depuis 7 ans. Le curé de l'époque dans le bulletin paroissial salue l'élection du maire.
Ici une photo du conseil municpal :
Au premier rang de gauche à droite : M. Uguen, ancien maire et 1er adjoint, M. Guyomard, maire, M. Vincent Le franc, 2° adjoint.
Au 2° rang sur le trottoir : M. Le Sommer, M. Chevalier, M. Le Roch, M. Touchard, M. Guelzec, M. Savary, M. Doriol, M. Laurent.
Sur le perron de la mairie : M. Malry, M. Josso, M. Le Derff, M. Noblanc, M. Balleriaud, adjoint, M. Le Guyer.
Au dernier rang du haut : M. Laudrin, M. Le Digabel, M. Gianerini.
Sous mandat, la rue de la Fontaine sera léargie et le monument aux morts déplacé pour prendre sa position actuelle Place De Gaulle à côté du cimetière.
A la fin de son mandat, Séné a fortement accru sa population : 2744 hab en 1968, 3537 hab en 1975 et 4627 hab en 1982.
Albert GUYOMARD décède à Vannes le 23/02/2008. Ces obsèques eurent lieu à Séné.
Montsarrac, son usine et son port
Tout le monde connait Port-Anna au bout de la presqu'île de Langle, en bas de la butte de Bellevue, qui fait face au village de Moréac en Arradon et à l'ïle de Conleau à Vannes.
Mais Port-Anna est récent dans l'histoire de notre commune. (lire article dédié). Un autre port a exité à Montsarrac qui resta actif durant toute la seconde moitié du XIX°siècle. Le port fut aménagé tout en bas de la rue qui descends depuis le calvaire (lire article sur le patrimoine) qui passer près de la fontaine de Montsarrac (lire article sur le spuits & fontaines) et poursuit vers l'île de La Garenne...
Au début l'usine chimique de Montsarrac :
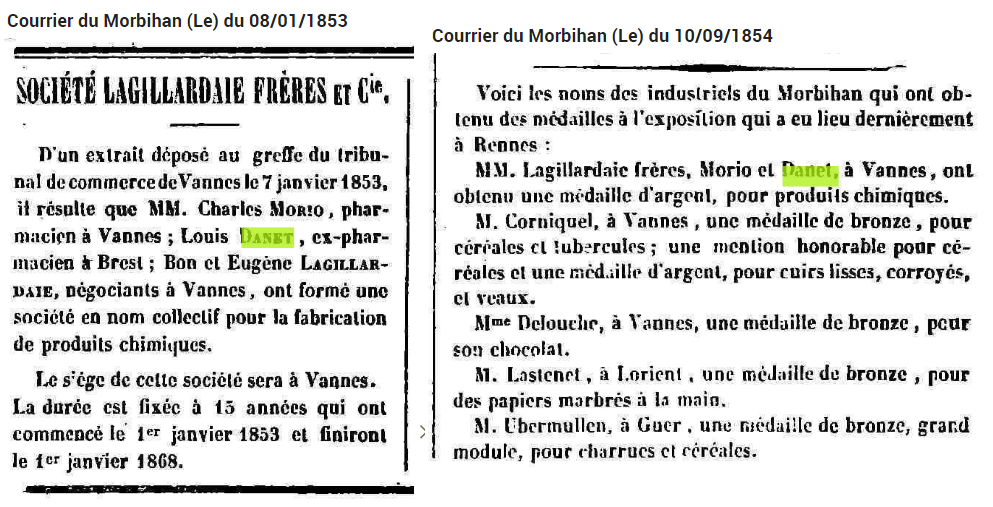
Sous le Second Empire, la France devient un pays industriel. Les sciences progressent, des projets industriels fleurissent sur le territoire national. A Vannes, plusieurs associés, Charles MORIO [12/10/1819 - 15/7/1883], pharmacien à Vannes, Louis DANET, ex-pharmacien à Brest et les frères Bon et Eugène LAGILLARDAIE [9/11/1823 Auray - 25/3/1904 Paris], négociants, créent une société en janvier 1853 pour la fabrication de produits chimiques. Dès septembre 1854, l'entreprise est primée à Rennes comme nous le relate le Courrier du Morbihan.
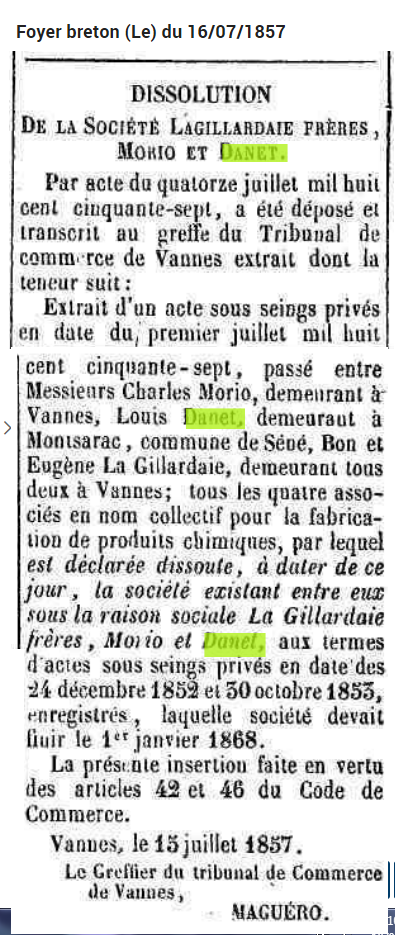
En juillet 1857, la société de produits chimiques Lagillardaie Frères est dissoute.......par acte du tribunal de commerce. L'usine trouve un repreneur comme nous l'indique l'annuaire de 1864. M. Charles Auguste Ange OUIZILLE [29/9/1822-26/4/1881] a repris l''activité à Montsarrac. La famille Ouizile est apparentée à la famile Lagillardaie.
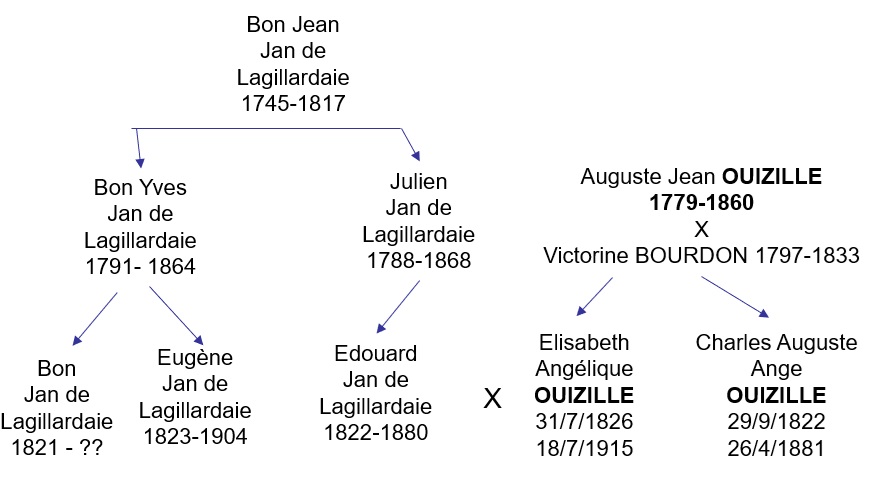
Les douaniers en poste sur Séné participent au contrôle de cette activité.

Le 9 avril 1853, les frères La Gillardaie, de Vannes, sont autorisés à installer au lieu dit « La Garenne », sur la commune de Séné, une fabrique de produits chimiques : sulfate de potassium, chlorure de potassium cristallisé, alun, nitrate de potasse, iode, brôme…
Tous les ans, des échantillons de chlorure de sodium sont prélevés par les douanes et examinés. En 1860, c’est M.Perrin, pharmacien place Henri IV, qui en est chargé. Par la suite, les échantillons sont envoyés à Nantes.
Voici le certificat de prise d’échantillons dressé le 23 août 1862 :
« Nous soussignés Brière Henri, commis des Douanes aux Quatre Vents (Commune de Séné) et Lhôte, patron des mêmes douanes à Mont Sérac, certifions que, par suite de déclaration enregistrée sous le n°3 au bureau des Quatre Vents et faite ce jour au nom de Mr Ouizille fils, propriétaire de l’usine de Mont-Sérac, par Mr Boutillier son fondé de pouvoir, pour la quantité de cinquante trois mille kilogrammes de chlorure de sodium impur que l’on se propose d’expédier à Rouen ; nous avons procédé au prélèvement d’échantillons qui doivent être soumis à l’examen des experts désignés par le préfet du Morbihan pour savoir s’il y a lieu de délivrer le certificat d’innocuité prescrit pour la consommation de ces produits. Nous avons, en conséquence, retiré de différents endroits de la masse de chlorure de sodium des petites quantités de ce produit qui ont été mélangées en notre présence et placées ensuite dans deux bocaux scellés de notre cachet et de celui de Mr Boutillier.
Fait à Mont Sérac le 23 Août 1862 ».
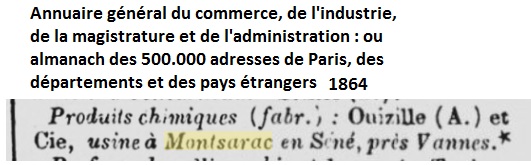
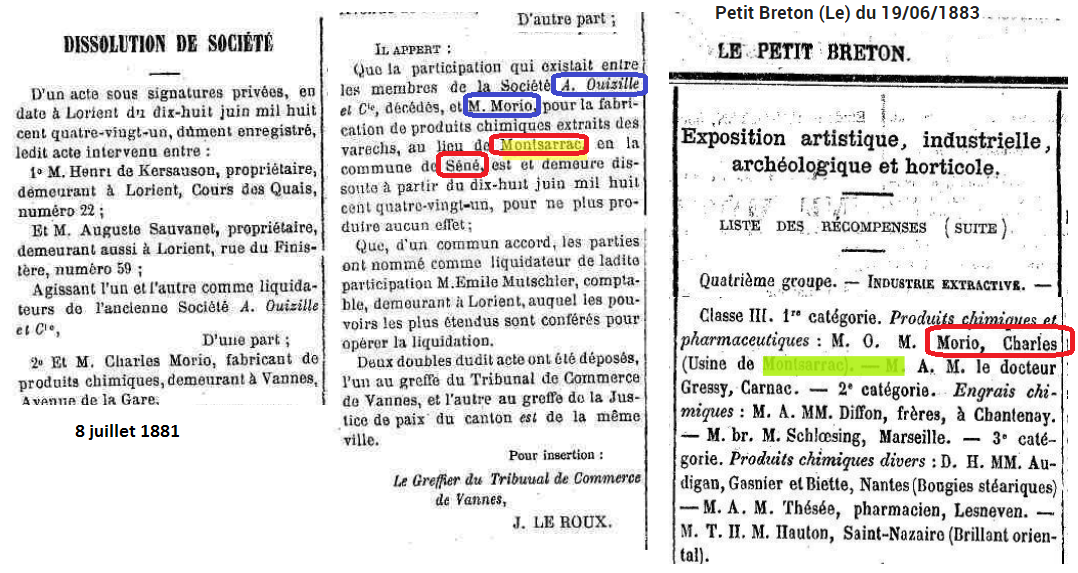
L'activité de fabrication de produits chimiques perdurera jusqu'en 1881 date du décès d'Auguste OUIZILLE négociant et banquier de Lorient [29/9/1822-26/4/1881]. Charles MORIO demande la dissolution de leur entreprise. Il semble qu'il décide de continuer seul l'activité et il obtient un prix en juin 1883. Cependant, en septembre 1883, l'usine est mise en vente. L'annonce de sa vente nous renseigne sur la fabrication de produits chimiques qui avait lieu à Montsarrac.
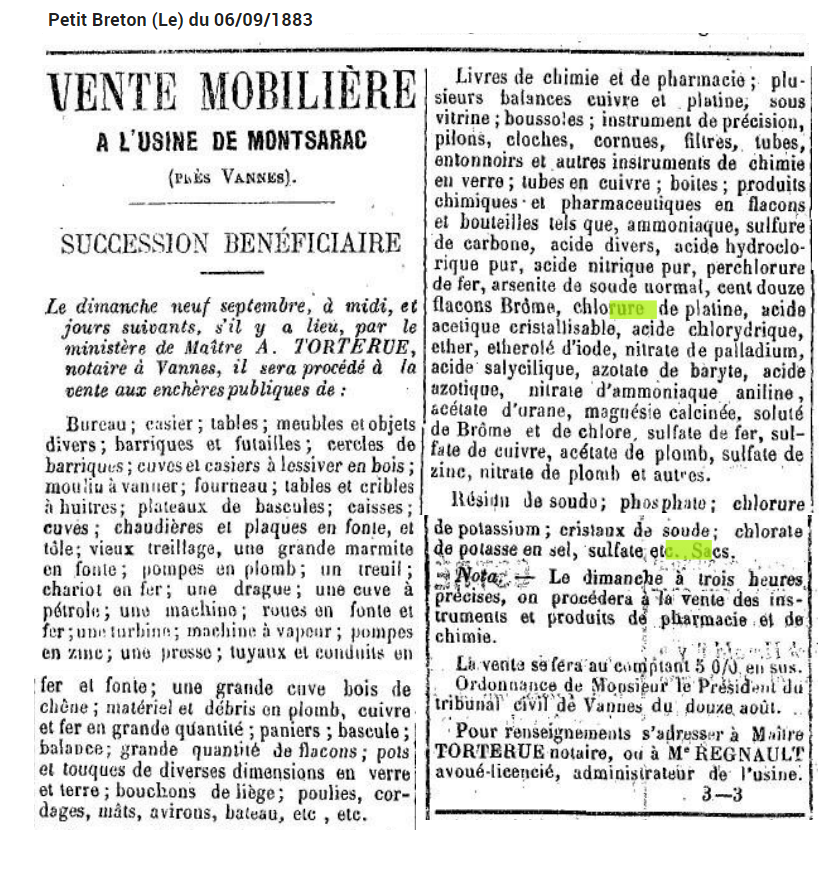
Maître Torterie, notaire et Maître Regnault avoué licencié, administrateur de l'usine en liquidation, nous dressent un inventaire complet des biens mis à la vente :
bureau; casier; tables; meubles et objets divers; bariques et futailles; cercles de barriques; cuves et casiers à lessiver en bois; moulin à vanner; fourneau; table et cribles à huîtres; plateaux de bascules; caisses; cuves; chaudières et plaques en fonte et tôle; vieux treillage, une grande marmite en fonte; pompes en plomb; un treuil; chariot en fer; une drague; une cuve à pétrole; une machne; roues en fonte et en fer; une turbine, machine à vapeur; pompes en zinc; une presse; tuyaux et conduits en fer et fonte; une grande cuve de bois de chêne; matériel et débris en plomb, cuivre et fer en grande quantité; paniers; bascule; balance; grande quantité de flacons; pots et touques de diverses dimensions en verre et terre; bouchons de liège; poulies, cordages; mâts; avirons, bateau, etc, etc,
Livres de chimie et pharmacie; plusieurs blances cuivre et platine; sous vitrine; boussoles; instruments de précision, pilons, cloches, cornes, filtres, tubes, entonnoirs et autres instruments de chimie en verre; tubes de cuivres; boites; produits chimiques et pharmaceutiques en flacons et bouteilles tels que, ammonique, sulfures de carbone, acides divers, acide hydrochlorique pur, acide nitrique pur, perchlorure de fer, arsenite de soude normal, cent douze flacon sde brôme, chlorure de platine, acide acétique cristallisable, acide chlorhydrique, éther, éthérolé d'iode, nitrate de palladium; acide sallycilique, azotate de baryle, acide azotique, nitrate d'ammoniaque aniline, acétate d'urane, magnésie calcinée, soluté de brome et de chlore, sulfate de fer, sulfate de cuivre, acétate de plomb, sulfate de zinc, noitrate de plomb et autres...Résidus de soude, phosphate, chlorues de potassium, cristaux de soude, chlorate de potasse en sel et sulfates etc, sacs.
L'extraction d'iode à partir de "pain de soude" :
L'usine de produits chimiques de Montsarrac produisait de l'iode et du iodure de potassium à partir de "pains de soude" produits par des usines en Bretagne qui trataient le varech récolté en mer. L’iode était utilisée en médecine et en photographie.
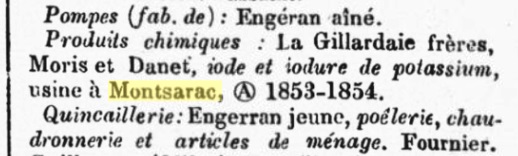

Société de Traitement Chimique des Algues
Usine de Trégunc (Finistère)
Extrait wiki-pedia : L'essor des industries de fabrication de l'iode à partir du goémon
Initialement utilisé presque uniquement comme engrais, l’usage industriel du goémon se développe à partir de la fin du XVIIIe lorsque ses cendres, les « soudes de varech », riches en carbonate de sodium, entrent dans la fabrication du verre ; on s’en sert aussi en savonnerie, pour nettoyer le linge, teindre des étoffes… L’invention de Nicolas Leblanc, qui mit au point en 1791 un procédé de fabrication du carbonate de sodium à partir du sel marin provoqua la ruine des « soudiers ».
Mais en 1812, Bernard Courtois découvre que l’on peut obtenir de l’iode à partir de cendres de varech. Ce n’est toutefois qu’en 1829 qu’ouvre au Conquet (usine Tissier) et d'autres la première usine bretonne d’extraction d’iode obtenu par calcination du goémon dans des fours à soude. Des usines à iode se créent le long du littoral breton (on en compte 18 à la fin du XIXe siècle le long du littoral breton), par exemple à Pont-l’Abbé en 1852, Vannes en 1853, Quiberon en 1857, l’Aber-Wrac’h (usine Glaizot) en 1873, Guipavas en 1877, Lampaul-Plouarzel et Audierne en 1895, Loctudy et Kérity (Penmarc'h) en 1914, faisant travailler en tout plus de 300 ouvriers à la veille de la Première Guerre mondiale.
On comprend pourquoi des pharmaciens sont à l'origine de l'usine d'extraction d'iode à Montasrrac.
Il fallait récolté 25 tonnes d'algues frâiches pour obtenir 5 tonnes d'algues séchées.
Extrait des annales de géographie, 1947 Marcel Gautier :
Le goémon séché en plein air, est mis en meules couvertes de gazon puis brûlé dans des fours à fosses analogues aux anciens fours à varech du XVIII°siècle, où on produisait en Normandie la "soude" réclamée par les verriers. Il s'agit de rigoles (0.6 m de large, 0.4m de profondeur, 10 à 15 m de long) grossièrement maçonnes en granit particulièrement choisi pour éviter qu'ilne "brîle", c'est à dire qu'il ne s'écaille, sous l'action d'une température atteignant jusqu'à 800°. La fumée des fours, au moment du travail, abscurcit toute la côte des goémoniers. Quelques "brûleries" en briques, plus perfectionnées, existent à Plouguerneau, Portsall, l'Aver Wrac'h, Argenton. Le produit de combustion, la "soude" masse vitreuse et scoriacée, découpé en pain, est vendu aux usines après titrage variant de 0,3 à 1,8%. Toutefois, à l'île Calot, près de Carantec, cette vente se fait aux enchères. L'extraction d'iode entraine une série d'opérations pendant l'obtention de liqueurs toujours plus concentrées. les sous-produits de fabrications sont vendus comme engrais (poudrettes).
L'arrêt de l'activité et la vente de l'usine :
La vente de l'usine se réalisera en plusieurs étapes si on en croit ces annonces de presse. Au delà des produits chimiques et du stock de l'ancienne activité, l'usine comprenait des bâtiments intéressants qui malheureusement tombèrent en ruines. L'époque n'était pas à la résidence secondaire "les pieds dans l'eau" d'autant que le lieu devait sans doute être pollué...
Le 7° lot dresse l'inventaire des bâtiments : quatre corps comprenant magasins, ateliers, remises, écuries, chambre d'habitation, jardin, cour, puits, carrière, une grande pièce de terre plantée en partie de sapins, le tout enclos d'un seul tenant pour une contenance d'envrion 2 ha. 25.000 frs de mise à prix.
L'ancienne usine à iode échut à la commune de Séné qui s'en désaisit vers 1930. Elle fut acheté par la famille Giannerini, maçons à Séné, qui y fit pendant quelques années une extraction de pierres. Dans les années 2010, elle fut acquise et rénovée en maison d'habitation.
La construction de la cale de La Garenne, la naissance du port de Montsarrac :
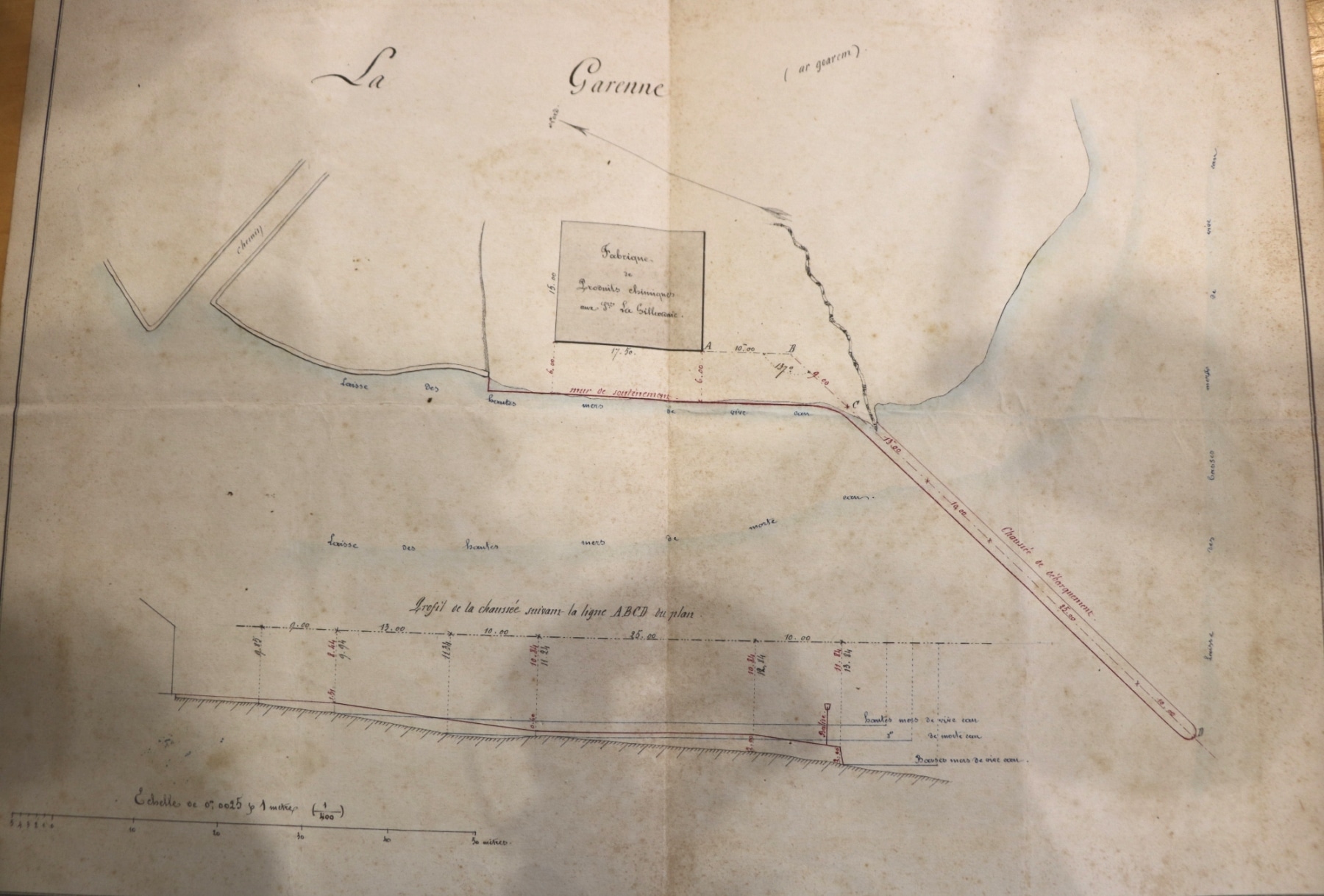
Maxime MAUFRA [1861-1918],
1910 - La plage de saint-Pierre de Quiberon, L'usine à iode.
Huile sur toile - Collection particulière.
L'usine chimique était située sur l'île de la Garenne au bout du village de Montsarrac. Dès 1853, les propriétaires adressent une demande en préfecture pour être autorisés à construire une chaussée au pied de leur usine. Ils ont besoin de recevoir les pains de soude des usines du nord Finistère. Peu à peu, la cale privée devient le quai fréquenté par des bateaux faisant du cabotage.
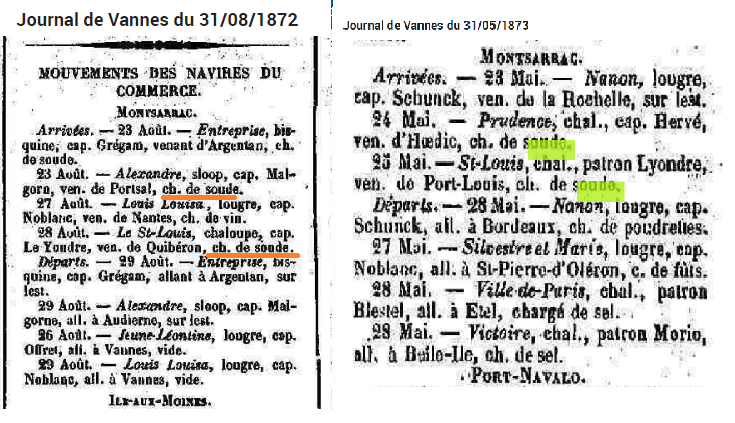
Avec quelques mots clefs judicieux, un peu de patience, on retrouve sur le site des archives du Morbihan, des vieux articles de journaux qui nous relatent l'activité maritime à Montsarrac. On parle de "Mouvements des Navires de Commerce" au port de Montsarrac comme pour celui de Vannes, de Port Navalo etc.. Le Golfe du Morbihan, à une époque où le transport routier n'est pas développé, est emprumpté par un tas de bateaux, de caboteurs qui transportent vivres (vin, pomme de terre, sel), des matières, bois, charbon et poudrette (engrais) et les pains de soude nécessaires à l'usine de Montsarrac. Ils emportent également du sel en provenance des marais salants de Séné et du petit équipement, fûts de vins et touques vides (récipient métallique).
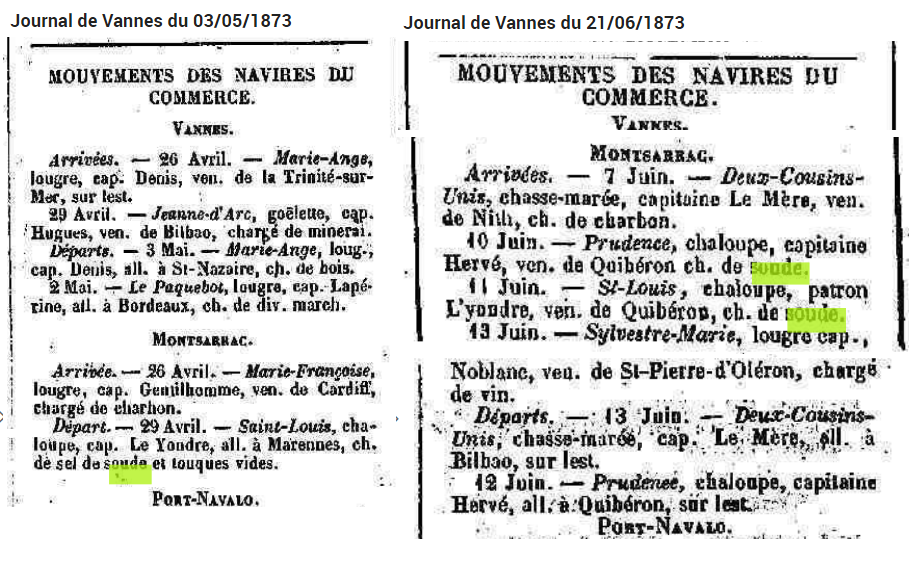
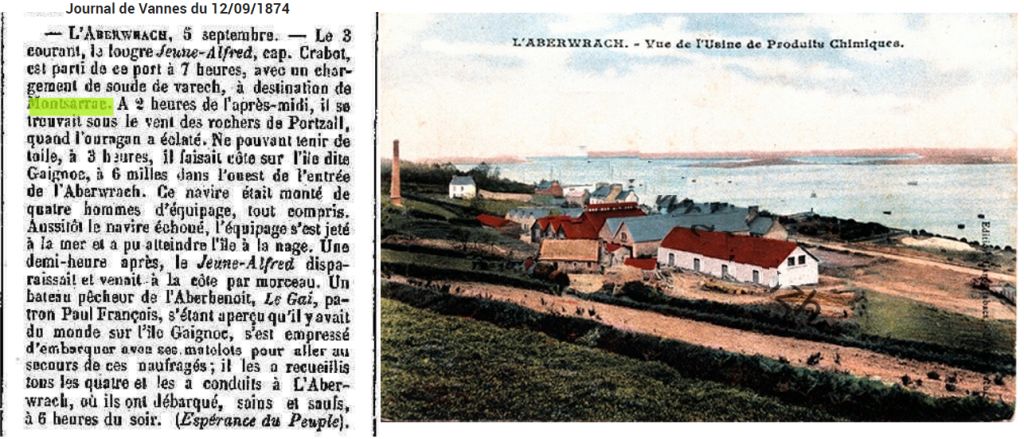
En septembre 1874, le lougre Jeune-Alfred, du capitaine Crabot, parti du port de l'Aber Wra'ch avec un chargement de soude à destination de Montsarrac fit naufrage sur les roches de Portsall, comme nous le relate cet article du Journal de Vannes.
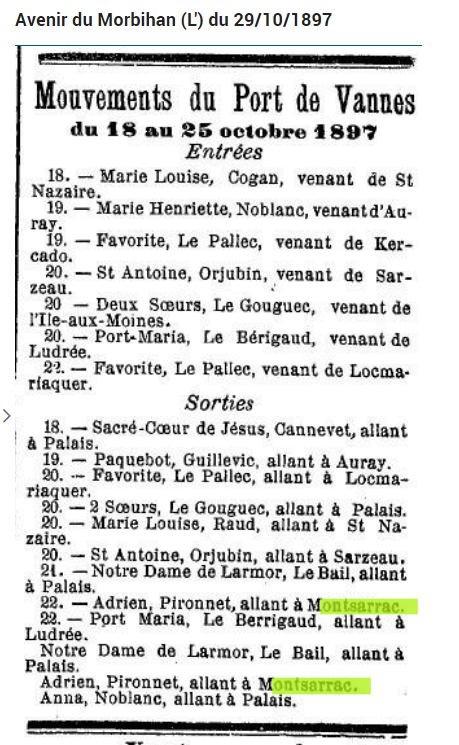
La dernière mention du port de commerce de Montsarrac trouvée dans la presse locale date d'octobre 1897.
La prospérité du village de Montsarrac à Séné :
Durant ces années 1850-1890, le village de Montsarrac sera relativement prospère. Selon le dénombrement de 1886, le village est habité essentiellement de famille de marins, quelques pêcheurs et pêcheuses [catégorie différente des marins, sans doute pêcheurs à pied), leurs épouses sont des ménagères. Parmi les marins, 5 maîtres de cabotage.
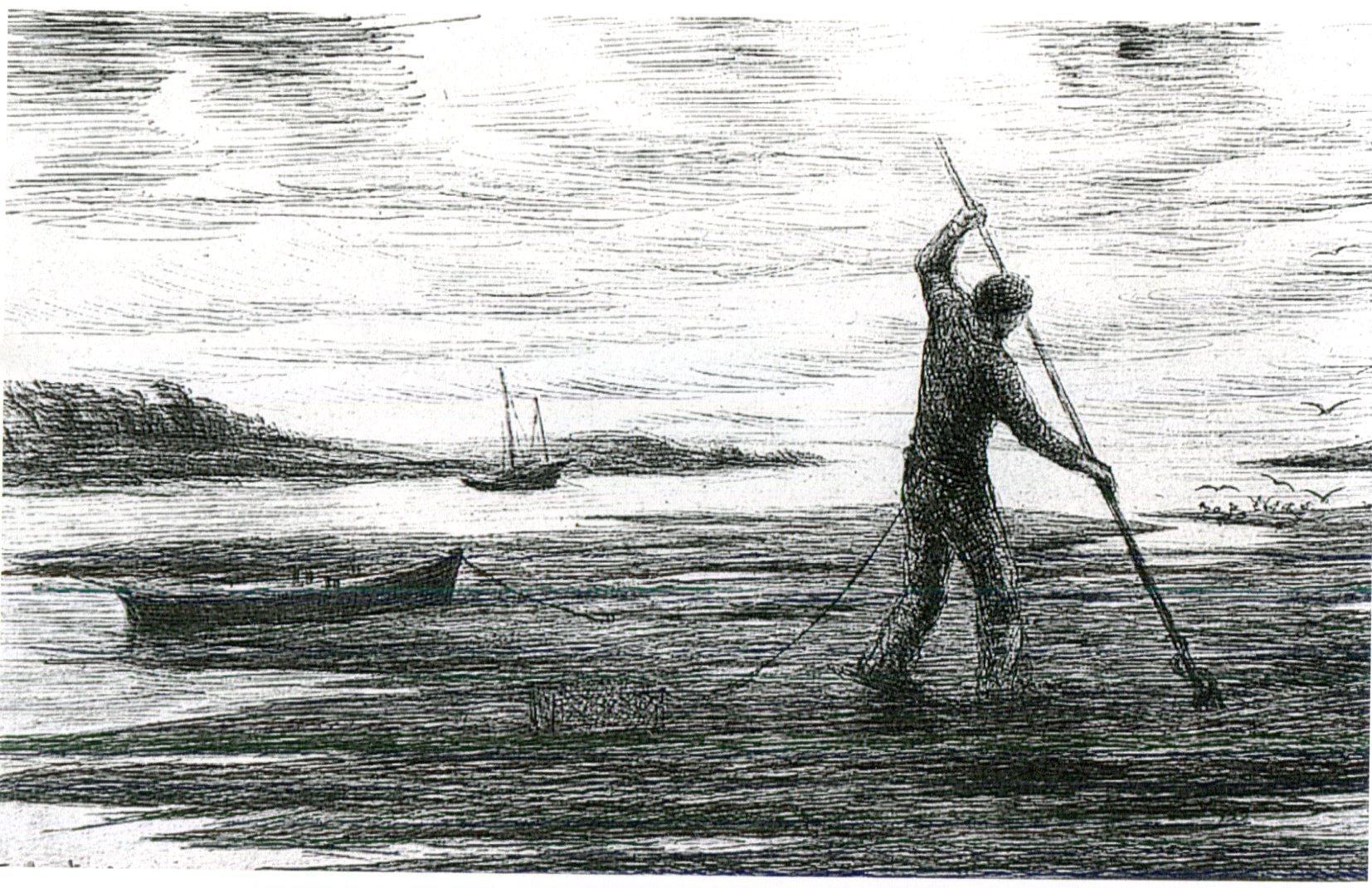
Pêcheurs d'anguille, gravue de jean Frélaut. Tout y est : la plate échouée en bordure de la vasière, les sabots-plats pour progresser et le vivier attaché autour de la taille du pêcheur. Le geste indique qu'il faut taper fort dans la vase pour surprendre les anguilles enfouies. Au second plan, un sinago est mouillé dans le milieu du chenal. (Texte G.Millot)
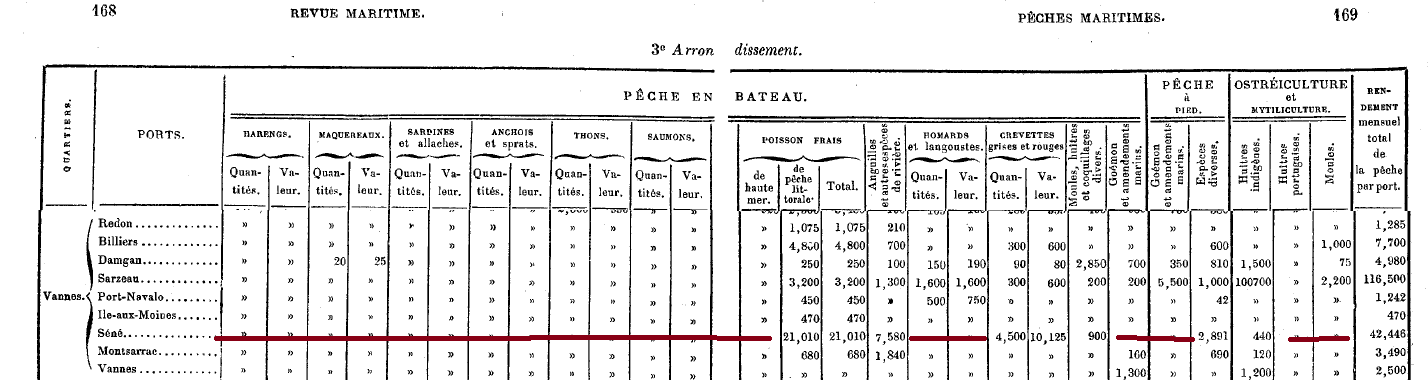
Cette statistique de 1898 rend compte du type de pêche pratiquée par les marins de Montsarrac, village traité à part par l'administration maritime de l'époque. On ramène à quai du poisson frais de la pêche littorale, 680 Kg, des anguilles et autres poissons de rivières pour 1840 Kg, 160 Kg de goémon, 690 Kg d'espèces diverses, 120 Kg d'huitres indigènes, soit 3.490 kg de "rendement mensuel de la pêche au port de Montssarac" [env 42 T par an], à comparer aux 42.446 Kg débarqués à Séné en un mois.
On compte aussi des journaliers et des journalières. 2-3 retraités; un propriétaire, M. de Castellan au château de Bot-Spernen (lire article sur le château) . Un étudiant et pas mal d'enfants de tout âge dont un enfant de l'assistance publique placée chez une famille..
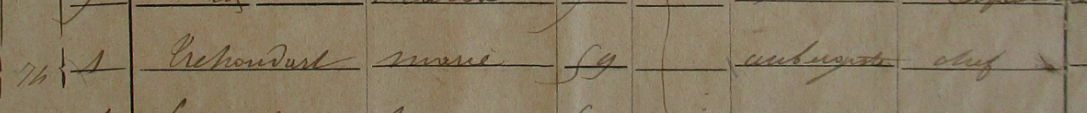
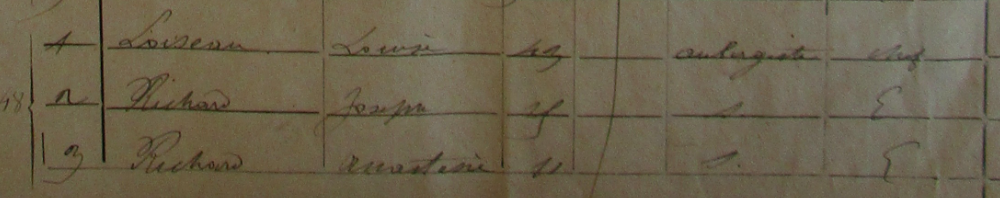
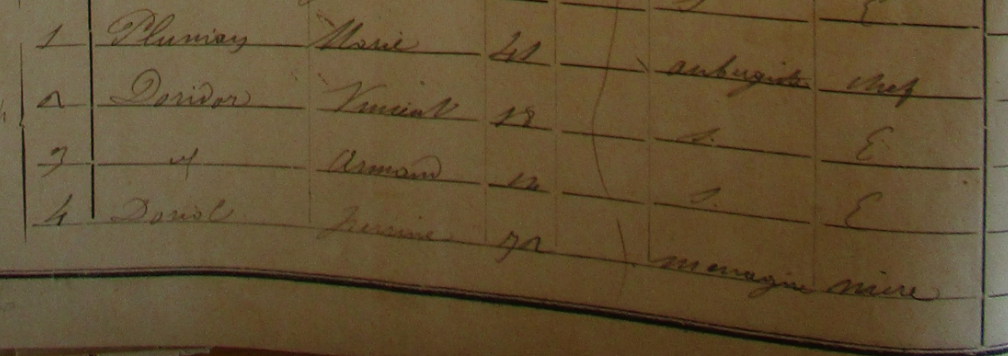
Le village compte aussi avec 4 cabaretières, un boulanger et 3 aubergistes femmes, Marie PLUNIAN, 41 ans, Mouise LOISEAU, 43 ans et Marie TREHONDART qui servent à boire et à manger aux pêcheurs et marins du port, à des journaliers et aux ouvriers de l'usine à varech... On dénombre aussi un charretier, un maçon, un garde maritime et 3-4 familles de cultivateurs.
Une école sera même ouverte entre 1867 et 1873 à Montsarrac tenue par une soeur des Filles du Saint-Esprit qui vient du bourg mais où?. (lire article sur les écoles). En 1869, le village a failli se doter d'une vraie maison d'école. On retrouve aux archives du Morbihan, le plan envisagée pour cette école. Le conseil municipal ne suivra pas le souhait du Prefet argumentant qu'il préfère privilégier les classes du bourg. Elle devait être construite sur la parcelle n°480 cadatrée en 1845, soit aujourd'hui en venant de Bilherbon vers Montsarrac, au tout début de la côte sur la gauche.
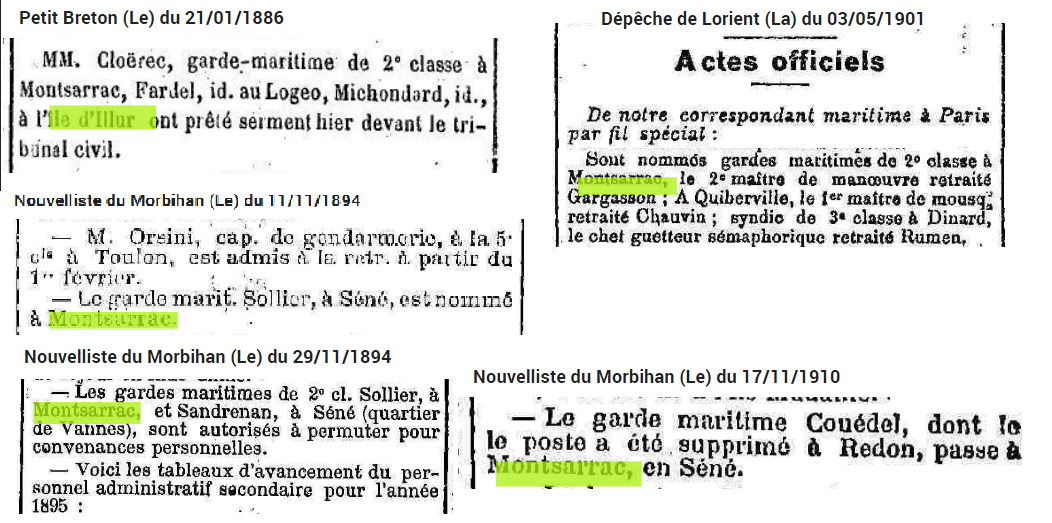
Le garde maritime à Montsarrac, était sans doute posté dans la guérite de l'île de la Garenne, d'où il pouvait suivre les mouvements des bateaux chargés de sel et surveiller les concessions ostréicoles.
L'activité du port décroitra et le souvenir d'un port à Montsarrac s'évanouira. Plus tard, Port-Anna, 2° port à Séné, installé en "eaux profondes" prendra le relai avec la pêche et l'ostréiculture.
32 "voleurs" de palourdes, 1932
Dans son ouvrage intitulé "Au Pays des Sinagots" , Jean RICHARD consacre un chapître au "braconnage". Il est vrai que les Sinagots se sont faits au cours des décennies une réputation de fraudeurs dans la pêche en tout genre, le dragage illégal des huitres et comme nous l'indique cet article, dans la pêche non autorisée à la palourde.
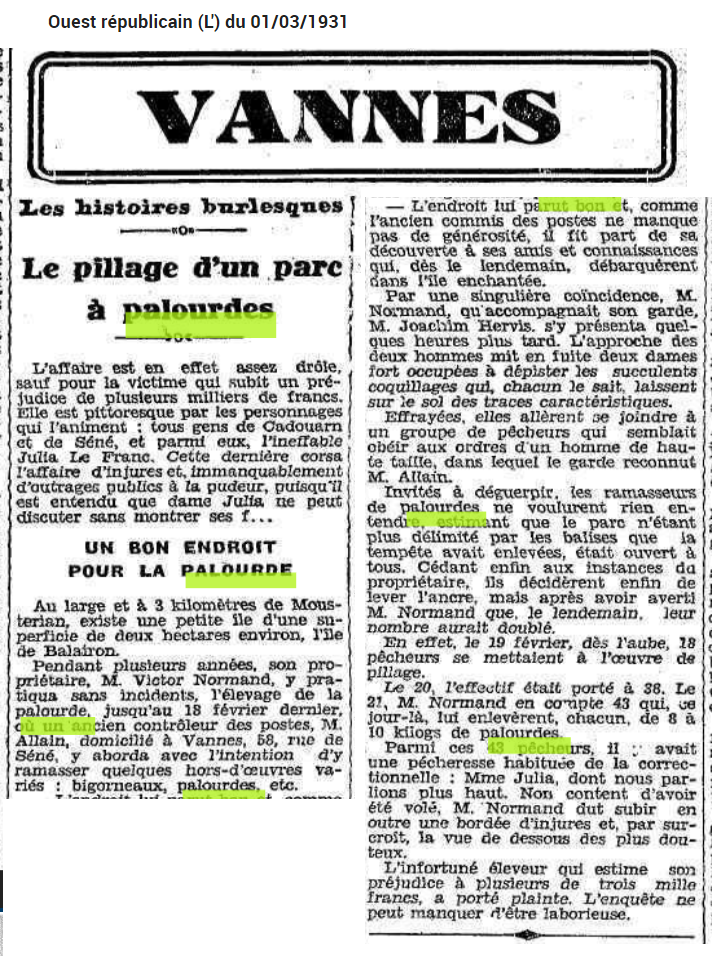
Cet article de l'Ouest Républicain daté du 1er mars 1931, nous relate, non sans humour, un vol de palourdes commis par des "gens de Cadouarn et de Séné". La lecture de cet article et d'autres coupures de presse permet de retracer les péripéties de ce vol de mollusques.
M. Victor NORMAND, résident à Vannes au 6 rue du Pot d'Etain, détient des droits sur un parc à huîtres autour de l'île de Bailleron, commune de Saint-Armel. Pour surveiller ses lots n°31-58 et 36-67, il emploie un garde maritime, Joachim HERVIS, habilité à porter un fusil et un ouvrier COQUART. M. Normand déclarera lors du procès qu'il avait des soupçons que son parc à huître était visité par des maraudeurs depuis l'afflux de palourdes à vil prix à la Poissonnerie de Vannes et parce que certains Sinagots se vantaient d'avoir gagner de coquettes sommes à la suite de ces vols.
Le 18 février 1931, Jean Marie Célestin ALLAIN, 64 ans, ancien controlleur des PTT, demeurant au 58 Rue de Séné à Vannes (actuelle rue Monseigneur Tréhiou), se rend sur l'île de Bailleron et est surpris par le garde et son patron avec des palourdes.
Non content de se faire débusquer, le sieur ALLAIN revient le lendemain avec un groupe de Sinagots. Le procès qui s'en suivit relèvera une succession de vols. Le 19 février 1931, 18 pêcheurs seront reconnus pour avoir volé des palourdes; le 20 février, se sont 38 personnes qui auront à répondre du même délit; le 21 février, on en comptera 43. Ils reviendront également les 14 et 15 mars 1931.
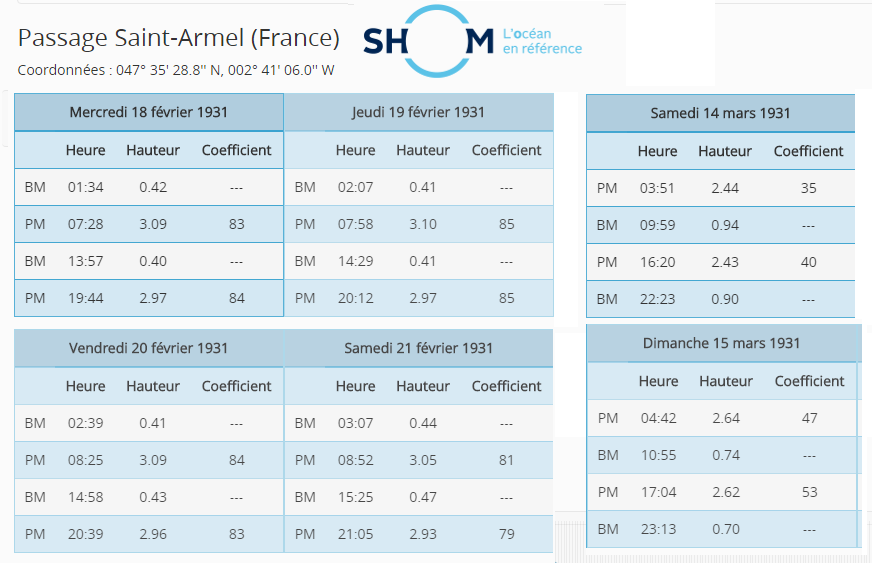
Le procès, hors norme, eut lieu au Tribunal Correctionnel de Vannes le mercredi 29 mars 1932.
L'audience était présidée par M. Denise, assisté de M. Billaud, juge au siège et M. Devèze du barreau de Vannes. M. Le substitut Reliquet soutenait l'accusation. Maître Belanfant assurait la défense du principal inculpé M. ALLAIN. Maître Legrand défendait en bloc la trentaine de Sinagots poursuivis.

Les pouvoirs public avaient demandé à M. André, Inspecteur du Contrôle des Etablissements de Pêche de vérifier la présence de palourdes sur les dites concessions. Me Legrand fit rire l'assistance quand il demanda "si les palourdes pouvaient s'évader de leur parc". Mme Veuve Doriol, marchande de coquillages aux Halles de Vannes confirma avoir acheté à des Sinagots des palourdes sans se soucier de leur provenance. Pour se défendre d'avoir pénétré dans les concessions de M. Normand, les "voleurs" argumenteront que les dites concessions étaient mal délimitées par des balises que la tempête avait enlevées et qu'ils étaient sur le domaine public.
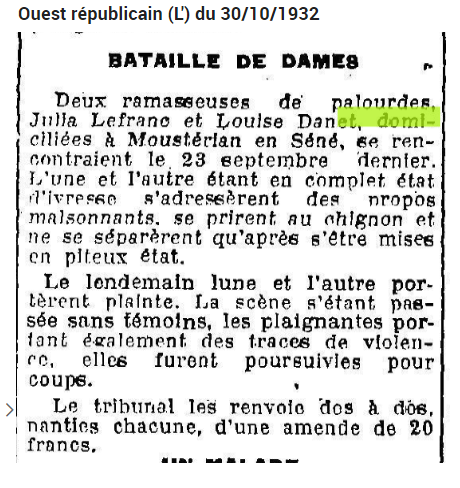
Parmi les auteurs de l'infraction, une dénommée Julia LE FRANC [ 20/2/1903 9/7/1935] se fit remarquée. Le journaliste indique qu'elle était habituée de la correctionnelle, on dirait aujourd'hui "bien connue des services de police", comme l'indique cet article de presse datée d'octobre 1932. Julia LE FRANC injuria MM Normand et Hervis et leur montra ses fesses! Julia LE FRANC s'illustra plus positivement en tant que mère. Elle accoucha par 2 fois de faux-jumeaux. Son marie fit construire un sinagot "Le Trois Frères" et le baptisa en 1943 en l'honneur de ces 3 garçons. En circonstance atténuante, la jeunesse de Julia fut endeuillée par la noyade de son jeune frère et de sa soeur ainée en 1915.
Un autre journaliste décrit l'énergumène lors du procès : La déposition de Julia LE FRANC rompt la monotonie des débats : Torrès [Maurice Torrès, chef du PCF] est un torrent, Julia est une cataracte. Elle est communiste bien entendu, la côte doit être à tout le monde, et sans mesure, elle fait le procès des parqueurs qui veulent la mort du pauvre pêcheur."
Le réquisitoire fut sévère à l'encontre de M. ALLAIN, accusé d'être le chef de l'expédition. La préméditation fut démontrée car le balisage des concessions aurait été enlevé.
Le Tribunal condamna M. ALLAIN à 150 fr d'amende; Mme Julia LE FRANC, 29 ans, pêcheuse à Séné, à 50 fr; Marie Louise DANET, 33 ans, pêcheuse à Moustérian à 30 fr, toutes deux en état de récidive.
Dans la liste des condammés à 20 fr d'amende avec sursis, on note la présence de 11 jeunes filles, de 2 veuves, de 9 femmes, d'1 jeune homme, et de seulement 6 hommes dont 2 retraités. Les vols étant commis aux heures de travail des hommes.
Hommes : Julien DANET, 71 ans marin pecheur en retraite à Moustérian, Patern LE FRANC, 36 ans de Moustérian, Pierre LE DORRIDOR, 63 ans marin pêcheur en retraite et Mathurin NOBLANC, 53 ans, marin pecheur. Raymond NOBLANC, 26 ans de Cadouarn; Ernest LE FRANC, 27 ans Cadouarn.
Jeune homme : Ange RIO, 17 ans de Cadouarn.
Jeunes filles : Désirée PIERRE, 16 ans de Cadouarn; Marie Odette LE DORIOL, 18 ans de Cadouarn, Véronique RIO, 17 ans de Cadouarn, Félicie DANET, 19 ans de Cadouarn, Marie Josèphe MARTIN, 20 ans de Cadouanr, Anastasie LE FRANC, 20 ans de Cadouarn, Marie Louise BARO, 16 ans de Cadouarn, Léonie MOREL, 22 ans de Cadouarn, Hélène LE ROUX, 20 ans de Cadouarn, Philomène BARRO, 29 ans, Marie Louise BARO, 30 ans Cadaourn.
Veuves de pêcheurs : Marie HAZIL, veuve QUINTIN, 32 ans de Cadouarn; Julienne HAZIL veuve PIERRE 37 ans de Cadaourn
Femmes de pêcheurs : Armandine JOUANGUY, femme Noblanc, 30 ans, de Cadouarn, Clémentine HAZIL femme Gregam, 41 ans, Marie Zelie LE MAY femme Le Ridan 48 ans; Marie CLERO femme Morel, 48 ans Cadouarn; Anne Désirée Marie LE MAY femme Richard; Anne Marie MARTIN 66 ans; Léonie Marie Désirée MALRY; Raymonde MOREL de Cadaourn Aglaée BOCHE femme LE QUINTREC.
Les plaignants firent appel de cette décision et un nouveau procès eu lieu le 7 juin 1932 à Rennes.
Le procès en appel à Rennes pour les Sinagotes !
Une première audience eut lieu le 7 juin 1932 mais le procès en appel fut renvoyé au 28 juin. M Normand fit valoir les témoignange de son garde M. Hervis et sa femme ainsi que de son employé M. Coqaurt. L'inspecteur André renouvella son témoignage et le gendarme Carré et le maréchal des Logis Chambiley confirmèrent leur écrits. L'affaire fut mise en délibéré....
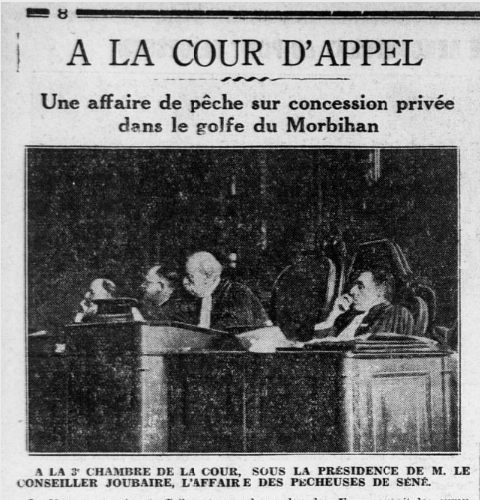
Quinze jours plus tard, la Cour d'Appel de Rennes acquittait l'ensemble des prévenus en estimant que les faits n'étaient pas suffisamment établis". L'avocat de la défense argumenta que la concession de M. Normand était une concession pour l'ostréiculture et en aucun cas une concession pour l'élevage de palourdes !
L'histoire ne dit pas à partir de quand les Aurotités décidèrent de la création d'une zone réglementée pour la pêche à la palourde.
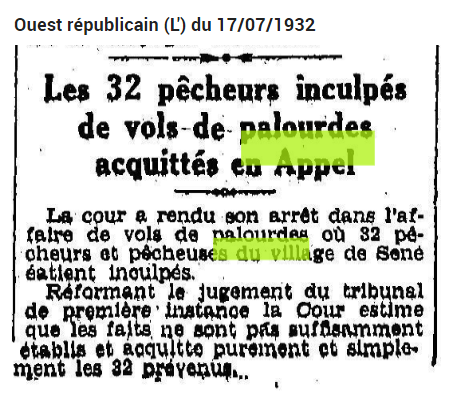
Deux pêcheurs liquident leur vieilles rancunes, 1933
Article daté du 3 septembre 1933 repris et complété par des informations d'autres articles et des éléments d'état civil.
SENE Au village des "Sinagots" deux patrons pêcheurs liquident une vieille rancune.
Dans le petit village de Cadouarn, situé sur le bord du Golfe du Morbihan, deux patrons pêcheurs, Pierre ALLANIOUX et Lucien CLERO, se rencontrant au bas du chemin qui descend du village, ALLANIOUX, dont les instincts batailleurs étaient connus de tous ses voisins, sans aucune discussion, sauta à la gorge de CLERO et le terrassa. CLERO réussit au bout d'un moment, à prendre le dessus et, s'étant dégagé de l'étreinte de son adversaire, fou de colère, frappa à coups de poing et à coups de pieds chaussés de sabots, à tort et à travers. Pierre ALLANIOUX, atteint à la tempe droite, expirait quelques minutes plus tard. CLERO alla immediatement se constituer prisonnier, regrettant son acte involontaire.
Nouveaux détails.
Samedi soir, vers 17 heures (nous sommes le samedi 2 septembre 1933), CLERO qui, outre son métier de pêcheur, élève des huîtres aux environs de l'ïle de Boëd, située en face de la presqu'île, revenait de ses parcs et regagnait la maison familiale. Mais, au lieu d'y accéder directement, comme à son habitude, il voulut faire le tour par la ruelle principale pour prendre sa femme qui se trouvait chez des amis. Chemin faisant, près de la côte, il rencontra Pierre ALLANIOUX, qui revenait de Vannes où il avait touché une petit héritage et où, aussi, il avait fait de nombreuses libations.
[Avec sa femme et sa belle-soeur, ils avaient visité l'armateur qui leur avait remis le montant d'un petit héritage, bien mince, puisqu'il s'agissait de quelques centaines de francs. En descendant de l'autobus qui les ramenait au bercail, ils semblaient en état d'ébriété]
ALLANIOUX l'interpella au passage et lui demande de l'argent pour boire. Julien CLERO voulut passer son chemin sans répondre, mais l'ivrogne ne l'entendait pas ainsi et vit, là, l'occasion de montrer sa force. Il sauta à la gorge de CLERO qu'il serra comme dans un étau, et tous deux roulèrent à terre sur le bord du chemin où se trouve une petite mare desséchée.
ALLANIOUX eu d'abord l'avantage et CLERO suffoquait; mais bientôt, ce dernier réussit à se dégager de l'étreinte de son adversaire et, aveuglé alors par une colère qui semble quelque peu légitime, il se vengea à coups de poing et à coups de pieds, frappant à tort et à travers.
"Assez, Julien" cria ALLANIOUX, et CLERO se releva, prêt à s'en aller. Il fut alors stupéfait de voir que sa victime ne bougeait plus, [il perdait son sang en abondance d'une blesure à la tête], il était mort. Affolé, CLERO, regrettant d'avoir frappé si fort, se rendit au bourg où il raconta à l'adjoint la scène qui venait de se passer, le priant d'alerte la gendarmerie.
La victime
Pierre ALLANIOUX [13/01/1879 - 2/09/1933, est pensionné de la Caisse des Invalides pour une blessure contractée au Tour du Parc, pendant la guerre] comme nous le disions plus jaut, était mal considéré par ses voisins.[ Il est bien recensé lors du dénombrement de 1931 au village de Cadouarn avec son épouse.]
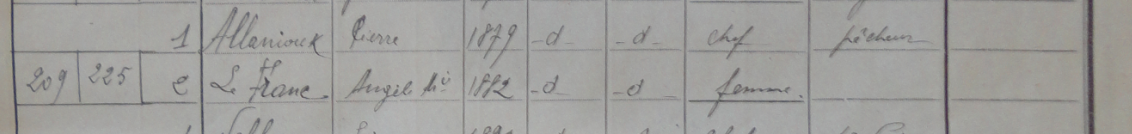
Il s'enivrait souvent, et avait l'ivresse méchante. Les rixes auxquelles il a pris part sont nombreuses, et si, depuis des annés, il a donné des coups, il lui est arrivé d'en recevoir aussi. "Cela devait finir ainsi", nous disait un pêcheur qui ne semblait pas regretter outre mesure la disparition de celui qui était un peu devenu la terreur du village. Sa femme [Angèle Marie LE FRANC] se livre à la boisson; sa fille [Lucienne divorcée LE GOINVEC] est encore en ce moment interdite de séjour, à la suite d'une condamnation encourue pour avoir trempé, il y a quatre ans, dans le meurtre de LE GREGAM. Pierre ALLANIOUX qui, lui aussi, était patron pêcheur, était âgé de 54 ans.
En liberté provisoire
Julien CLERO est âgé de 48 ans, il est marié et père de quatre enfants [comme le confirme le dénombrement de 1931]
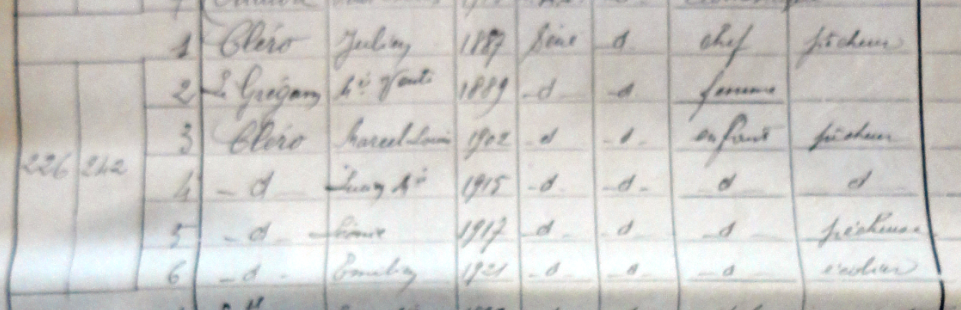
Le bourg entier s'accorde pour donner sur lui les meilleurs renseignements. Depuis avant 1914, il était harcelé par sa victime d'aujourd'hui, et il dut fuir bien souvent pour éviter le dénouement qu'il regrète si amèrement à l'heure actuelle. Le Parquet [qui s'est rendu sur place] après interrogatoire, l'a laissé en liberté provisoire.
Le docteur Franco, médecin legiste s'est rendu dimanche matin, au village de Cadouarn, pour pratiquer l'autopsie de la victime. Pierre ALLANIOUX portait des blessures à la tête et à la jambe gauche. Après un examen minutieux, le praticien a conclu que la mort avait été déterminée par une blessure à la cuisse gauche, profonde de 7 à 8 centimètres et faite, sans doute, avec un instrument pointu et tranchant, tel qu'un couteau. La section de l'artère fémorale aurait déterminé une violente hemorragie et peut-être une embolie. La mort dut être presque instantannée.
Cette découverte laisse à penser quer CLERO qui affirmait ne s'être servi que de ses poings et de ses pieds, aurait sorti un couteau de poche pour se défendre.
Le jugement de cet affaire eut lieu le 26 août 1933 et aboutit à un non-lieu reconnissant que Julien CLERO avait agit en légitime défense.
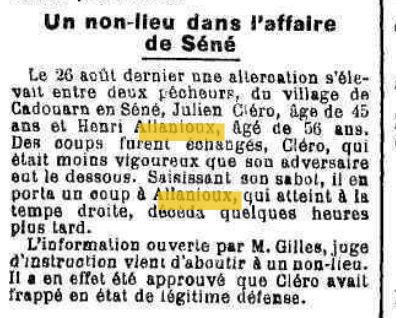
Marie BENOIT, la boulangère résistante
Marie Emilie BENOIT nait le 3 août 1906, au village de Kerarden où ses parents sont boulangers. Le dénombrement de 1911, juste avant la Première Guerre Mondiale, nous livre la composition de la famille Benoit.
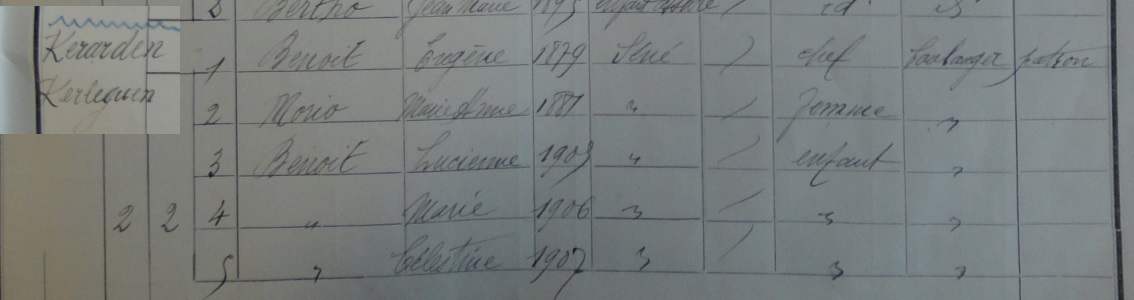
Au dénombrement de 1921, après guerre, elle n'apparait pas. Est-elle dans un lycée quelconque à étudier ? A l'âge de 15 ans elle commence à travailler comme boulangère chez ces grand-parents, les Morio, boulanger à Cariel.
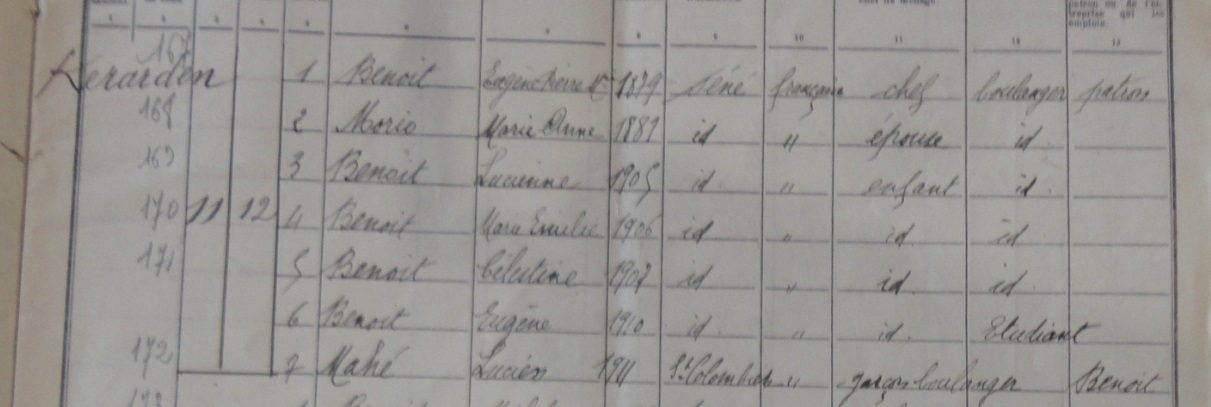
En 1926, elle est pointé par l'agent de l'administraiton à Kerarden comme boulangère. Elle à 20 ans. En 1928, elle passe son permis de conduire : elle est l'une des premières, à Séné, à l'obtenir. Cela lui permet alors d'acheminer ses pains, avec sa camionnette Citroën.
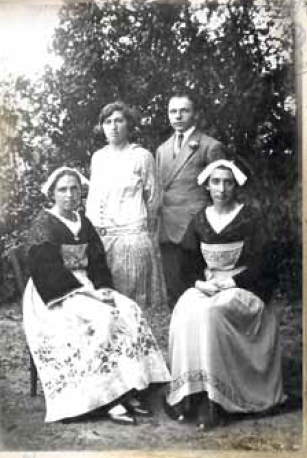
Marie Emilie BENOIT en 1926, assise à gauche
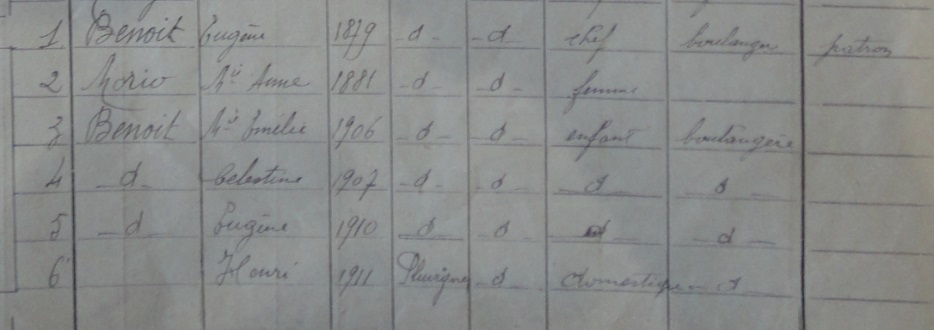
Au début des années trente, ses parents reprennent la boulangerie des Le Douarin à Cariel et la famille s'installe sur la presqu'île.
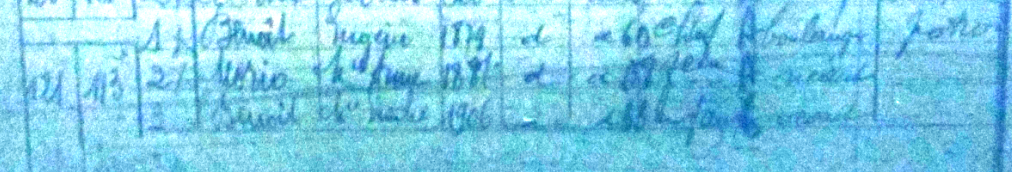
Au dénombrement de 1931, elle réside chez ces parents.Agée de 25 ans, elle est encore célibataire.
Porteuse de paquets au maquis
Pendant l'Occupation, sa tournée faisait quelques détours vers Colpo et Grand-Champ, avec certains paquets, parmi ses pains, au contenu mystérieux. Elle allait les porter au maquis de Botsegalo. En juillet 1944, 27 Résistants y furent fusillés. Parmi eux, Roger et Jean Le Gregam, 21 et 28 ans, domiciliés aussi à Séné et dont une place, à Montsarrac, porte le nom.
Son véhicule fut réquisitionné afin de servir de chauffeur aux offciers allemands basés à Séné. Comme d'autres Sinagots, elle cache des fugitifs réfractaires au Service du Travail Obligatoire.
Se dénonçant elle-même, Marie échappe de peu à l'arrestation. Après la guerre, elle poursuivit son activité de boulangère.
A la Libération, son père Eugène BENOIT, devient maire de Séné.
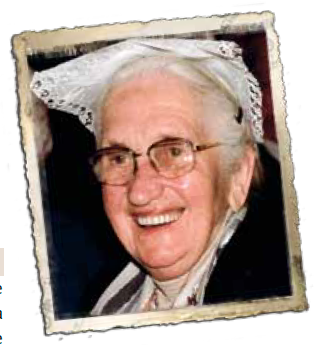
Au dénombrement de 1962, elle est encore active dans la boulangerie de Cariel désormais à la famille LE PENRU.
Ici la volià photographiée par Le Télgramme lors du repas des ancien en octobre 1996.
Marie BENOIT décède à Séné à l'age de 98 ans. Une rue porte son nom inaugurée le 12 octobre 2013.

Du Centre International de Séjour à l'UCPA
En 1993," l'ancêtre" de la communauté d'agglomération "Vannes Agglo", on disait à l'époque, le "SIVOM" acronyme pour "Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple" décidait la construction d'un "Centre International de Séjour" du Pays de Vannes. L'achèvement des travaux avait lieu en mai 1993 et la gestion confiée à une "association" ad hoc.
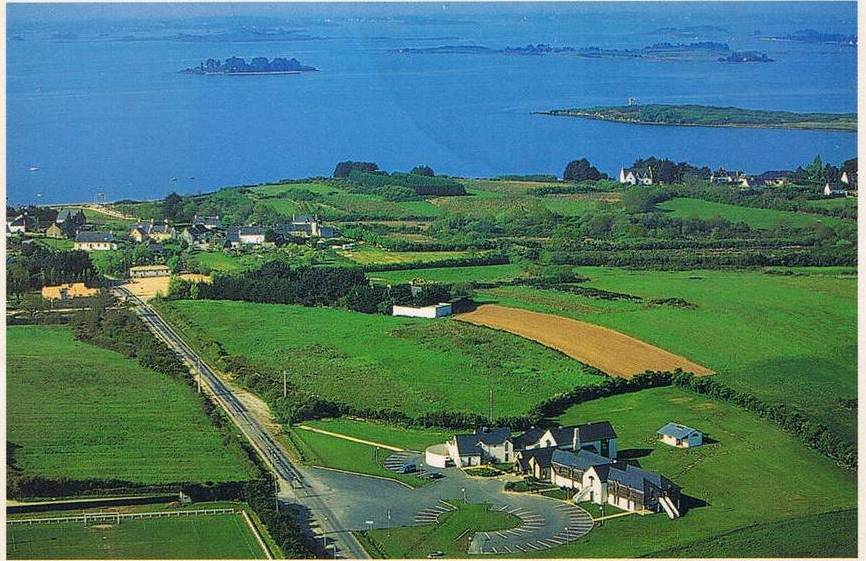
L'implantation avait été retenue à Séné entre le village de Moustérian et les hameaux de Gorneveze et Morboul, en face du plateau sportif Le Derf, à quelques centaines de mètres de la plage de Moustérian et proche du littoral et de la base nautique de la Pointe du Bill gérée par la Mouette Sinagote.
Par cette décision, la commune de Séné confortait son rôle de "poumon vert et maritime" de Vannes, forte déjà du Centre AVLEJ également à Moustérian. [lire article dédié].
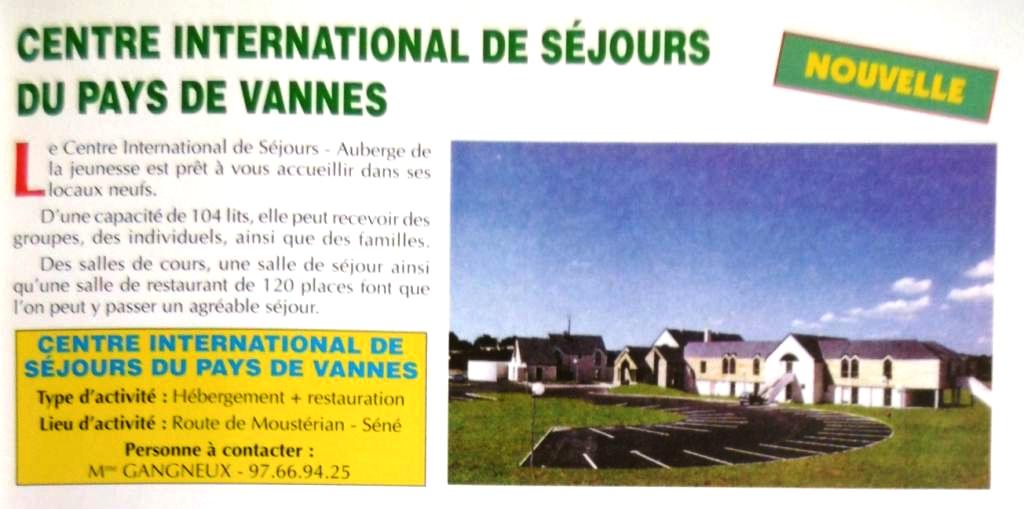
Sur un terrain de 16.640m², sortait 1.800 m² de bâtiment sur trois niveaux, à une époque où l'on ne pensait pas trop à l'accueil des personnes à mobilité réduite... La première directrice fut Mme Gangneux. L'Auberge de Jeunesse fut affublée d'un nom pompeux de "Centre International de Séjour".
Durant ces années, l'accueil de groupes scolaires pendant les vacances a sans doute constitué l'essentiel de la clientèle du "CIS de Mousterian"..[Trouver des sources]. Cependant, les auberges de jeunesse ont vite été un modèle en perte de vitesse auprès d'une clientèle d'enfants et de parents en manque de loisirs "un peu plus fun".
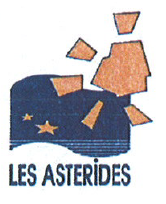
Le SIVOM transformé en Agglo de Vannes choisit un nouveau gestionnaire plus "professionnel". Le groupe Les Astérides de la Roche sur Yon dynamisa la structure.
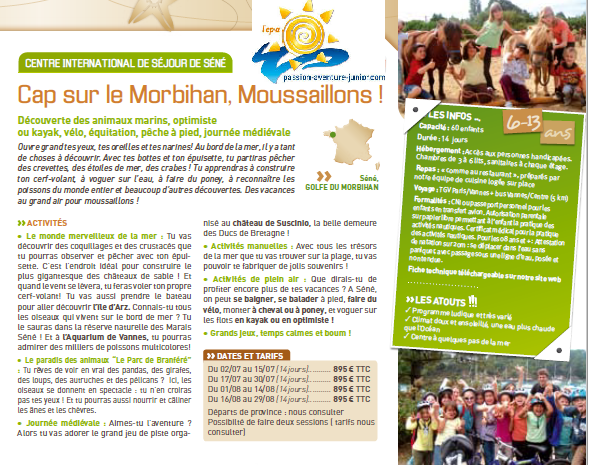
Les dernières années sous sa gestion, par exemple entre 2008 et jusqu'en 2013, l'organisateur de séjours pour adolescents LCPA mis à son catalogue de prestations, des séjours à Séné. Cela représentait en 2008-2009 plus de 20% des entrées. Le centre de séjour complétait son remplissage en accueillant pendant 7 saisons, des jeunes sportifs du CFEM, Centre de Formation et d'Entrainement Multisport du Pays de Vannes, autre structure publique subventionnée. Sa principale ressource était de servir de dortoir aux élèves du Lycée de Menimur avant que cet établissement scolaire privé n'aggrandisse le sien. Malgré ces efforts, le produits pour l'exercice 2008-2009 accusait une baisse de plus de 10%...
Les élus de Vannes Agglo décidèrent de se défaire du Centre International de Séjour qui ne correspondait plus aux besoins de leurs administrés en Pays de Vannes...
La ville de Séné racheta le centre en 2011 pour la somme de 834 k€ et renouvella le mandat de gestionnaire au groupe Astérides. Sans véritable projet pour ces batiments, la municipalité, endettée, dû se résoudre à se défaire elle aussi de la gestion du centre.

Il fut cédé en 2018 pour 1.035 K€ (terrain compris), à un professionnel expérimenté de l'acceuil avec hébergement, l'UCPA. Le centre UCPA de Séné-Moustérian s'est spécialisé dans l'accueil des 6-11 ans en multisports, incluant un apprentissage du cirque en partenariat avec le cirque Micheletty et bénéfice de plus de 90 places d'hébergement.
https://www.ucpa.com/sejours/hebergement-hebergement-sene
Tour de Tenero, par Jacques de CERTAINES
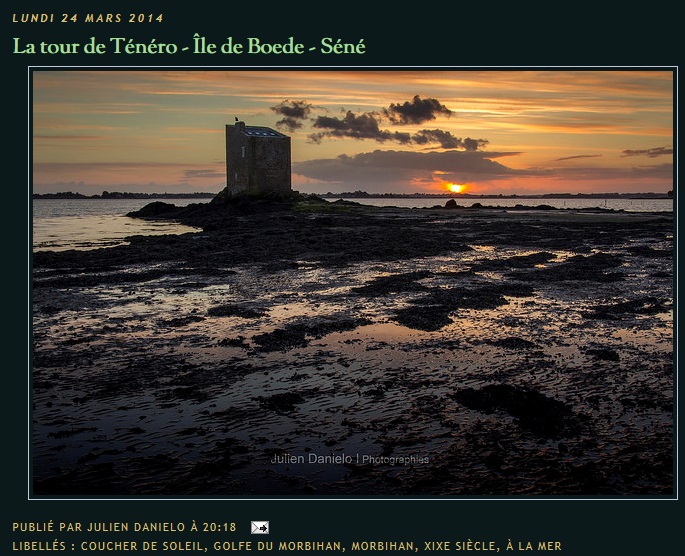
Histoire de La Tour TENERO
https://sites.google.com/site/tourtenero/histoire-de-tenero
Texte rédigé par J. de Certaines le 10-09-2011, v2
L’origine de la tour de Ténéro (47° 36’ 08,44 Nord, 02° 45’ 20,89 Ouest, canton de Vannes-Est, commune de Séné, au SE de l’ile de Boëd) n’est pas élucidée.
Les documents retrouvés sont à ce jour insuffisants pour étayer des certitudes. Le service historique du Musée des Douanes de Bordeaux s’est révélé incapable de retrouver les informations souhaitées sur les réseaux douaniers du Morbihan aux XVIIIe et XIXe siècles. On ne peut donc qu’émettre des hypothèses seulement étayées par leur vraisemblance.
Deux hypothèses sont discutées : soit elle n’a été qu’un poste de gardiennage des parcs à huîtres et daterait alors de la fin du XIXe siècle, soit elle a pour origine un poste de douane, reconverti plus tard en poste de surveillance des parcs à huîtres, et serait alors plus ancienne d’au moins un siècle.
Une carte de 1771-185 indique toutefois que le rocher sur lequel est construite la tour, s'appelle déjà Tenero".
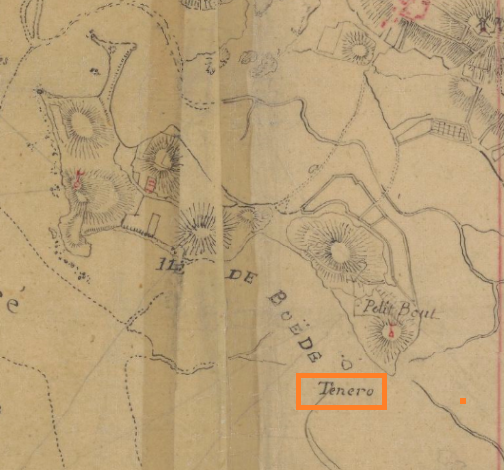
Histoire connue depuis 1884.
La première implantation connue de source sûre est un poste de surveillance des parcs à huîtres édifié entre 1884 et 1891 par Jean-Louis Gregam, ostréiculteur. On peut s’interroger sur la localisation de cette tour, au ras de l’eau, alors que juste derrière elle, une butte culmine à 15m offrant un point de vue amélioré. L’édifice a été détruit en 1891 puis reconstruit en 1899 par Mathurin Sévin, retraité de la gendarmerie, buraliste et ostréiculteur.
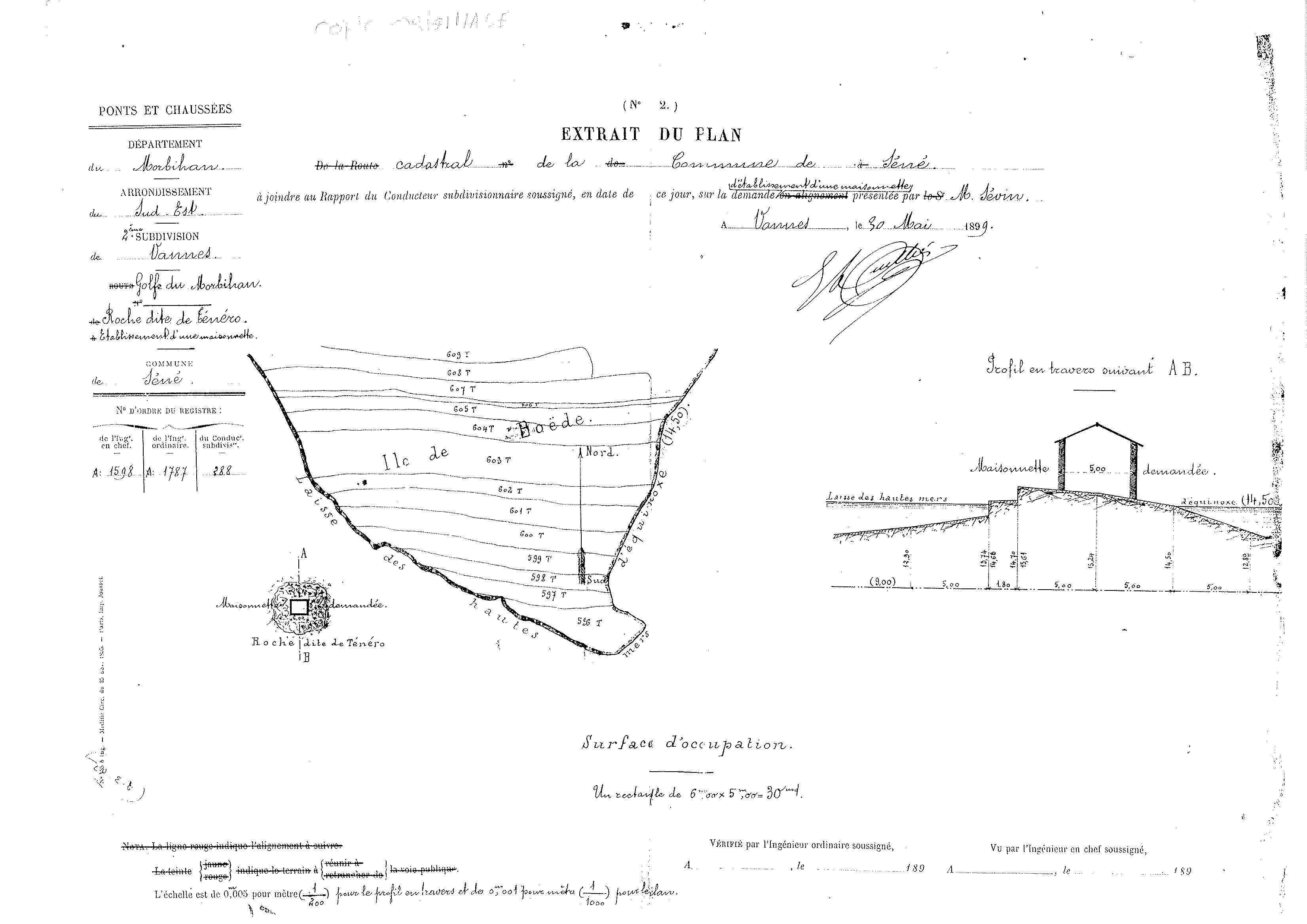
Au dénombrement de 1906 et de 1911 le chef de famille Gouello déclare l'activité de garde de parc à huitres. Sur les autres dénombrements antérieurs et postérieurs aucune famille ne déclare cette activité sur Boed.
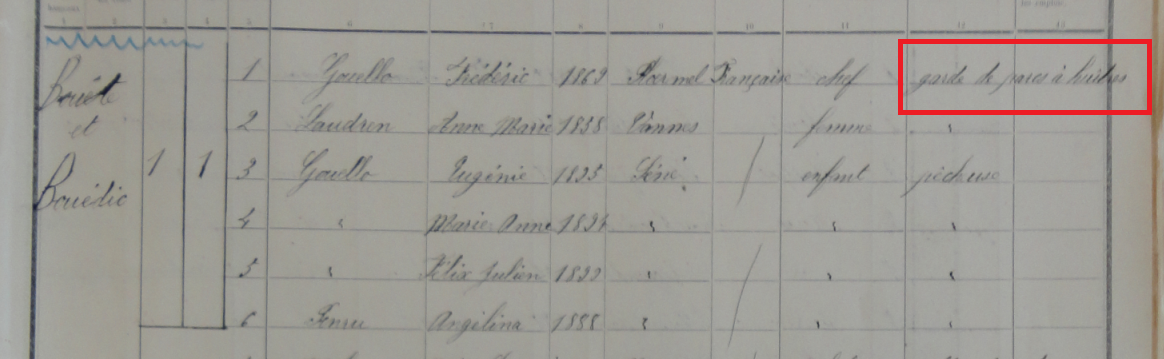
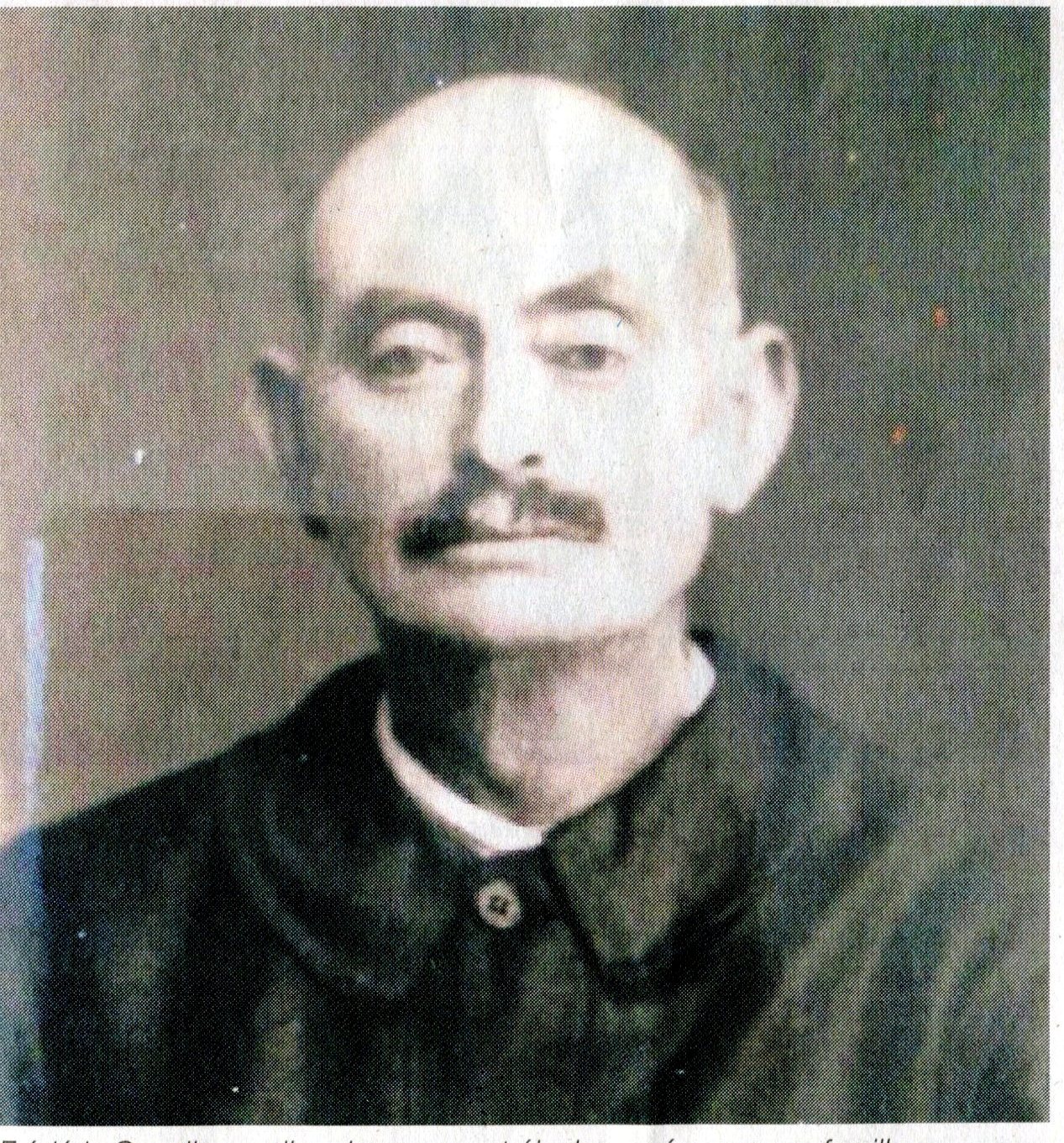
Sa concession d’ostréiculture (n° 516) est reprise en 1935-36 par Joseph Sévin (d’où le nom parfois donné de « cabane à Sévin ») puis de 1944 à 1985 par Madame Pellen (de la famille Sévin). Ensuite abandonnée, la tour devenue possession de l’État est confiée le 7 mars 2007 à l’Association Ténéro pour la réhabiliter et la mettre en valeur. C’est en fonction de ces données que la fiche du patrimoine de Bretagne (GLAD, le portail des patrimoines de Bretagne) la date de 1899 tout en la mentionnant « douane », ce qui parait contradictoire puisqu’en 1899 les douanes n’avaient aucune raison de se maintenir sur un tel site.
Une tour douanière sous Napoléon vers 1808 ?
La gabelle (impôt sur le sel) était sous l’Ancien Régime, depuis le monopole royal sur le sel établi par Philippe VI en 1343, l’impôt le plus impopulaire et le plus inégalitaire d’une région à l’autre : le prix du minot (52 litres) de sel était par exemple vingt fois plus élevé en Anjou (pays de « grande gabelle ») qu’en Bretagne (pays de « franc salé »). Il en résultait une intense contrebande qui servit notamment à fournir (avec aussi la révocation de l’Édit de Nantes) les galères en « faux-sauniers » condamnés sous Louis XIV. Des esprits éclairés remettait déjà en cause la gabelle bien avant que la Révolution ne l’abolisse ; en 1707, Vauban écrivait : « Le sel est une manne dont Dieu a gratifié le genre humain, sur laquelle par conséquent il semblerait qu’on n’aurait pas dû mettre de l’impôt. »Qui dit « contrebande » dit « douaniers » : à la fin de l’Ancien Régime, il y avait en France 15000 « gabelous », soit trois fois plus que de gendarmes.
Ces douaniers étaient répartis en brigades, en particulier dans les zones littorales, avec leurs casernes et leurs postes de surveillance. On les appelait aussi les « catula » en fonction de la question qu’ils posaient aux gens qu’ils interpellaient : « Qu’as-tu là ? ».La Révolution a supprimé la gabelle en 1791 mais, à court d’argent, Napoléon devait la rétablir en 1806 tout en l’uniformisant.Les années 1808-1809 furent des années d’implantations intensives de casernes de douaniers et abris de surveillance dans le Morbihan, en particuliers dans les zones où étaient implantés des marais-salants.
Un dénombrement sur le cadastre de 1833 donnait 212 hectares de marais-salants sur Séné soit plus de 10% du territoire de la commune.En 1848, la loi abolissant la taxe sur le sel et autorisant son importation annonçait le début du déclin des salines du Morbihan, progressivement remplacées par l’activité ostréicole naissante.S’il y a eu une période active pour les gabelous du Morbihan, elle se situe donc entre le rétablissement de la gabelle par Napoléon en 1806 et son abolition en 1848 ; c’est donc dans cette moitié du XIXe siècle qu’il faut rechercher la possible construction (ou reconstruction) de la tour de Ténéro. On peut d’ailleurs se demander pourquoi cette tour aurait été construite au niveau de la mer alors que la butte au sud de Boëde culmine à 15 mètres et aurait donc été un excellent lieu pour y installer un poste d’observation.À cette époque, la douane était organisée en brigades pouvant comporter une centaine d’hommes mais subdivisées en équipes de cinq à dix hommes. Pour la surveillance rapprochée des marais-salants, des équipes de deux douaniers, l’un de garde, l’autre se reposant, disposaient de cabanes en torchis, les « abri-vents ».
Suite à la décision de Napoléon en 1806, un grand programme de construction de casernements et postes de douanes plus conséquents eut lieu dans le Morbihan en 1808-1809. Un centre de recette fut établi aux Quatre-Vents à Séné. En 1841, Séné comportait 31 douaniers, il y en avait 57 à l’île aux Moines, une dizaine à l’île d’Arz… P. Huon note un afflux de douaniers dans la zone de Séné dés 1806.Parmi les postes de douanes de la région, on relève Kerliscond, Cariel, Langle, Monsarac, Varsach, Bararach, Cadouarn, Falguerec, Brouette et Boëd.Il n’est pas impossible que le poste mentionné à Boëd soit la tour de Ténéro. En effet, si l’on regarde la carte marine résultant des levées de 1819 et 1820, la roche de Ténéro est partie intégrante de l’île de Boëd, ce qui n’est pas choquant si l’on tient compte du lent enfoncement du golfe du Morbihan.Or ce poste de Boëd représentait une situation exceptionnelle pour contrôler, de l’est à l’ouest par le sud, les salines de Séné et Saint-Armel, celles de Rudevent sur l’île d’Arz ainsi que le trafic maritime vers et depuis la rivière de Noyalo.En effet, la contrebande se faisait soit par terre (chevaux et piétons) soit par mer, ce qui justifie un poste sur la roche de Ténéro. Les îles étaient considérées comme des entrepôts de contrebande et, en face, Arz, l’île des capitaines, possédait une flotte de caboteurs dont les armateurs îliens étaient aussi parfois propriétaires de salines. Les armateurs devaient en effet faire aussi bien des déclarations d’entrée par mer que de sortie, ce qui ne devait pas toujours être fait très rigoureusement. Un poste d’observation important face à Arz paraissait donc particulièrement justifié.De plus, le sel n’était pas seul en cause.
La Bretagne tenait une place particulière dans la contrebande du tabac qui n’était autorisé au débarquement que dans quelques grands ports comme Nantes, Saint-Malo, Morlaix ou Lorient. Le « faux-tabac » pouvait très bien pénétrer aussi depuis l’Espagne ou l’Angleterre par les navires d’Arz qui chargeaient en retour du « faux sel ». Localement, les contrebandiers utilisaient des « yoles » à fond plat (ancêtres des « plates » du golfe) mais aussi des navires plus gros, de 10 à 15 mètres, gréés en chasse-marées.La contrebande était importante et suscitait une répression parfois cruelle ; Napoléon a fait établir en 1810 un marquage au fer rouge « VD » (voleur des douanes) pour les contrevenants.Dans l’été 1814, il y eut une pénurie de sel dans la région de Vannes qui entraina une intensification de la contrebande et du pillage des salines. Le 26 août 1814 près de Boëd, une armée de quatre-vingt fraudeurs s’oppose à une cinquantaine de douaniers armés renforcés par des grenadiers des 130e et 75e régiments de ligne et la douane à cheval de Meucon. Malgré l’ampleur exceptionnelle de cette « escarmouche », il n’y eut que des blessés dans les deux camps. Est-ce cet incident qui incita à construire la tour de Ténéro à la place d’un simple abri-vents ? Un poste douanier à Boëd est mentionné en juin 1816 avec quatre gabelous qui mirent en déroute des voleurs de sel. La taille de la tour de Ténéro correspond assez bien à l’hébergement d’une sous-brigade de quatre ou cinq douaniers.
De la protection des salines à celle des parcs ostréicoles à la fin du XIXe siècle.
La consommation d’huîtres était importante chez les grecs et les romains. Elle le sera aussi sous l’ancien régime, mais seulement dans la classe la plus riche : Vatel se serait suicidé parce que ses bourriches n’étaient pas arrivées à temps ! Mais cette consommation provenait du dragage d’huîtres plates (Ostrea edulis) sauvages et non de l’aquaculture. La drague abîmait les fonds et détruisait les gisements, renforçant vers 1850 la nécessité de passer de la cueillette à la culture, ce qui se fera en Bretagne quelques années après les débuts dans le bassin d’Arcachon. Dès le milieu du XIXe siècle, l’huître creuse (Crassastrea angulata), dite « portugaise », était cultivée dans l’estuaire du Tage. En 1868, « Le Morlaisien » jeta à la mer sa cargaison d’huîtres portugaises et le bassin de Marennes-Oléron fut ainsi colonisé. L’huître creuse, beaucoup moins chère à produire que la plate, contribua ainsi à la démocratisation de la consommation d’huîtres qui explosa dans le dernier quart du XIXème siècle.
Les débuts de l’ostréiculture sont très liés aux « conflits d’usage » du littoral : c’est en 1539 qu’un édit de François Ier intègre le rivage au domaine royal, étendu à la zone d’estran par les ordonnances de Colbert et un décret de 1852 mais les conflits existent aussi entre les paysans-riverains et les inscrits maritimes défendus par la Marine : l’ostréiculture est-elle une activité de paysans (de la mer) ou une activité de marins ? Déjà du temps de la drague, une réglementation, notamment sous Louis XV, en avait fixé des limites. Dès lors qu’il y a réglementation, il y a fraude et les sinagos, formés par la contrebande du sel, y excellaient. En 1848, la goélette « La Gazelle » est envoyée sur les côtes du Morbihan pour pourchasser les fraudeurs ne respectant pas les règles de dragage, et notamment les sinagos. En 1874, le préfet maritime de Lorient écrivait : « Quant aux pêcheurs de Séné, ils sont peu intéressants par eux-mêmes. Ma lettre d’hier vous informe de l’intention qu’ils ont manifesté de piller les huîtres semées dans le Morbihan… C’est une population active mais turbulente et à laquelle il est difficile de faire accepter de régler même lorsqu’elles sont faites en vue de leur intérêt… ».
Les débuts de l’ostréiculture (même si le mot culture est inapproprié pour désigner un élevage) sont très liés aux travaux du biologiste Victor Coste, proche de Napoléon III. En 1855, le commissaire de la Marine affirme que la reproduction artificielle des huîtres est maîtrisée.
Une première concession morbihannaise est attribuée en 1858 dans la rivière de Pénerf. On considère que c’est en 1863 que l’ostréiculture a pénétré dans le golfe du Morbihan dans la rivière d’Auray avec une concession accordée à M. Lizard, puis à Saint-Armel avec la concession de M. Pozzy en 1874, Larmor-Baden, Arradon, Séné, Arz avec la famille Jardin vers 1875… C’est aussi vers cette époque que Napoléon III a organisé l’exploitation du domaine public maritime. Aujourd’hui après les épizooties du milieu des années 1960 et du début des années 1970, c’est l’huitre creuse japonaise (Crassostrea gigas) qui est cultivée. La crise en cours de mortalité des naissains (particulièrement chez les triploïdes) va sans doute contraindre à rechercher une nouvelle espèce.Dès le début de l’ostréiculture, la protection des parcs contre le pillage s’est imposée comme s'était imposée la surveillance du dragage. Dans les périodes où la production est inférieure à la demande, les vols augmentent. C’est le cas aujourd’hui : en 2010, quatre vingt gendarmes ont été mobilisés dans le Morbihan pour la protection des parcs, assistés de bateaux et d’hélicoptères et complétés par des sociétés privées de surveillance et des gardes assermentés. Il est donc probable que la fin du XIXe siècle, avec l’explosion de la demande, a été aussi une époque de pillage dans les parcs nouvellement implantésLa surveillance des parcs ostréicoles a donc logiquement pris la suite de la surveillance des salines dans la mesure où les voleurs d’huîtres ont logiquement succédé aux voleurs de sel.Il y a du cependant avoir un « trou » entre les deux dans la mesure où les marais salants ont disparu progressivement vingt ou trente ans avant le développement de l’ostréiculture en Morbihan.Sur une roche basse exposée aux attaques de la mer, cette vingtaine d’années a du suffire pour dégrader la tour de Ténéro. Les restes de celle-ci ont pu alors servir de fondement à l’implantation de la première cabane de surveillance ostréicole sur ce site par Jean-Louis Grégam entre 1884 et 1891. Cette cabane aurait été ultérieurement reconstruite sur les mêmes fondements reprenant le plan de l’ancienne tour douanière, une tour carrée de 5 mètres sur 5 caractéristique des tours douanières du début du XIXe siècle que l’on retrouve par exemple aussi sur la bute de la pointe de Bararach au nord de Port-Anna, point de surveillance de la rivière de Conleau.
Conclusion provisoire.
Compte-tenu de l’importance des constructions douanières dans le Morbihan vers 1808-1810, il serait étonnant que ce site stratégique de l’île de Boëd n’ait pas été utilisé. Il est d’ailleurs possible que la tour construite avec sa configuration carrée caractéristique des constructions douanières du Morbihan (contrairement par exemple aux tours génoises rondes du littoral méditerranéen) ait elle-même succédé à une implantation douanière plus ancienne ; rappelons que le sentier des douaniers a été implanté sur le littoral en 1791. Cette construction probable des années 1808-1810 faisait peut-être elle-même suite à une construction douanière datant de l’ancien régime.
En 1848, lors de l’abandon de la taxation du sel, cette tour a dû être logiquement abandonnée par la douane. Il s’en est probablement suivi une période de vingt ou trente ans pendant laquelle, non entretenue, elle a pu être partiellement détruite par les intempéries.Lorsque la consommation d’huîtres explose en se démocratisant vers 1860, le pillage des concessions a dû faire renaître une situation analogue à ce qu’avaient été, un demi-siècle plus tôt, le pillage des marais salants et la contrebande. Mais les moyens de l’État mis au service des douanes étaient plus importants que les moyens des ostréiculteurs pour préserver leurs parcs. Il est donc logique qu’un Jean-Louis Grégam ou un Mathurin Sévin n’aient pas reconstruit la tour dans ses dimensions antérieures.Les archives nous disent qu’en 1891, Jean-Louis Grégam démolit sa cabane. Rappelons que les difficultés économiques ont fait baisser la consommation d’huîtres à cette époque (et ce jusqu’à la fin de la guerre de 1914-18) ce qui devait logiquement réduire l’incitation au pillage. Peut-être même Grégam a cessé sa production jusqu’à ce que sa concession soit reprise en 1899 par un retraité, Mathurin Sévin.Lorsque la concession ostréicole est reprise en 1935-36 par Joseph Sévin, la consommation d’huîtres est repartie, ce qui justifierait une reconstruction de la tour de surveillance jusqu’à ses dimensions douanières antérieures (plus de 6 mètres de haut).
En conclusion :1°) Il n’est pas impossible que le site de Ténéro ait été utilisé comme poste de douane dès l’ancien régime, sa position en faisant un site exceptionnel d’observation des mouvements dans la partie nord-est du Golfe du Morbihan.2°) Il est plus que probable qu’une construction douanière y ait été faite après la restauration de la gabelle par Napoléon en 1806. La structure carrée de la tour correspond en effet à l’architecture des tours douanières.3°) À l’abolition de la taxation du sel en 1848, cette tour a dû être laissée à l’abandon pendant quelques dizaines d’années, ce qui a pu provoquer sa destruction partielle par les intempéries.
4°) Lorsque la surveillance des parcs à huîtres est devenue nécessaire avec la démocratisation de la consommation et donc la pression sur la production, les premiers ostréiculteurs ont pu récupérer les ruines pour y établir une cabane de surveillance.5°) Lors de la baisse de la demande de la consommation pour des raisons économiques vers 1890, cette cabane a pu être provisoirement démolie ou abandonnée.6°) Lors de la reprise de la demande après la guerre de 1914-18, la surveillance des parcs s’imposant de nouveau de façon plus importante, un édifice plus conséquent a pu être reconstruit sur la base et selon les plans de la tour ancienne.
Éléments de bibliographie.
Jean Bulot, L’ile des capitaines – Chronique maritime et sociale d’une île du Ponant du XVII au XXème siècle, Editions AMB –Liv’Editions, 2001.Jacques de Certaines et Jean Bulot, Dossier pour la réhabilitation des salines de Rudevent, Dossier privé déposé à la mairie de l’île d’Arz et au Conseil Général du Morbihan, 2008.Pierre Dalido, Séné salines, Cahiers d’Histoire maritime du Morbihan, n° 24, juillet 1993, pp 84-144 et n° 25, Novembre 1993, pp 87-130.Michel Donatien, Les marais salants de Séné de 1720 à 1900, Gazette de l’île aux Moines, n° 133, 1984.Yvon Dufrêne, Gabelous et culs salés : la fraude du sel au XIXème siècle dans le Morbihan, Ass. des Amis de la réserve de Séné, 2001.Jacques et Ronan Guillet, De 1850 à nos jours, l'ostréiculture en Bretagne, Coop Breizh 2008.Paul Hervé, Sus aux salines, chronique judiciaire du Morbihan de jadis, Bull. Soc. Polymathique du Morbihan, 110, 1983, pp 21-22.Jean-Claude Hocquet et Jean-Luc Sarrazin, Le sel de la baie – Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantique, Presses Universitaires de Rennes, 2006.Paul Huon, Sinagots et douaniers, Cahiers d’Histoire maritime du Morbihan, n° 25, Novembre 1993, page 131.Françoise de Person, Bateliers contrebandiers du sel, Ed. Ouest-France, Rennes 1999.Camille Rolando, Séné d’hier et d’aujourd’hui, Mairie de Séné, 1996.
Elisabeth Rogani, L’Administration des douanes d’Ancien Régime : fonctions et résistances à ces fonctions sur le littoral breton au XVIIème siècle, in G.Le Bouëdic et C.Cerino (Eds), Pouvoirs et littoraux du XV au XX ème siècle », Presses Universitaires de Rennes, 2000.
Université du troisième âge et pour tous, Il y a cent ans sonnait le glas des marais salants morbihannais, Vannes, n° 5, 1981.
Merci à ceux qui voudront bien amener des corrections ou des compléments à cette note