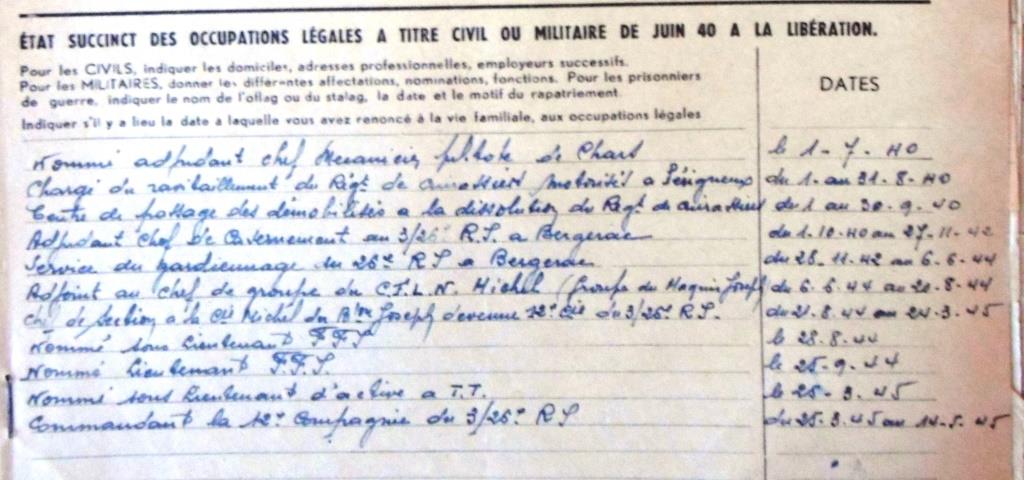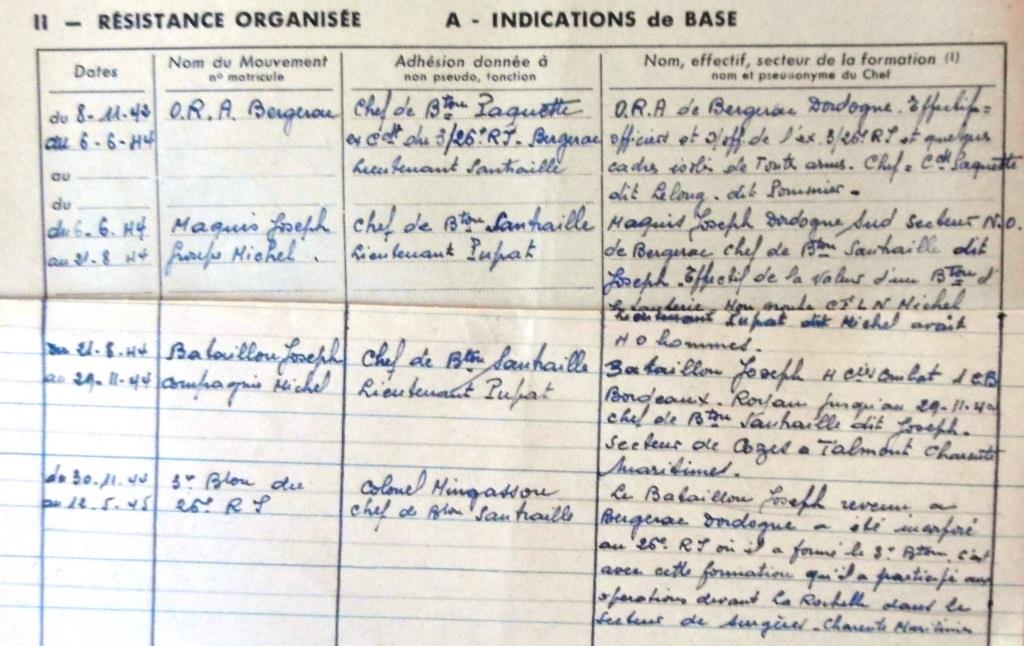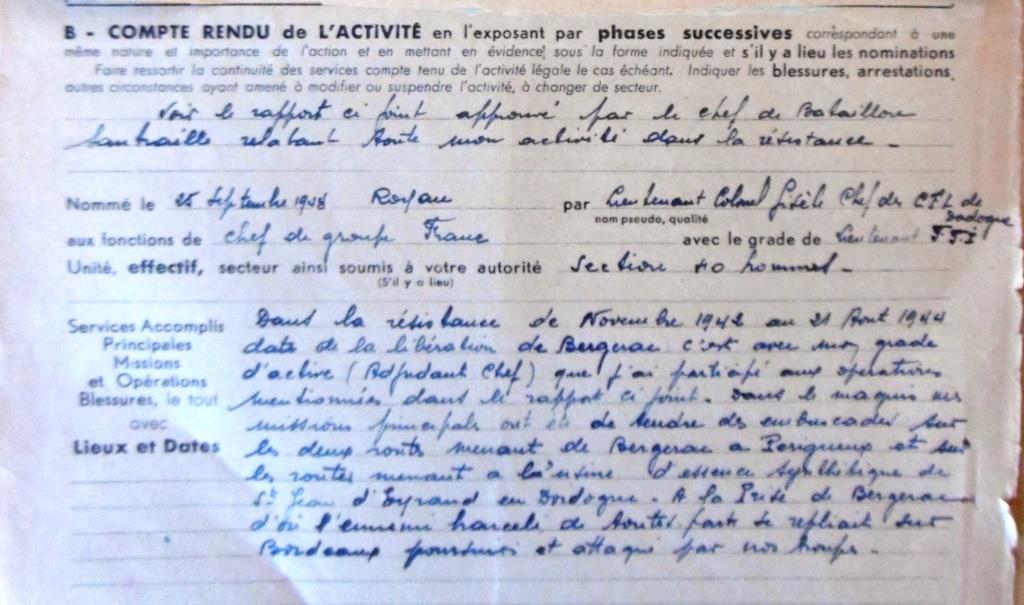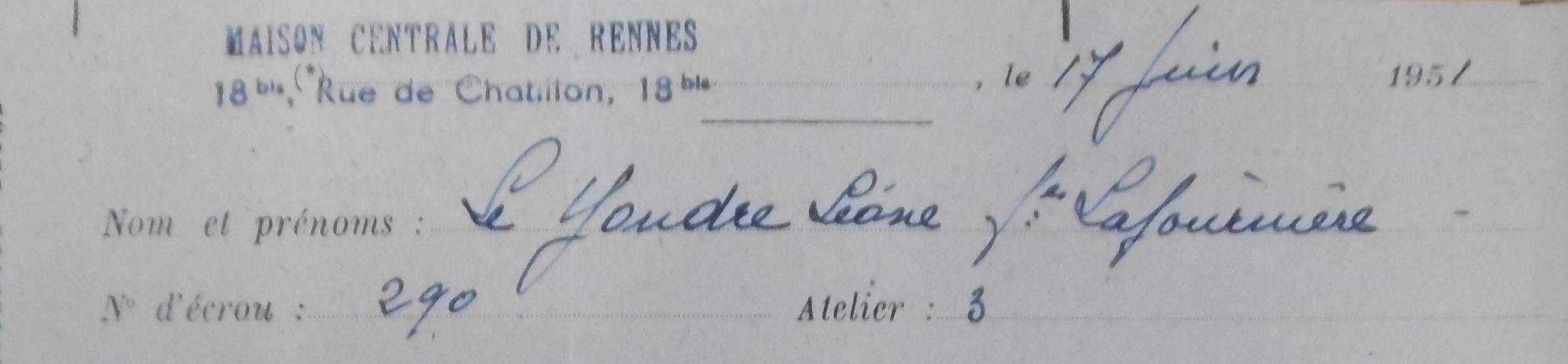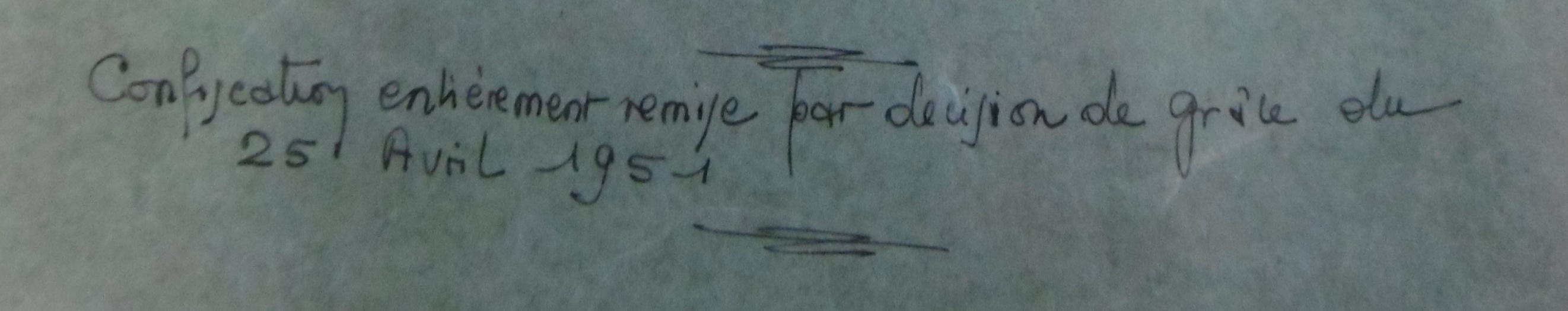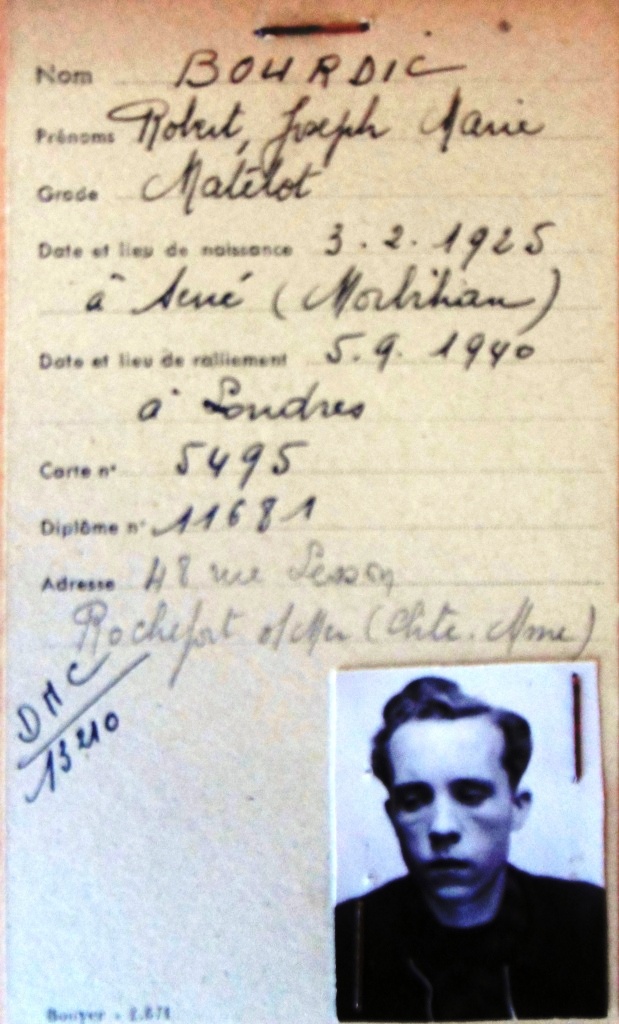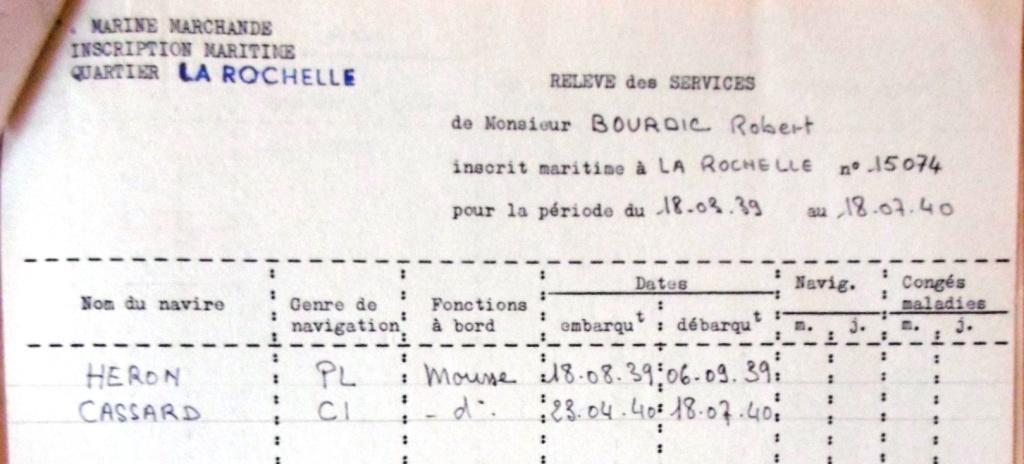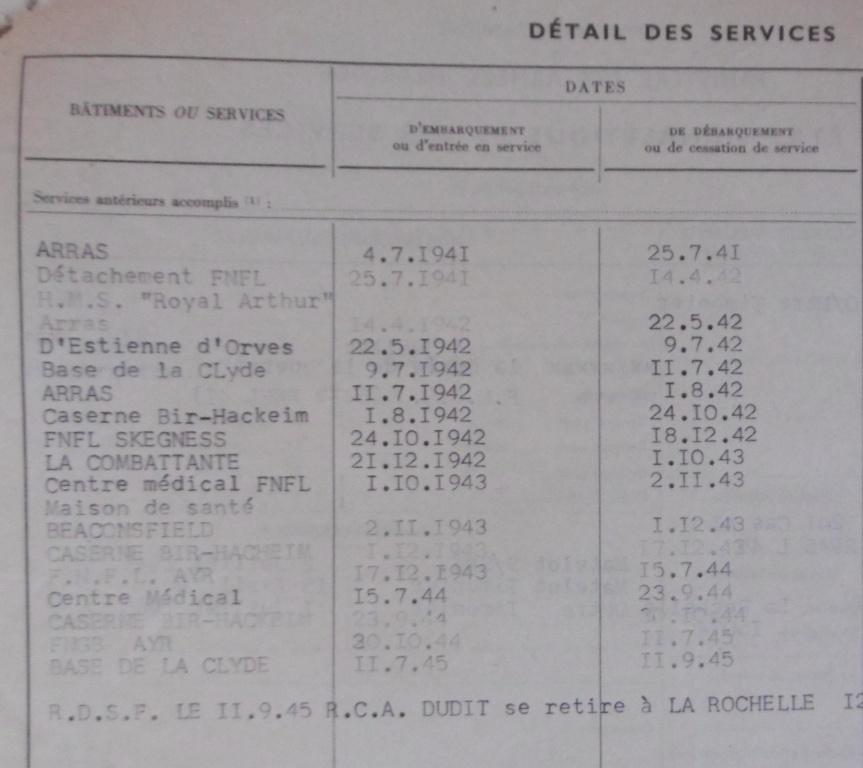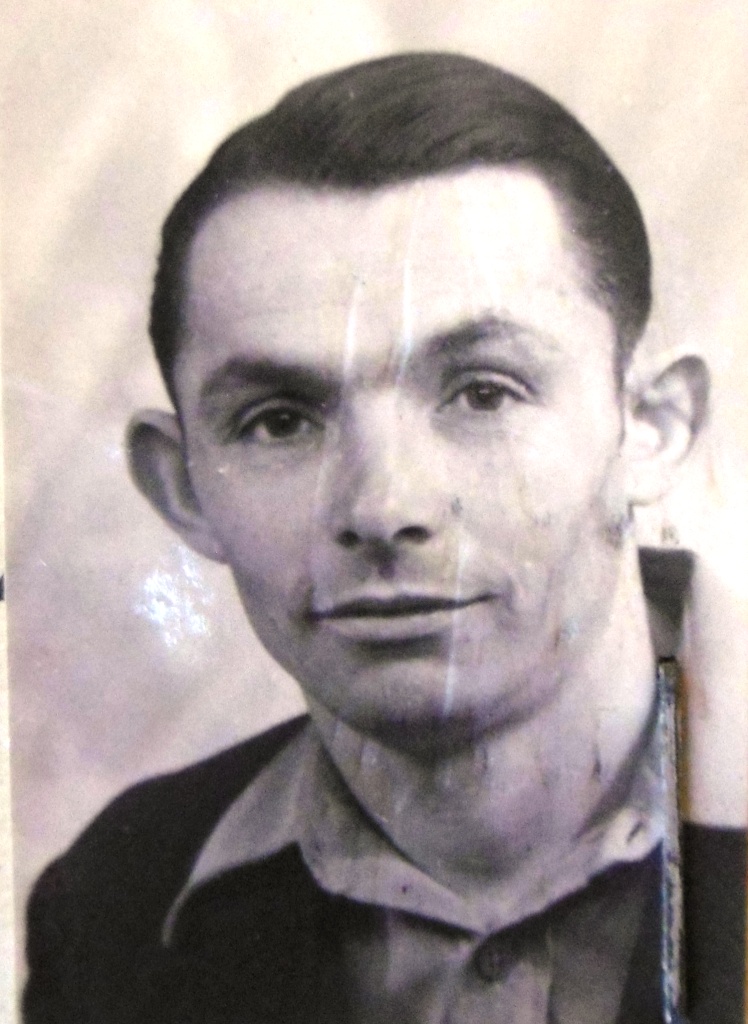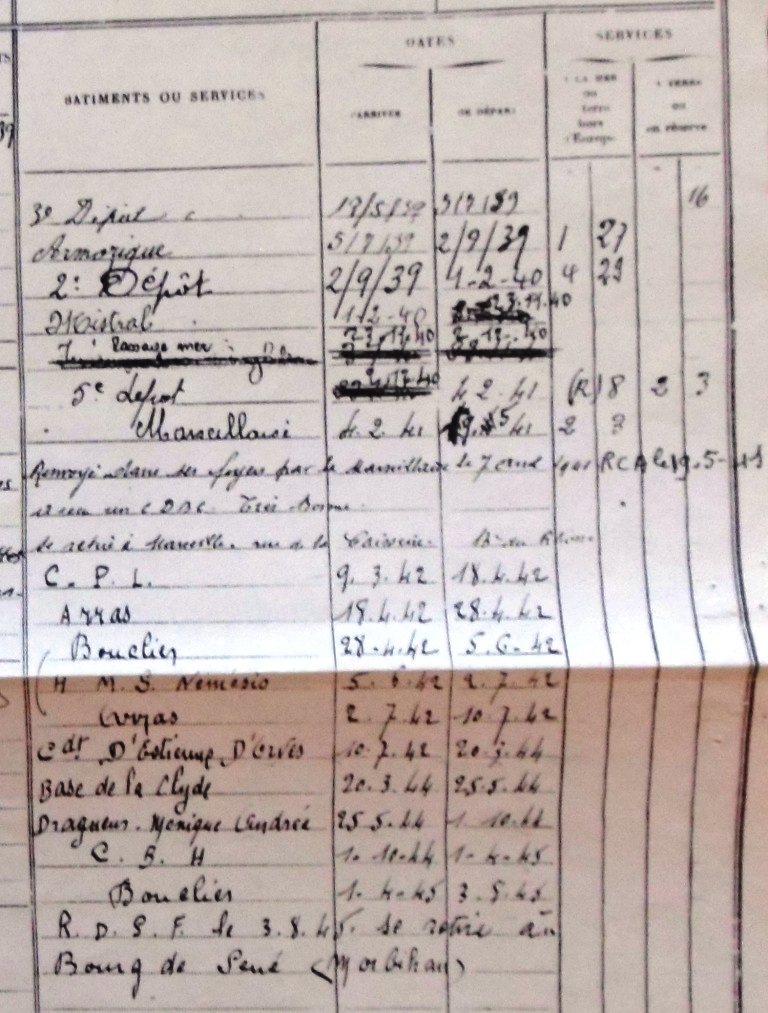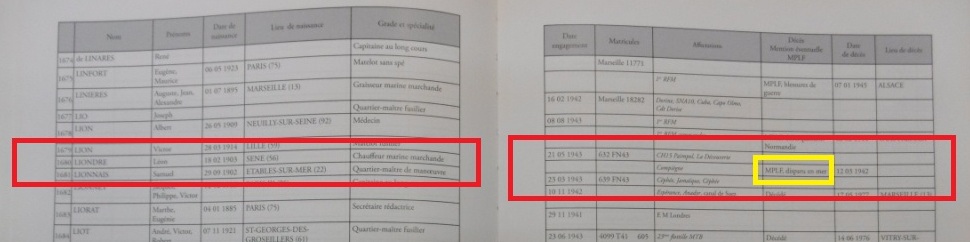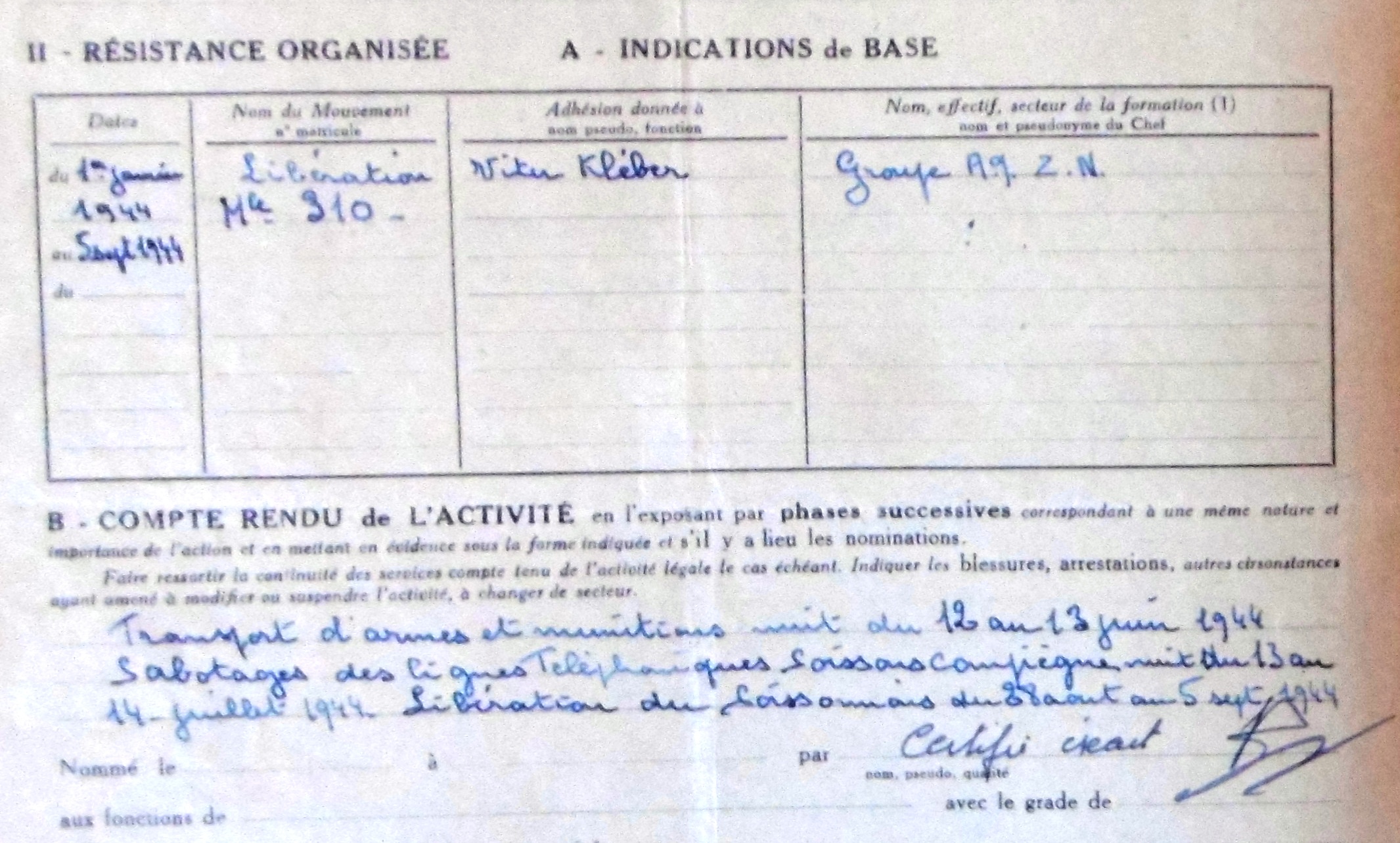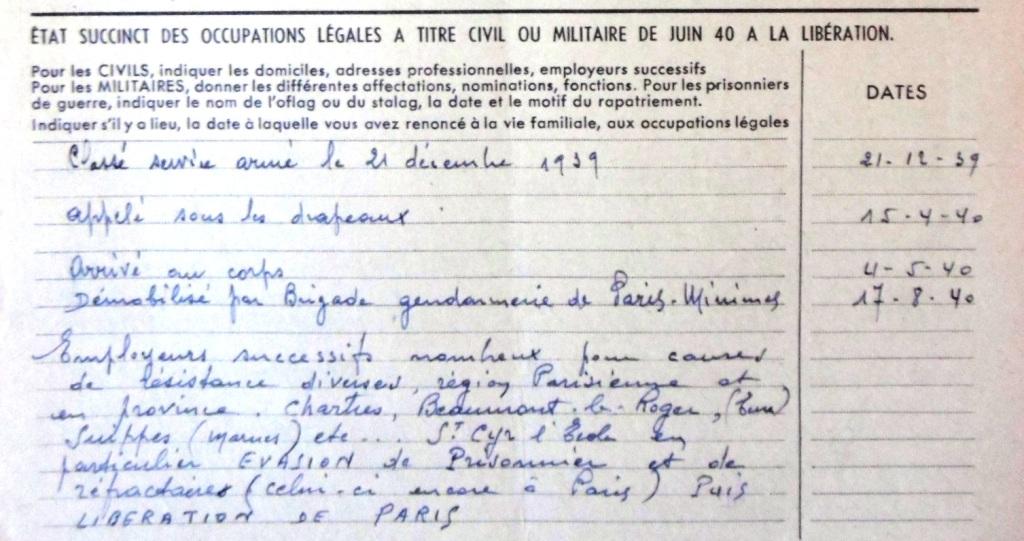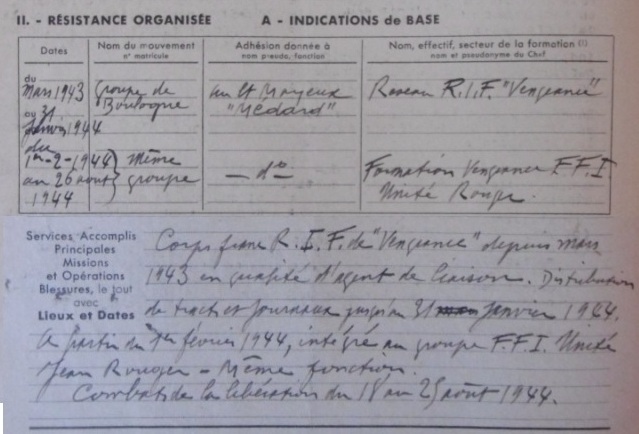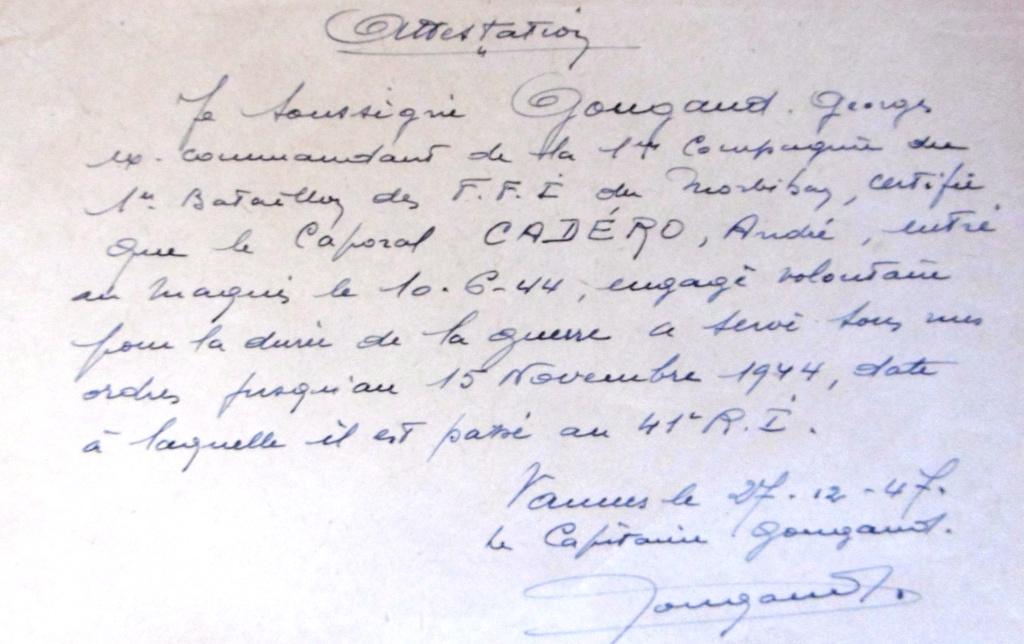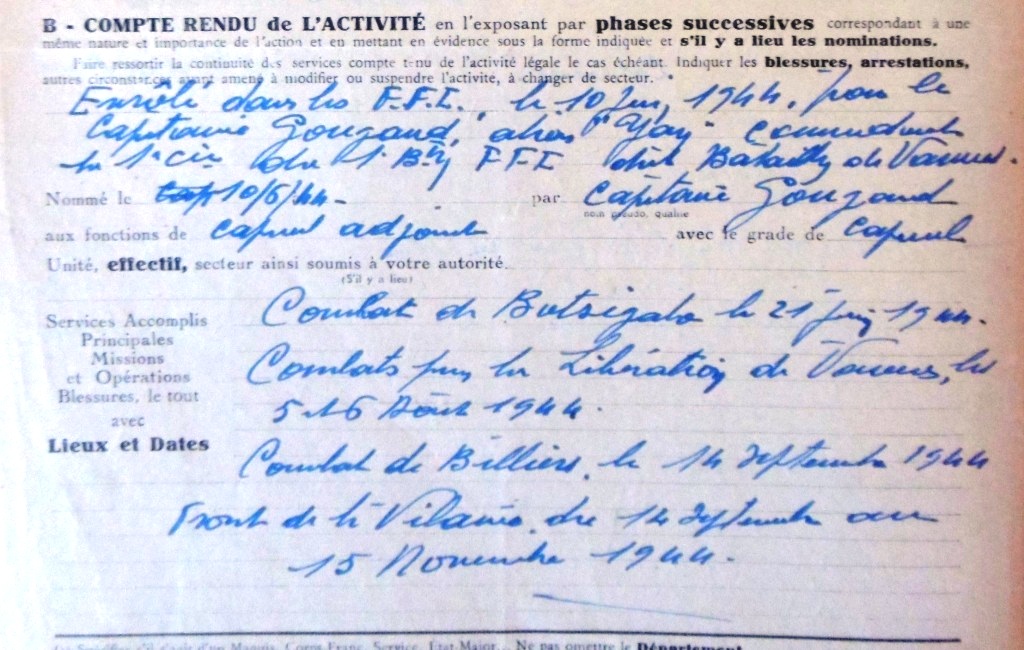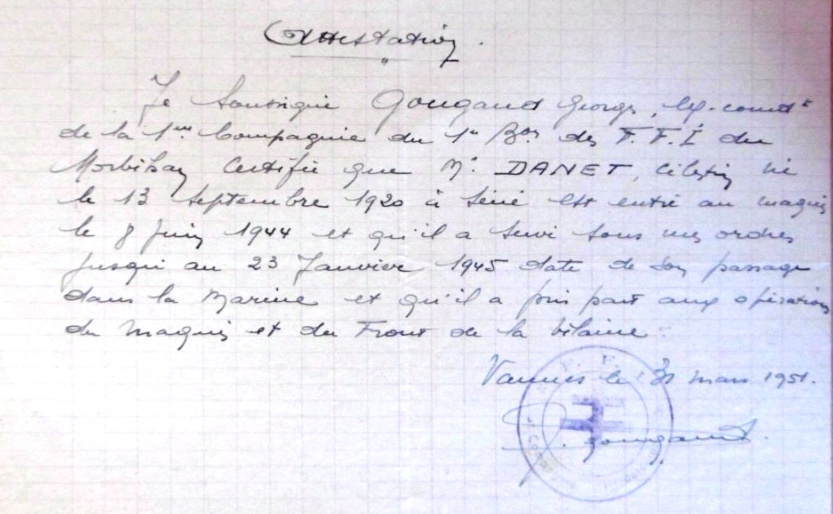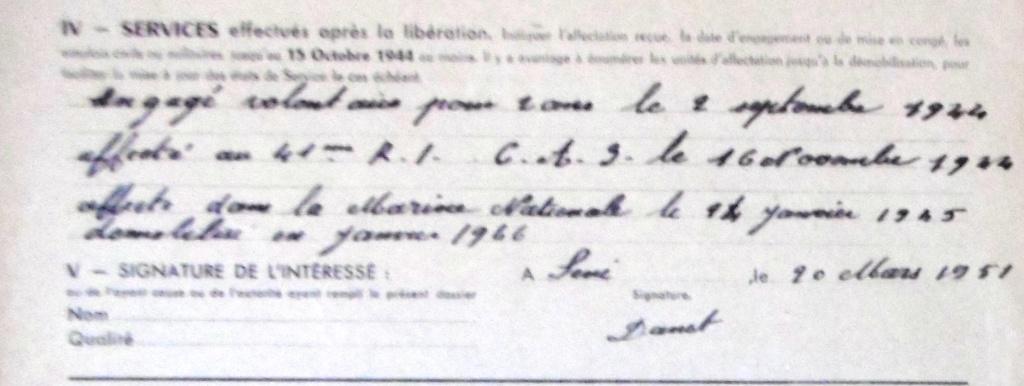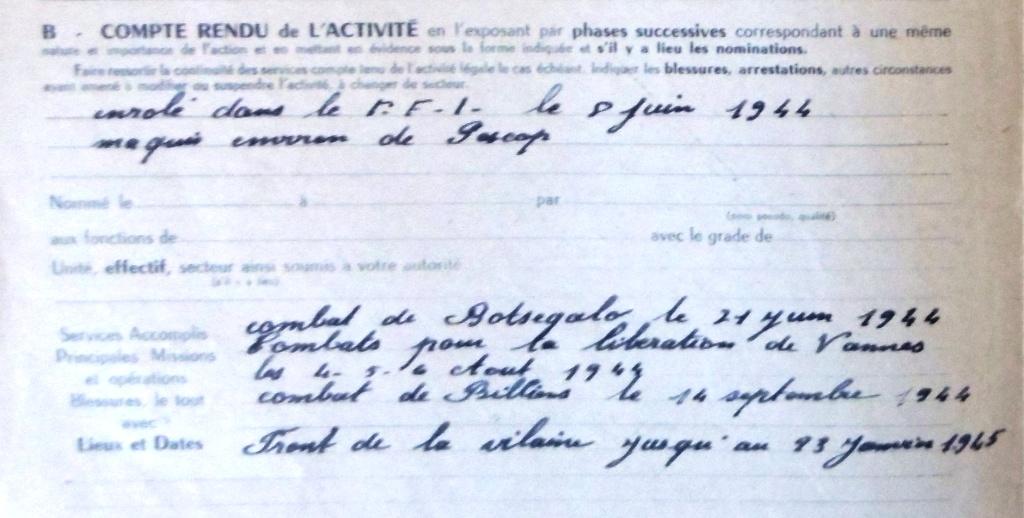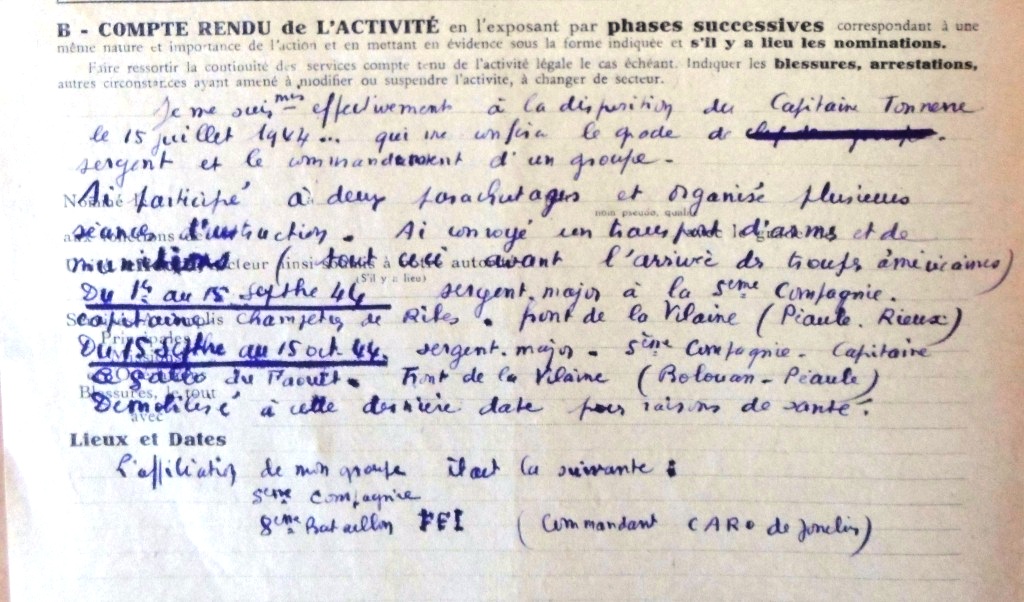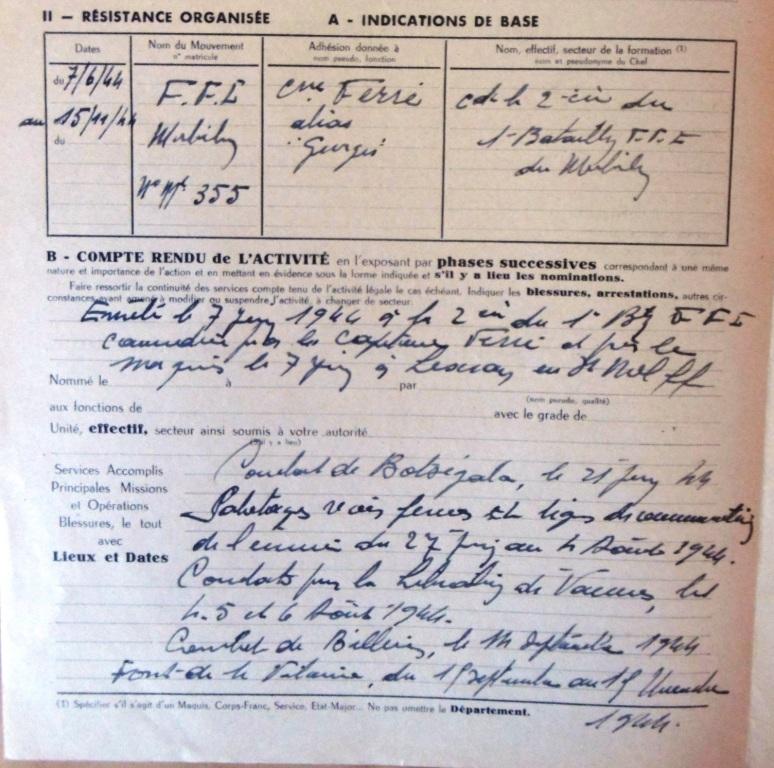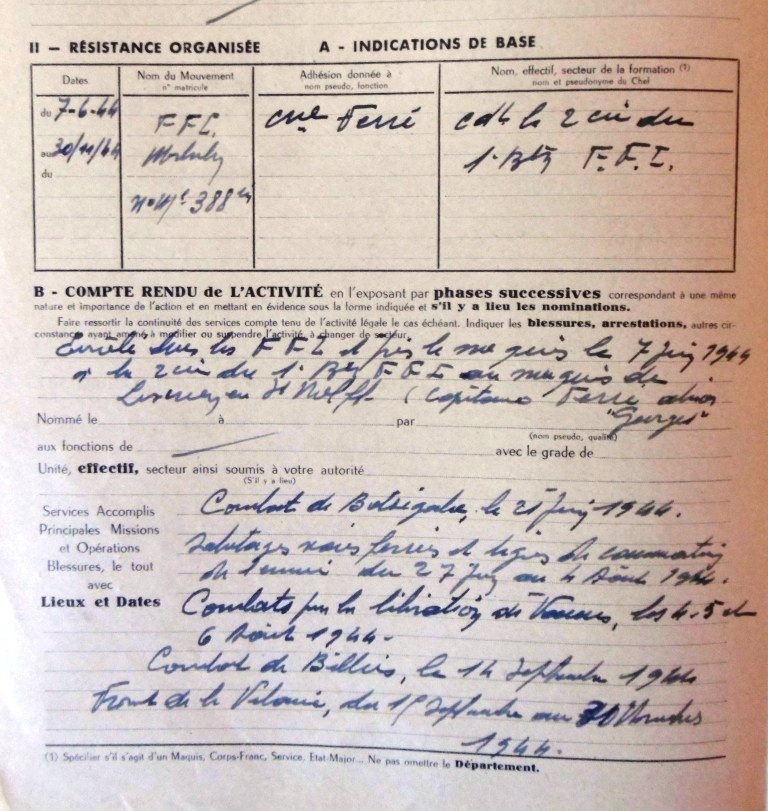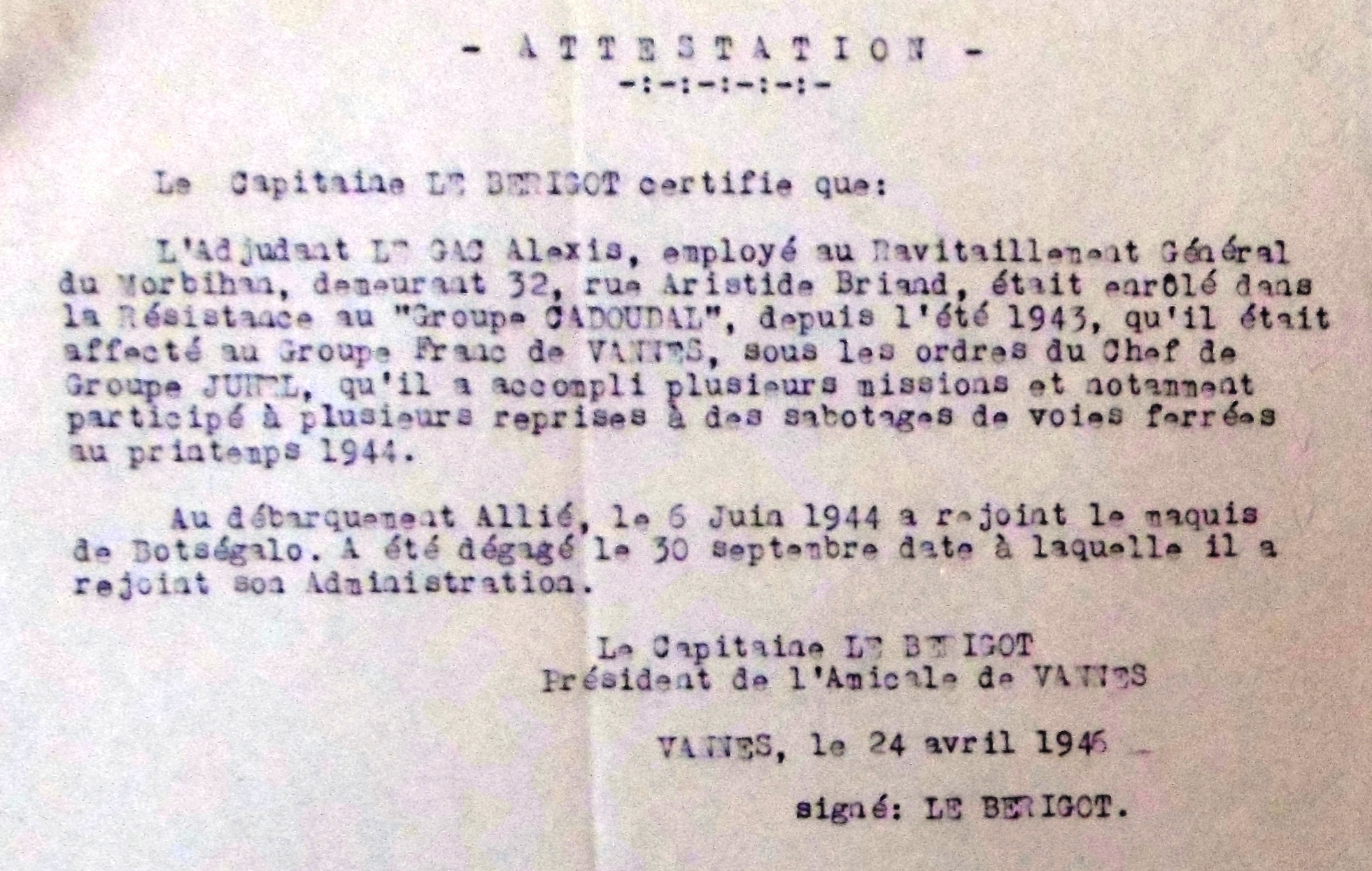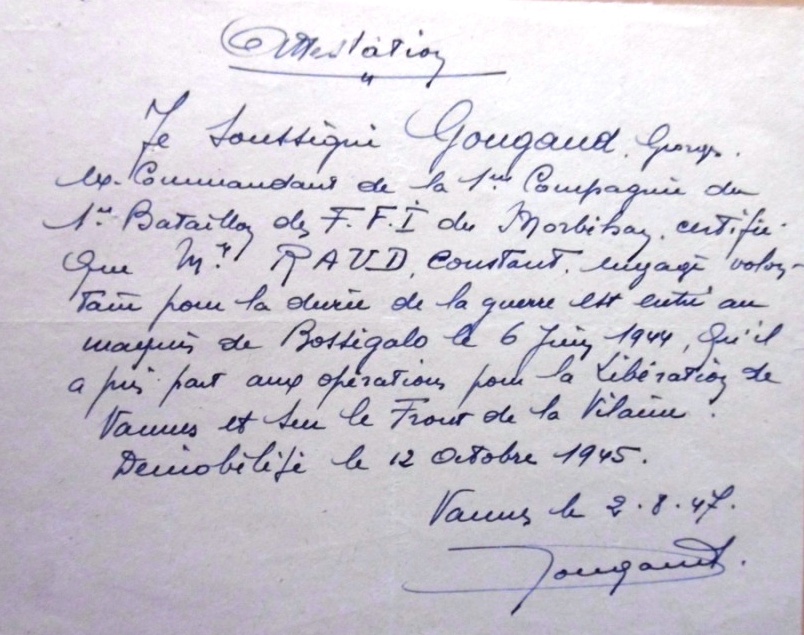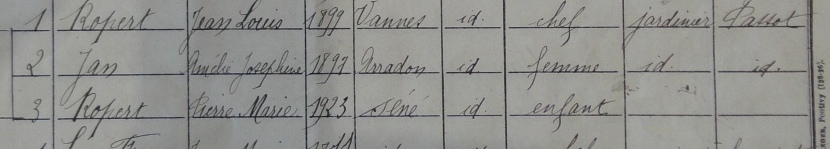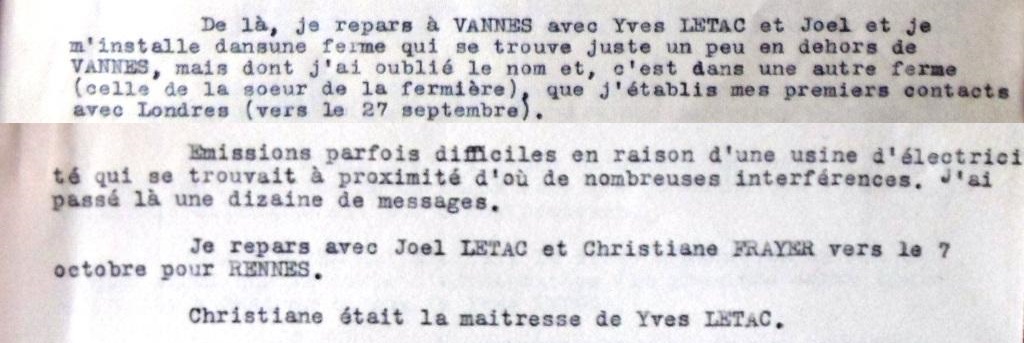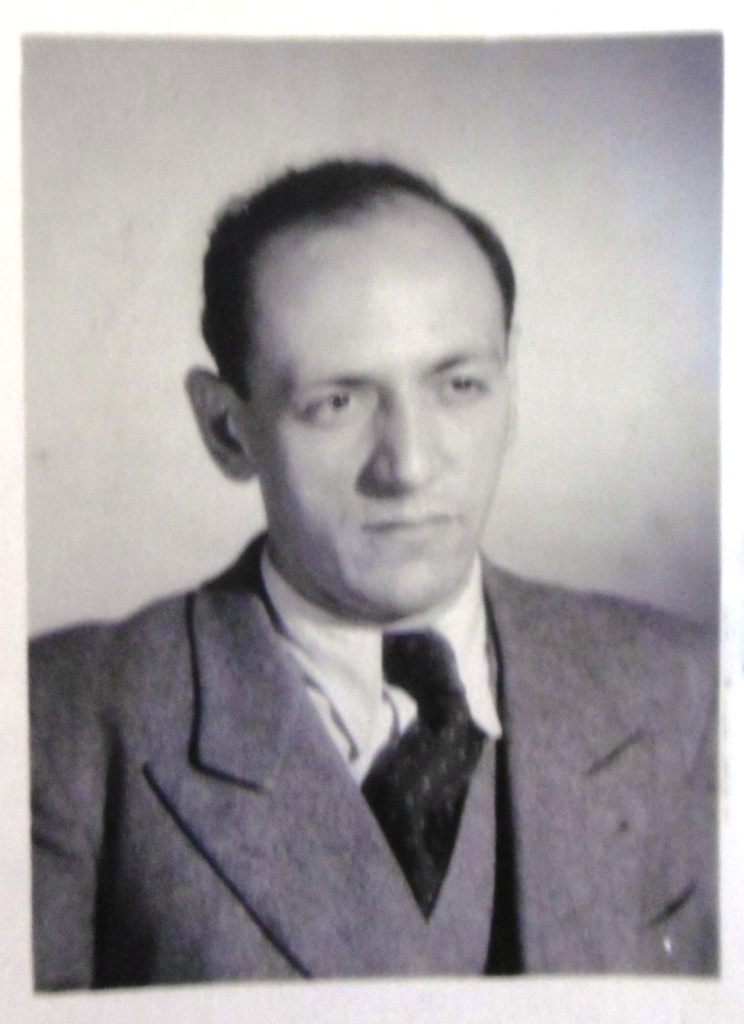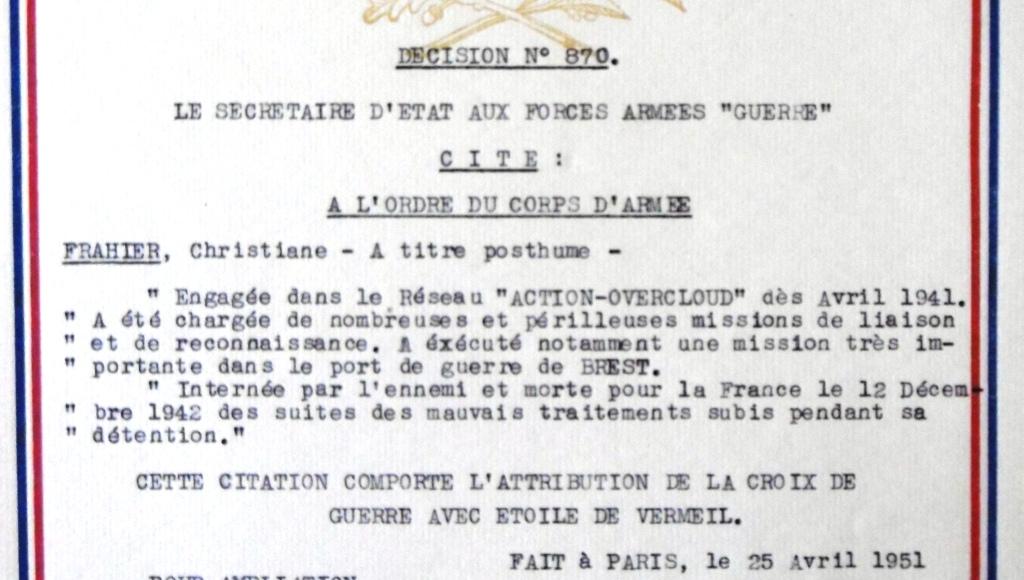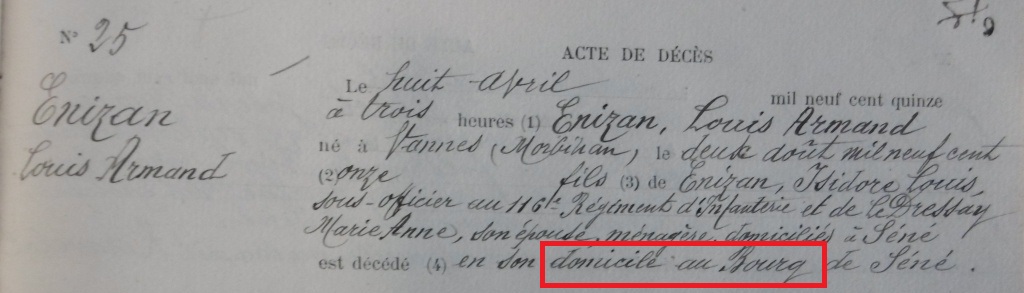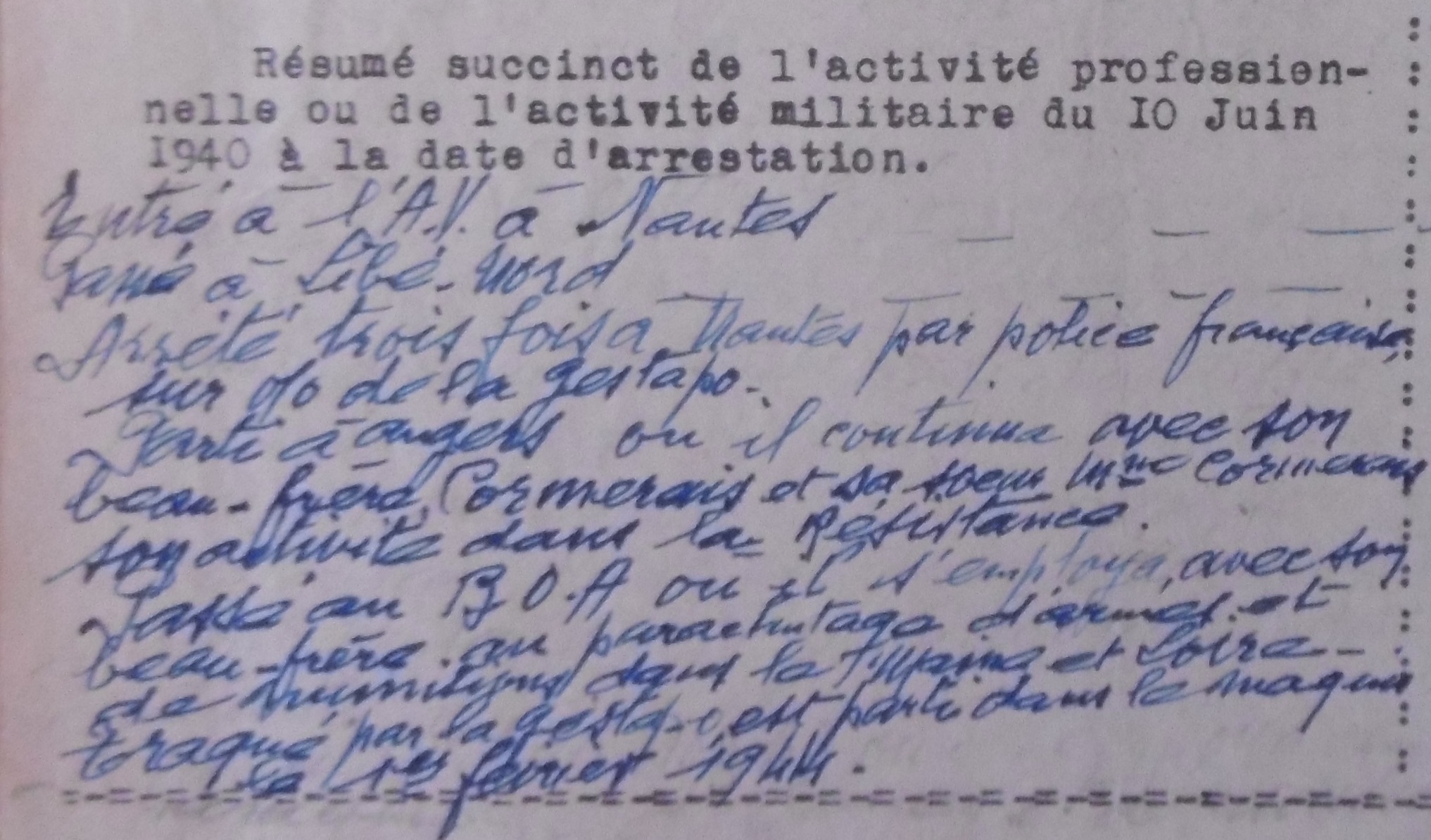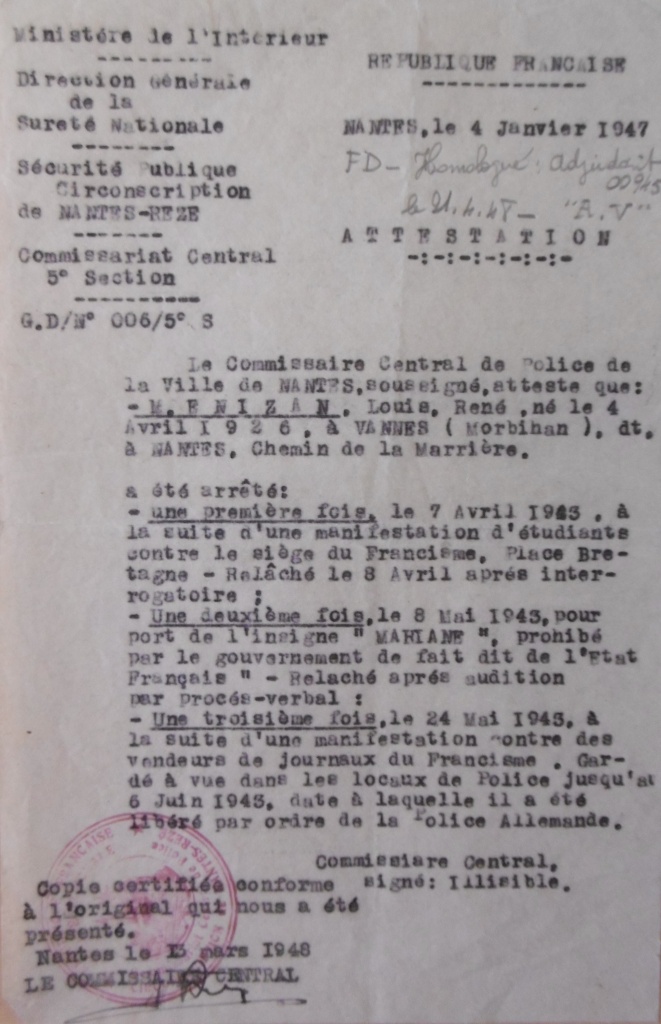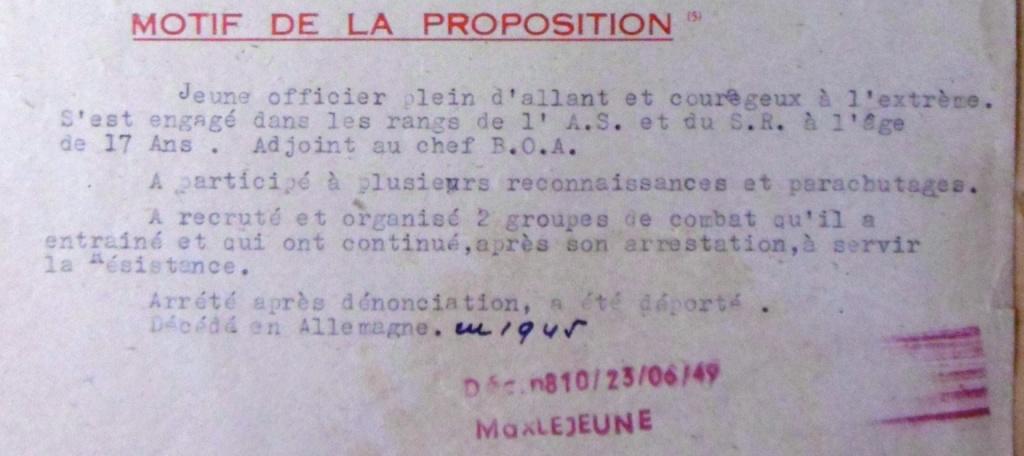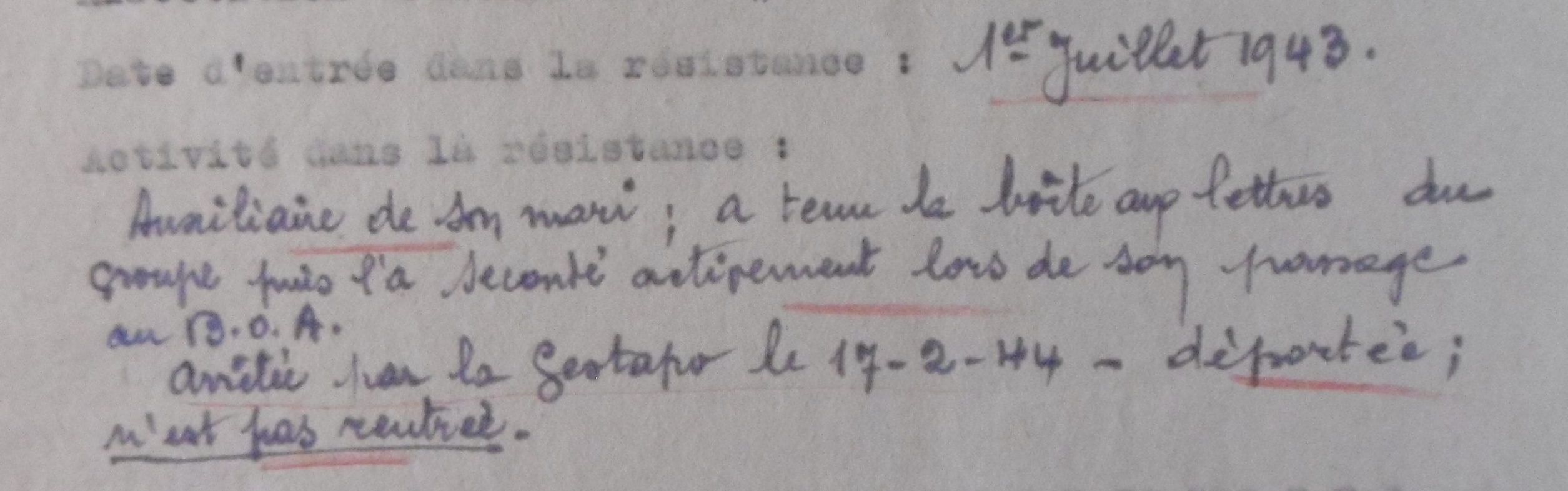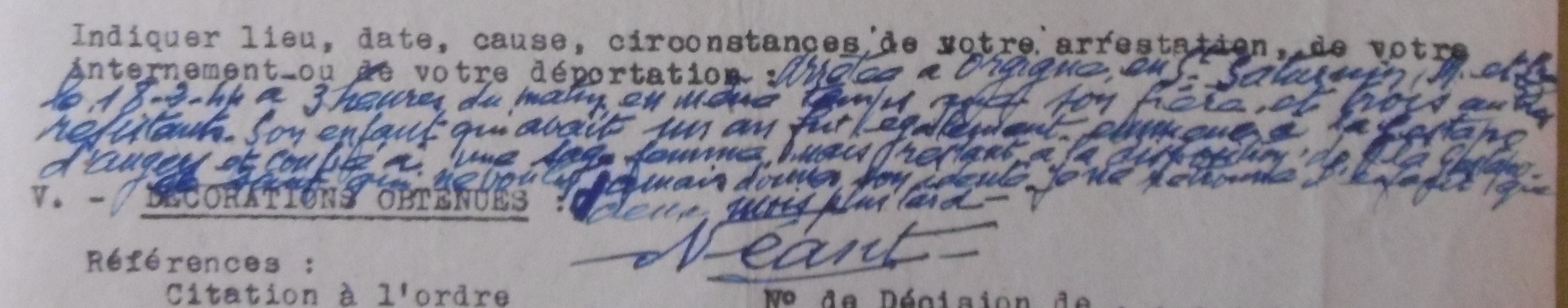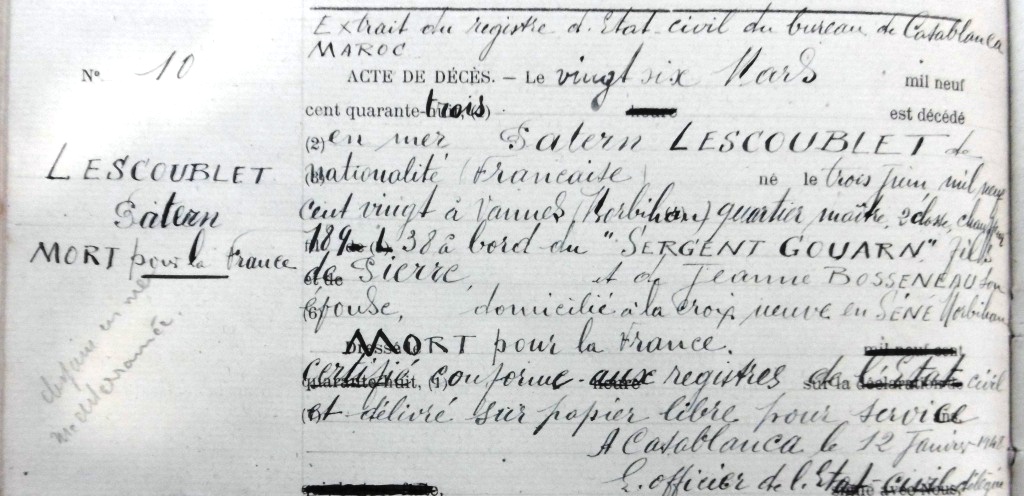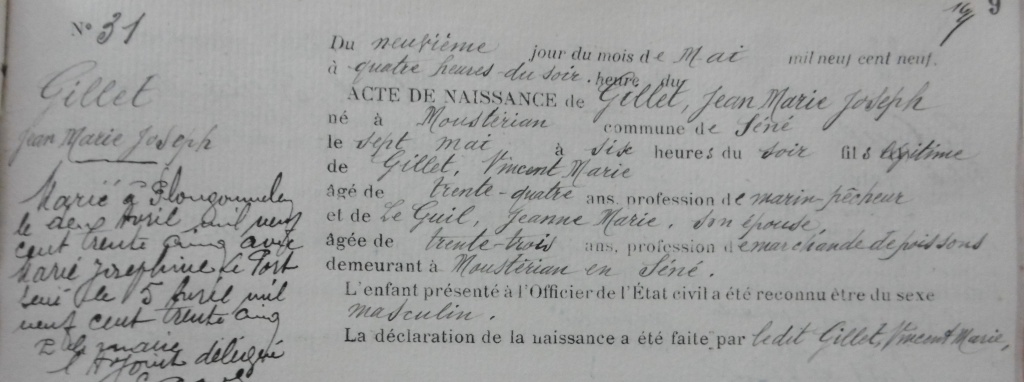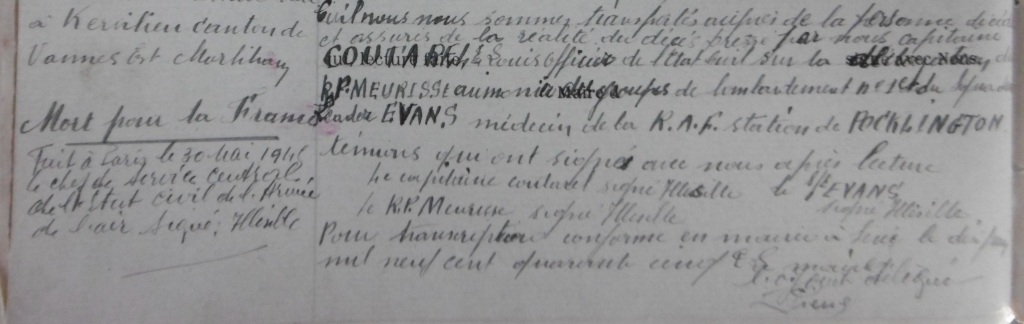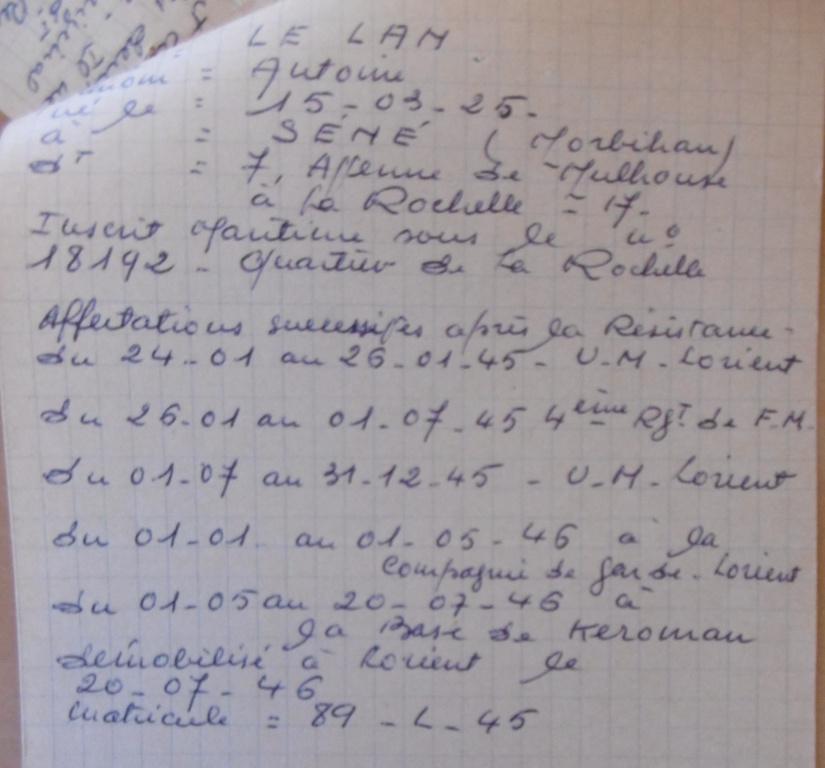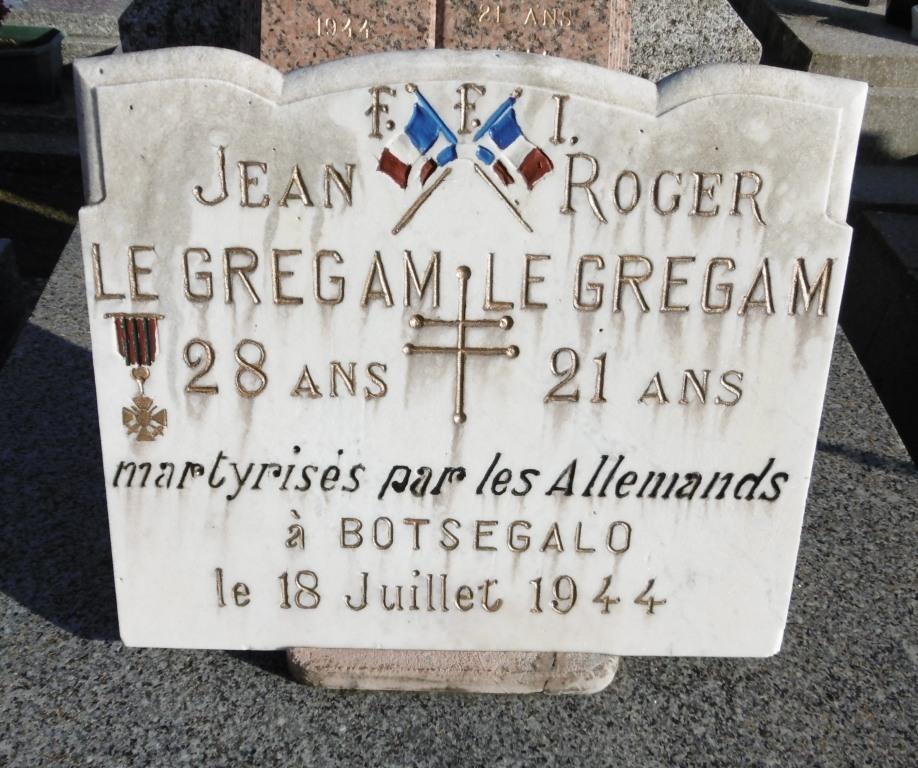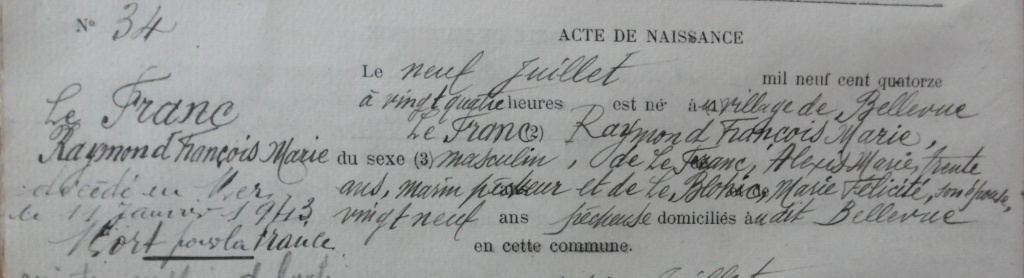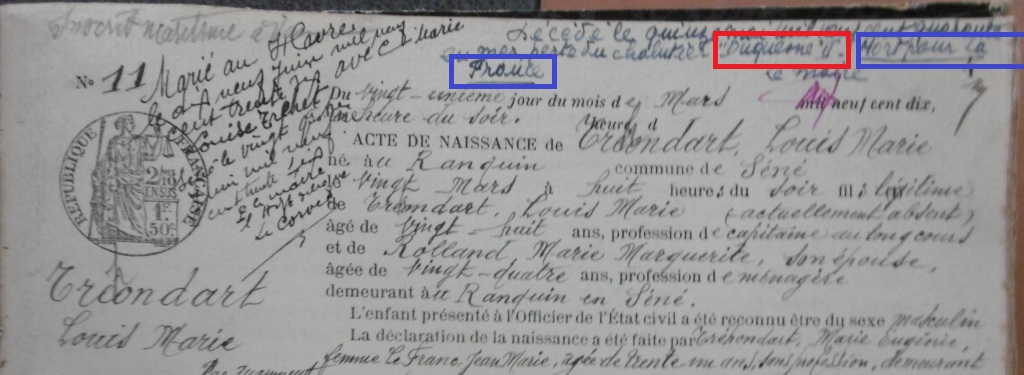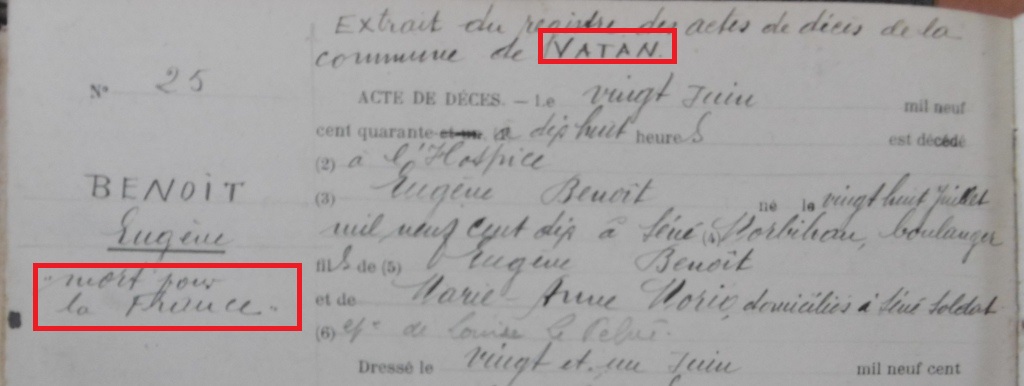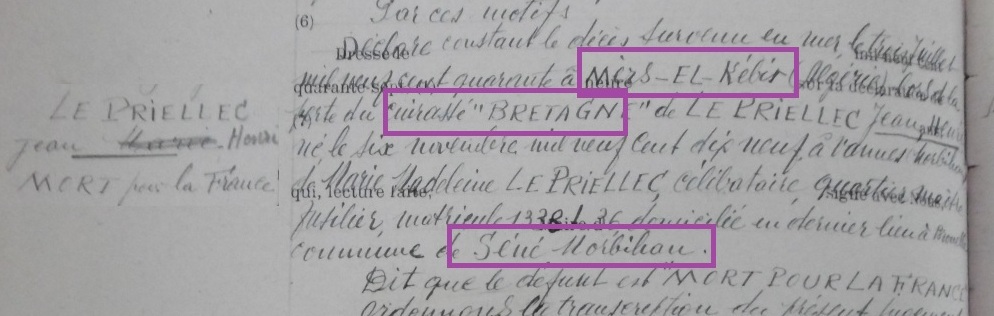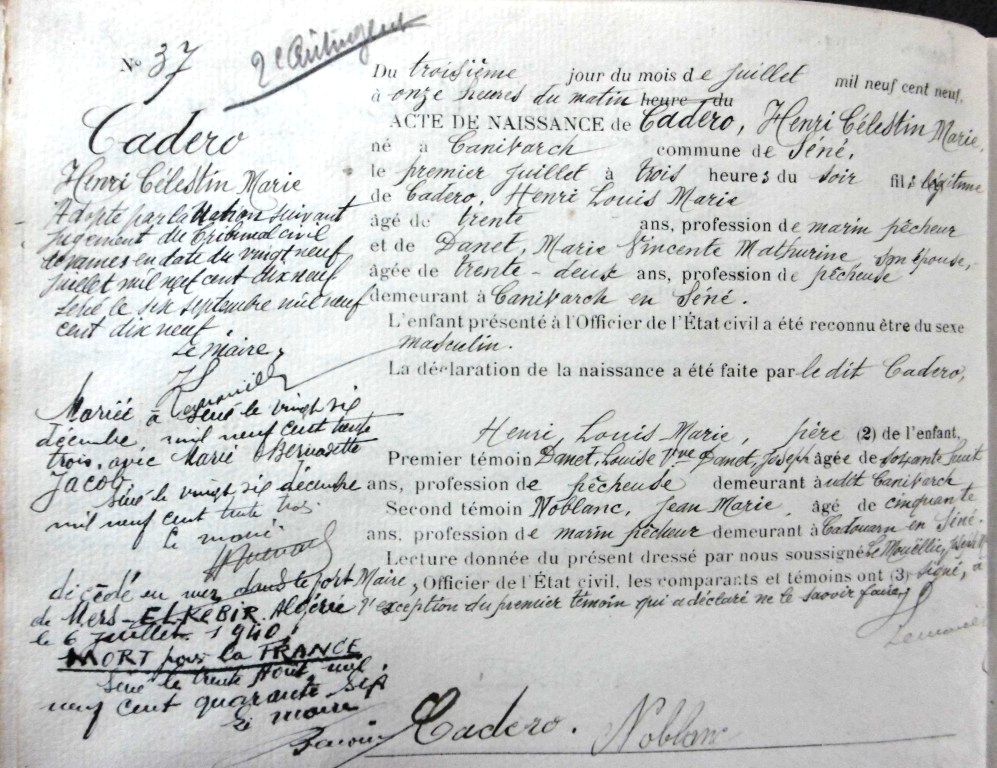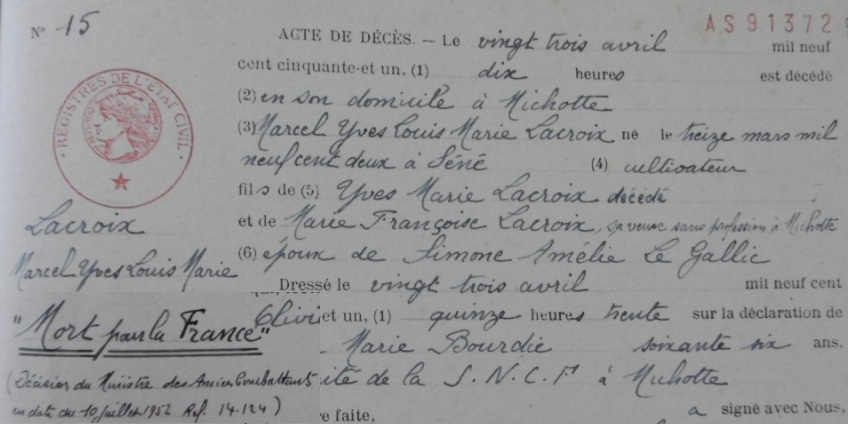Guerre 39-45
- LE HAY Jean Marie résiste à Périgeux
- Le compte rendu du procès 4/4
- Le déposition de Leontine LE YONDRE 3/4
- La traitresse de Kerdavid 1944
- LE RAY, SEVENO, LE ROI et GUELZEC, déportés sinagots
- Joseph PIERRE, timonier sur le "Curie" par Pierre OILLO
- JOLLIVET, décède en Indochine occupée par les Japonais
- Marins sinagots des FNFL
- Les FFI sinagots
- Marie Augustine LE BRUN, Résistante
- Marie Augustine LEBRUN, hommage
- Les DORIDOR victimes de guerre, Lorient, 1943
- ROBERT Eugène, prisonnier de Vichy en Indochine
- ENIZAN, déportés,1945
- 39-45 : Combattre pour libérer la France : 3/3
- La version de MATEL Robert 2/4
- 2 Sinagots échappent à leur exécution, 1944 1/4
- Les frères LE GREGAM, résistants,1944
- 39-45 : Deux pêcheurs victimes de mines : 2/3
- Sauvetage de 4 aviateurs allemands, 1941
Guerre 39-45
LE HAY Jean Marie résiste à Périgeux
Jean Marie LE HAY nait le 10 aout 1910 à Moustérian. Sa mère Marie Louise HUDE a épousé son père l'année dernière le 6 octobre 1909 à Séné. Son père est maçon comme l'atait son grand-père. La famille apparait lors du dénombrement de 1911.
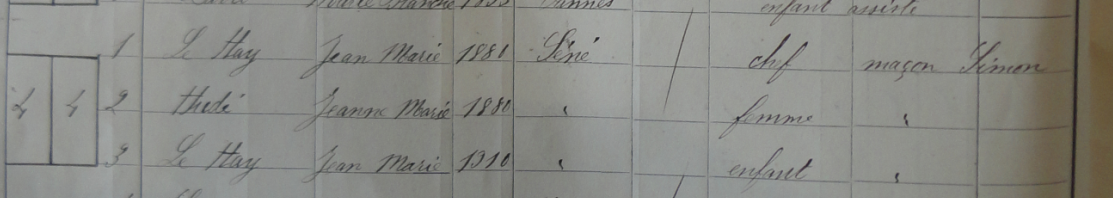
Le destin de la famille bacule lors de la Première Guerre Mondiale. Son père est mobilisé. Alors qu'il est au front, son épouse accouche en 1915 d'un enfant nommé Auguste. Blessé , il est ensuite hospitalisé et on lui détecte la tuberculose. Il quitte l'hopital militaire en mars 1917 et regagne son foyer à Séné où il décède le 9 juillet 1917. Il est inhumé à Séné le 10 juillet où sa tombe est encore visible au cimétière.
Le 29 juillet 1919, le jeune Jean Marie est "adopté par la Nation. Sa mère et ses 2 garçons son recencés en 1921. Elle ne se remariera pas.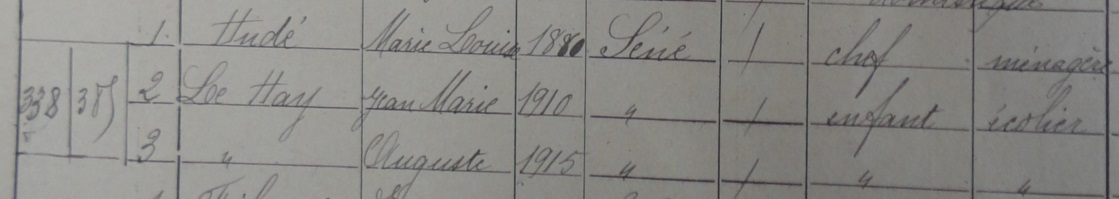
Comme son père et son grand-père, Jean Marie sera maçon. Le 9 septembre 1934, âgé de 24 ans, il épouse Hélène Marielle Renault au Cours (56).
Lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, il est âgé de 29 ans et il est mobilisé au sein du régiment de Chars de Combat RCC de Tours. Il est affecté à la surveillance et à l'entretien des chars à Périgeux. Dès novembre 1942 il rejoint un groupe de résisitants et mène différentes actions (lire ci-dessous). A l'été 1944, il participe à la libération de Périgueux.
Plusieurs mention à son dossier : "A participé activement au camouflage d'armes de l'armée d'artmistice (armée de Vichy) , a travaillé admirablement à l'organisation de l'ORA locale [Organisation de Résitance d'l'Armée] , se trouvait à l'hôpital le 6 juin, a rejoint le maquis sans attendre la fin de sa convalescence, a fait preuve de qualités d'energie d'ordre et d'une grande expérience des hommes. Chef de tous, très dynamique, est au dessous de toute éloges".
Démobilisé, il vit un temps à Marseille en 1948. Il finit par rejoindre Séné.
Il décède à Séné le 24 septembre 1964.
Son dossier de résitant conservé aux archives de Vincennes renferme son témoignage:
"A la démobilisation de l'Armée en novembre 1940, j'ai sorti et camouflé chez des particuliers une grande quantité de matériel de couchage, d'ameublement et tout l'outillage des ateliers.
Ce matériel a été en partie distribué aux services de la place Bergerac, la garde mobile et l'intendance a emporté tous les draps. Le reste du matériel (800 couvertures et 60 matelas) ont été camouflés chez M. Hertzog, notaire rue du Pont Saint-Jean à Bergerac. J'ai fait remettre une centaine de ces couvertures à un groupe du maquis (M. Belin ébéniste à Bergerac) et le reste du groupe Joseph.
Entré à la résistance au groupe militaire du Commandant Paquette ex-chef du bataillon du 3/26 RT en novembre 1942.
J'étais particulièrement chargé de l'entretien et du camouflage du matériel d'armement et des munitions qui se trouvaient en dépôt dans le bois de M. Durteu près de Pombonne.
Quelques temps avant le débarquement, j'ai effectué sur l'ordre du Comandant Paquette, le transport de dépôts d'armes chez M. Imbert Henri à Buade, commune de Ginestet où avec l'aide des camarades Guyon, Chauvin, Begin et Lenne nous avons procédé à leur remise en état.
Le dépôt comprenait alors 20 mitrailleuses Hochkies, 9 mitrailleuses allemandes, 24 mitraillettes anglaises, 60 lances grenades de 50 et une quarantaine de révolvers.
Avec la capitaine François 1er (Feyri) et la camionnette de M. Gardcette, nous avons fait l'échange des boites de chargeurs de F.M.24 détenus au dépôt Garcette à Bergerac par le groupe civil de M. Bergerte actuellement sous-préfet à Bergerac.
Croyant les opérations de débarquement des Anglais imminentes, j'ai procédé toujours sur l'ordre du Commandant Paquette à la distribution des révolvers à tous les membres du groupe connaissant bien la mitraillette anglaise, j'avais prélevé sur le dépôt du groupe un engin que je transportais à tour de rôle chez les camarades et l'instruction terminées, je l'ai remise au groupe. A.L. (M. Wyrth) avec lequel j'étais en liaison.
Egalement chargé des transports, j'ai été mis en relation avec mon collègue du groupe civil M. Berthomeu, peintre à Bergerac pour coordonner le travail des deux groupes.
J'étais également en liaison directe avec l'Adjudant-Chef Courdesse dit Bernard chargé du service camouflage de Matériel(CDM).
J'ai participé aussi à l'instruction du groupe de résistance de Peymylou (Père Brunet et M. Chambon).
Avec le Chef de Bataillon Santraylle, j'ai participé à des déplacement de nuit sur les terrains de parachutage.
Etant en relation avec MM Belin et Fournier, j'ai participé au camouflage des réfractaires au STO en les dirigeant vers les maquis.
En services au gardiennage du 3/26°RT à Bergerac, je servais de relais entre le Commandant et les camarades sous-officiers du groupe, de ce fait j'ai effectué de nombreuses missions de liaison parfois éloignées surtout lorsqu'il fallait aller chez le Colonel Paquette au delà de Montpont en Dordogne occupée Menesplet.
Les Boches ayant réquisitionné le garage Sygala à Bergerac, j'ai sorti et camouflé chez moi une moto CDM. Le Service CDM m'avait bien promis les papiers qui attesteraient que cette moto m'appartenait en propre, mais ils ne m'ont jamais été remis et ma famille n'a pas été à l'aise lorsque les Boches ont occupé ma maison quelques jours après le 6 juin 1944.
Le garage ne devait sans doute pas les intéresser car ils n'y ont pas mis les pieds.
Entré à l'hôpital militaire et opéré d'une fistule à l'anus le 3 juin, je suis néanmoins sorti clandestinement de ct établissement 4 jours après et fait de la moto pour aller livrer un dépôt de 6400 litres d'essence aux forces de la résistance. Ce dépôt était dans la propriété de M. Durieu à Saint-Sauveur.
Dès ma guérison, je suis entré au maquis à Saint Julien de Crempse avec le commandant Santrailles. Le Colonel Adeline, par l'intermédiaire de l'Adjudant-Chef GYOT, m'avait fait savoir au 6 juin qu'il me considérait comme faisant partie des troupes de la résistance mais qu'il m'interdisait de sortir de l'hôpital avant ma complète guérison.
Affecté au groupe Michel comme adjoint au chef de groupe, j'ai participé aux opérations du secteur Nord-Ouest de Bergerac, à la prise de Bergerac et aux opérations devant Rpyan jusqu'au 1er décembre 1944.
A la formation du 26°RI à Bergerac, le 1er décembre 1944, le groupe Michel qui était devenu Compagnie Michel du Bataillon Joseph a été transformé en 12Cie.
Le 22 janvier, le bataillon quittait Bergerac pour participer aux opérations devant La Rochelle ou nous nous trouvons toujours.
ASP 53223, le 24 février 1945
Le Lieutenant LE HAY (FFI°
Signé LE HAY.
Le lieutenant Pupat, comandant la 12° compagnie du 26°RI, certifie exacte les déclarations du Lieutenant Le Hay en ce qui concerne son activité au maquis depuis son entrée au Groupe Michel. Ayant le Lieutenant Le Hay comme adjoint, depuis cette date et sans interruption, c'est à dire depuis plus de 7 mois, je ne peux que m'en féliciter;
Excellent chef de section et sachant commander, possédant les connaissances militaires nécessaires pour commandes une compagnie et l'ayant fait à maintes reprises, je ne regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas encore été homologué car il a effectivement exercé ces commandements;
Signé Pupat.
A
Le compte rendu du procès 4/4
La Liberté du Morbihan, samedi 10 mars 1945
La patronne de “La Belote” devant la Cour de Justice
Vers la fin de juillet 1944, un homme – Robert MATEL – entrait au bar de «La Belote” vers midi. La patronne du café, Léontine LE YONDRE, épouse séparée de l’ex-coureur cycliste Lucien LAFOURNIERE, sort peu après en sa compagnie. Il la conduisit au Café de la Rabine, puis au-delà du café tenu par Mme Vve RUAULT à la Madeleine. Elle le suivit sur la route de Sainte-Anne. Au cours de leur traversée du Bois de Kerluherne, il lui fit voir une mitraillette, puis ils semblèrent oublier l’un et l’autre ce qui les avaient amenés au sein de cette verte solitude et ils en profitèrent à la manière banale de bien des couples d’amoureux. Chacun des partenaires donnera sur ce voyage une version psychologiquement différente. Quant à ce qui se passa, ce fut aussi simple que cela.
Pourquoi l’accusée eut-elle le désir de repasser seule au retour au débit de Mme Vve RUAULT ? Pourquoi le maquisard MATEL retourna-t-il le soir en compagnie de deux camarades à «La Belote”? Là-dessus les thèses s’affrontent. Ce qui est certain, c’est que la visite au débit RUAULT fut suivie de l’arrestation de la débitante par la feldgendarmerie et que la venue des trois amis au bar de la femme LAFOURNIERE provoqua une opération de police et par conséquence, l’arrestation des deux amis de MATEL. D’autre part, le lendemain de la promenade au bois de Kerluherne, la ferme de Kergrain fut perquisitionnée d’une manière brutale et crapuleuse par la feldgendarmerie et la famille LE ROUX, famille paisible de braves gens, eut gravement à souffrir de cette sauvage descente de police, à laquelle participa en uniforme allemand la tenancière de « La Belote ».
Ce fut le 31 juillet vers midi que MATEL engagea rue du Mené un combat à mort avec les Allemands, après qu’un coup de feu eut été tiré sur lui par un feldwebel alors qu’il se trouvait en compagnie du Lieutenant LE FLOCH.
Cet officier de la résistance devait succomber ce jour-là à une blessure au ventre. Notons que son témoignage aurait peut-être permis d’éclaircir, au cours des débats, certains points demeurés obscurs en dépit des efforts de M. Mérour, le consciencieux magistrat à qui revint la lourde charge d’instruire cette affaire dont le caractère s’aggrave de cette circonstance douteuse que deux des jeunes gens tombés aux mains des Boches, les jeunes MAHE et LE CAM, ont été fusillés à Arradon et que deux de leurs camarades n’ont dû qu’à un miracle de surhumaine énergie d’échapper à leurs bourreaux.
Fixé par tous les yeux, Léontine LAFOURNIERE va rapidement s’asseoir à l’extrémité du box, la plus rapprochée du siège du Commissaire du Gouvernement, occupé par M. GUERIN-VILLAUBREUIL. Elle semble en proie à une brusque émotion dès que ses premiers regards se portent sur la Cour. M. le Président JACQUES a pour assesseurs MM. LE BOULCH, JOLLIVET, PRASLON et MARTIN, aux côtés desquels deux juges suppléants, MM. THEBAUT et TAMAREILLE sont venus prendre place.
Elle a à répondre de trahison, d’entretien en temps de guerre et sans autorisation du Gouvernement, de relations avec des agents de l’Allemagne, de dénonciations.
Elle écoute attentivement l’appel des témoins. Sa servante et accusatrice Simone PASCO ne répond pas. Elle ne viendra pas déposer. Une récente maternité la retient à Rennes.
Le Président évoque l’enfance de l’accusée, aînée de six enfants. Jusqu’en 1940, son père a tenu le café de «La Belote ». "Ca fait juste un an aujourd’hui qu’il est mort", fait-elle remarquer.
De son passé elle n’est pas fière.
D-- Les renseignements qu’on a recueillis sur votre compte vous sont défavorables.
R--Ce n’est pas de ma faute. M. le Président.
D--Votre conduite et votre moralité ne sont pas exemplaire.
R--Faut savoir comment j’ai été élevée.Et elle ajoute en baissant le ton : "je mérite les reproches qu’on peut me faire."
Elle estime que son café n’était pas un plus mauvais lieu que quelques autres établissements de Vannes. Elle y recevait dit-elle des femmes qui travaillaient avec les Allemands. L’accusation lui reproche aussi d’avoir reçu des femmes de prisonniers.
Si elle a été condamnée à six mois de prison pour vol elle fait ressortir que c’est avec sursis en même temps qu’une amie principale coupable qui, elle a eu une peine de deux ans d’emprisonnement. Sa première condamnation pour violences lui a été infligée à l’occasion d’un échange de coups avec une maitresse de son mari. La seconde c’était pour avoir frappé l’infidèle.
On revient en arrière. Dans son enfance elle ne fut pas heureuse avec son père qui lui préférait ses sœurs. C’est la raison qui l’a poussée dit-elle à quitter Vannes à seize ans après avoir fait un apprentissage chez une tailleuse pour hommes.
D--Là vous avez sombré dans la débauche et la prostitution puis vous avez connue LAFOURNIERE coureur cycliste qui est devenu votre amant. Vous avez vécu avec lui. C’était un amant complaisant ? L’accusé ne répond pas.
-Il a profité de l’exercice de votre séduction. Pendant 16 ans, vous avez partagé avec lui vos ressources – si j’ose dire – Au bout de 16 ans vous vous êtes mariée avec lui…Pourquoi ?
-Parce qu’en 1939, ma mère, étant malade, m’a offert de prendre la suite du café. Mon mari y voyait un intérêt. Moi j’avais une occasion de me racheter. L’affaire se fit le 24 septembre 1940.
D-Les Boches étaient déjà là ?
R-« Ils » étaient déjà là…Le café était déjà fréquenté par les Allemands. C’était près de la gare et il n’y avait pas beaucoup de civils. Le café était très coquet. J’avais fais des frais.
Le Président fait allusion au mari dont l’accusée vit aujourd’hui séparée. Coureur, il courait dans le sillage d’un autre coureur quelque part du côté de Pluvigner. Cela ne plaisait pas à son épouse.
-Ce n’était pas par jalousie, précise-t-elle, mais il partait à Paris « faire la foire » emportant l’argent de la maison.
Léontine LAFOURNIERE se défend d’avoir dénoncé son mari aux Allemands. Elle dit n’avoir jamais su qu’il avait été prisonnier et avoir été victime d’une vengeance d’intérêt. A ce propos elle se hâte de généralise : « Il n’y a que des vengeances dans ce procès ! ».
Quand le Président lui fait observer que le café de «La Belote” était le quartier général de la Feldgendarmerie elle proteste : "Quand la Feldgendarmerie vient dans un café, les autres clients s’en vont…"
Pourtant, elle trouva une occasion de fréquenter la Feldgendarmerie. Son café ayant été fermé par suite d’un bal clandestin elle intervint – en vain d’ailleurs –auprès des Allemands pour faire reporter cette mesure. Ca prouve, triomphe-telle que je n’étais pas aussi bien qu’on le dit avec les Allemands qui à trois reprises m’ont dressé contravention.
On fait allusion à la vie intime de l’accusée.
-Vous avez été la maitresse d’un Allemand : Hans Heintz. Alsacien, M. le Président.
Le Président proteste. Elle réplique :"Moi, je dis ce qu’il m’a dit."
Cette liaison dura un an, Heintz fut remplacé par un Français.
Il est question de quelques policiers boches de marque que la patronne de «La Belote” dit ne pas avoir connus plus particulièrement. Et elle ajoute: "J’avais aussi la police Pétain qui venait dans mon café."
Elle se défend d’avoir été une indicatrice. L’interrogatoire porte ensuite sur les menaces dont elle a été l’objet. Il lui est reproché de na pas en avoir saisi la police française.
Elle n’était pas armée répond-elle.
Ses excellentes relations avec une dame vertejaune, indicatrice des Allemands luis sont rappelées. Elle affirme n’avoir connu son rôle que quand à son retour de Paris elle a appris que cette femme avait été abattue par les patriotes. Elle avoue n’avoir donné, pour sa part, aucun renseignement aux Allemands. Pourtant l’accusation retient contre elle la dénonciation du jeune Marcel OUDAGE et de ses deux amis qui avaient exprimé leur indignation de la voir si intime avec les Boches. Elle discute les faits les plus amples qui vont tout à l’heure être rappelés par le témoin et se prétend étrangère à cette dénonciation.
Enfin, il est question de la visite du jeune MATEL . C’était le 30 juillet 1944, un dimanche matin. L’accusée venait d’Arradon où elle couchait depuis les bombardements du camp de Meucon.
« Quand il est entré, dit-elle il a commandé un vin blanc, puis demandé qui était Mme LAFOURNIERE. Quand il a su que c’était moi, il m’a dit "j’ai un ordre de vous descendre". Je l’ai fait pénétrer dans la cuisine. Je lui ai déclaré que j’étais innocente. Il m’a commandé de faire ma prière braquant sur moi un révolver. Je l’ai supplié de ne pas mettre la menace à exécution. J’ai eu très peur. Ma bonne était là. Elle s’est mise à crier. Il a fermé toutes les portes. On a discuté. J’ai réclamé des preuves. Il a parlé d’un Lieutenant dont il n’a pas cité le nom. Il m’a fait voir la pochette en dentelle bretonne me questionnant pour savoir si elle était à moi ou à ma bonne. Je lui ai répondu que cette pochette n’était pas à nous et je l’ai invité à déjeuner avec nous. Il a refusé disant qu’au maquis on mangeait mieux que cela. Pendant que nous déjeunions il a bu deux ou trois vins blancs puis il m’a donné l’ordre de le suivre pour voir disait-il son lieutenant sur la Rabine et me prévenant que si je faisais un signe de la tête ou du regard il m’abattrait comme une bête. Dans la rue de la Fontaine nous avons croisé une patrouille allemande et nous sommes passés devant la Feldgendarmerie. Ca m’aurait été facile alors si j’avais voulu de la « donner » comme vous le dites. Je ne l’ai pas fait parce que j’avais peur. Je n’ai jamais pensé que c’était un patriote. J’ai pensé qu’il voulait m’entrainer dans le maquis…
D-Vous ne vous sentiez pas tellement en danger ? constate le président.
Léontine LAFOURNIERE resta seule pendant vingt minutes au café de la Rabine. Puis MATEL revint la chercher. Il la ramena à "La Belote” où il reparla du mouchoir de dentelle. De "La Belote” il la fit l’accompagner à la Madeleine, au café RUAULT Ils passèrent par l’Avenue Victor Hugo, la rue et l’avenue Hoche. Chez Mme RUAULT le malheureux MAHE vint rejoindre MATEL puis ce dernier parti alors seul vers la route de Sainte-Anne avec l’accusée.
Nous nous sommes arrêtés dans le bois de Kerluherne. Là, il a sais une mitraillette qui était cachée sous la fougère. Il m’en a menacée. Le voyant monter et démonter cette mitraillette après m’avoir emmenée jusque là, j’ai eu l’impression que c’était un fou. Nous avons aperçu un couple. Il a aussitôt tiré un coup de feu en criant aux promeneurs : »Vous fermez vos gueules ». Ces gens ont répondu »Vous pouvez y aller ». A ce moment il m’en a menacée (sic) de sa mitraillette. Je l’ai supplié de ne pas tirer lui disant que je ne méritais pas la mort car je n’avais dénoncé personne. Il m’a répondu qu’il avait un ordre de l’abattre, mais il adit aussi :’Je ne veux pas vous descendre parce que je ne vois pas mon lieutenant ». Je ne comprenais plus rien. Il a alors caché sa mitraillette et n’a gardé que son révolver à la main. En marchant il m’a fait une déclaration d’amour. Le reste vous le savez ».
Le Président : « C’est vous qui avez joué la scène de la séduction.
Léontine: Non, Monsieur le Président.
Le Président : C’est vous qui lui avez proposé vos faveurs.
Léontine: C’est lui qui…
Le Président: Enfin cela revenait à la même.
Léontine: Ah non Monsieur le Président. Il m’a dit que c’était malheureux de me descendre. Il m’a demandé de l’argent. Et c’est pour réclamer 20.000 Frs qu’il est revenu le soir à mon café.
D-Pourquoi êtes vous retournée au café de Mme RUAULT ?
R-Pour voir quelle physionomie (sic) elle aurait fait en me revoyant seule.
D-Vous vouliez savoir le nom de MATEL.
R-Non, je n’ai rien demandé à Mme RUAULT. Dans le bois MATEL m’avait dit qu’il s’appelait ROGER.
Quand le soir il revint au bar de «La Belote” avec ses camarades, l’accusée l’a assure-t-elle entendu dire à ceux-ci : « Elle ne perd rien pour attendre ». Elle a pensé qu’il attendait le départ des Allemands pour mettre à exécution ses menaces.
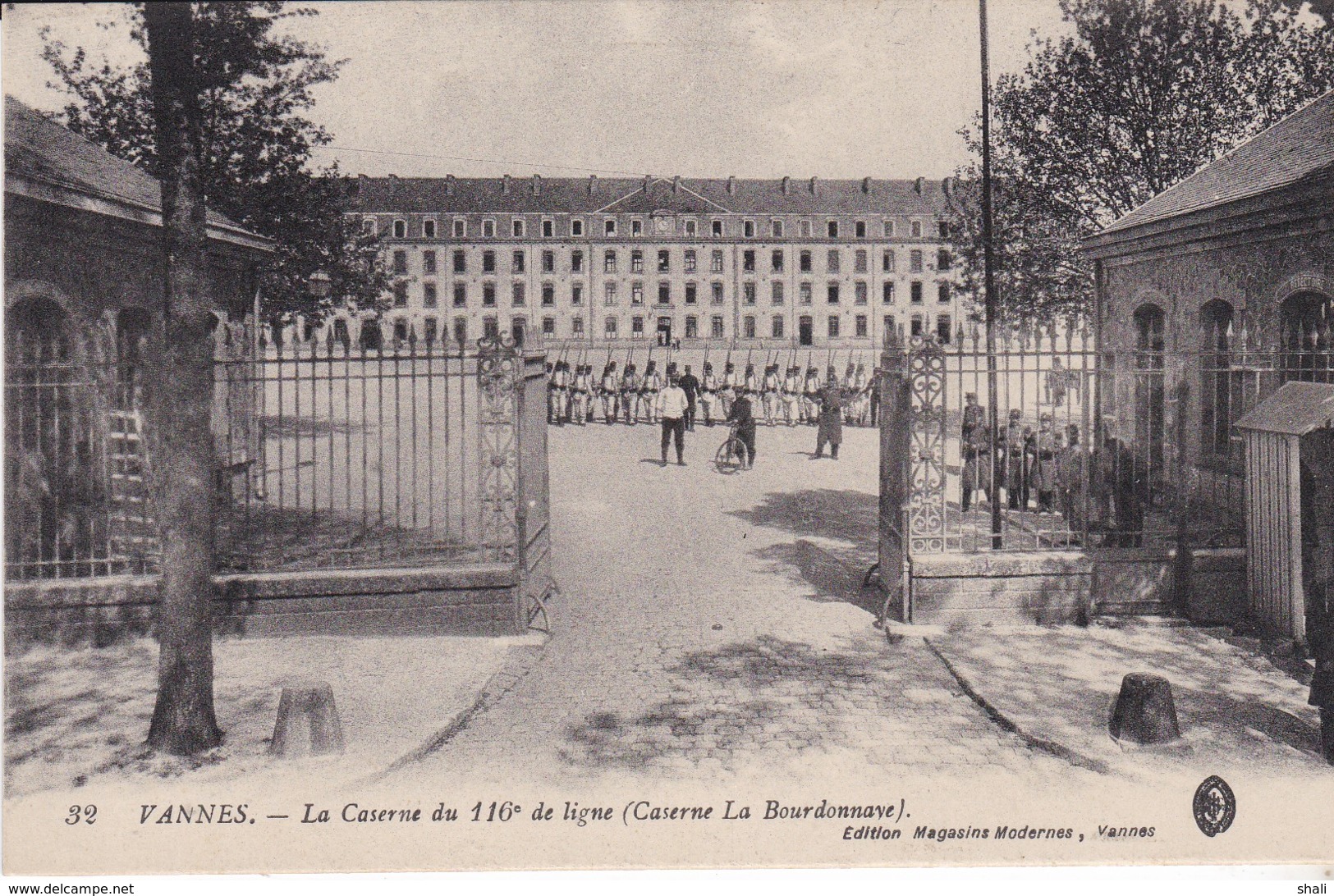
Prise d’affolement, je suis allée à la Caserne de La Bourdonnaye où j’ai dit au chef de poste qu’il y avait un terroriste qui me menaçait dans mon café.
D-Vous avez fait état de trois terroristes.
-D’un seul.
D-Vous avez dit trois.
C’est à la suite de cette démarche que MAHE et LE CAM furent appréhendés près du pont de chemin de fer, tandis que MATTEL qui avait un vélo, réussissait à s’enfuir.
-Je ne suis pas responsable de ces arrestations, proteste l’accusée.
-Pourtant, réplique le Président, après cette arrestation vous avez, selon votre bonne répété aux Allemands : »Très bon, très bon ».
Interrogée par les Allemands sur ce qui s’était passé au cours de la journée, la femme LAFOURNIERE a fait le récit complet de ce qui s’était passé, d’où l’enquête de la feldgendarmerie. Les témoignages en marqueront les étapes.
A cours de la confrontation avec Mme RUAULT, cette débitante rappelle l’accusée m’a traitée de garce et m’a giflée.
Le Président- On ne peut pas dire que cette gifle vous l’avez volée.
Le soir, la patronne de «La Belote”fut l’hôte choyée de la feldgendarmerie qui désormais allait veiller sur elle au point de l’emmener à Auray. Sa présence y fut constatée au café Josso à l’heure même où éclatait à Vannes la fusillade dramatique de la rue du Mené et au cours de laquelle le témoin MATEL crut reconnaître une femme parmi les uniformes allemands qu’il apercevait dans la bagarre. Cet alibi de l’accusée, indiscutablement prouvé par l’instruction, constate le Président, fait la lumière sur un incident important, une partie de la presse ayant imprimé que c’était la femme LE YONDRE qui accompagnait les Allemands au moment où l’un de ceux-ci ouvrait spontanément le feu sur MATEL.
L’accusée s’est bien travestie en militaire allemand mais ce fut pour accompagner les enquêteurs de la feldgendarmerie à la ferme des LE ROUX, près du bois de Kerluherne. Elle avait mis des lunettes noires.
--Ils m’avaient fait boire du Cognac, explique-t-elle et j’avais ce jour-là autant peur des Allemands que la ville j’avais peur de MATEL.
Elle assure que ce n’est pas elle qi a mené les Allemands à la ferme dont elle déclare n’avoir pas connue l’existence. Ce sont eu, dit-elle, qui l’ont conduite à cet endroit.
--Je suis innocente de la dénonciation des LE ROUX.
Elle précise qu’elle n’a pas, comme on le lui reproche procédé elle-même à un interrogatoire. Elle prétend avoir seulement répété les questions posées et être restée pendant la perquisition sur le seuil de la porte.
Le Président –Vous avez dans cette double mort une incontestable responsabilité morale : votre part de responsabilité est écrasante, car c’est à cause de votre intervention que ces deux jeunes gens ont subi leur sort tragique. S’il y a eu cet enchainement d’évènements, c’est que vous aviez peur. Si vous aviez peur il fallait partir. »
--Je n’avais dénoncé personne, je n’avais donc pas à partir.
D—On vous soupçonnait d’être une indicatrice.
R—Il n’y a aucune preuve. Je suis innocente.
L’interrogatoire, qui a duré trois heures et demie se termine sur l’évocation de l’arrestation de l’accusée à Paris. L’audience est suspendue. Tenant compte des avertissements du Président, l’auditoire très dense n’a cessé de demeurer calme et digne. Il fera preuve du même sang-froid pendant les dépositions.
Pendant deux heures les témoins vont se succéder à la barre.
Le lieutenant Michel LE BOUCHER, 39 ans de la sécurité militaire, ayant découvert la retraite à Charenton de l’accusée, a obtenu l’autorisation d’aller l’arrêter. Il la ramena à Vannes. Elle lui a dit-il, offert près de 100.000 Frs pour qu’il la laisse libre.
--Je n’ai jamais proposé d’argent, répond la femme LAFOURNIERE.
M. Jean LAIGO, 38 ans, rédacteur au CCRB dit qu’ayant entendu dire par un cheminot que la patronne de «La Belote”était dénonciatrice, il l’a lui-même signalée à MATEL qui recherchait le propriétaire d’un mouchoir e dentelle. Il ne peut dire le nom du cheminot.
Voisine du café de « La Belote », Mme PREJEAN, née Parisot, a vu l’accusée dans une auto allemande, mais n’a jamais entendu dire qu’elle avait dénoncé des patriotes.
C’est au milieu de l’attention générale que Robert MATEL, 27 ans, poseur de voies, s’avance vers la cour. Il parle lentement. La blessure qu’il s’est faite à la gorge pour échapper aux Allemands, le jour de la fusillade de la rue du Mené le gêne. Mais il ne semble pas y avoir que cette gêne physique. S’il donne des détails précis sur le combat des rues de vannes au cours duquel il déclare avoir tué plusieurs Allemands et en avoir blessé un aussi grand nombre, il est d’une extrême discrétion sur la façon dont il persuada l’accusée de l’accompagner au bois de Kerluherne et sur les choses hors du sujet qui s’y passèrent.
C’est le 29 juillet alors qu’il faisait l’enquête sur la provenance du mouchoir de dentelle que le témoin LEGO l’a orienté vers le café de «La Belote”où il est allé à onze heures puis à midi pour rencontrer la patronne.
--Elle disait qu’elle n’était pas une dénonciatrice. Nous autres on ne peut rien faire sans ordre.*C’est pourquoi il tenait à voir le lieutenant LE FLOCH qu’il ne trouva pas.
D—Vous ne lui avez pas dit que vous vouliez la descendre ?
R—Non, il m’était impossible de le dire à ce moment. En face du café il y avait un train en gare.
Au banc de la défense Mes Bourdon et Droalen s’étonnent que les choses se soient passées si facilement. On parle de la pochette de dentelle.
--Cette pochette avait été portée par une dénonciatrice de patriotes que nous voulions identifier.
Il a laissé l’accusée au café de la Rabine pour aller voir si le lieutenant LE FLOCH en présence de qui il voulait la xxxxxx était au café des Colonies.
De quoi a-t-il été question dans le bois ? De somme offerte, d’après le témoin qui ajoute que, quand le couple passe, le coup de feu partit seul.
D—Vous n’avez pas menacé la femme LE YONDRE de votre mitraillette.
R—Je l’avais sur le dos. Je lui ai dit que je n’avais pas l’ordre de la descendre. Et le témoin MATEL confirme que ce qu’il savait sur la femme LAFOURNIERE il le tenait seulement du témoin LEGO.
Il faut bien en venir à la bagatelle. Elle me l’a proposée elle-même, explique le jeune caporal-chef.
Pourquoi est-il retourné le soir même à «La Belote”? « C’était un peu risqué » constate le Président. Quand il a vu l’accusée s’éclipser il a lui-même dit à ses camarades : « ça sent mauvais ».
La défense veut connaître le casier judiciaire du témoin.
On apprend qu’il a deux minimes condamnations et qu’actuellement il est détenu en vertu d’un extrait de jugement du tribunal de Nantes le condamnant à 13 mois de prison pour avoir acheté 900 Fr un vélo volé.
Le Président oppose à cette ombre les cinq balles dont a été atteint le témoin, les tortures qu’il a subies et la condamnation à mort à laquelle il n’a échappé que par le départ précipité des Allemands.
Après Mme RUAULT du café de la Madeleine et son fils qui furent maltraités par les feldgendarmes, on entend le jeune Marcel OUDAGE qui, consommant à «La Belote”et ayant devant les Allemands traité la patronne de « viande à Boches » fut avec deux camarades signalés par celle-ci à une patrouille allemande, alors qu’il était réfractaires et maquisards. Ils furent tirés d’embarras par leur employeur.
Mme LE ROUX et son fils, qui raconte la scène de Kerluherne et leur arrestation montrent l’accusée travaillant à l’enquête en collaboration avec les Allemands.
La femme LAFOURNIERE nie en bloc la sincérité de tous les témoignages ce qui ne semble pas servir sa cause.
L’audience est levée à 20H15.
Repris à 11H cet après-midi les débats sont consacrés au réquisitoire et aux plaidoiries. L’arrêt semble devoir être rendu en fin d’après-midi.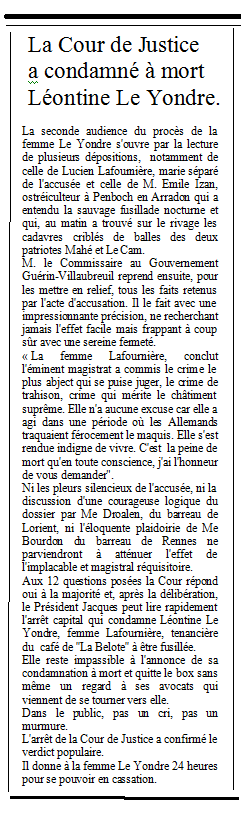
EPILOGUE : L'article de presse ci-dessus, reproduit pour en faciliter la lecture, indique de Léontine LE YONDRE fut condamnée à l'issue du procès à mort et à être fusillée. Ses biens devaient lui être confisqués au profit de l'Etat. Elle est incarcérée à la prison de Rennes. Elle se pouvoit en cassation el 10 mars 1945.
Cependant, le Général De Gaulle la gracie par décret du 24 mars 1945 et sa peine de mort est communée en une peine pour travaux forcés en peprpétuité.
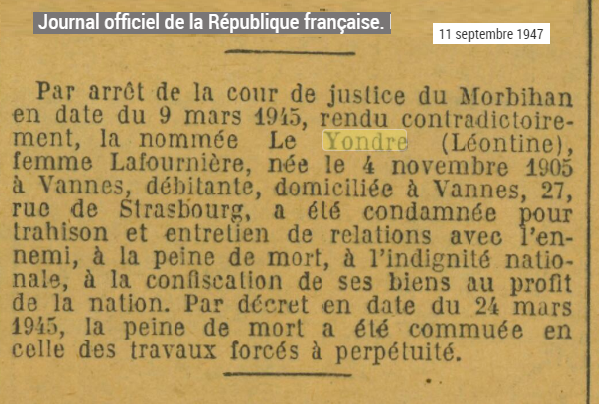
Léontine Eugénie Joséphine LE YONDRE bénéficie d'une grâce le 25/4/1951 et ses biens confisqués lui furent restitués. Elle quite la Bretagne?
Léontine LE YONDRE née à Vannes le 4/11/1915, divorcée de Lucien LAFOURNIERE, se remariera en 1965 à Ormes (71). Sa dernière adresse connue était à Revigny (Jura). Elle décède à l'hôpital 2 rue Regard de Lons Le Saulnier (39) le 13 décembre 1977.
Le déposition de Leontine LE YONDRE 3/4
1ère déclaration de Léontine LE YONDRE le 25/10/1944 (texte en noir) complété par sa 2° déposition du 2/11/1944 (texte en bleu)
Déclaration de madame LE YONDRE Léontine, femme LAFOURNIERE, née le 4 novembre 1905 à Vannes, sans enfant, sans condamnation.
Depuis le 24 septembre 1940, je tiens le café de ‘’La Belote’’ rue de Strasbourg à Vannes. Pendant un an et demi, j’ai vécu en bonne intelligence avec mon mari. Depuis nous sommes séparés de corps ; par la suite j’ai eu plusieurs amants dont un nommé Hans HEINTZ, sujet allemand (ou Alsacien selon sa maitresse) , il travaillait comme chauffeur à la Kriegsmarine. Cela a duré environ 7 à 8 mois. Ensuite, j’ai fréquenté un nommé Georges DEBLED, gendarme à la gendarmerie maritime qui occupait le château de Boloré à Arradon.. (Sur la photo ci-dessous, Léontine et Hans devant la porte du café de la Belote)
L'inculpée, Léontine Eugénie Joséphine LE YONDRE:
La tenancière du bar de la Belote est la fille ainée de Marie Madeleine LE MEITOUR [1/4/1878-7/1/1943] et de Jean Marie LE YONDRE [24/5/1876 Ploeren-6/3/1944 Vannes]. La fratrie comptera 4 soeurs et 2 frères sur les 9 enfants mis au monde par leur mère. Sa jeune soeur Odile, témoignera lors du procès en rappelant que son père, ''un homme violent et sujet à l'intempérance'', l'avait contraint à quitter le foyer dès quelle le put, comme plus tard deux autres membres de la famille.
Dès sa naissance, Léontine est placée en nourrice à Plougoumelen, chez une tante, la dame LE MOUROUX, qui l'a élevée pendant onze années. C'est à Plougoumelen qu'elle est scolarisée dans une école de soeurs. A l'âge de 11 ans, ses parents qui habitaient alors rue de Bel-Air à Vannes, la reprennent auprès d'eux. Ils l'envoie d'abord à l'école des soeurs Jeanne d'Arc, puis à l'école publique Sévigné, rue Le Hellec qu'elle quitte à l'âge de 14 ans environ, après avoir obtenu le Certicicat d'Etudes Primaires Elémentaires. Quelques mois après sa sortie de l'école, Léontine est placée en apprentissage chez Mme Picard, née EPAUL Victorine, demeurant à Vannes, place de l'Hôtel de Ville. Elle est apprentie couturière puis tailleuse pour hommes. Sa soeur dira d'elle qu'elle avait un caractère très changeant et plutôt faible qui la pousse à de mauvaises fréquentations d'hommes algériens rencontrés à l'Hotel du Cheval Noir. Elle perd son emploi et décide de "monter à Paris".
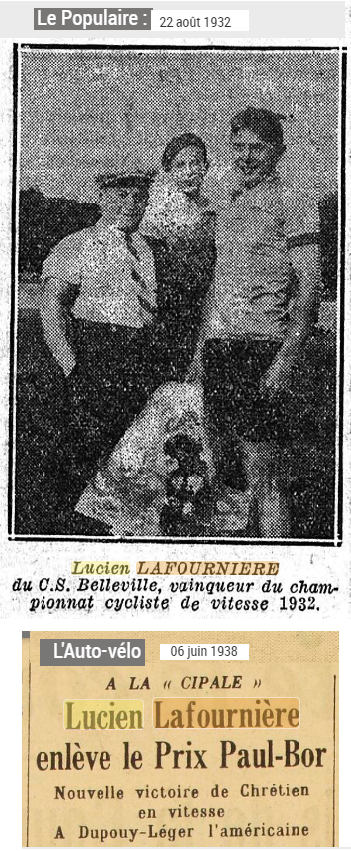
En région parisienne, elle rencontre Lucien Léon LAFOURNIERE, né le 16/7/1908 à Bautain en Haute Marne, alors courreur cycliste professionnel. Elle vivra avec lui 16 ans en concubinage avant de l'épouser dans la commune des Lilas en banlieue parisienne, le 17/9/1940. En tant que femme, elle ne doit pas pouvoir reprendre en son nom la gestion du Café de La Belote a son père, si bien qu'elle se trouve un mari pour l'occasion. Sa mère décède en janvier 1943. Elle divorce le 8/6/1943, lassé de ses infidélités et n'ayant plus l'utilité pour conserver son commerce [vérifier ces points]. Son père décède l'année suivante en mars 1944, avant la Libération de Vannes à l'été 1944.

Pendant toute l’Occupation, mon café était surtout fréquenté par des Boches.
Le dimanche 30 juillet, vers 13H30 il est venu me chercher en me disant de le suivre et m’a emmené au bois de Kerluherne, en passant par le café de l’Océan, Place Gambetta et le café tenu par Mme RUAULT à la Madeleine où nous avons consommé. De là nous nous sommes dirigé vers Sainte Anne. Avant d’arriver au Pont de Kerluherne, MATEL m’a fait entrer dans le bois qui est à gauche de la route. Nous avons atendu un bon moment, il fallait parait-il avoir l’ordre du lieutenant..
Dans le bois, le nommé MATEL a déniché une mitraillette, il me la fait voir et voulait s’en servir pour me descendre ; depuis notre départ il attendait l’ordre de son lieutenant ; ne l’ayant pas reçu et ne voulant pas me descendre, il a recaché sa mitraillette. Il était environ 17H.
Il a profité de la circonstance pour abuser de moi et m’a demandé une somme de 20.000 frs. Ensuite m’a relâchée en me donnant rendez-vous chez moi vers 19H. Je suis parti seule et me suis arrêté en cours de route au café RUAULT, déjà précité, et où j’ai pris une consommation. Je suis rentré chez moi, 18 Heures.
A ce moment, j’ai ouvert le café, ma bonne étant là, c’était elle qui servait quant à moi, je restais au comptoir à côté d’elle.
J’ai vu toujours vers 19 heures arriver MATEL, qui était suivi de LE CAM et MAHE, sont venus le rejoindre. MAHE je l’avais déjà remarqué au café RUAULT à la Madeleine; Un des trois hommes a demandé à ma bonne à quelle heure je fermais mon café et se sont intéressés au départ des militaires allemands.
.A ce moment, j’ai eu peur car ils étaient ivres j’ai demandé à ma vosine Mme Préjean d’avertir ma bonne et qu’elle vienne me rejoindre à la Feldgendarmerie. Quant à moi, je suis partie téléphoner aux Feldgendarmes depuis la Caserne de la Bourdonnaye. J’ai dit au téléphone que l’homme qui était venu m’attaquer chez moi était dans mon café et consommait avec ses camarades, les nommés LE CAM et MAHE. Je suis resté à la Bourdonnaye environ ¾ d’heure puis je me suis rendue à la Feldgendarmerie. J’ai trouvé la bonne dans une pièce au 1er étage ma bonne y était déjà, plus tard dans la soirée, on m’a mis en présence de Mme RUAULT. A ce moment là je lui ai dit « que je défendais ma peau ayant été attaquée à main armée dans la journée ». Ma bonne et moi avons couchées ce soir là à la Feldgendarmerie.
La Feldgendarmerie à Vannes était située rue des Fontaines, certainement à la place de l'hotel Desne-Dolo, à l'opposé de l'église de saint-Patern. Léontine LE YONDRE et sa bonne Simone PASCO pouvaient dormir dans les anciennes chambres de l'hôtel.
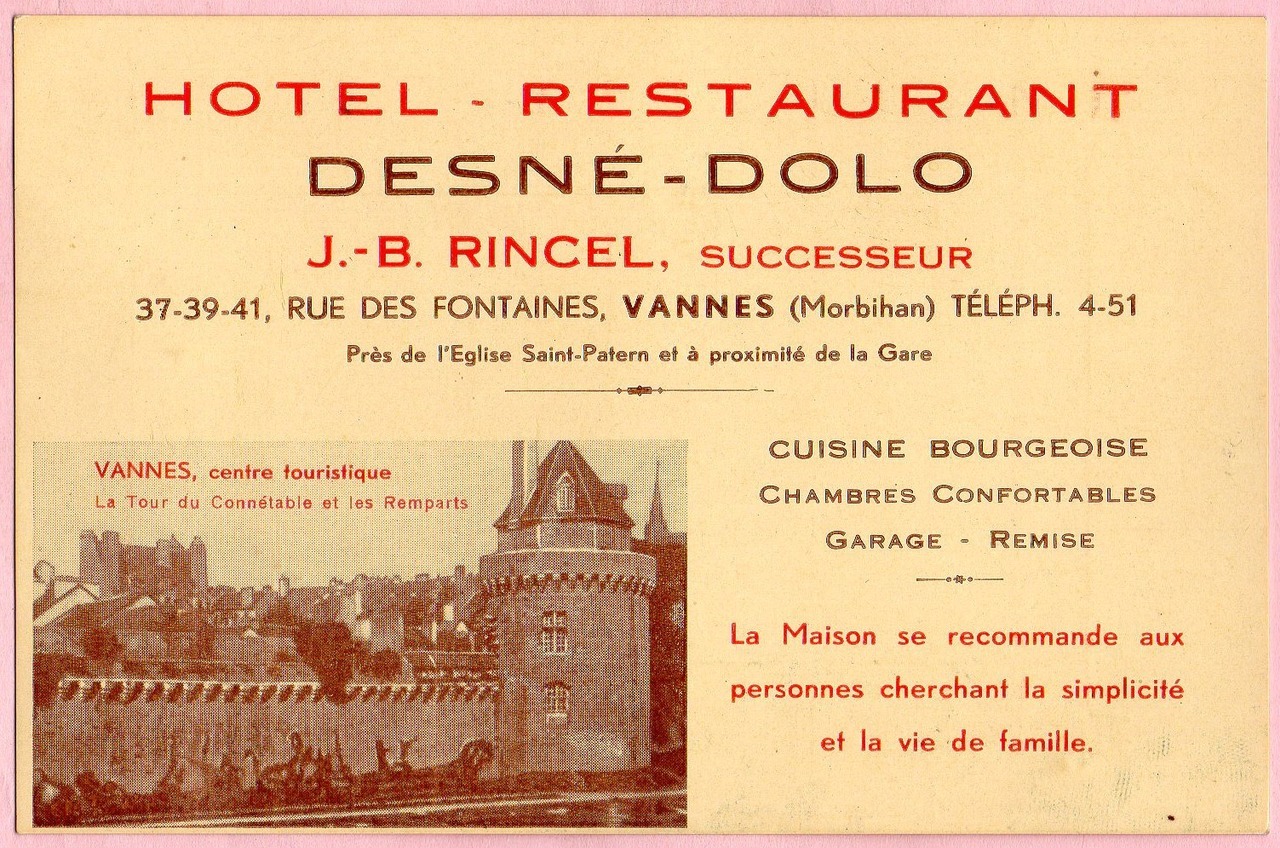
Le lendemain matin, lundi, je n’ai pas bougé de la Feldgendarmerie nous sommes parties ma bonne et moi avec les feldgendarmes à Auray. Nou sommes passsés par Arradon, j’avais du linge à y déposer. A notre retour, il était 12 heures 30 environ, nous avons mangées chez Dréano . Avant de déjeuner, vers 11H30, on est venu me chercher dans ma chambre pour voir si je reconnaissais un homme qui était allongé par terre, la figure tuméfiée, j’ai reconnu l’agresseur de la veille, ensuite nous sommes allé manger ma bonne et moi au café Dréano accompagnée de gendarmes allemands. J’ai dit au feldgendarmes qu’il m’avait sauvé la vie et qu’il avait empêché ses camarades de me descendre.
L’après-midi, vers 15 heures 30, ils sont venus me chercher dans la chambre, Ils m’ont habillé en sous-officier allemand pour aller reconnaître les agresseurs de la veille. , ils donné une capote allemande, une casquette et une paire de lunettes noires. Je suis montée dans la voiture habillée de cette façon, nous avons pris la rue des Fontaines, place Lyautey, rue du Mené, rue Hoche, toute de Sainte Anne, et nous nous sommes arrêtés au pont de Kerkuherne.
Il y avait deux voitures allemandes et neuf boches. Ils ont commencés à fouiller le bois, après m’avoir demandé où se trouvait la mitraillette de MATEL, nous avons fait des recherches dans tout le bois mais je n’ai pu retrouver l’endroit ; voyant que l’on ne trouvait rien nous sommes allés à la ferme Le ROUX à Kergrain que je connaissais pas qui se trouvait pas loin de là.
Mme LE ROUX était au champs avec deux ou trois personnes ? Je suis allé moi-même lui demander si son fils n’était pas lieutenant. J’ai ajouté ‘’pourtant les Allemands disent qu’un lieutenant terroriste loge chez vous. Mme RUAULT a nié. Les Allemands lui ont demandé de les suivre à la ferme. Auparavant ils avaient cerné celle-ci. LE ROUX ne se trouvant pas à la ferme, ils sont allés le chercher et l’ont ramené Alors que nous nous trouvions les Allemands et moi dans la cour, le fils LE ROUX est arrivé. Les Allemands l’ont frappé et l’ont contraint à ce mettre contre un mur les bras en l’air, tout cela c’est passé en ma présence. C’est à ce moment qu’une personne agée que je ne connaissais pas est venue demander à Mme LE ROUX s’il elle pouvait lui prêter une charrette et un cheval pour emmener une bête qui était malade. Les Allemands ont cru qu’ils complotaient. J’ai dit à l’interprète que les paroles de ces personnes étaient correctes. Ils ont appelés la belle-fille, Mme LE ROUX et la personne âgée et les ont placé contre le mur, dans la même position que le fils. Ensuite ils ont fouillé la maison. Pendant ce temps j’étais dans la cour avec deux Allemands. Ils ont demandé au fils LE ROUX ses papiers, quel métier il exerçait, il a reconnu de lui de menuisier. L’Allemand lui a demandé à plusieurs reprises s’il était Lieutenant, à chaque fois il a répondu « Non ». ils l’ont encore frappé puis l’ont remis au mur. Tout cela se passait en ma présence. Lors de la perquisition, les Allemands ont trouvé un costume de soldat de couleur kaki, ils lui ont demandé d’où il provenait l’ont obligé à la prendre et à les suivre. LE ROUX marchait devant moi vers les voitures, il est monté dans la première, moi dans la seconde avec trois Allemands et nous nous sommes rendus à la Feldgendarmerie. Ils m’ont demandés si je connaissais le nommé LE ROUX, je leur répondis que non, ils ont fait monté LE ROUX dans la voiture en le frappant et en le bousculant ; quant à moi, je suis montée dans la seconde et nous avons fait la route vers la Feldgendarmerie.
En cours de route, j’ai enlevé l’uniforme boche que je portais. A notre arrivée, j’ai quitté le costume de sous-officier allemand. Le soir, moi et ma bonne avons soupé au Café Dréano et couché à la Feldgendarmerie. Le mardi, j’ai déjeuné chez Dréano. Vers les 15 heures environ je me suis rendu accompagnée d’un Allemand chez Choubert. Le soir après diner, je me suis rendu vers les 20 heures, et accompagné de duex Allemands, chez moi, en traversant la cour de la gare. Nous avons rendu visite à Mme MAHE qui habite rue de Strasbourg prolongée, pour prendre la gérance du café ; Mme MAHE nous a offert une consommation et nous avons trinqué ensemble, m abonne m’accompagnait. Le soir, j’ai couché au Cheval Noir avec ma bonne.
Le soir je me suis rendu, accompagnée de ma bonne et d’un Allemand chez Dréano où nous avons déjeuné. Après déjeuner, je me suis rendue à la Feldgendarmerie, pour leur demander de me conduire à Arradon. Ils ont alors accepté car ils se rendaient à Auray, et afin de me rendre service, repassèrent le soir à Arradon. Nous sommes rentrés vers 18 heures, avons soupé le soir chez Dréano et couché au Cheval Noir.
Le jeudi, nous sommes allées, ma bonne et moi, à la Feldgendarmerie pour y prendre son vélo, car elle avait l’intention de se rendre chez elle, c’est alors qu’un Allemand est venu la chercher pour la conduire à l’hôpital parce qu’elle avait contaminé un soldat allemand. J’ai déjeuné seule chez Dréano, vers 14 heures. L’après-midi, je me suis rendu seule, rue Pasteur, afin d’essayer de trouver une occasion pour partir, j’ai quitté Vannes par un camion dont je ne connaissais pas le chauffeur. Je suis allé à Paris où j’ai pris en gérance un café, au 7 rue Victor Hugo à Charenton où l’on est venu m’arrêter le 18 octobre 1944.
Je regrette tout ce que j’ai fait, je l’ai fait sans aucun ordre je n’ai jamais touché d’argent et ne suis inscrite à aucun parti politique.
A Vannes le 23 octobre 1944.
Lu persiste et signe.
La traitresse de Kerdavid 1944
C'est par ce titre, dans son livre intitulé "1939-1945 La Wermarcht en Bro-Gwened, que Jean RICHARD nous relate l'histoire de l'épouse d'un marin sinagot qui fut assassinée en juillet 1944. Sans cet effort de mettre par écrit la mémoire de nos anciens, cette anecdote de l'Occupation aurait été oubliée...
Une femme tuée par une arme à feu, cela doit laisser des traces?
En cherchant sur le site des Archives du Morbihan avec le nom de son mari RIDAN et en se limitant au mois de juillet 1944, on trouve "bingo" un article qui rend compte de la mort de Anne Marie ALEXANDRE, femme du marin sinagot RIDAN de Kerdavid.
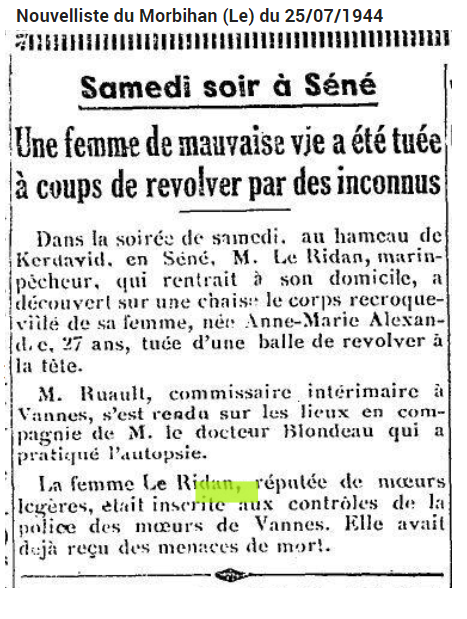
Il aura suffit d'un seul coup de révolver pour tuer Anne Marie ALEXANDRE épouse RIDAN, assise sur une chaise à son domicile dans le village de Kerdavid. On va en mairie chercher son acte de décès pour toujours vérifier les identités des personnes. Il nous apporte la précision sur l'heure dee l'assasssinat: 23H. Le commissaire intérimaire RUAULT fut dépêché sur les lieux. Le médecin militaire Jean Albert BLONDEAU [6/7/1876 Figeac - 4/2/1962 Vannes], ancien du 265° Régiment d'Infanterie de Vannes fit l'autopsie.
Que sait-on sur la victime?
Anne Marie ALEXANDRE [12/7/1917 Vannes - 22/7/1944 Kerdavid Séné] était la fille du couvreur puis ouvrier au télépgraphe, Léon Marie ALEXANDRE [11/4/1885 Vannes - 24/121954 Vannes]. Elle vient au monde alors que son père est mobilisé sur le front. Son père perdra son épouse Anne Joséphine GUEDO [1/11/1887 Vannes - 13/6/1939] et il se remariera le 8/3/1941 avec Marie Françoise AUDO. Elle avait une soeur, Odette ALEXANDRE, née après la démobilisation de son père. [11/5/1919-22/7/2006 Rebais-77].
Souffant de problèmes pulmonaires, son père Léon Aexandre est plusieurs fois en convalescence pendant l conflit.. Bléssé à deux reprises, il est gazé en octobre 1918. Est-ce à cause de ces années de guerre que sa fille, dans un jugement en date du 14 octobre 1930, sera "adoptée par la Nation"?[rechercher l'acte].
A l'âge de 23 ans, la jeune femme épouse un marin sinagot, Ernest Louis RIDAN [30/3/1912 Cadouarn - 10/2/1979] le 8 mai 1940 à Vannes. Il était le 3° enfant au sein d'une famille de de marins comptant 6 enfants: Ernest, 1912, Ange, 1908, Louis, 1910, Désirée, 1917, Robert, 1926, Jean André, 1929.
Ernest Louis RIDAN était décoré depuis 1937 de la Médaille d'Honneur de la Marine de Commerce. Il se remariera le 17/9/1946 à Saint-Port sur Gironde avec Odette Ida Taphanel.
Que sait-il pasé pendant l'Occupation?
Son époux, Ernest a été sans doute mobilisé en 1939, âgé de 27 ans. L'acte de mariage nous indique que lors d'une permission, le quartier maître chauffeur dans la marine vint à Vannes épouser Anne Marie ALEXANDRE. A-t-il été fait prisonnier? L'article de presse ajoute que la victime était "inscrite aux contrôles de la police des moeurs de Vannes" et avait reçue des menaces de mort. Il semble que la victime se soit donnée à de la prostitution, peut-être fréquenté les soldats allamends et doné ou divulgué par maladresse des informations sur les résistants sinagots à quelques semaines de la Libération.
Que sait-on sur l'auteur de ce réglement de compte?
Un dénommé "Bouboule" aurait tué d'un coup de révolver la traitresse de Kerdavid, le samedi 22 juillet 1944 vers 23H. Ce pseudonyme était fréquent pendant la guerre au sein des résistants. La rumeur courrait que femme Ridan allait dénoncer une quinzaine de jeunes Sinagots pour leur engagement dans la Résistance...Sur son acte de décès enregistre par René FAYET, le maire nommé par Vichy, aucune mention de sa mort violente.
Pour quelle raison en était-elle arrivé-là?
Plus...
LE RAY, SEVENO, LE ROI et GUELZEC, déportés sinagots
L'historien amateur qui s'intéresse à la Seconde Guerre Mondiale commence par résencer et relater les Sinagots Morts pour la France. Ensuite, il s'intéresse aux résistants bien répertoriés par le Service Historique de la Défense. Comment ne pas dès lors chercher si des Sinagots n'ont pas été déportés par les Allemands?
On se souvient de Louis et Anne Marie Enizan dont les parents étaient orginaires de Séné. A ce jour, trois autres Sinagots ont été identifiés comme déportés en Allemagne. Il s'agit de François LE RAY [23/11/1921 Vannes- 30/5/1990 Vannes], de Joseph SEVENO [4/8/1914 Séné - 28/12/1982 Concarneau]? d'Albert LE ROI [29/12/1912 - 31/5/1944 Paris] et d'Arthur GUELZEC [5/06/1914 Vannes - 21/12/1984 Séné]. Si les trois premiers furent libérés de leurs geôles allemandes par les Alliés, GUELZEC réussit à s'évader.
1-François LE RAY [23/11/1921 Vannes- 30/5/1990 Vannes],
Déportation : à la mémoire de François
Texte de Louis LE BOULICAUT, neveu de François LE RAY, paru dans le journal. L'auteur choisit de faire parler son oncle défunt en puisant dans les souvenirs des conversations qu'il eut avec lui.
Le 3 septembre 1939, à notre entrée en guerre, moi, François LE RAY, né le 23 novembre 1921 à Vannes, je vivais au Versa à Séné, chez ma mère, veuve depuis le 14 juillet 1928. Je travaillais comme plâtrier chez Botze, entrepreneur vannetais, rue du Roulage, où j’avais appris mon métier.
Pour conforter leurs installations chez nous, les ‘’Fridolins’’ entreprirent de fortifier les façades maritimes et je me suis retrouvé sur le chantier de la base sous-marine de Lorient.
Fridolin: Surnom donné aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale
Est venu ensuite le temps de l’application des accords franco-allemands relatifs au Service du Travail Obligatoire, le ‘’STO’’) en Allemagne. Après quelques visites de gendarmes français chez ma mère, je me suis ‘’réfugié’’ dans les fermes de la campagne vannetaise, pour échapper à ce ‘’STO’’.
Jeune inconscient, je me suis fait surprendre à Vannes le 10 décembre 1943, après le couvre-feu, par une patrouille de « Fridolins’’. Je m’étais attardé avec deux copains à l’entrée du porche donnant accès à une cour située à l’arrière de l’actuel bar-PMU de la rue du Maréchal Leclerc (ancienne rue du Roulage).
Pour m’arrêter, les ‘’Fridolins’’ m’ont coursé jusque sur le toit d’un immeuble voisin où étaient domiciliés mes deux copains. Le lendemain, mes deux copains et moi avons été transférés à Redon. Là-bas, nous avons eu à subir de nombreux interrogatoires très « musclés ». Puis ce fut le retour sur Vannes, à la prison Nazareth.
Le 13 mars 1944, on me poussait en gare de Vannes, au fond d’un wagon à bestiaux. D’instinct, je m’arrangeais pour être bloqué contre une petite ouverture, ce qui m’a permis, tout au long d’un atroce et interminable voyage, de bénéficier de l’air extérieur et de l’eau de pluie.
On nous a sortis brutalement de notre cage puante à Natzweiler et conduits à pied au camp de Struthof. Là, je suis devenu le matricule 103.479 et j’ai dû abandonner mes vêtements pour un léger pyjama rayé dans le sens vertical et deux semelles de bois munies de lanières…
C’est en mai 1945 que les Alliés ont rattrapé notre troupe de zombies, faible reliquat des déportés entrainés par les Boches fuyant Dachau à l’approche des Alliés. Les limaces et les escargots gobés pendant notre sinistre errance m’avaient permis de survivre encore une fois. Dans cet ‘’exode’’ celui qui ne suivait plus était massacré sur place et jeté en bordure du chemin.
Au Struthof, il y avait eu le froid, la boue, la neige, les degrés abrupts des escaliers à gravir ou à descendre en portant des pierres, la nourriture a minima de survie. Tout cela relevant d’une stratégie démoniaque destinée à nous briser et à nous conduire à petit feu vers la mort.
Après cette mise en condition, il y a eu, pour moi, Buchenwald, puis Dachau. J’y ai vu et subi tout ce que des cerveaux dérangés peuvent générer d’atrocités monstrueuses [..]
Toutes ces besognes étaient de notre ressort sous les coups de schlague généreusement distribués par des kapos sélectionnés parmi les droits communs les plus pervers. J’ai vu des enclos où l’on laissait mourir de faim des prisonniers soviétiques totalement privés de nourriture. J’ai vu des pendaisons et des décapitations à l’occasion de nos interminables appels quotidiens dans le froid, la boue, la neige, la chaleur, la poussière. Exécutions publiques, pour l’exemple, à la suite d’une simple esquisse de révolte ou d’une tentative de fuite. J’ai vu des phalanges tranchées, à la hache, toujours à l’occasion de nos rassemblements, pour un chapardage de nourriture, réussi ou tenté.
[..] J’ai du des réveils au petit matin, entouré de camarades morts pendant la nuit ; des injections de produits à expérimenter ; des compagnons se jetant sur les barbelés ou se précipitant vers les miradors pour trouver la délivrance par la mort ; des Boches venir en famille se promener les jours de fête devant nos barbelés. Je pourrais encore en rajouter mais est-ce vraiment nécessaire ?
Pour survivre, je me glissais le plus souvent possible, dans la corvée aux cuisines, où j’arrivais, à la dérobée, à laper dans les bidons d’eaux grasses.
J’ai retrouvé ma mère au Versa en Séné, au mois de mai 1945. J’avais 23 ans et j’étais très abîmé au moral comme au physique. Mes deux copains de la rue du Roulage ne sont jamais revenus.
Le 30 mars 1990, la grande faucheuse m’a foudroyé sur ma bicyclette rue des Quatre Frères Créa’ch à Vannes alors que j’allais, comme tous les jours, sur la tombe de mes parents, de mon épouse et de ma sœur.
Que peut-on ajouter à ce récit émouvant d'un jeune Sinagot soumis à la barbarie nazie?
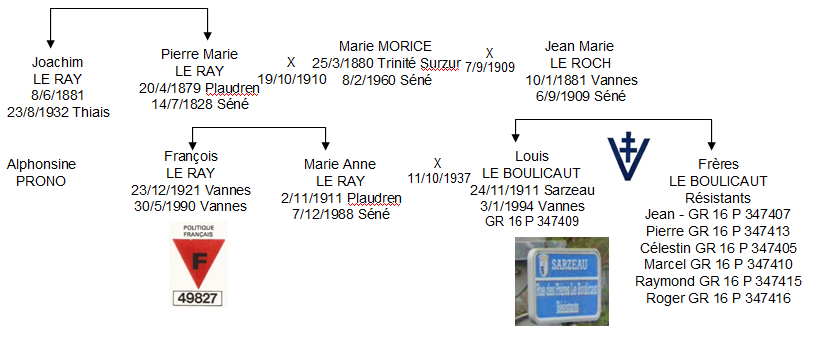
François LE RAY nait au sein d'une famille originaire de Plaudren. Son père, Pierre Marie LE RAY épouse Marie MORICE, veuve de Jean Marie LE ROCH. Leur premier enfant, Marie Anne nait à Plaudren en 1911. La famille s'installe à Séné courant 1912 au Versa.
Sa fiche de matricule nous indique, que Pierre Marie LE RAY est mobilisé et blessé le 9/9/1914 à la cuisse gauche avec raccourcissement de la jambe, lors de la bataille des frontières. Passage à l'hôpital de Bourgueil puis à celui de Tours le 13/4/1915. Il sera renvoyé dans ses foyers.
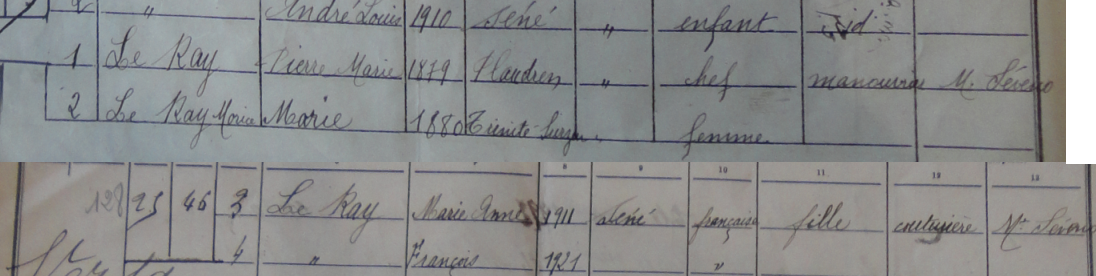
La famille a acheté la maison à langle de Versa et de la route vers Bohalgo. Les ''Le Ray'' apparaissent lors des dénombrements de 1921 et 1926 établis au Versa. Ce trois pièces logent trois familles. Après guerre, il travaille à la forge de Kérino à Vannes. Il décèdera en 1928, victime du tétanos. Il laisse une veuve avec deux enfants, Marie Anne, 17 ans et François 7 ans. qui est sans doute scolarisé sur Bohalgo ou Vannes. A l'âge de travailler, François LE RAY est pris en apparentissage comme ouvrier platrier chez l'entreprise BOLZE, rue du Roulage à Vannes. Fin 1937, sa soeur ainée se marie et quitte le petit logis familial.
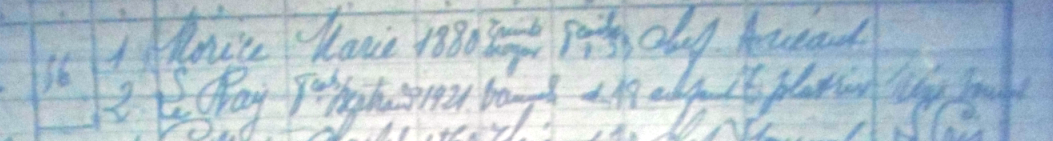
Quand la guerre éclate en septembre 1939, François LE RAY y travaille encore chez BOLZE. Trop jeune pour être mobilisé, il continue a travailler pendant les début de l'Occupation. La construction est à l'arrêt aussi se tourne-t-il vers Lorient, où les Allemands construisent la base de sous-marins. Son petiti-fils se rappelle qu'il réussit à voler un pistolet à un Allemand qu'il cachera dans son jardin à Séné. Quand le Gouvernement de l'Etat Français instaure le Service de Travail Obligatoire, le jeune LE RAY, ne répond pas aux autorités. Recherché par la gendarmerie, il se cache dans les fermes des alentours, à Balgan ou Bézidel. Comme il le raconta à son neveu, par maladresse, il se fait cueillir entant que réfractaires au STO. Il est arrêté lors d'une rafle rue du Roulage avec Robert GUILLO [17/02/1923 La Neuvilette 51-29/11/1944 Gotenhofen] et André EHANNO [9/06/1924 Vannes - 3/5/1945 Lübeck], déportés comme lui et non rentrés. On le soupçonne d'appartenir à un réseau de résistants et le voilà condamné à la déportation.
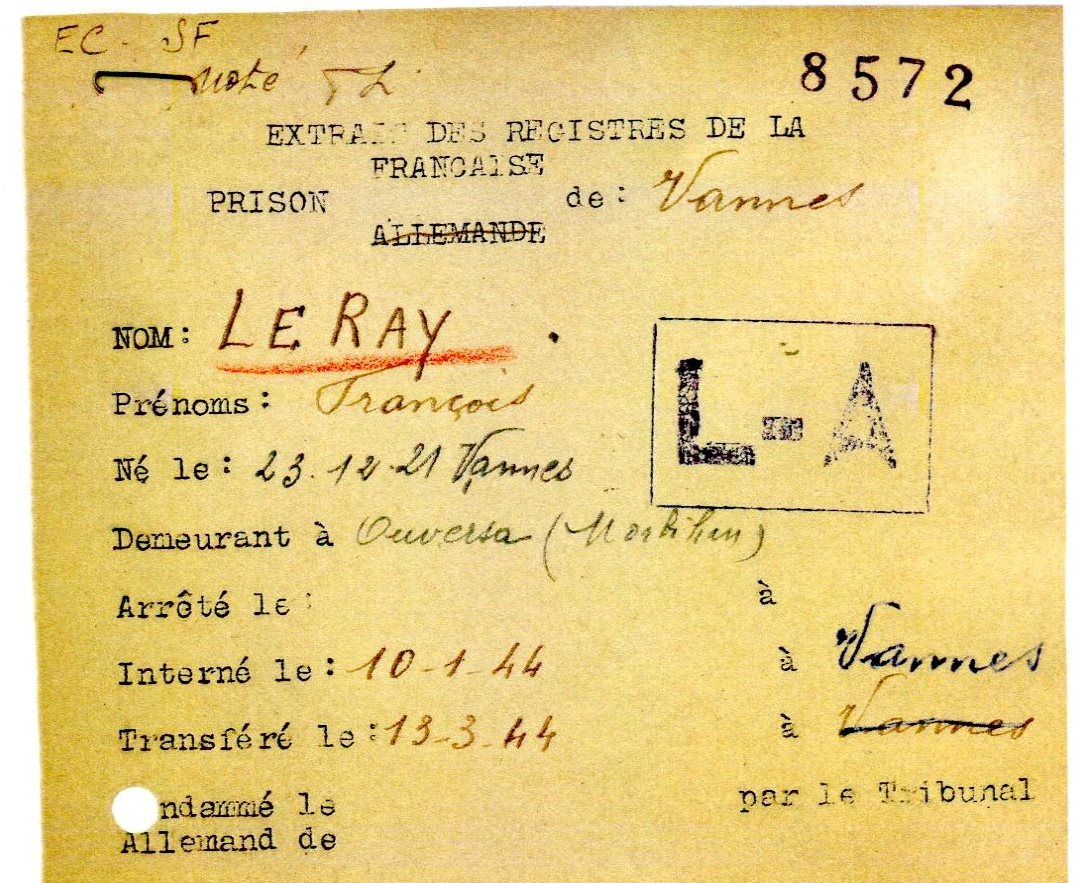
A son retour, il sera interrogé par la gendarmerie dans le cadre de la constitution de son dossier de déporté. Il déclarera: "Le 10 décembre 1943, vers 23 heures, je me trouvais rue du Général Leclerc à Vannes, lorsqu'au cours d'une rafle effectuée par la feldgendarmerie, j'ai été arrêté et conduit à leur bureau ru des Fontaines, d'où dans la même nuit j'ai été dirigé à la maison d'arrêt de vannes. Là, je suis resté une dizaine de jours puis transféré à Redon où après un séjour de trois semaines, j'ai été dirigé sur un camp de concentration à Natzwiller (Bas-Rhin) et par la suite sur différents camps de déportés politiques en Allemagne, notamment à Dachau. J'ai été libéré par les Américians au début de mai 1945 et je suis rentré dans ma famille le 16 du même mois. Si les Allemands ont maintenu mon arrestatin c'est je le suppose parce qu'ils ont découvert sur moi une fausse carte d'identité que je m'étais procurée pour éviter le service du travail obligatoire, auquel j'étais régulièrement astreint."
Arrêté à Vannes, il est conduit à Redon avant d'être incarcéré à la prison de Vannes du 10/1/1944 au 13/03/1944, comme l'atteste cet extrait des registre de la prison de Vannes. Il est embarqué dans un wagon à bestiaux en gare de Vannes pour Paris où le 6 avril 1944, son train redémarre vers le camp de concentration KL Natzweiler-Strudhof en Alsace à nouveau annexée au sein du III° Reich.

Après le débarquement et l'avancée des Alliés sur tous les fronts, les camps de concentrations sont peu à peu évacués vers l'intérieur de l'Allemagne. François LE RAY est évacué parès 3 mois passé dans le camp du Struthoh pour celui de Buchenvald et ensuite le camp de Dachau. Avant que les Américains n'arrivent, les Allemands fuient ce camp avec les derniers prisonniers encore valides, pour une dernière marche funèbre. Son convoi pédestre prendra fin intercepté par les Alliés.
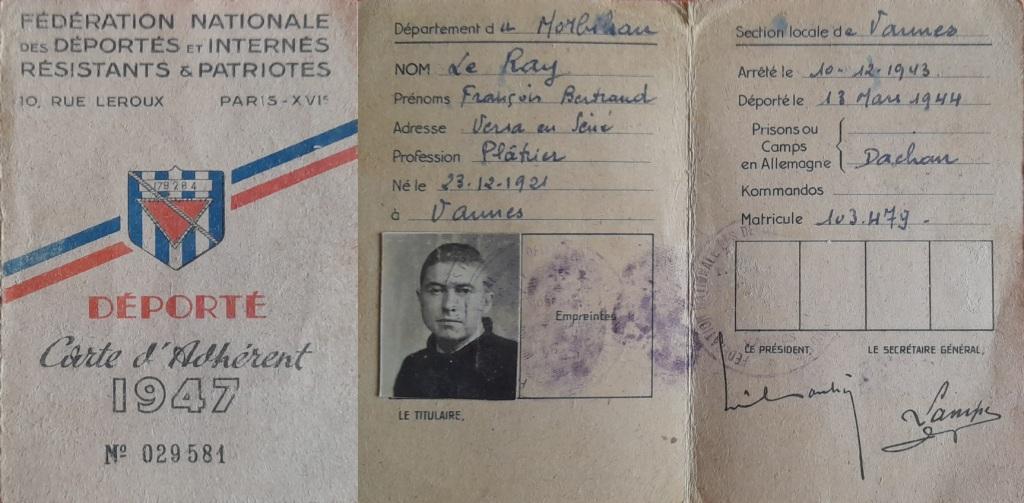
Il revient sur Séné où il retrouve sa soeur, mariée depuis 1937 à Louis LE BOULICAUT (père), et sa mère.
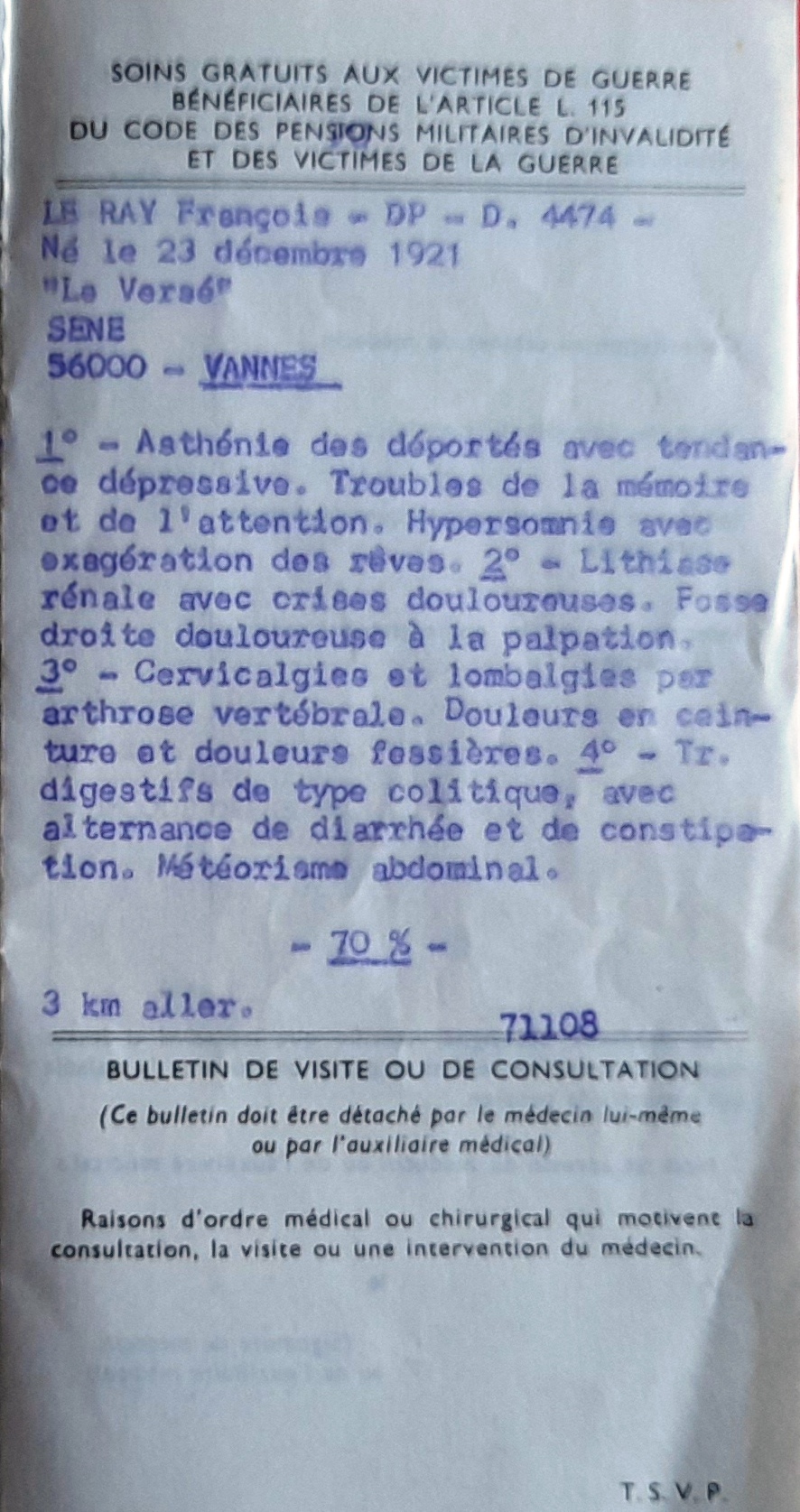
Son état de santé est fragile. Cauchemars, crises de psychose, problèmes rénaux, sont répertoriés dans son carnet de santé. Il obtiendra sa carte de Déporté en 1947 n°029581 et bénéficera d'une petite pension qu'il n'essaiera pas d'améliorer malgré un état de santé précaire.
Il se marie vers 1953-54 avec Alphonsine PRONO à Ploeren. Il reprend des chantiers mais aura une vie professionnelle cahotique altérée par les séquelles de ses mois d'internement. Homme de constitution robuste, mais meurtrie par la déportation, François LE RAY vivra très chichement dans la maison familiale où il refusera l'installation de l'eau courante et l'arrivée de l'électricité, préférant sa lampe à pétrole. Il possédait un vélo pour ses déplacements. A ses heures perdues, cet ancien ouvrier du bâtiment allait chiner dans les décharges pour y récupérer des matériaux afin d'aménager son logis et son jardin. Lui et sa femme feront l'acquisition d'une mobylette qu'ils utiliseront que peu de temps;

Homme simple, solitaire et endurci par la déporation, il se confiera facilement à ses neveux quand ils eurent l'âge de comprendre, let qu'ils venaient rendre visites à leur grand-mère à Séné. Il leur racontait sa vie au camp, les sévices subis, le quotidien d'un prisonnier, les expériences faites sur les détenus et malgré tout sa chance d'en être revenu.
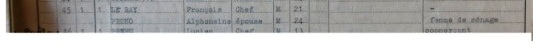
Il était assidu aux visites au cimetière, où reposent sa soeur et sa mère; c'est en allant à bicyclette se recueillir sur la tombe familiale qu'il décède, probablement d'une crise cardiaque, le 30 mai 1990. L'enterrement eut lieu dans l'intimité. Il fut inhumé dans la tombe familiale au cimetière de Boismoreau.
2- Joseph SEVENO [4/8/1914 Séné - 28/12/1982 Concarenau] AC 21 P 674-600
Joseph Louis Théophile SEVENO nait au bourg de Séné au début de la Première Guerre Mondiale. Son père, Vincent Marie [22/9/1878-28/7/1947] déclare alors la profession de second maître mécanicien, pour ce marin militaire engagé qui fera la Grande Guerre [voir au SHD de Lorient son parcours]. Selon l'acte de mariage de son fils, il était décoré de la Légion d'Honneur. Lors du dénombrement de 1921, la famille Seveno est pointée au bourg. Le grand-père Seveno n'était autre que le maréchal ferrant et forgeron du bourg.
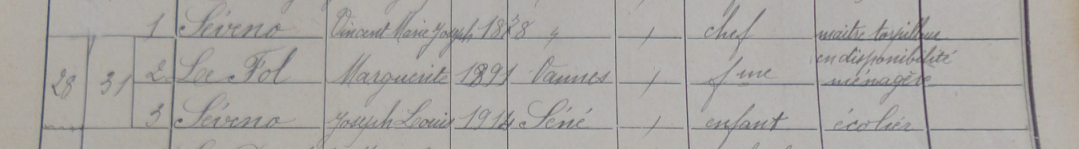
Au dénombrement de 1936, Joseph Séveno est revenu à Séné et déclare la profession d'employé de banque. Il est ensuite clerc de notaire à l'étude de Maître Laudrin Prosper à Vannes avant la guerr et au début de celle-ci. [trouver son dossier de soldat]. Après l'Armistice il revient à Séné, il est alors âgé de 25 ans. Le site de la résistance su Morbihan nous livre ces éléments:
"Chaque lundi du mois d’avril 1942, des départs de détenus extraits des prisons de la Santé, de Fresnes ou du Cherche Midi étaient embarqués dans un train de voyageurs, pour être conduits sous la garde de Feldgendarmes vers la prison de Karlsruhe. Parmi les 6 détenus déportés ce 6 avril 1942, se trouvaient François ALLANO né le 23.01.1907 à Vannes et Joseph SEVENO, né le 04.08.1914 à Séné. Arrêtés pour détention illégale d’arme, vraisemblablement un fusil de chasse, ils ont été tous les deux condamnés à 5 ans de travaux forcés. De Karlsruhe, ils étaient transférés à la prison de Sarrebruck, puis à celle de Rheinbach et enfin à celle de Siegburg."
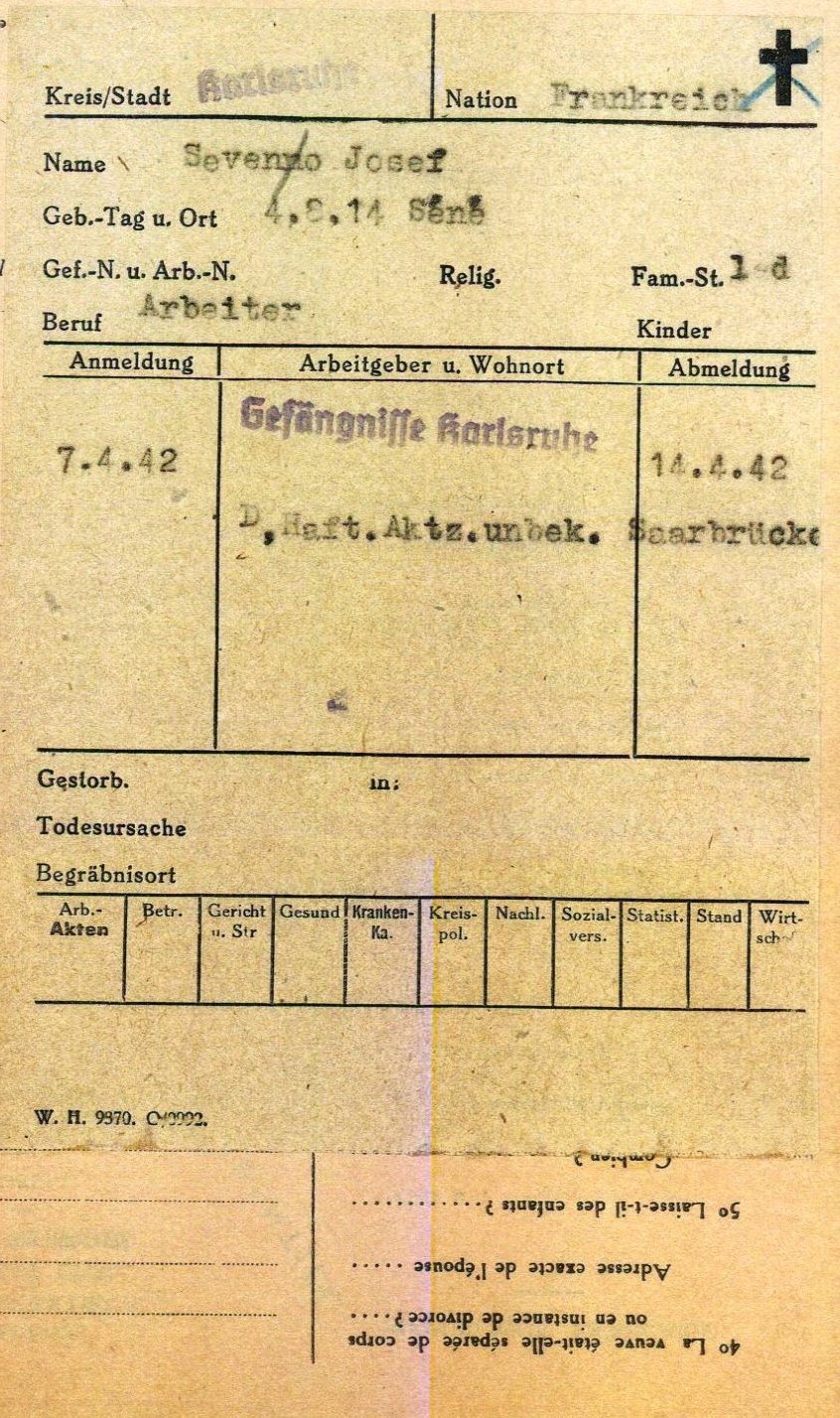
Dans on dossier, on peut lire qu'au cours d'une perquisition faite à son domicile à Séné les Autorités Allemandes on découvert un fusil de chasse qu'il n'avait pas remis à la Mairie. Comme François Allano, il est incarcéré à la prison de Vannes du 18/2/1942 à fin mars 1942. Il est ensuite trnasféré à la prison de Fresne. Dans un convoi de déporté il arrive en Allemagne où il est interné dans différentes prison : Sarrebruch, Trèves, Cologne, Manneheim, Lutwigshafen, Rheinbarch, Cologne et enfuin Siegburg.

Dans le camp de Siegburg, il cotoie le déporté résisitant G. Lepinard, qui reprendra son activité de marbrier à Vannes. Ils seront libérés par les Alliés qui ont établi plusieurs rapports sur l'état de cette prison et de ses détenus.
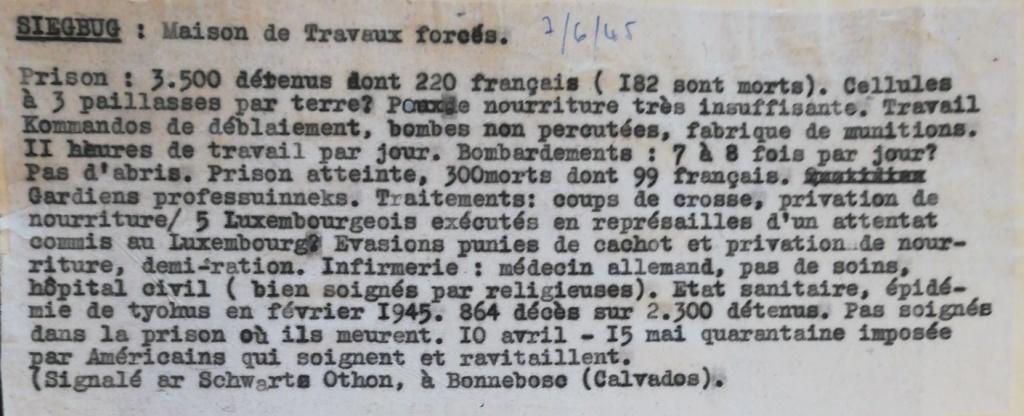
Un autre document conclut:"En résumé, la situation effroyable des détenus de Sieburg a été notifiée 2 jours après l'entrée des troupes américaines: Les mesures médicales prises par le Medical Corps vont enrayer le typhus. Les mesures humanitaires prises par le Major Scarborough vont permettre aux détenus d'attendre avec patience, la fin de leur quarantaine et leur évacutation."
Survivant après 3 ans de détention dans ces conditions effroyables, Joseph SEVENO subit une période de quarantaine avant d'être libéré le 10/4/1945. Il rentre en France. Il sera reconnu "déporté politique" par l'administration française.
Il se marie le 1/7/1947 à Vannes avec Antoinette MATEL et il déclare la profession de clerc de huissier; il réside à Séné. Il se remarie le 14/8/1958 à Concarneau avec Yvette DREAU. Il décède à Concarneau le 28/12/1982.
3-Albert LE ROI [29/12/1912 - 31/5/1944 Paris] dossier AC 21 P 476 519
Dans l'attente de la consultation de son dossier de victime de guerre au SHD de Caen, que sait-on d'Albert Louis LE ROI. Il nait au village de Langle. Son père est marin pêcheur. La famille est recensée au dénombrement de 1921, 1926 et 1931à Langle.
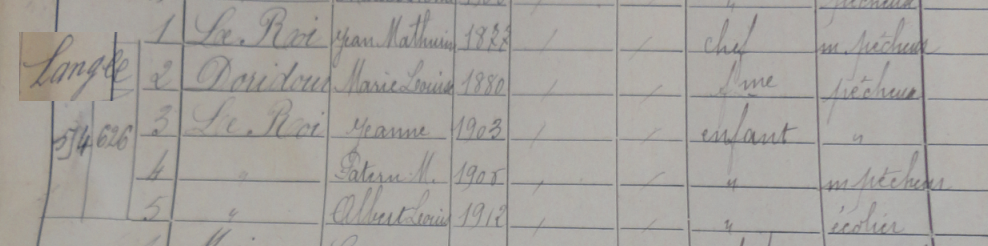
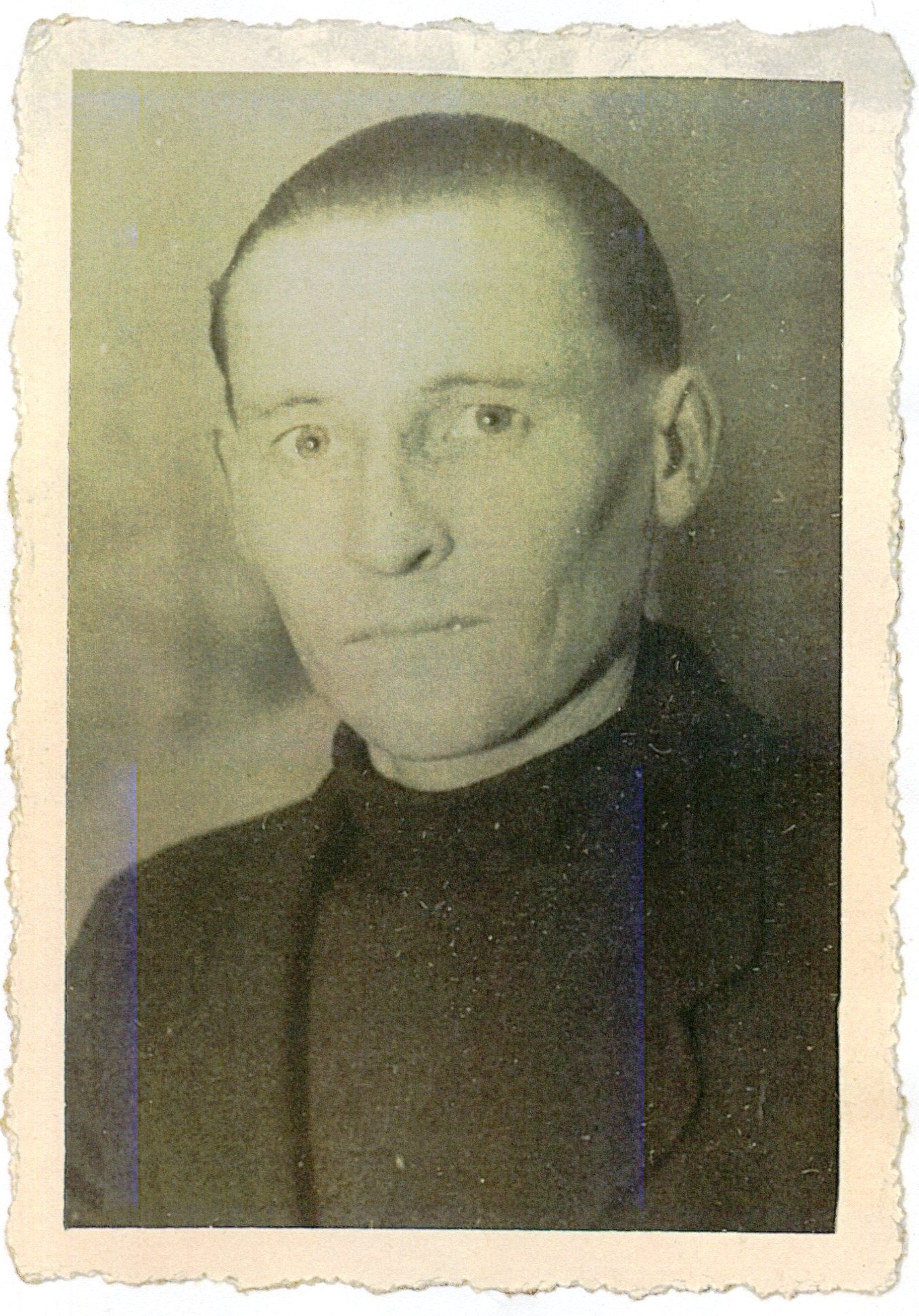
Le 27/1/1936, il se marie avec Reine LE FRANC [30/4/1918-26/10/1979 Eaubonne], dont il divorcera le 15/4/1940. Lors du dénombrement de 1936, le couple vit à Langle et accueille au foyer sa mère veuve. Avant guerre, il est marin de commerce. Pendant l'Occupation, sans travail, il se fait embaucher au port de Vannes; il vit alors à Arradon. Il revient sur Canivarch en Séné. Il est déporté en Allemagne au titre de travailleur requis le 18/12/1942. Il se retouve dans un camp à Srpochavel en Westphalie.
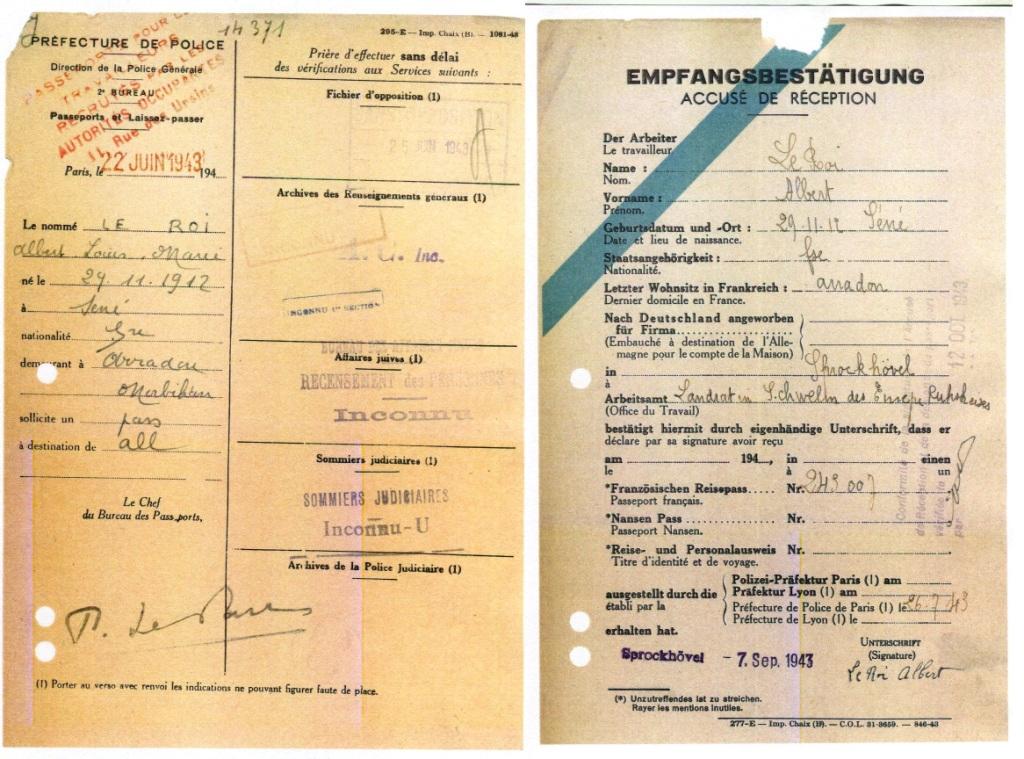
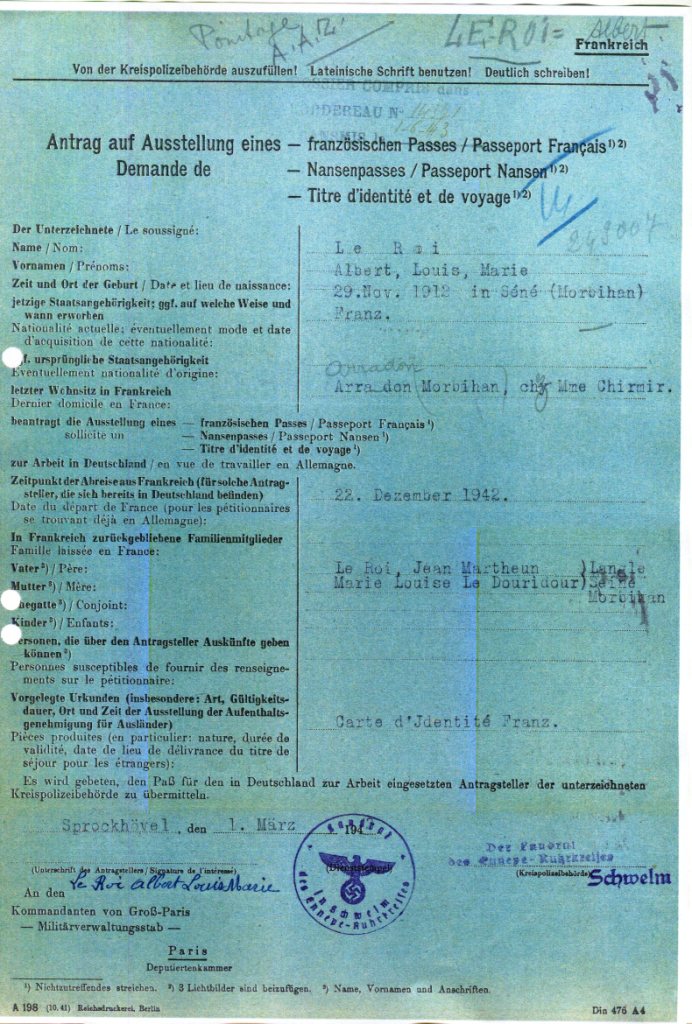
Il tombe malade en Allemagne où il contracte la tuberculose pulmonaire. Il rentre en France où il est accueillie par sa soeur Jeanne LE ROI au Blanc-Mesnil en région parisienne.. Il est alors quelque temps forgeron. Il est admis le 28/12/1943 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris où on lui confirme sa tuberculose pulmonaire bilatérale (les deux poumons sont atteints). Il décède le 31/05/1944.
Arthur Louis GUELZEC [5/06/1914 Vannes - 21/12/1984 Séné].
Les parents d'Arthur GUELZEC se marient le 26/10/1912 à Vannes. Louis Marie GUELZEC est maçon de son métier. Il sera mobilisé en août 1914 au sein du 34° régiment d'artillerie. Tombé malade, il est admis à l'hôpital militaire de Rennes où il finira la guerre. 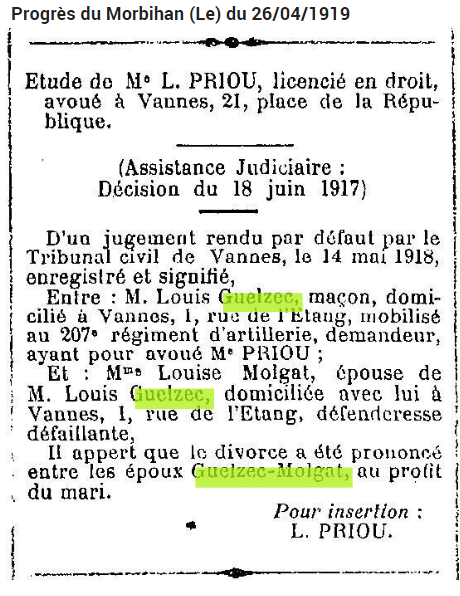
Ce n'est pas un mariage suffisamment solide en cette période de guerre. Le couple divorce en 1917. Marie Louise LE MOLGAT quitte le foyer et son fils est confié à son grand-père Jean Guillaume et à sa grande-tante. Après l'armistice, la famille quitte le 3 Rue de l'Etang à Vannes et gagne la petite maison rue des Vierges à Séné, où cohabient 3 gnérations comme l'indique cet extrait du dénombrement de 1921.
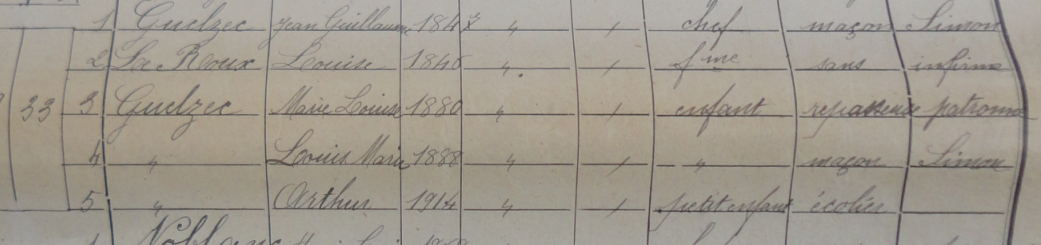
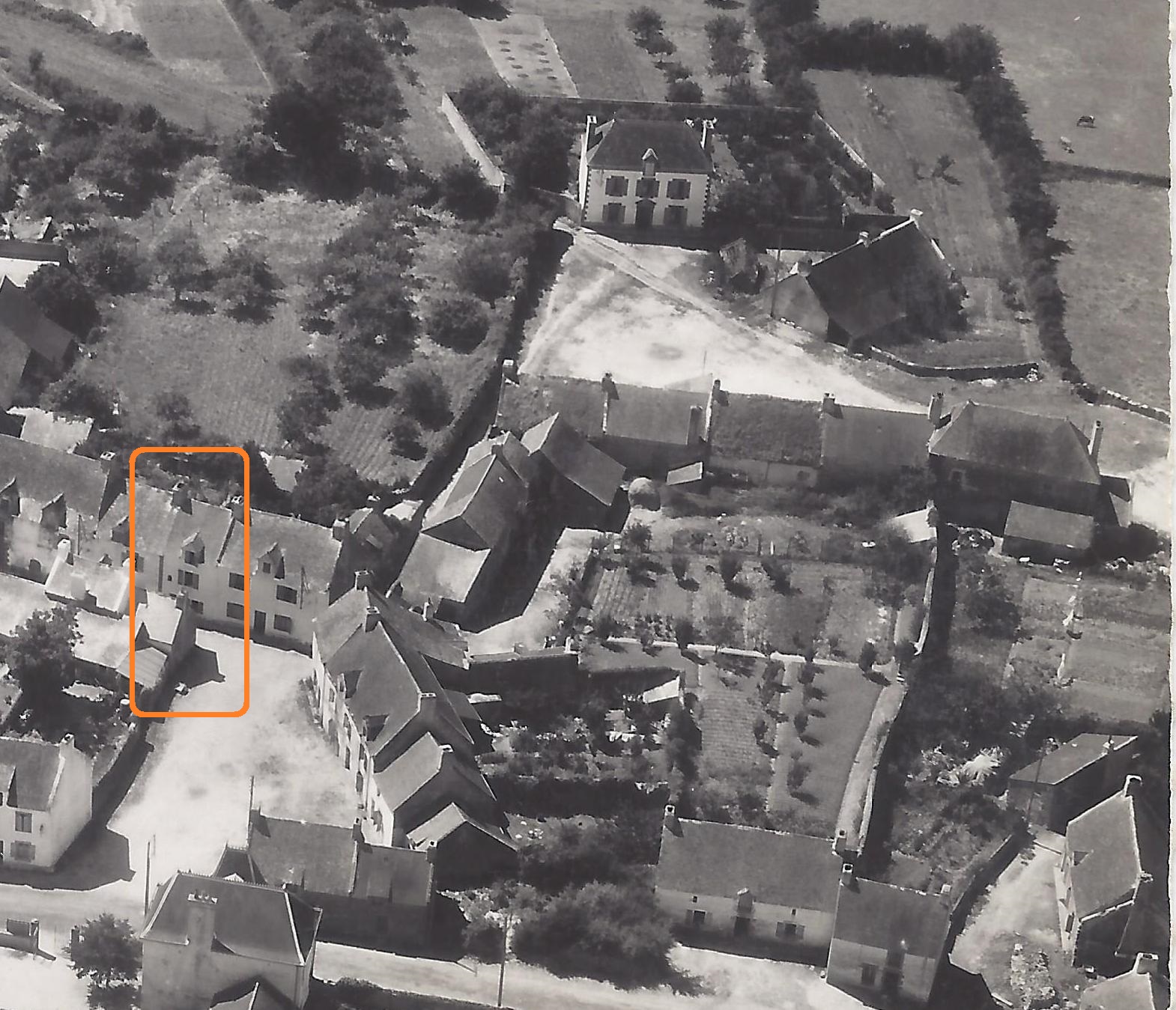
Cette maison et l'autre mitoyenne furent détruites pour faciliter l'accès à ce qui allait devenir la place Coffornic. Louis et son fils vivent à l'étage dans environ 20m² et le grand-père et sa soeur vivent au rez-de-chaussée. La famille Guelzec est recensée en 1931.Arthur, son père et sa tnate vivent sous le même toit reu des Vierges.
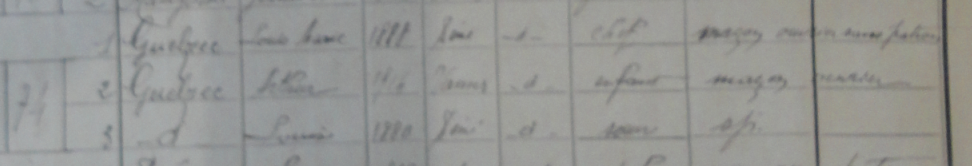
De la classe 1914, Arthur fait son service militaire vers 1934-35 au sein du régiment d'artillerie.

Il se marie en février 1935 avec Madeleine TOSTEN. Il est maçon comme son père. La famille s'agrandit de Louis, né en 1935 puis Christiane née en 1937. 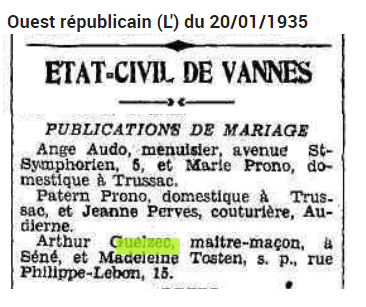
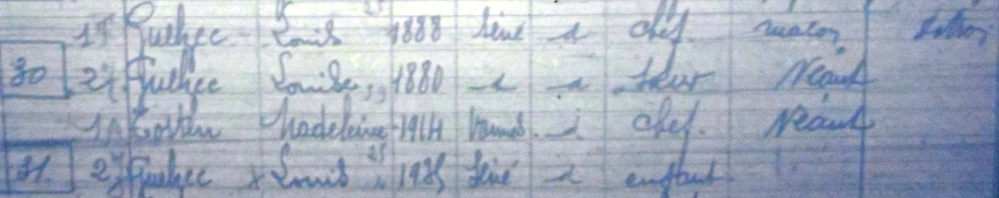
Au dénombrement de 1936, Arthur GUELZEC est absent, il doit accomplir son service militaire. Son épouse Madelien TOSTEN veille sur son fils Louis et sur son beau-père Louis et sa soeur.
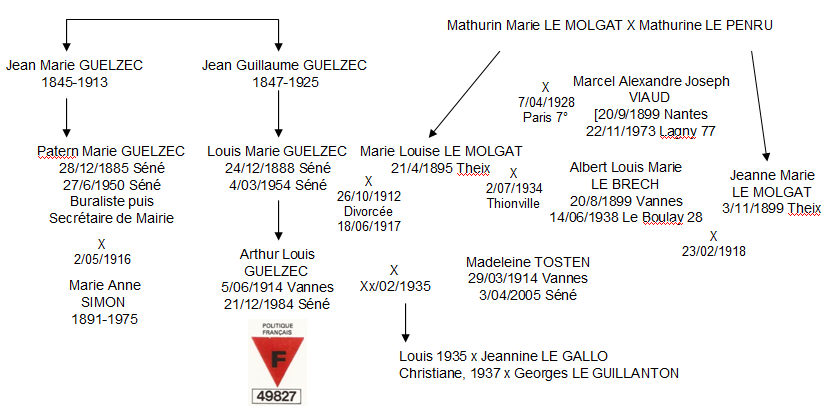
Quand la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, il rejoint le 35° Régiment d'Artillerie qui est posté en Belgique pour contrer une possible pénétration allemande qui se fera par les Ardennes. Cette armée du nord se replie sur Dunkerque pour aider à l'embarquement des Britanniques. Lors de la Bataille de la "poche de Dunkerque", le Sinagot Louis Désiré PIERRE [3/08/1913 - 2/06/1940] décèdera.
- Source wikipedia: le 35e Régiment d'Artillerie Divisionnaire (35e R.A.D.) fut crée le 1er janvier 1934, venant du 35e R.A.C. en garnison à Vannes dissous. Intégrée à la 21e DI le 10 mai 1940, sous les ordres du général Lanquetot. En juin 1940, le 35e R.A.D. est anéanti aux deux tiers protégeant l'embarquement des forces alliées à Dunkerque ( nom de code Opération Dynamo ). Après la Seconde Guerre mondiale, reconstitué en avril 1947 à Tarbes, il devient le 35e R.A.L.P.
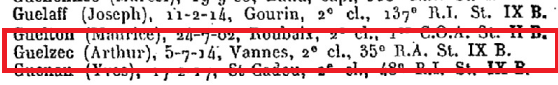
Arthur GUELZEC est fait prisonnier et comme d'autres soldats, il est conduit à pied vers des camps en Allemagne. Le sien se situe à la frontière avec la Pologne annexée par le III° Reich.
[aller au SHD de Vincennes pour consulter son dossier GR 16 P 274043]
Selon sa fille, il réussira au bout de trois tentatives à s'évader et regagnera la France. Après sa seconde évasion, il est expédié dans le camp disciplinaire de Rava Ruska, aujourd'hui en Ukraine, à l'époque en Pologne. Il y restera du 5 mai 1942 au 24 décembre 1942. Ce séjour lui vaudra d'être reconnu comme Interné Résistant. De retour à son Stalag il travaille come couvreur pour les Allemands (en allemand dachdecker). A verso des photos communiquées à la famille, ce tampon en allemand où on lit : Gaprüft: vérifié et Dachdecker : couvreur).
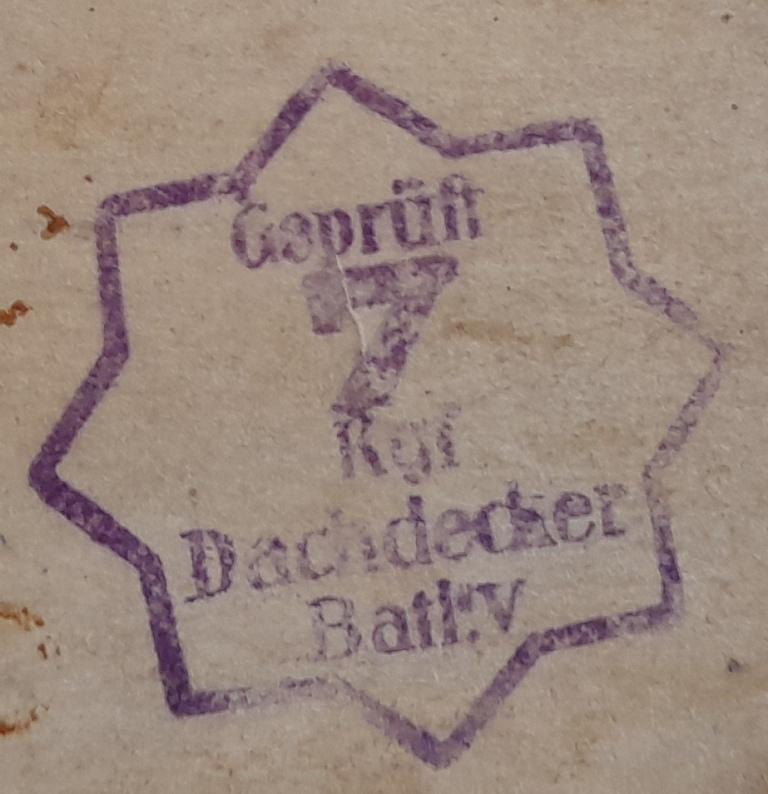
Malgré une ambiance sportive, comme le montre ses photos prises dans le camp et envoyées en 1943 à la famille, Arthur GUELZEC orgnaise uen 3° tentative d'évasion fin 1943, début 1944.
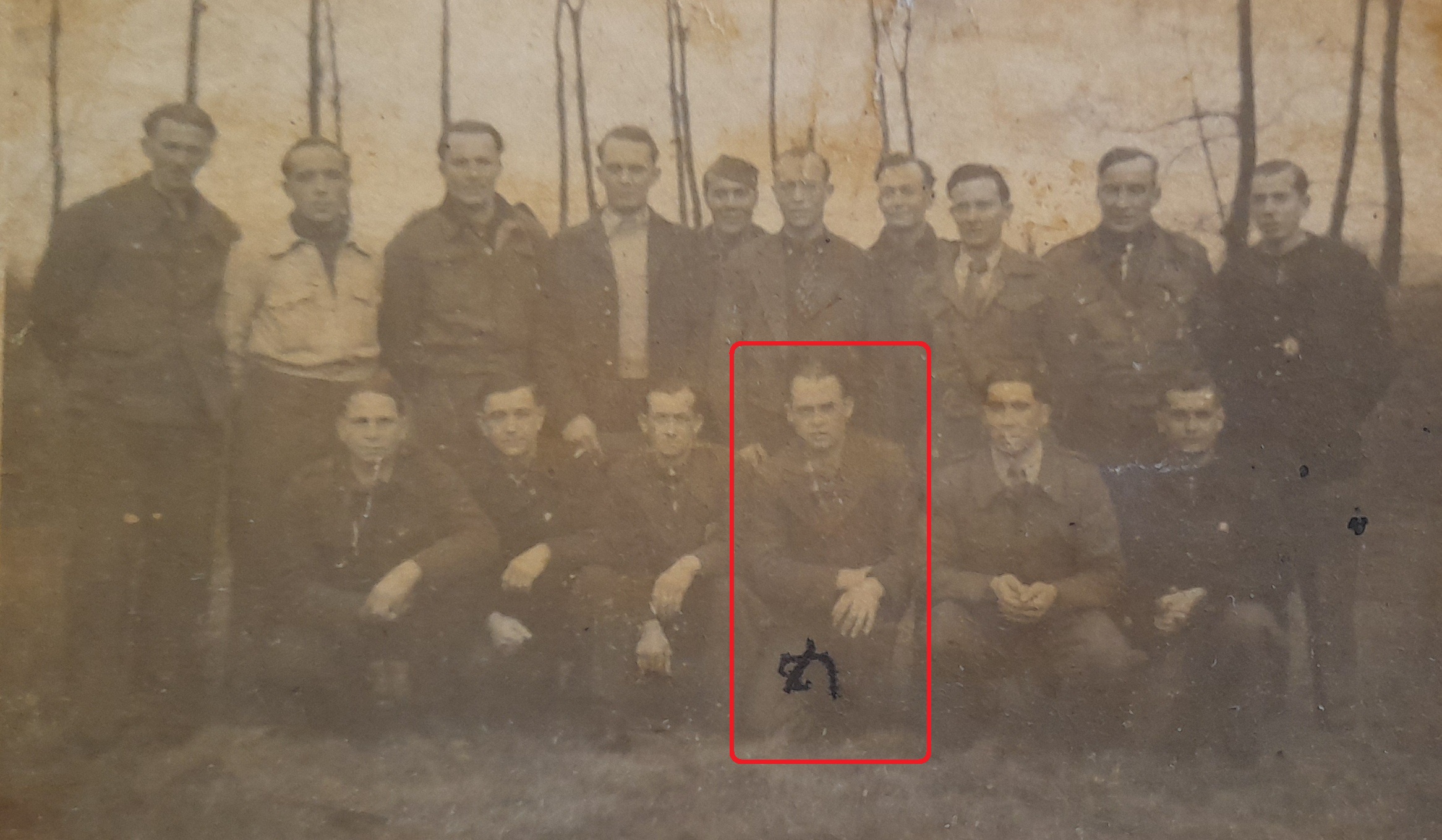
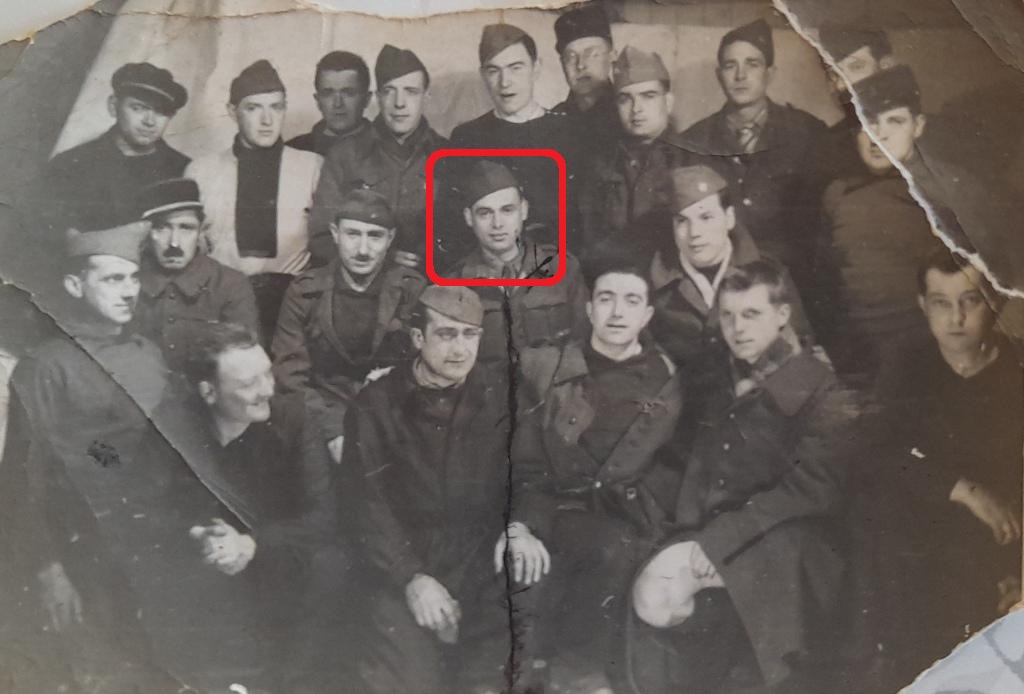

Il s'évade du Stalag avec un camarade, Roger MORICE de Rennes [à identifier]. Ils marchent la nuit et arrivent à voyager cachés sous un train. Ils arrivent à Paris et regagnent la Bretagne.
Une fois à Séné, les Autorités Allemandes avertis de sa présence, le recherchent. Prévenu par la mairie de Séné , où Patern GUELZEC, le cousin de son père, est le secretaire de mairie, il quitte la maison rue des Vierges et se cache à Vannes au Pargo, chez sa tante Marie Vincente LE MOLGAT [28/5/1885-12/9/1968] mariée avec Louis Marie COURTOIS.
Rue des Vierges, les soldats allemands font une descente à la recherche du moindre indice trahissant la présence d'Arthur GUELZEC chez les siens, notamment des tickets de rationnement. Soldats casqués, mitraillette à la main, impressionnent les deux enfants, d'autant que leur mère est emmenée à la Commandatur de Vannes, place de la République. Elle sera libérée au bout de 10 jours grâce à l'appui de femmes allemandes chez qui elle était allée faire le ménage.
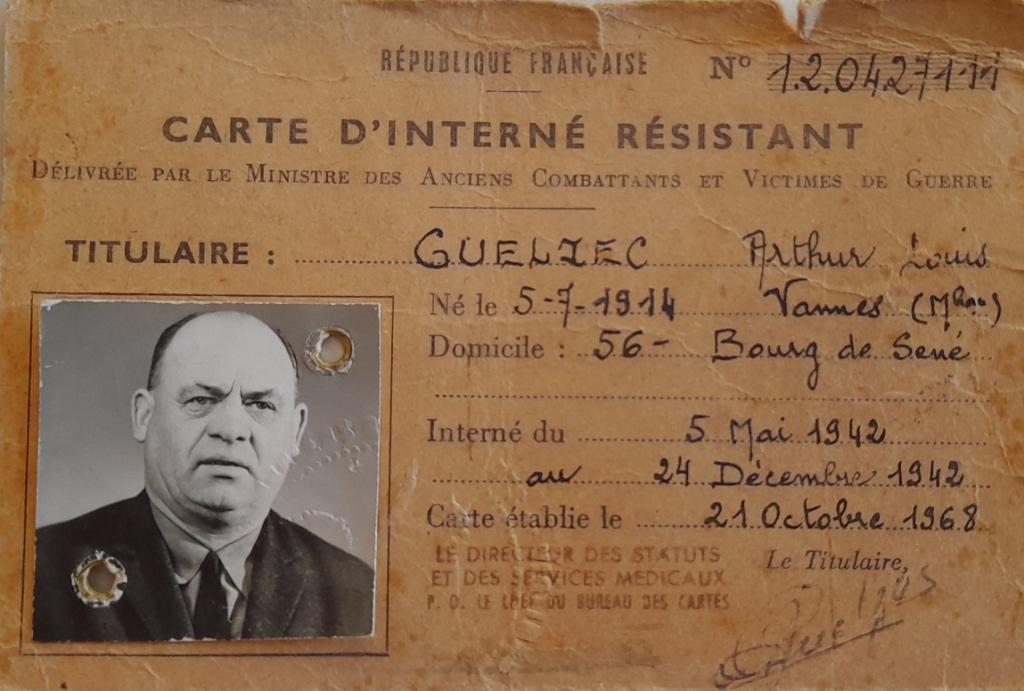
Après la Libération, il participe au déminage de Lorient pour lequel il suit des cours à Saint-Germain en Laye. Maçon comme son père, il fonde son entreprise qui comptera jusqu'à 20 ouvriers. Au début des années 1950, il achète 1.000 m² de landes à M. Noblan où il construit le hangar pour son enteprise puis une belle demeure toujours présente à Bel Air.
Il décède à Séné à quelques jours de Nöel 1984.
Joseph PIERRE, timonier sur le "Curie" par Pierre OILLO
Article repris sur le site france-libre.net, écrit par M.Pierre OILLO. quelques rajout de wiki-sene. Original en pièce jointe.
JOSEPH PIERRE, TIMONIER SUR LE «CURIE»,
SOUS-MARIN DES FORCES NAVALES FRANÇAISES LIBRES
La famille de Joseph PIERRE [31/3/1924-22/4/212] est originaire de Séné où il est né le 31 mars 1924. La famille est pointée lors du dénombrement de 1926 et vit au village de Cadouarn. Tous les enfants sont nés à Séné. Joseph reprend le prénom de son frère mort nourrisson en 1923. Son père, marin-pêcheur à Séné va s'installer à l'Île d'Arz vers 1930 pour y exploiter des parcs à huîtres. Ses parents décèderont sur l'île aux Capitaines.
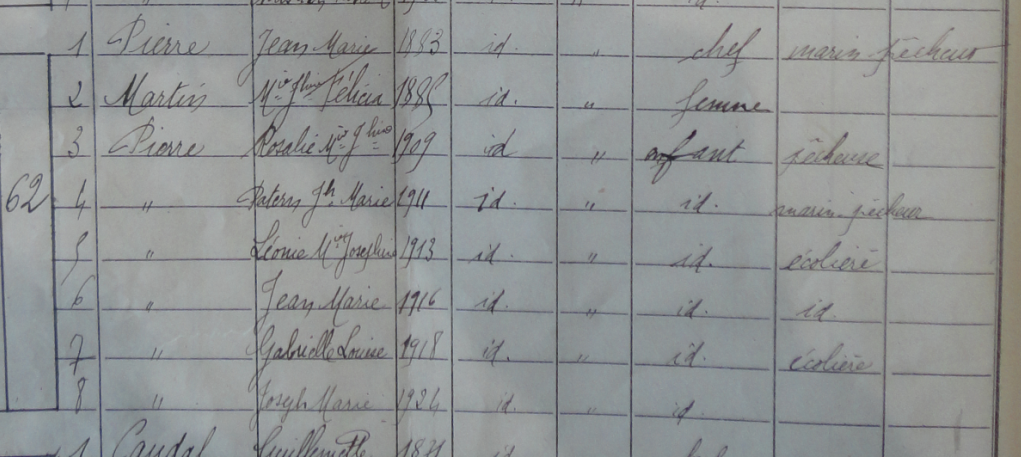

Dès son plus jeune âge, comme de nombreux jeunes originaires de cette île du golfe du Morbihan, il sait qu’il répondra à l’appel de la mer ; non pas comme marin-pêcheur mais qu’il s’engagera dans la marine marchande et voyagera à travers le monde. Il est d'abord mousse en août 1938 sur le Suzanne; Au début de 1939, Joseph n’a que 14 ans, quand il embarque comme mousse dans le port de Lorient sur un cargo charbonnier : l’Armenier.
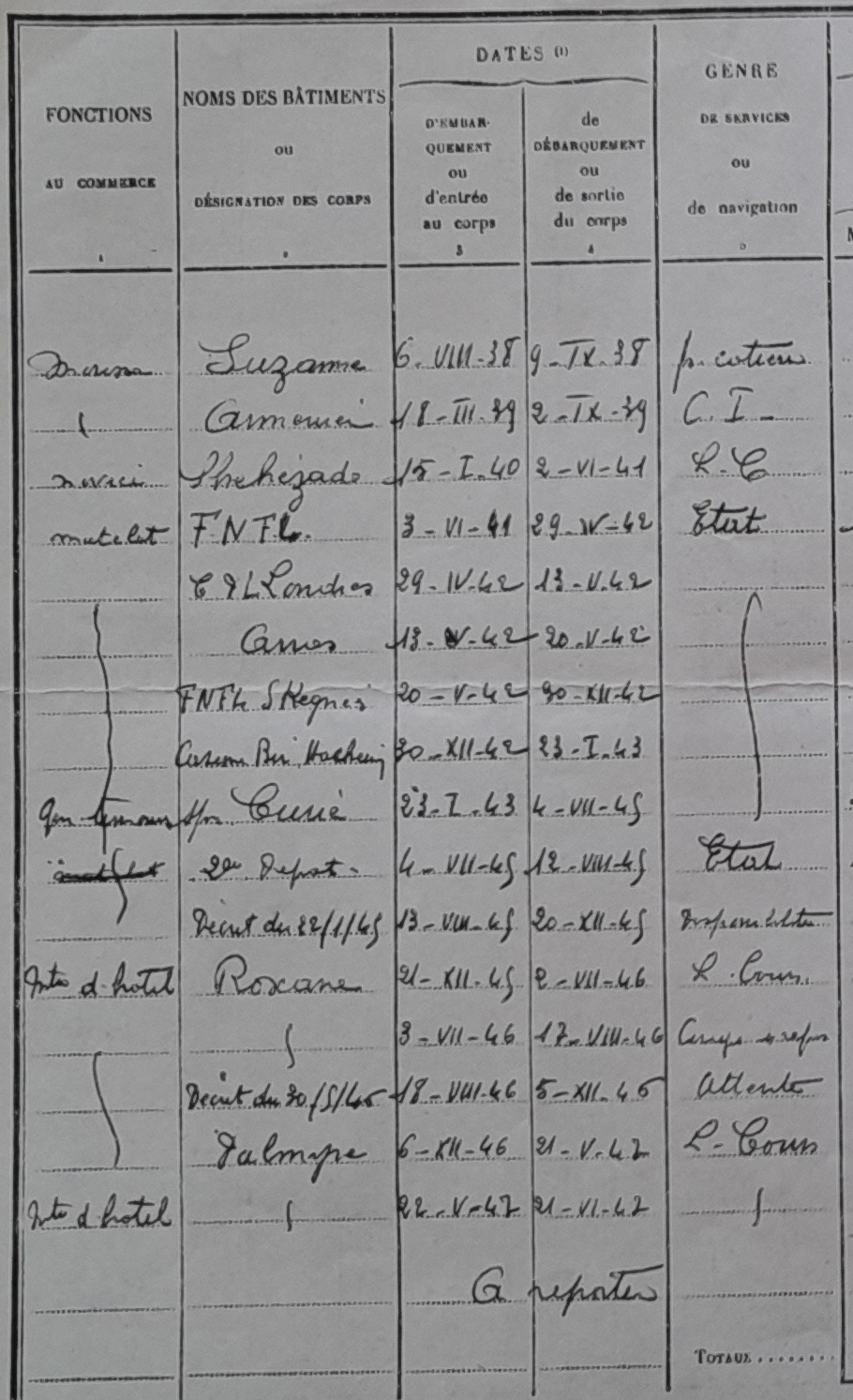
La fiche d'inscrit maritime de Joseph PIERRE nous retrace précisément son parcours de marin. Le 3 septembre 1939 la France déclare la guerre à l’Allemagne. C’est la mobilisation générale. Son bateau étant réquisitionné, Joseph est trop jeune pour être mobilisé. Il est débarqué le 3 septembre et revient à l’île d’Arz en attendant de trouver un embarquement sur un navire de la marine du commerce. L’occasion se présente en janvier 1940.

Un poste de novice lui est proposé sur le « Shéhérazade », un pétrolier qui transporte jusqu’au Havre, de l’essence qu’il va chercher à Corpus Christi au Texas dans le Golfe du Mexique. En juin 1940, alors que le déchargement vient d’être terminé et que l’arrivée des Allemands est imminente, le « Shéhérazade » quitte Le Havre pour Brest puis Le Verdon à l’embouchure de la Gironde. C’est là que l’équipage entend l’un des messages du général de Gaulle qui appelle les Français pour leur demander de refuser le déshonneur de la défaite et poursuivre la lutte à ses côtés. Le pétrolier rejoint Casablanca. Après une escale d’une quinzaine de jours, il part pour New Orleans, port sur le Mississipi.
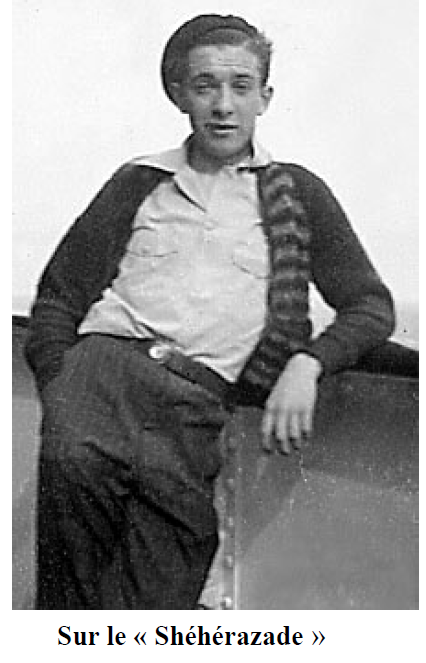
Prisonnier des Américains puis des Anglais
L’armistice ayant été signé par le gouvernement de Vichy, les relations avec les Etats-Unis doivent être réexaminées. Le pétrolier est mis sur un mouillage qu’il lui est interdit de quitter. Joseph Pierre et tout l’équipage du « Shéhérazade» sont consignés à bord. C’est un régime de semi-liberté, relativement souple qui va durer sept mois. Ils sont autorisés à aller à terre par petits groupes. Joseph aimerait bien rejoindre les Forces Françaises Libres mais aucune opportunité ne lui est offerte. Il se méfie de certains membres de l’équipage et des représentants français dans le pays car beaucoup sont restés fidèles au maréchal Pétain. Les relations commerciales ayant été rétablies entre les États-Unis et le gouvernement de Vichy, le « Shéhérazade » est autorisé à aller à Bâton Rouge, au nord de New Orleans, pour faire un chargement d’essence qu’il doit transporter à Casablanca. Nous sommes au début du mois de juin 1941. A environ trois jours des Bermudes, le pétrolier qui fait route vers le Maroc est arraisonné par un croiseur anglais et dérouté vers Hamilton au Canada. Tout l’équipage est interné dans un camp à terre.

Le 28 juin 1941, à 17 ans, Joseph Pierre rejoint la France Libre.
Dans la semaine qui suivit leur internement, les marins du « Shéhérazade » reçurent la visite du commandant Ortoli des Forces Navales Françaises Libres. Le sous-marin « Surcouf » qu’il commandait étant en réparation à Hamilton, il demanda à rencontrer ses compatriotes pour leur proposer de rejoindre les rangs des F.N.F.L. Sur les 42 hommes d’équipage, seulement 8 acceptent de poursuivre la lutte avec le général de Gaulle. Joseph PIERRE qui n’a que 17 ans, est l’un d’entre eux. Peu après, il embarque sur un navire F.N.F.L, le bananier « Maurienne ». Le 16 juin 1940, le bananier Maurienne a appareillé de Basse-Terre en Guadeloupe à destination de Brest. En mer, son commandant, le capitaine au long cours Yves Salaun capte le 18 juin la BBC et entend l’appel, malgré un message de l’amirauté des Antilles lui intimant l’ordre de rejoindre Bordeaux et un autre de celle de Casablanca le 22 juin, il met le cap sur Halifax où il arrive le 28 juin 1940 avec son chargement de bananes. Il n’y eut aucune objection de l’équipage à rallier la France Libre. Depuis son passage au FNFL, il ravitaille les îles anglaises des Bahamas et de la Jamaïque à partir des ports canadiens de Montréal et d’Halifax. C’est dans ce dernier port que ce bateau coule le 7 février 1942 à la suite d’un incendie accidentel. Pendant deux semaines, son équipage est hébergé au Seamen’s Club d’Halifax. C’est enfin sur un bananier norvégien que Joseph PIERRE voit son souhait de rejoindre la Grande-Bretagne enfin exaucé. Il embarque comme passager en direction de Liverpool.
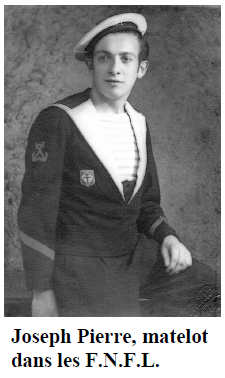
En Angleterre
A peine débarqué, il est dirigé vers Londres et Patriotic School, lieu de passage obligatoire pour tous les étrangers qui arrivent au Royaume-Uni. 
Patriotic Scholl à Londres
Les Anglais se méfient et craignent la présence d’espions parmi les arrivants. Joseph qui a déjà servi dans les Forces Françaises Libres n’y passa que 48 heures alors que d’autres qui avaient plus de mal à justifier leurs motivations ou qui paraissaient suspects y firent un séjour beaucoup plus long. Le bruit circulait entre ceux qui devaient subir les interrogatoires des services anglais, que desagents de l’ennemi détectés parmi les nouveaux arrivants avaient été liquidés.
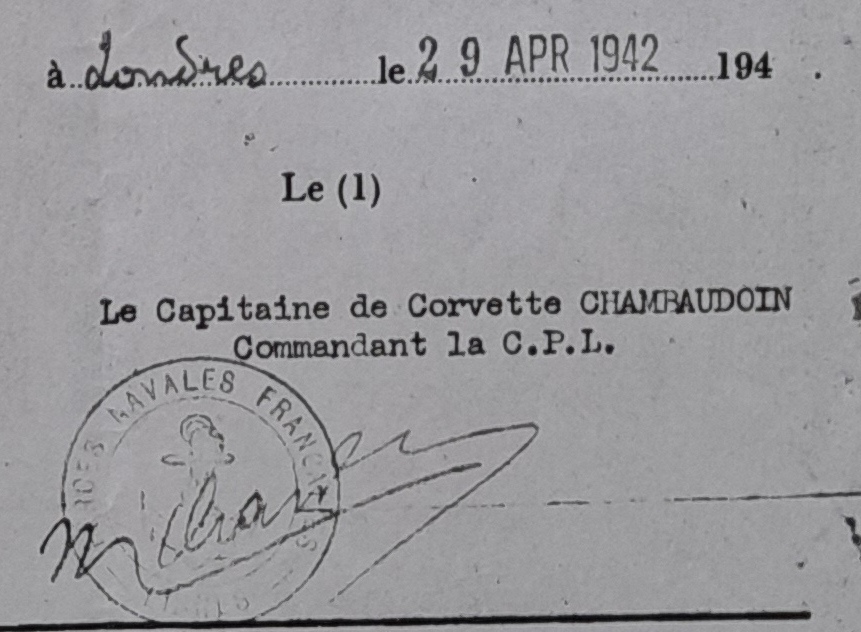
En quittant Patriotic School, Joseph PIERRE est géré par l'administration française en Grande Bretagne,. Le bureau du CPL, la Compagnie de Passage à Londres l'enregistre officiellement le 29/4/1942 mais c'est la date de son engagement en mer du 5/6/1941 qui sera retenue.

Il est dirigé sur Portsmouth où se trouve le bateau dépôt « Arras » où il est incorporé dans les F.N.F.L. et reçoit son matricule portant le n° 6291 FN 41, et son paquetage. Il assiste à des raids de bombardiers allemands sur la ville et découvre le comportement admirable de la population anglaise. Il rejoint ensuite le HMS Royal Arthur à Skegness, un camp d’entraînement à terre de la Royal Navy situé au Nord Est de l’Angleterre. Pendant huit mois, jusqu’en mars 1943, il va recevoir une formation et un entraînement militaire complétés par des cours de timonier qui vont le préparer pour son futur embarquement.
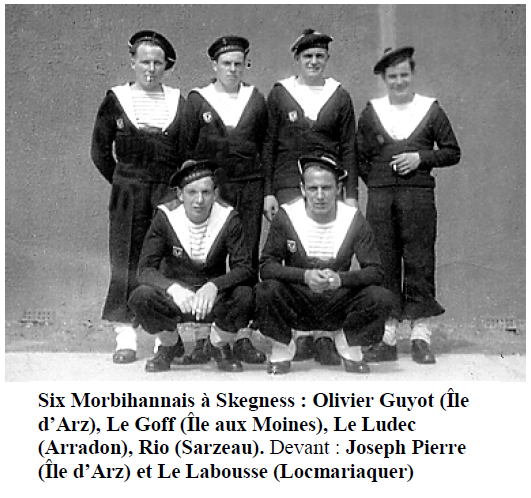
«Où diable avons-nous mis les pieds ? »
A sa sortie de Skegness, Joseph PIERRE, reçoit son affectation. Il va embarquer comme timonier sur le «Curie». Ce sous-marin vient de sortir des chantiers Vickers Amstrong de Barrow in Furness.

C’est un sous-marin anglais du type «U» dont le premier, construit en 1936 était l’« Unity ». Mieux équipé que les sous-marins français des F.N.F.L, le «Curie» est doté des derniers perfectionnements : sondeurs à ultrasons, loch électrique, ASDIC (ancêtre du SONAR), radar permettant une détection à plus de 15 milles nautiques, dont l’écran était un disque d’une quinzaine de centimètres de diamètre.
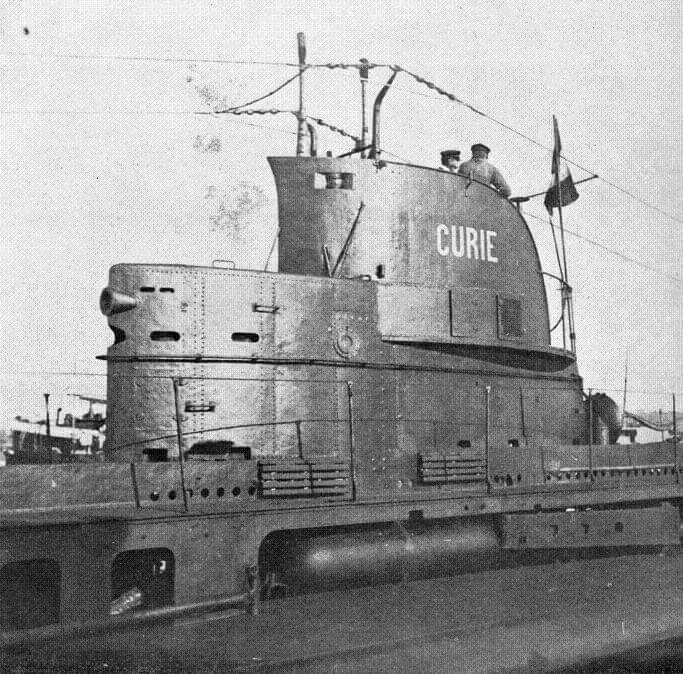
En attendant la fin des travaux, l’équipage suit l’instruction propre aux sous-mariniers et découvre que pour servir à bord d’un sous-marin, chacun doit apprendre à vivre dans l’espace réduit qui lui est attribué, connaître avec précision les manoeuvres qu’il doit effectuer et aussi, qu’à bord, la polyvalence est de règle. En plus du second-maître Even, pour une attaque au canon, il fallait être au moins six hommes donc tous les hommes d’équipage furent initiés à la manoeuvre du canon de 76. L’instruction alternait avec des visites du bâtiment par petits groupes pour permettre à chacun de trouver ses repères et de s’habituer à vivre dans l’exiguïté d’un sous-marin. La longueur de 61 mètres était rassurante mais à sa partie la plus large, il ne mesurait que 4 mètres 85. « Comment allions-nous vivre dans un espace si réduit ? Claustrophobes s’abstenir ! ».

Le rôle d’équipage était complet en février 1943. Le sous-marin était placé sous le commandement du capitaine de frégate Mestre , nommé par le général de Gaulle. Les officiers et officiers mariniers avaient déjà servi dans les sous-marins F.N.F.L. Junon et Minerve mais dans leur presque totalité, les hommes de l’équipage découvraient ce type de bâtiment. De part et d’autre du kiosque, l’inscription P 67 était peinte en gris et le nom « Curie » figurait en lettres de bronze. Sur l’avant du kiosque, l’emblème du « Curie » dessiné par l’enseigne de vaisseau de 1°classe François A’Weng : un cerf qui charge au-dessus de la devise « A corps perdu », était en place mais le sous-marin était toujours anglais alors que l’envie de participer à la lutte était grande chez l’équipage qui avait hâte de prendre la mer.
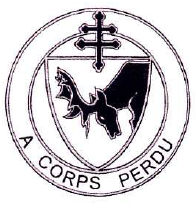

Enfin, le 23 avril 1943, en présence de l’amiral Auboyneau qui a remplacé l’amiral Muselier à la tête des Forces Navales Françaises Libres, le sous-marin est remis au général de Gaulle, chef de la France Libre. C’est le capitaine de frégate Mestre, camarade de promotion de l’amiral Auboyneau qui est présent à la cérémonie.
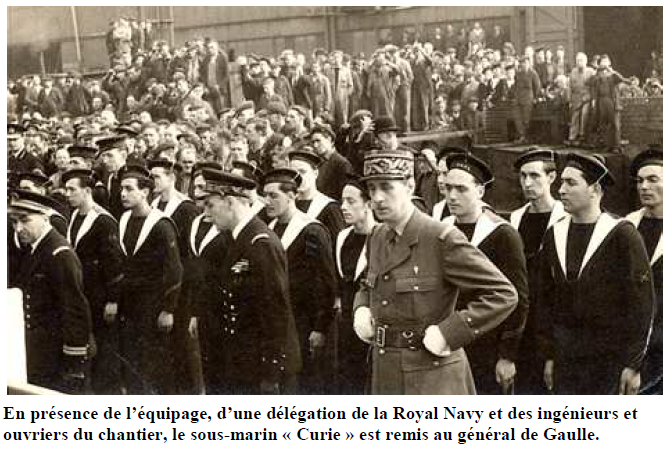
Dès avril 1943, c’est sous son commandement que les essais et exercices commencent. Le lieutenant de vaisseau Pierre Sonneville, envoyé en mission en France afin de créer un réseau de résistance, venait de rentrer par lysander (avion monoplane) en Angleterre. Comme il a déjà commandé le sous-marin « Minerve », l’amirauté anglaise souhaitait le voir prendre le commandement du nouveau sous-marin qui allait travailler avec une escadrille anglaise. Le général de Gaulle ayant finalement donné son accord, le 10 mai, le commandant Sonneville embarquait sur le « Curie ». C’est avec lui que le sous-marin termine ses essais avant de partir le 29 juin 1943 pour une patrouille au départ de Scape Flow en direction du nord de la Norvège puis pour des patrouilles d’endurance qui duraient chacune deux semaines avant de revenir au mouillage dans le fjord la Clyde près de Glasgow. Le « Curie » et son équipage sont enfin prêts à effectuer la mission qui leur est confiée et à rejoindre la zone d’action qui leur est attribuée : la Méditerranée.

Le Curie opérera en Méditerranée
Le 20 août 1943, le sous-marin, accompagné par la « Minerve » appareille pour une destination inconnue. Peu après le départ, la « Minerve » est attaquée par erreur dans l’ouest de la Manche par un avion de la Coastal Command. Il y a trois morts sur le sous-marin et les avaries l’obligent à faire demi-tour. Après avoir patrouillé le long des côtes françaises de l’Atlantique, au bout de 21 jours particulièrement éprouvants, le « Curie » arrive le 10 septembre 1943 à Gibraltar. Il était temps car les vivres commençaient à manquer. Pendant les trois derniers jours du trajet, l’équipage ne disposait plus que de quelques boîtes de conserve et des biscuits de mer à se partager pour les repas. Surprise, dès l’accostage à Gibraltar, des sous-mariniers anglais, les bras chargés de pain frais, de fruits et même de bouteilles de vin attendaient le « Curie » qui allait faire partie de leur escadrille. Joseph Pierre et ses amis découvraient la solidarité qui existait au sein des équipages des sousmarins anglais.
Depuis le 3 août 1943, les Forces maritimes d’Afrique du Nord restées fidèles à l’amiral Darlan ont fusionné avec les Forces Navales Françaises Libres. Malgré cela, les contacts furent difficiles avec l’équipage d’un croiseur français qui faisait escale à Gibraltar. Joseph n’a pas oublié : « Dans les rues, certains pompons rouges de la marine dite« nationale » n’avaient pour nous que mépris, nous traitant de traîtres, de rebelles vendus aux Anglais. Alger fut notre escale suivante. Quel allait être l’accueil de nos compatriotes d’Afrique du Nord et surtout des marins qui, nous l’espérions, avaient enfin découvert qui était le véritable ennemi ?
Le 17 septembre 1943, le « Curie » accosta contre le «HMS Maistone », notre bateau-mère de la Royal Navy et de la 8° escadrille de sous-marins anglais à laquelle nous étions rattachés. Notre présence dans une unité anglaise était-elle à l’origine de la haine manifestée par ces marins français ? Ils avaient choisi la fidélité au vieux maréchal et accepté l’occupation de leur pays par une armée ennemie alors que nous avions fait le choix de suivre le général de Gaulle et de participer avec lui et les alliés, à la poursuite de la lutte pour que la France retrouve sa dignité.
A Alger, en ce mois de septembre 1943, il ne faisait pas bon porter l’insigne à Croix de Lorraine sur les quais du port. Notre premier maître mécanicien Guivarch en sait quelque chose puisqu’il fut molesté par des marins d’un contre-torpilleur. La présence à notre bord de trois marins anglais, un officier de liaison, le sub-lieutnant Cox, un radio, T. Wilson et un timonier, W. Wallace ne justifiait pas non plus ce comportement. Nous étions sur un sous-marin confié aux Forces Navales Françaises Libres pour la durée de la guerre, battant pavillon français et dont le mât de beaupré portait le drapeau à Croix de Lorraine de la France Libre.

Par contre nous fraternisions avec les Français Libres qui, depuis 1940, se battaient depuis la Syrie et le coeur de l’Afrique, eux aussi aux côtés des Anglais, et qui s’étaient distingués par leur courage lors des combats de Koufra, Bir Hakeim, Tobrouk, pendant les campagnes de Libye et de Tunisie.
Le commandant Sonneville écrira : « Le lendemain, les permissionnaires renoncent à aller à terre. L’atmosphère à Alger est irrespirable, faite de poussière, de pauvreté et de prétention » Par bonheur, cette première escale Algéroise fut très courte puisque six jours après son arrivée, le « Curie » allait appareiller pour sa première patrouille le long des côtes de Provence. Finalement, au fil du temps et des patrouilles, les relations vont s’améliorer, en particulier entre les officiers du Casabianca et ceux du « Curie » et le commandant Sonneville proposera au commandant L’Herminier de prévoir la nomination du Lt de vaisseau Chailley pour le remplacer. Il écrira : « cette désignation serait le symbole d’une fusion qui n’est pas encore faite dans les coeurs et serait la concrétisation d’un effort sincèrement voulu pour apaiser nos éternelles dissensions ».

Canonné par le croiseur « Montcalm »
Le 8 novembre 1943, le « Curie » part pour sa 5 ème patrouille en Méditerranée. Il se dirige vers le golfe de Gênes et navigue en surface au départ d’Alger. Vers 7 heures 45, alors qu’il est toujours en vue du Cap Matifou, il va croiser le « Montcalm » qui rentre de mission. Le commandant demande à Joseph Pierre qui est le timonier de quart de transmettre l’indicatif du sous-marin. Ce signal constitué de quatre lettres ou chiffres, changeait toutes les 24 heures et était connu de tous les bateaux français et alliés naviguant dans la zone concernée. Le «Montcalm» accuse réception puis demande la répétition de l’indicatif. C’est le second maître timonier Henri Toussaint qui le transmet et reçoit la réponse «Bien reçu» du Montcalm. A ce moment, le croiseur se trouve à 1,5 milles sur babord du « Curie » sur lequel flotte le pavillon français.
A la stupéfaction générale, le croiseur ouvre le feu et des gerbes d’eau apparaissent dans le sillage du sous-marin. En quelques secondes, alors que retentit le klaxon « plongée rapide », Henri Toussaint se précipite sur l’échelle de descente, suivi de l’enseigne de vaisseau François A’Weng, du Lieutenant de vaisseau Chailley venu se familiariser avec le bateau, de Joseph Pierre et du commandant Sonneville. Le sous-marin était déjà à 5 ou 6 mètres sous l’eau qui commençait à envahir la baignoire quand le pacha atterrit sur le plancher du P.C.
Au sein de l’équipage, l’incompréhension est totale. La sortie a été signalée à l’amirauté d’Alger et aucune erreur n’a été commise lors de l’envoi du signal d’identification. L’Italie a signé l’armistice et comme il n’y a aucun U–Boot allemand en Méditerranée aucune confusion n’est possible. D’ailleurs, à 1,5 mille de distance, à moins d’être totalement incompétent, il est impossible de confondre un sous-marin de construction anglaise naviguant
en surface et battant pavillon français avec un sous-marin allemand. Alors, pourquoi ? Incompétence aussi bien dans l’identification du sous-marin que du réglage du tir ?
« Nous apprendrons plus tard que 10 obus de 90, 23 de 40 et une centaine de 20 ont été tirés et par bonheur pour nous, aucun ne toucha le sous-marin. » Volonté délibérée de couler un sous-marin anglais mis à la disposition de la France Libre ? Cela montrerait, à un point encore jamais atteint, la haine et l’hostilité de certains officiers de la « Royale » restés longtemps fidèles à l’amiral Darlan et au maréchal Pétain. N’oublions pas que plusieurs d’entre eux, ont préféré saborder leurs navires à Toulon, le 26 novembre 1942, plutôt que de rejoindre les alliés et de participer àla lutte contre l’Allemagne nazie.
« La plus grande consternation régnait à bord du « Curie ».Nous l’avions échappé belle !
Nous savions que nous vivions une vie dangereuse. A bord, nous ne parlions jamais de nos familles, de notre passé, de notre avenir. Notre famille, c’étaient les copains de l’équipage ; notre passé avait débuté le jour de notre embarquement sur le « Curie » ; l’espérance de vie d’un sous-marinier allemand était de quatre mois. De combien de temps serait la nôtre ? Notre avenir, c’était l’instant présent. Tous, nous avions choisi de refuser la défaite, de poursuivre le combat et si nécessaire, de faire le don de notre vie pour que notre pays retrouve sa liberté mais nous n’acceptions pas de mourir sous les obus d’un croiseur français».
La tentation fut grande au sein de l’équipage de tirer ses torpilles et d’envoyer par le fond ce fleuron de l’ancienne flotte de Vichy. Si près de l’objectif, les quatre torpilles de 533 mm contenant chacune 450 kg d’explosif n’auraient laissé aucune chance au « Montcalm ». Bien que choqué, le commandant Sonneville garda son sang froid et décida de poursuivre sa mission entre la Corse et le nord de l’Italie. Il écrira : «Ou bien le responsable s’est laissé emporté par l’hostilité aveugle qui dresse encore beaucoup d’officiers de Vichy contre ceux de Londres, ou il a voulu nous faire une plaisanterie maisdans ce cas, sa première gerbe est tombée beaucoup trop près pour mon goût ». Il envoie un message au premier lord de l’amirauté dont dépend la 8° escadrille de sous-marins: « Je demande des sanctions immédiates s’il s’agit d’un acte d’hostilité délibéré de la part du « Montcalm ». Si cet incident désagréable est dû à une erreur, c’est à dire à l’incapacité du commandant, j’exige des excuses… »
Joseph Pierre qui n’avait pas encore connu le cauchemar des grenadages venait de vivre l’un des moments qui le marquèrent pour toujours : « Bien que les obus du « Montcalm » ne nous aient pas touchés, j’ai bien failli perdre la vie lors de cette canonnade. Le fil électrique de l’aldis est en effet resté coincé dans le panneau du sas, contraignant le commandant à rouvrir ce panneau en urgence. A deux ou trois secondes près, c’était le drame. Le système de fermeture automatique du panneau inférieur du sas protégeant le poste central aurait fonctionné. Le « Curie » aurait été sauvé mais le commandant Sonneville et moi aurions été condamnés. Je reverrai toujours le visage blême du commandant. Lui et moi savions que nous revenions de loin. « A notre retour à Alger, nous avons retrouvé avec plaisir les anciens des combats d’Erythrée et de la division Leclerc. Nous avons constaté que l’hostilité que manifestaient les Vichystes à l’encontre des Français Libres existait toujours mais surtout dans la marine. Après l’incident survenu lors de notre précédente sortie, le moral était plutôt bas. Une bonne nouvelle vint réconforter et réjouir l’équipage : notre pacha, le lieutenant de vaisseau Pierre Sonneville était promu capitaine de corvette. Notre mission suivante revêtit pour nous un caractère particulier car il s’agissait d’aller déposer dans le nord de l’Italie, sur une plage près de Gênes, trois spécialistes anglais du plastiquage qui devaient aller détruire un viaduc situé dans une vallée étroite inaccessible aux bombardiers alliés. La présence de nombreux champs de mines près de la côte empêcha le débarquement de l’équipe de sabotage. »
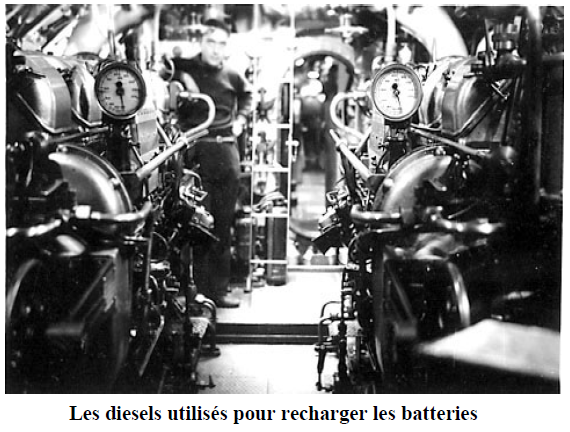
Le 18 novembre 1943, le départ du «Curie» en mission vers Toulon est retardé en raison des dynamos qui sont défectueuses. L’«Usurper», autre sous-marin anglais de l’escadrille, son voisin dans le port, part à sa place. Le « Curie » appareilla le lendemain « Dès le départ, nous sommes accueillis par le mauvais temps qui se transforma en tempête et rendit notre mission très inconfortable. Secoué pendant 17 jours, le « Curie » fut tout heureux de retrouver le port d’Alger où une mauvaise nouvelle l’attendait : l’«Usurper » avait sauté sur une mine et disparu avec tout son équipage.
Pendant nos escales, nous recevions parfoisdes visites comme celle de Louis Jacquinot, ancien député de la Moselle, commissaire à la marine dans le gouvernement provisoire d’Alger. Un autre jour ce fut un militaire portant l’uniforme américain sans aucun grade ni insigne, qui utilisait une canne pour se déplacer . Il nous salua d’un retentissant « Bonjour messieurs ! ». C’était Antoine de Saint-Exupéry, qui disparut quelques mois plus tard aux commandes de son avion. »

A Malte avec la 10° escadrille de sous-marins .
A la fin de sa sixième patrouille, le « Curie » rejoint la 10° escadrille anglaise dont la base logistique est à Malte, mais qui possède une base avancée dans l’île de la Magdalena, au nord de la Sardaigne. C’est là qu’il arrive le lendemain de Noël 1943. Des travaux devant être effectués sur un périscope et un entretien général s’avérant nécessaire, le « Curie » rejoint Malte et entre en cale sèche dans l’arsenal de La Valette.
« C’est pendant cette longue escale technique à Malte que le commandant Sonneville nous fit part de son prochain départ. Nous pensions tous qu’il allait être remplacé par son second, l’enseigne de vaisseau Jean-Pierre Brunet aussi c’est avec surprise et méfiance que nous découvrîmes le nom de notre futur pacha : le lieutenant de vaisseau Pierre-Jean Chailley qui était présent à bord depuis quelques missions et qui n’était pas un Français Libre. Après l’hostilité manifestée par les marins de la flotte française à Alger et l’agression délibérée du « Montcalm » ce ne fut pas de gaieté de coeur que l’équipage apprit la nouvelle ». Sur tribord de la baignoire du « Curie » était apposée une plaque de cuivre portant l’inscription « Pola 1914 ».
C’était dans ce port de l’Adriatique que le premier sous-marin portant le nom de « Curie » fut coulé par les Austro-Hongrois. Pierre Chailley, l’officier en second qui disparut avec son bateau n’était autre que le père du nouveau pacha. Une autre information vint aussi rassurer l’équipage et lui permettre de comprendre pourquoi c’était cet officier qui avait été choisi pour commander un sous-marin de la France Libre : Pierre-Jean Chailley était un ancien officier du sous-marin «Casabianca» qui s’était échappé de Toulon lors du sabordage de la flotte française. Le 1° février 1944, le lieutenant de vaisseau Chailley prend le commandement du « Curie ». Très rapidement, le nouveau commandant sut se faire apprécier et aimer de l’équipage. « Il était très humain et très proche de ses hommes. » Enfin remis en état et après les essais obligatoires au large de Malte qui devint sa base d’intervention en Méditerranée, le « Curie » reprit ses missions. Son rythme de travail fut établi à 13 jours de patrouille suivis de 13 jours à la base.
La vie à bord
Pendant la journée, le sous-marin naviguait en plongée puis, dès la tombée du jour, il s’éloignait à 10 milles des côtes et faisait surface jusqu’au lever du soleil. Ses batteries étant alors rechargées, il repartait en plongée dans son secteur de patrouille. La vie à bord était découpée en tranches de 4 heures. Ayant la spécialité de « Timonier de surface », le service de Joseph Pierre se déroulait principalement la nuit. Il était de veille dans la baignoire, côté tribord pendant 2 heures puis assurait 2 heures de quart, au central, à la barre de direction.
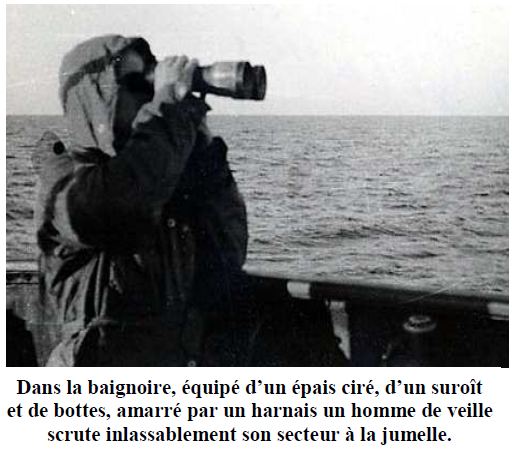
« Mon poste de combat était à la barre de plongée arrière. Le second maître Toussaint, également timonier était à la barre de plongée avant et pouvait rectifier une erreur d’assiette que j’aurais pu commettre. Au moment de l’attaque, le commandant devait garder constamment la vue au périscope aussi aucune erreur de profondeur n’était admise ». Sur le « Curie », tout était regroupé : périscopes, ASDIC, radar, commandes des moteurs, commandes de barres de plongée et de direction, manoeuvre des purges et des remplissages des ballasts et manoeuvre des pompes. Les officiers et les officiers mariniers avaient des couchettes individuelles qui étaient rabattues dans la journée. Ils avaient leur lavabo et leur W.C. Le long de la coursive, entre les deux portes étanches, se trouvait leur carré avec une petite table et un canapé de chaque côté.
Tout l’équipage était logé dans le poste avant. « Nous étions une trentaine de quartiers-maîtres et matelots à vivre dans un espace d’une trentaine de mètres carrés avec pour compagnes, arrimées, deux de chaque côté, les quatre torpilles de réserve, enduites d’une épaisse couche de graisse. Nos hamacs étaient disposés sur trois rangées sur toute la longueur. Ils étaient superposés et accrochés au plafond. J’ai eu la chance de me voir attribuer un hamac facile d’accès car il était situé en bas dans la rangée centrale ».
La cuisine, si l’on peut donner ce nom au petit local d’à peu près 1,50 m sur 1 m, était située près du carré des officiers. « Chaque jour notre cuisinier Pierre Faucon réalisait des miracles avec le peu de denrées dont il disposait. Un petit frigo nous permettait d’avoir des vivres frais : légumes et viande pendant trois jours de navigation. »
En plus du « dortoir », le « restaurant » se trouvait aussi dans le poste avant. Il n’y avait ni tables ni chaises. « Nous prenions nos repas assis sur un coffre de 3 mètres de long fractionné intérieurement en petits compartiments de 40X40 munis d’un cadenas, où chacun de nous rangeait son uniforme, ses chaussures, ses papiers et ses autres affaires personnelles Pour la boisson, de Skegness jusqu’à Alger, nous n’avons eu que du thé à boire. Le radio et le timonier anglais avaient la charge de le préparer dans un récipient d’environ 10 litres où tout était mélangé : eau bouillante, thé, lait et sucre. Chacun se servait en y plongeant son quart. On s’était fait à ce breuvage, personne ne se plaignait, mais pour beaucoup, le vin manquait. Pour la toilette, nous n’avions à notre disposition qu’une cuvette en inox contenant une dizaine de litres d’eau. Un peu d’eau sur la figure, (un débarbouillage comme disait ma grand-mère), lavage rapide des dents, pas de rasage et nous étions prêts à prendre notre service, en rêvant à la douche que nous prendrions en arrivant à terre. Nous vivions ainsi, imprégnés par notre propre odeur de transpiration et par toutes les autres effluves qui se dégageaient dans cette atmosphère confinée. Nous ne nous en rendions pas compte mais nous plaisantions en disant que dès l’accostage, après l’ouverture du panneau avant, à 50 mètres à la ronde, il n’y aurait plus aucun moustique, tous auraient péri, asphyxiés par l’odeur nauséabonde et les émanations qui s’échappaient de notre « cercueil de métal».
Les W.C. se trouvaient à l’autre extrémité du sous-marin, collés au servomoteur. Quand il fallait évacuer la cuvette, il fallait effectuer plusieurs manipulations successives et surtout ne pas se tromper dans l’ordre des manoeuvres sinon c’était la catastrophe pour le maladroit. Heureusement cela s’est rarement produit. Lorsqu’il fallait mettre les torpilles de réserve dans les tubes de lancement, c’était le grand chamboulement. Il fallait tout d’abord dégager le poste avant en enlevant les hamacs et les caissons puis, à l’aide de palans car les torpilles étaient très lourdes, il fallait manoeuvrer avec la plus grande prudence Mais tout était parfaitement réglé, jamais il n’y eut d’accident.
Au retour à la base, chacun avait une tâche bien définie. Joseph était chargé de l’entretien du matériel optique et plus particulièrement des périscopes qui devaient être nettoyés avec le plus grand soin avec des peaux de chamois. Il était aussi en charge des pavillons. Dès l’arrivée dans un port, à cheval sur l’étrave étroite du « Curie », il allait placer le pavillon de beaupré à Croix de Lorraine. Le pavillon national était hissé à la corne, juste derrière le kiosque. Le pavillon pirate était toujours à l’honneur dans la marine anglaise donc dans l’escadrille à laquelle était rattaché le sous-marin aussi, en haut du périscope de combat, flottait « Jolly Roger » sur lequel était représentée chacune de ses victoires. Pendant les jours d’escale, Joseph Pierre faisait aussi fonction de vaguemestre.
Le 20 mars 1944, le « Curie » arrive à la Magdalena, poste avancé plus proche de sa zone d’action fixée le long de la côte française. Le 28 à l’aube, deux torpilles sont tirées sans succès en direction d’un torpilleur qui navigue accompagné de deux vedettes rapides armées de grenades sous-marines. Le « Curie s’éloigne rapidement pour recharger les tubes lance-torpilles avec deux de ses torpilles de réserve. Le 2 avril le « Curie » fait surface et attaque au canon une vedette rapide qui choisit de prendre la fuite. Le 5, il est de retour à la Magdalena, îlot rocheux, inhospitalier où la seule distraction était la baignade quand la température de l’eau le permettait.
«Il ne nous reste plus qu’à prier Dieu, nous allons tenter de passer sous les torpilleurs !»
Le 16 avril 1944, le «Curie» est parti pour sa 8°patrouille. Le 20, depuis 6 heures 30 du matin, il est en plongée dans le secteur de Toulon, non loin de la côte et des champs de mines. Au périscope, il découvre soudain que deux chasseurs de sous-marins allemands sont très proches et se dirigent dans sa direction. Il a sans doute été repéré quelques heures avant, alors qu’il profitait de l’obscurité pour naviguer en surface.
« Nous plongeons rapidement à 60 mètres et faisons le silence complet. L’attaque est brutale. Dès 6 heures 30, l’enfer débute. Le bruit des grenades est infernal. On entend leurs sifflements lors de leurs descentes puis les explosions qui encadrent et secouent le bateau. Les chasseurs les lancent parfois par séries de quatre ou de six. A chaque explosion nous sommes terriblement secoués car ils nous ont parfaitement repérés. Nous sommes pétrifiés devant ce bruit infernal causé par l’éclatement des grenades si proches de nous. Il faut serrer les dents, s’enfoncer la tête dans les épaules et s’agripper à tout ce qui est accessible. On entend résonner sur la coque l’onde électromagnétique de l’écoute sous–marine de l’ennemi. Comme il fallait éviter le moindre bruit à bord, il était impossible de mettre les pompes en route pour maintenir l’assiette du bateau. Le commandant Chailley nous ordonna de nous déplacer sur l’avant. Les troisquarts de l’équipage se sont retrouvés assis par terre, les uns en face des autres. Nous restions ainsi, immobiles, impassibles, impuissants devant le danger que nous subissions, espérant que la prochaine grenade ne nous serait pas fatale. Comme nous, le timonier et le radio anglais étaient jeunes. J’ai entendu l’un d’eux qui appelait sa mère. Dans le bateau, les dégâts étaient importants : toutes les ampoules électriques avaient éclaté aussi nous étions en éclairage de secours. Poste radio et radar hors service. Au central, des cadrans avaient explosé. Vers 10 heures 30, à la suite d’explosions rapprochées qui avaient particulièrement secoué le sous-marin, l’homme de barre au poste central signale « avarie de barre ». Le « Curie » se mit à tourner en rond . Jean-Louis Gloaguen, quartier maître mécanicien était à son poste de combat au servomoteur. Il découvrit rapidement la cause de l’incident mais ne réussit pas à retrouver la clavette du gouvernail qui avait sauté de son axe. Il réussit à la remplacer par le manche de sa clé à volant et le gouvernail est revenu à zéro.
L’onde de pression d’une série de grenades pousse le sous-marin vers les profondeurs. Malgré les moteurs « en avant 4 », les barres de plongée « A monter toutes » et une pointe positive de 30°, le « Curie » coule. Le manomètre de profondeur fonctionne toujours :- 70 mètres, - 80 mètres, - 90 mètres, - 100 mètres. On entend des craquements dans la coque. Le commandant n’a plus le choix, il fait chasser l’eau des ballasts pour alléger le sous-marin. L’aiguille s’arrête. « En avant 2 » il faut s’éloigner sinon les chasseurs vont repérer les nombreuses bulles d’air qui vont éclater à la surface lorsqu’on va chasser l’air des ballasts pour éviter de faire surface et de se faire aborder ou canonner. A - 40, le « Curie » se stabilise. Les purges des ballasts sont ouvertes. Miracle ! aucune réaction de la part des bateaux allemands.
Une accalmie se produit. A genoux sur le parquet du poste central, le commandant étudie les trajets des torpilleurs qui tentaient de contraindre le sous-marin à se rapprocher dangereusement des champs de mines. C’est alors qu’il informe l’équipage de la décision qu’il vient de prendre :
« Il ne reste plus qu’à prier Dieu, nous allons tenter de passer sous les bateaux qui nous grenadent. » N’utilisant qu’un de ses moteurs pour limiter le bruit et à allure réduite, le « Curie » entreprend sa manoeuvre.
« Cela dura une heure mais pour nous, cela dura une éternité. Lorsqu’il entend le deuxième moteur qui se met en route, l’équipage comprend que l’espoir est revenu, que la manoeuvre de sauvetage a réussi. »
Une remontée à 12 mètres permet de voir au périscope les chasseurs de sous-marins qui avaient été rejoints par un troisième. Ils n’avaient pas détecté la fuite du sous-marin et tentaient toujours de le couler ou de l’envoyer dans le champ de mines. Hébétés, figés, se regardant sans rien dire les sous-mariniers comprirent qu’ils avaient frôlé la mort de très près.
« Il était grand temps que cela cesse car nous étions à bout de nerf. »
Par des manoeuvres désespérées mais parfaitement réussies, le commandant Chailley venait de sauver son bateau et son équipage. Il était digne d’être le pacha d’un sous-marin de la France Libre. L’autorisation qu’il donna un peu plus tard finit de convaincre les plus réticents. Il venait d’annoncer : « Autorisation de fumer » alors que cela était formellement interdit dans un sous-marin en plongée. Ce jour-là, nous avons reçu 83 grenades dont 60 entre 6 heures 30 et midi.
« Nous revenions de l’enfer. Ce grenadage, il faut l’avoir vécu pour se rendre compte du danger auquel nous étions exposés. Nous avions rendez-vous avec la mort, par bonheur elle n’a pas voulu de nous. Quand nous sommes arrivés à Malte, nous étions dans l’impossibilité de prendre contact par radio. C’est en Scott que nous nous identifiâmes auprès des escorteurs qui patrouillaient au large de La Valette.. »
Le 28 avril 1944, le « Curie était de retour à la Magdalena. Au cours de la patrouille suivante, le 12 mai, au large de la Ciotat, un chalutier armé allemand faisant fonction d’escorteur est repéré et attaqué au canon. Gravement endommagé, il coulera plus tard. Pour la première fois, notre mission nous conduisit au large de Port-Vendres et à proximité de la frontière espagnole.
« A la demande du commandement français du groupe de sous-marins de la Méditerranée, nous appareillons en direction d’Alger où nous arrivons le 29 mai. C’est pendant les quelques jours de repos que nous passons à Chréa dans l’Atlas non loin de Blida que nous apprenons le débarquement allié en Normandie. Le 6 juin, nous sommes rappelés à Alger où une cérémonie va se dérouler sur le croiseur Jules Verne avec remise de la Croix de Guerre au « Curie » et aux officiers et officiers-mariniers qui ont rejoint la France Libre en juin 1940. Le lendemain, le bateau reprenait la direction de la Magdalena. »
Le destruction des batteries de Port-Vendres
Lors de la 10° patrouille, le 21 juin 1944, il est près de 22 heures quand le « Curie » fait surface à 250 mètres de la jetée de Port-Vendres. Depuis plusieurs minutes, l’équipe des canonniers est prête à escalader l’échelle du kiosque. L’objectif est constitué par les batteries côtières du Cap Gros dont certaines sont en cours d’achèvement avec utilisation de pièces d’artillerie récupérées sur le croiseur « Strasbourg » après le sabordage de la flotte à Toulon. La surprise est totale chez l’ennemi.
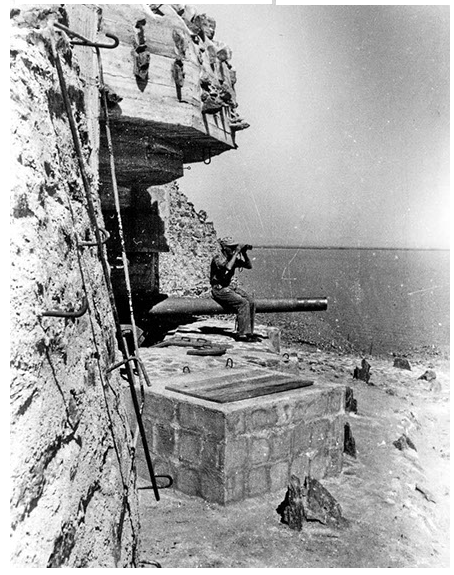

Le premier obus fait mouche. Quatorze obus sont tirés pendant les douze minutes passées en surface. L’un d’eux atteint un dépôt de munitions qui explose. Trois des batteries sont détruites. Rapidement les canonniers regagnent l’intérieur du bateau. Sous les tirs de l’ennemi, le « Curie » part en marche arrière puis en plongée à 60 mètres.

L’accueil à Malte est triomphal. Trois étoiles blanches sont cousues sur le « Jolly Roger » pour matérialiser la destruction des trois batteries allemandes.
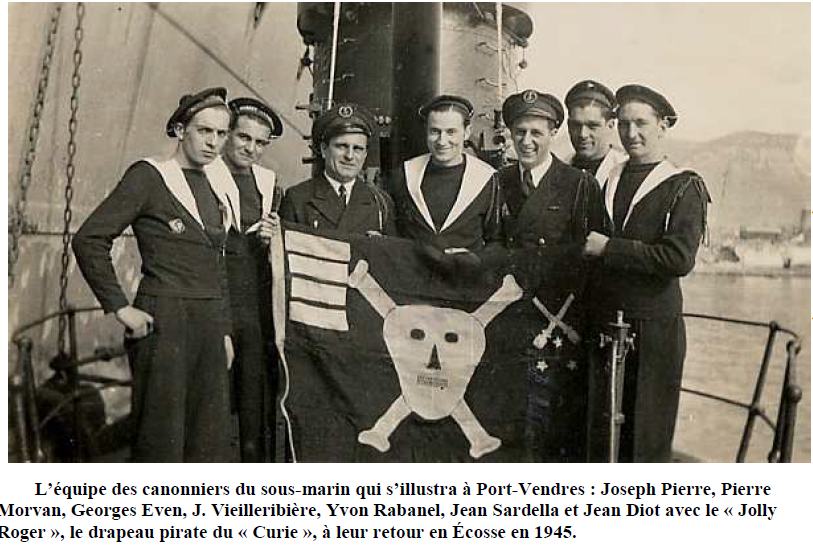
Le 18 juin 1994, la municipalité de Port-Vendres commémora le cinquantième anniversaire de l’attaque du 21 juin 1944. L’équipage du Curie fut invité mais seuls Joseph Pierre et Marc Deboos purent se rendre à la cérémonie. Ils furent reçus en héros par les habitants de Port-Vendres et les autorités civiles et militaires.
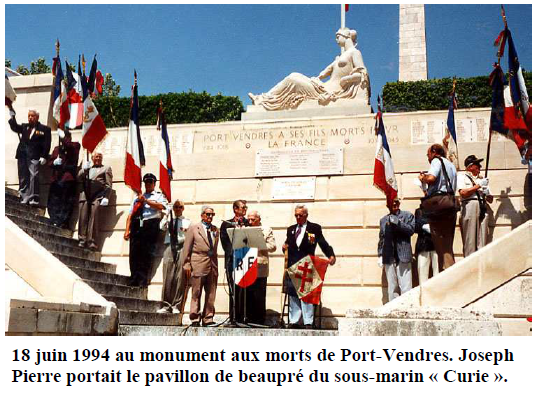
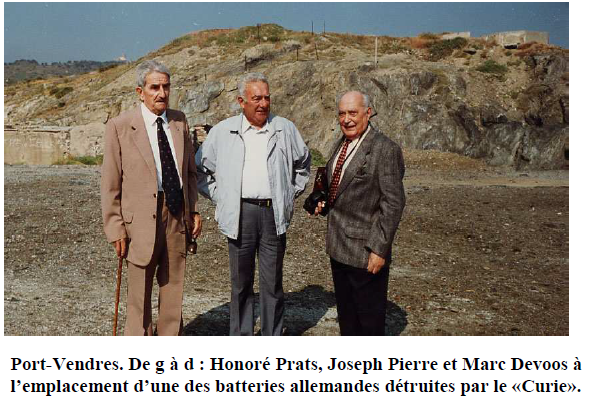
A cette occasion ils firent la connaissance de M. Honoré Prats. Le 21 juin 1944, avec un matelot, il était à bord du remorqueur « Sana » qu’il commandait et qui était chargé de la mise en place du filet métallique de protection qui interdisait l’entrée et la sortie du port. Il découvrit le sous-marin qui faisait surface et ouvrait aussitôt le feu sur la batterie du Cap Gros. Courageusement, il décida de retarder la sortie des vedettes rapides amarrées dans le port en bloquant l’hélice de son bateau avec le câble du filet. Il fallut aller chercher un chalutier pour dégager le remorqueur. Cette opération qui dura plus d’un quart d’heure permit au « Curie » de s’éloigner en plongée sous les tirs des pièces d’artillerie de la défense du port.
Le retour en Provence.
Le 3 août 1944, nouvelle victoire. Vers 22 heures, alors que le « Curie » est en plongée, un cargo allemand protégé par un torpilleur est aperçu à l’ouest de La Ciotat.
« Nous nous rapprochons de l’objectif et nos quatre torpilles sont tirées. Nous apprendrons plus tard que le cargo transportait des mines ce qui expliquait la violence de l’explosion. Une bande blanche est cousue sur notre « Jolly Roger ». Les mines étaient bien un danger que nous redoutions. A proximité de la côte et plus particulièrement des ports, les Allemands modifiaient sans cesse leurs champs de mines. Notre travail consistait aussi à repérer leurs tracés à l’ASDIC et à les faire figurer sur nos cartes. Il fallait travailler au plus près. L’opération était particulièrement dangereuse, surtout quand le sous-marin s’engageait dans une chicane du champ de mines comme cela est arrivé. Le commandant était alors obligé d’effectuer des anoeuvres délicates pour sortir du piège.»
« Nous sommes à la Magdalena le 15 août 1944 lorsque nous apprenons le débarquement des troupes alliées sur les côtes de Provence. Nous sommes envahis d’une joie immense et nous pensons que nous avons, nous aussi, apporté notre contribution à ce moment historique en transmettant les informations que nous avions recueillies en longeant ces mêmes côtes les jours précédents. Renseignements qui ont facilité l’approche des bateaux et le débarquement des troupes alliées à travers les champs de mines. Sur notre île, nous nous reposons et profitons de la température de l’eau pour nous livrer aux joies de la baignade, en attendant notre prochaine mission qui allait revêtir un caractère particulier puisque nous allions faire escale à Saint-Tropez. Quel allait être l’accueil de nos compatriotes?
Le 10 septembre, en fin d’après-midi, le « Curie » s’amarre au môle du Portalet. Nous n’attendions aucune manifestation délirante de la part de la population mais nous étions curieux de découvrir les réactions des premiers Français que nous allions rencontrer dans cette partie du pays enfin libérée de l’occupation allemande. Des enfants vinrent prudemment à notre rencontre et profitèrent du chocolat et des gâteaux secs que nous avions parcimonieusement prélevés depuis quelques jours sur nos rations puis ce fut l’inconditionnel admirateur du maréchal et des nazis qui arriva. Vêtu de son costume sombre et coiffé de son chapeau. D’un air supérieur, il nous fit remarquer que nous n’avions pas le droit d’arborer le drapeau français car nous étions des renégats au service des Anglais. D’autres combattants de la France Libre formés aux techniques des commandos auraient peut-être trouvé une réponse rapide à ces paroles blessantes et totalement déplacées. L’envie ne nous manqua pas d’envoyer ce guignol endimanché patauger dans les eaux du port. Nous évoquâmes d’ailleurs entre nous et à voix haute cette solution qui eut pour effet immédiat de voir le féal de Pétain et de la collaboration faire demi tour et s’éloigner aussi vite qu’il pouvait. »
L’arrivée à Toulon.
Appareillant dans la matinée du 12 septembre 1944, le « Curie » fut le premier bateau arborant le pavillon français à entrer dans le port de Toulon. Il accosta près de la préfecture maritime, contre un bout de môle où stagnait une couche de mazout si épaisse que Radium, le chien du bord, la confondit avec un quai. Il sauta pour y prendre pied et se retrouva paré d’une couleur noire qui nécessita plusieurs heures de toilettage. En fin d’après-midi, une escadre comprenant escorteurs et croiseurs vint mouiller dans la rade. Depuis, plusieurs de ces bâtiments ont revendiqué l’honneur d’avoir été le premier à entrer à Toulon. Le modeste « Curie » avec son pavillon bleu, blanc, rouge et son drapeau à croix de Lorraine, amarré au fond du port au milieu de sa nappe de mazout devait représenter peu de chose pour ces importantes unités de la marine nationale.
Nous avions idéalisé notre arrivée en France libérée. Les alliés qui avaient débarqué en Normandie étaient accueillis en libérateurs par une population enthousiaste. A Toulon comme à Saint-Tropez, nous ne perçûmes aucune joie particulière aussi ce fut sans regret, qu’après seulement trois jours d’escale, nous reprîmes la direction de Malte où nous retrouvâmes les autres sous-marins de notre escadrille : l’Upstart, l’United, l’Unswerving et l’Universal. Ce dernier fut quelques temps plus tard rebaptisé le Minesweeper (dragueur de mines) par les sous-mariniers de l’escadrille en raison de l’une de ses mésaventures : l’orin d’une mine s’étant pris dans l’une de ses hélices , comme il n’arrivait pas à s’en débarrasser, il la remorqua jusqu’à un port turc.

Départ pour la mer Égée.
Le sud de la France était libéré mais les Allemands étaient toujours présents en Méditerranée Le théâtre d’opérations du « Curie » allait changer et se situer dorénavant à l’est de Malte, dans le nord de la mer Égée. Les Allemands ayant posé de nombreuses mines entre les îles, le sous-marin passe illégalement dans les eaux territoriales turques, en surface la nuit pour recharger ses batteries et en plongée pendant la journée. Le 22 septembre 1944, le « Curie » quitte Malte pour sa 13° patrouille qui va se dérouler en Mer Égée. Il passe loin de Chypre toujours occupée par les Allemands et met le cap sur Castellorizo, une petite île grecque du Dodécanèse, proche de la Turquie, que des commandos anglais venus d’Égypte viennent de libérer. Le 26 septembre 1944, il mouille à Castellorizo,
Le 2 octobre 1944, W. Wallace, le timonier de liaison anglais aperçoit cinq navires qui se déplacent en convoi. Le «Curie» abandonne la poursuite de deux chalands pour se rapprocher des bateaux ennemis. Deux escorteurs encadrent un cargo et deux navires citernes. Pour se protéger des torpilles, les bâtiments changent fréquemment de cap. Les quatre torpilles sont lancées à quelques secondes d’intervalle et le « Curie » descend à 40 mètres pour se protéger du grenadage. Le cargo et un navire-citerne sont touchés et coulent rapidement.
En mai 2001, un neveu de Joseph Pierre s’est rendu en Grèce, dans le port de Glossa non loin du cap Pélion où il rencontra « Captain Kanaris », l’un des chef des partisans grecs qui luttaient contre les Allemands en 1944 et qui assista au torpillage le 2 octobre. Il se souvient d’un cargo, de deux bateaux armés, de trois bateaux coulés par le sous-marin et surtout d’une corvette qui a été touchée et qui est venue s’échouer sur les rochers du Cap Pélion. Avec ses partisans, Evangelos Yannopoulos, alias « Capitan Kanaris » surprit et attaqua l’équipage de la corvette échouée faisant une quarantaine de morts et trente prisonniers qui furent transportés et emprisonnés à Chypre.
L’escorteur de tête prend la fuite en protégeant le dernier navire-citerne tandis que l’autre escorteur part à la recherche des survivants. « Nous apprendrons plus tard que les deux bateaux coulés, le cargo « Assak » et le navire citerne « Berthe » étaient utilisés par l’Allemagne comme transports de troupes. Les torpilles magnétiques dont nous sommes désormais équipés se révèlent plus efficaces que celles dont nous disposions.» Après avoir rechargé ses tubes lance-torpilles, le « Curie » poursuit sa traque. Le lendemain, il est en surface quand il découvre deux cargos accompagnés d’un escorteur qui vont passer à moins de 800 mètres.
Plongée immédiate, « aux postes de combat ». Trois torpilles sont lancées. L’un des cargos est coupé en deux morceaux par l’explosion et coule en quelques minutes. A la suite d’une fausse manoeuvre, la quatrième torpille est restée dans le tube. « La base de Malte nous donne l’ordre de nous rendre dans l’île de Chios. L’escorteur ayant disparu, pendant la nuit, nous faisons surface pour secourir d’éventuels survivants du cargo. Nous naviguons parmi des débris qui flottent en surface mais ne trouvons qu’un radeau pneumatique portant de nombreuses taches de sang que nous récupérons et amarrons entre le kiosque et le canon. Alors qu’il a quitté les lieux du naufrage et qu’il longe en surface et à petite vitesse la côte turque, le « Curie » s’échoue sur un banc de sable non signalé sur la carte. Au bout d’une demi-heure d’efforts et en marche arrière, il réussit enfin à sortir de sa position délicate et à reprendre sa route pour Chios où il arrive le 5 octobre. « Avec l’aide de marins d’un escorteur anglais et après avoir placé notre sous-marin étrave en l’air et arrière sous l’eau, nous réussîmes à glisser la torpille hors du tube. La mise à feu n’était pas amorcée….ce dont nous nous doutions depuis la dernière utilisation car si cela avait été le cas, on ne parlerait plus du « Curie » en citant sa devise : « A corps perdu » mais en disant simplement « Perdu corps et biens ».
À Chios, Joseph Pierre commença à coudre trois bandes blanches correspondant aux trois navires coulés sur chacun des deux « Jolly Roger ». La couture n’était vraiment pas sa spécialité et ses copains de l’équipage, conscients de ses difficultés, lui demandaient d’accélérer ses travaux car il faudrait bientôt en coudre une bonne dizaine en plus.
C’est aussi dans cette île que son ami le quartier-maître mécanicien Jean-Louis Gloaguen put échanger deux paquets de cigarettes contre un cahier ce qui lui permit de continuer à écrire son journal de bord si précieux aujourd’hui pour retrouver avec précision le parcours du « Curie » pendant son périple en Méditerranée.
« En torpillant et coulant trois navires ennemis en 24 heures, nous venions de réaliser un fait d’armes exceptionnel dans l’histoire de la guerre sous-marine. Tous les sous-marins de la 10° escadrille et les équipages des bateaux présents à Malte étaient au courant de notre exploit. »
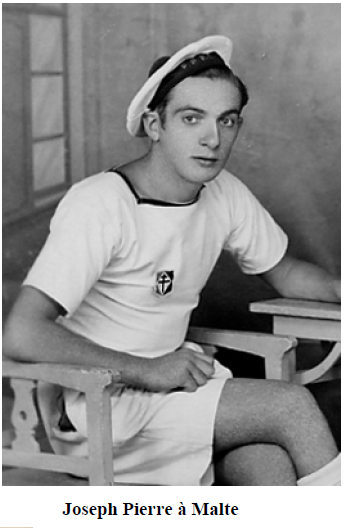
Le 13 octobre 1944, à l’arrivée à La Valette un peu avant midi, timonier tribord dans la baignoire, Joseph Pierre regarde avec fierté le « Jolly Roger » décoré de ses trois nouvelles bandes qu’il a hissé à bloc sur le périscope de combat.

«Jolly Roger »
Le pavillon pirate du sous-marin « Curie » a été
offert par Joseph Pierre au musée de la Résistance
Bretonne de Saint-Marcel situé dans le Morbihan,
près de Malestroit, sur les lieux-mêmes où s’illustrèrent
les parachutistes du bataillon S.A.S. du colonel
Bourgoin et les maquisards de trois bataillons
des F.F.I. lors des combats du 18 juin 1944.
La bande rouge représente le navire de guerre
allemand et les quatre bandes blanches les transports
de troupes et de matériel coulés par le
« Curie ». Les étoiles représentent les trois batteries
de Port-Vendres détruites au canon.
L’accueil est triomphal. Le captain S10,(commandant de la 10°escadrille de sous-marins), de nombreux officiers, les équipages d’une bonne vingtaine de bateaux et le personnel de la base HMS Talbot se sont rassemblés pour accueillir le sousmarin et le triple « Hip, hip, hip, hourra » qu’ils poussent tous en choeur, en l’honneur de l’équipage devait s’entendre bien au-delà de La Valette. Moment inoubliable qui faisait chaud au coeur et permettait d’oublier quelques instants les dangers que côtoyait chaque jour l’équipage du sousmarin. « Nous apprîmes quelques jours plus tard qu’il y avait eu de très nombreuses victimes parmi les équipages des bateaux coulés et les soldats allemands qui évacuaient les îles de la mer Égée vers Salonique. La présence de munitions au fond des cales contribua à alourdir le nombre des victimes. C’était la guerre…... c’étaient eux ou nous. »
Ce bâtiment ennemi gravement endommagé et mis hors de combat ne figure pas au bilan du « Curie ».
Après une vingtaine de jours de farniente à Malte, le « Curie » quitta HMS Talbot le 2 novembre 1944, les tubes lance-torpilles non approvisionnés. 1300 milles en surface à 11 noeuds et une plongée d’un peu plus d’une heure pour parcourir six milles dans les eaux territoriales turques et il arrivait à Chios où il se mettait à couple de l’escorteur anglais qui l’avait aidé à enlever la torpille restée dans l’un des tubes. C’est lui qui allait sortir de ses cales les huit torpilles qui allaient être transférées à bord du « Curie » en les faisant entrer par le panneau du poste d’équipage d’où elles étaient placées sur un chariot sur rails et transportées jusqu’au « dortoir » préalablement débarrassé de tout ce qui aurait pu gêner la manoeuvre. Quatre étaient introduites dans les tubes et les quatre autres étaient placées, deux de chaque côté, toujours enduites de leur épaisse couche de graisse « dont l’odeur allait accompagner nos rêves de vie au grand air lorsque nous serions installés dans nos hamacs. Nous n’aurons pas l’occasion d’utiliser ces torpilles. »
Retour à Malte
Le 9 novembre 1944, le « Curie » quittait définitivement la mer Égée et rejoignait Malte. La 10° escadrille rentrait en Angleterre. Les sous-mariniers du « Curie » participaient aux « farewell parties » organisées par leurs amis anglais. On ne quitte pas impunément des amis. La joie de retrouver son pays se mêlait à la tristesse d’avoir à quitter ceux qui avaient connu les mêmes risques et vécu les mêmes angoisses, enfermés à plusieurs dizaines de mètres sous la mer. Le 26 novembre, ce fut au tour du « Curie » de prendre le départ pour la Corse puis Toulon où le 29 il se mettait à couple du croiseur « Tourville » qui allait fournir le gîte et le couvert à Joseph Pierre et à tous les membres de l’équipage.

« En février 1945, nous participions à des exercices de détection de sous-marins. Nous sortions le matin et rentrions en fin d’après-midi. Alors que nous étions en plongée, plusieurs escorteurs dont « Le Fantassin », « Le Vigilant », « Le Sénégalais » et « Le Légionnaire » s’entraînaient à nous détecter. Exercices qui nous amusaient au début mais qui devinrent rapidement fastidieux. Le « Tourville» était le navire relais entre la préfecture maritime et les navires qui entraient ou sortaient de Toulon. Jean Diot originaire d’Étel et moi étions les deux timoniers du « Curie ». Astreints à faire le quart sur la passerelle du croiseur, nous étions chargés de transmettre en Scott et à bras les messages que la préfecture maritime adressait aux autres navires. Sur le sous-marin, nous n’avions pas eu souvent l’occasion d’utiliser ce genre de communication entre bateaux. Cela nous rappela notre entraînement de timonier que nous avions suivi, deux ans auparavant, à Skegness au Hms « Royal Arthur » dans le nord-est de l’Angleterre » C’est aussi en février, à Toulon, que tous les membres de l’équipage du « Curie » reçurent la Croix de guerre. Les mérites du sous-marin et de tous ceux qui venaient de participer à la lutte sous le pavillon de la France Libre étaient enfin reconnus et récompensés.
« Le 24 mars 1945, nous quittions Toulon. Après avoir fait escale à Oran puis Gibraltar, en convoi, avec plusieurs cargos et escorteurs, nous avons mis le cap sur l’Écosse.

Voyage vers l'Ecosse:
Le 14 avril 1945, en arrivant dans le Holy-Loch, une nouvelle fois, j’ai hissé notre « Jolly Roger ». Nous fûmes accueillis par un retentissant « Three cheers » en passant devant le « HMS Forth » qui fut notre premier bâtiment de base en 1943…….. La boucle était bouclée.
Le cauchemar que nous venions de vivre pendant tous ces jours en plongée dans notre cercueil d’acier nous avait profondément marqués. Le bonheur d’être toujours en vie, notre ami Wallace, l’Irlandais du bord, ne put s’empêcher de l’exprimer en laissant éclater sa joie peu après notre arrivée. Décoré comme nous de la Croix de guerre, il obtint l’autorisation de la porter ainsi que la fourragère sur son uniforme de la Royal Navy. Pendant une bonne dizaine de minutes, nous crûmes qu’il avait perdu la raison. Sous les regards surpris et incrédules des marins anglais des bateaux voisins, il parada sur le pont du « Curie », marchant au pas de défilé de la marine anglaise en pleurant toutes les larmes de l’Irlande. Nous revenions de l’enfer ! Je n’avais que vingt ans mais quel âge avais-je en réalité ?
Avant notre départ de Toulon, l’un d’entre nous avait aussi « pété les plombs ». Il s’agissait de l’un des plus anciens sur le « Curie », un quartier-maître de première classe qui fut appelé à comparaître devant un tribunal exceptionnel qui fut organisé à bord du sousmarin. Sans doute, profondément marqué par ses séjours sous l’océan, il n’avait pas compris qu’il allait falloir s’adapter à la vie sur le « Tourville » où la discipline et les règles à respecter étaient beaucoup plus strictes que sur notre sous-marin.
Certains pensèrent qu’il fut pris d’un accès de folie aussi soudain qu’imprévisible, imputable à l’évacuation brutale d’un stress refoulé pendant deux ans. Ce furent les circonstances atténuantes qu’évoqua son défenseur, le secondmaître timonier Henri Toussaint Il était reproché à l’accusé d’avoir attaqué «de façon fulgurante et tous azimuts», six matelots du «Tourville» qu’il avait mordus. Plusieurs sanctions furent demandées dont une mutation disciplinaire sur le « Montcalm » mais elle fut jugée trop infamante et rejetée. Le tribunal se contenta de prononcer la dégradation du coupable et le quartier-maître de première classe Radium se retrouva apprenti marin.
La réglementation anglaise interdisait la présence d’animaux à bord alors que les serins et les chiens étaient autorisés dans les sous-marins français pour détecter les gaz qui pourraient s’échapper des batteries. L’admission à bord de notre fidèle compagnon à quatre pattes, fox–terrier offert par Mrs Lindsay Carnegie, l’épouse du directeur du chantier de Barrow in Furness, avait été difficile à obtenir mais une dérogation fut accordée au «Curie», sous-marin anglais qui allait naviguer sous pavillon français. Notre ami Radium qui n’aboyait jamais à l’intérieur du sous-marin, qui était le seul chien capable de grimper à une échelle verticale, était un matelot exceptionnel.
Nous lui pardonnions la mauvaise habitude qu’il avait de montrer ses crocs à toute personne étrangère au « Curie ». Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’il était sanctionné. Il montait en grade après chaque patrouille mais il rétrogradait régulièrement pour « comportements inconvenants» comme ce fut le cas lorsqu’il leva la patte pour arroser le périscope de combat.
Il craignait particulièrement les grenadages. « Au premier coup de klaxon, il fonçait au poste central. À plat ventre, les pattes en croix entre la barre de plongée arrière et la console Asdic, il s’oubliait avant même que les opérateurs aux écoutes ne signalent la moindre grenade. »
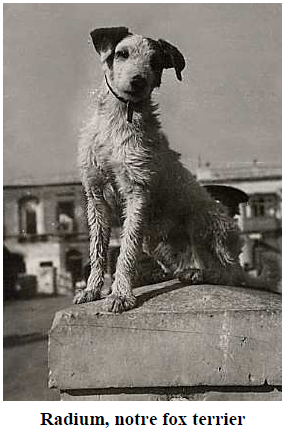
Le second-maître timonier Henri Toussaint était très attaché à Radium. C’est avec lui que partit le fox-scottish du bord. Il le suivit partout, même à bord du remorqueur que commanda plus tard son maître et un jour, il disparut en mer. Dans son livre « Le sous-marin Curie », Jean-Louis Gloaguen écrit qu’il est persuadé que ce ne fut pas une chute accidentelle : « Je pense qu’il a plongé pour aller chercher dans les profondeurs un sous-marin bleu marine dans lequel il avait tant d’amis ».
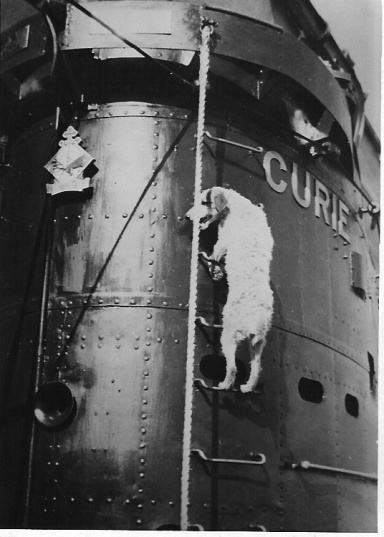
Témoignage de Joseph Pierre, recueilli par Pierre Oillo, délégué départemental du Morbihan de la Fondation de la France Libre.
Avec la complicité de Jean-Louis Gloaguen, camarade de combat de Joseph Pierre sur le « Curie ».
Photos : Joseph Pierre
Bibliographie
« A corps perdu » - Pierre-Jean Chailley,
« Le sous-marin Curie » - Jean-Louis Gloaguen
« Les combattants de la liberté » - Pierre Sonneville
Démobilisé après la victoire, Joseph PIERRE revient à Kervio sur l'Île d'Arz en Bretagne. Il se marie le 24/10/1945 avec Suzanne Marguerite Marie LE BIAVANT. Domicilié à Vannes (56), Joseph Pierre fut membre du Comité de Vannes-Pontivy de la Fondation de la France Libre dont il fut le porte-drapeau pendant de nombreuses années.
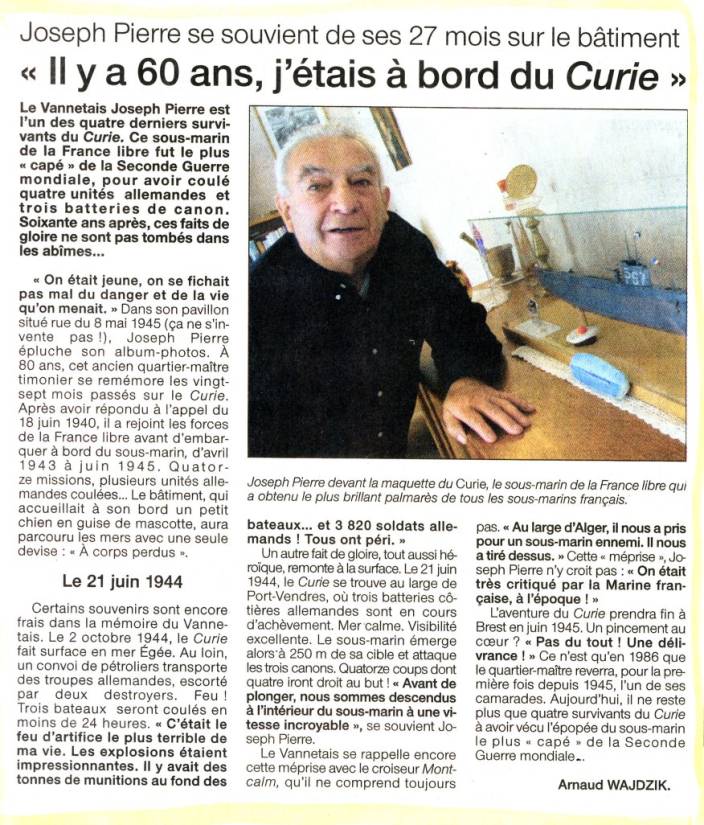
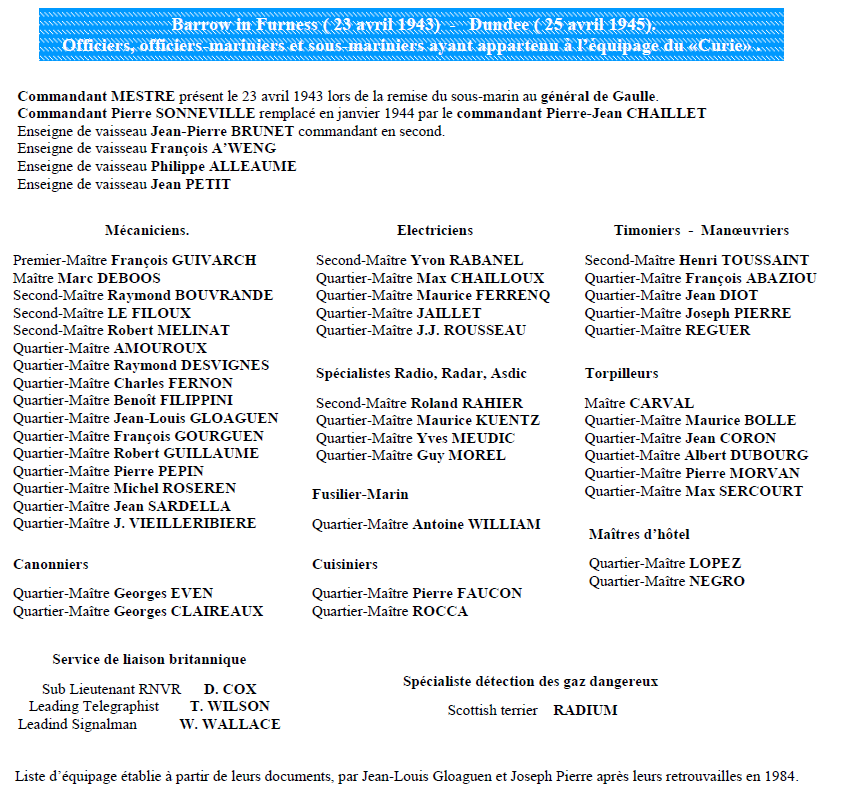
Certains de ces sous-mariniers comme Joseph Pierre et Jean-Louis Gloaguen furent présents sur le « Curie » pendant la totalité
de son activité au service des Forces Navales Libres. D’autres qui figurent sur le rôle d’équipage, quittèrent le bateau, pour raisons de santé comme Albert DUBOURG qui fut hospitalisé à Gibraltar et remplacé par Jean SARDELLA à Alger, ou d’accidents
survenus à bord comme ce fut le cas pour Jean DIOT qui fit une chute de plus de trois mètres en tombant du « Tourville »
sur le pont du « Curie » et fut hospitalisé à Marseille
JOLLIVET, décède en Indochine occupée par les Japonais
Pierre Marie JOLLIVET [30/1/1905 Séné - 4/7/1945 Saïgon] Sinagot "Mort pour la France"
Le soldat JOLLIVET est né à Séné au Petit Poulfanc d'un père manoeuvier, Joachim Mathurin JOLLIVET né le 3/2/1864 à Sulniac et d'une mère ménagère, Marie Josèphe JULIO née à Ambon le 6/1/1874.
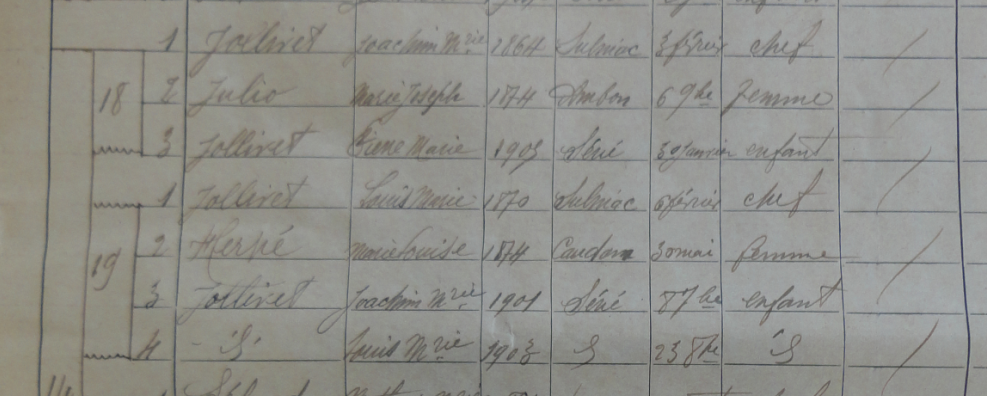
En 1906, la famille JOLLIVET est bien pointée par le dénombrement au Poulfanc en Séné où plusieurs frères Jollivet sont descendus de Sulniac pour travailler au Poulfanc.
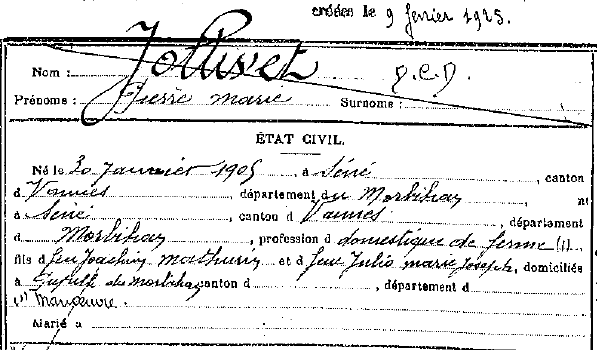
Sa fiche de matricule nous indique, qu'en 1925, avant de partir au service militaire, Pierre Marie JOLLIVET est garçon de ferme et vit à Séné. Il est affecté au Maroc. Il rentre en 1926 et s'installe à Saint-Nolff. Il se marie à Vannes le 19/9/1931 avec Simone Alexandrine Anne VISAGE [6/4/1911 - 2008 Merlevenez], native de Saint-Nolff. Il déclare alors la profession de camionneur et réside au n°5 de la rue Boismoreau à Vannes. Il est sans doute employé par les transporteurs installés route de Nantes à Vannes et Séné [lire histoire de Duclos Penru et des routiers de Séné].
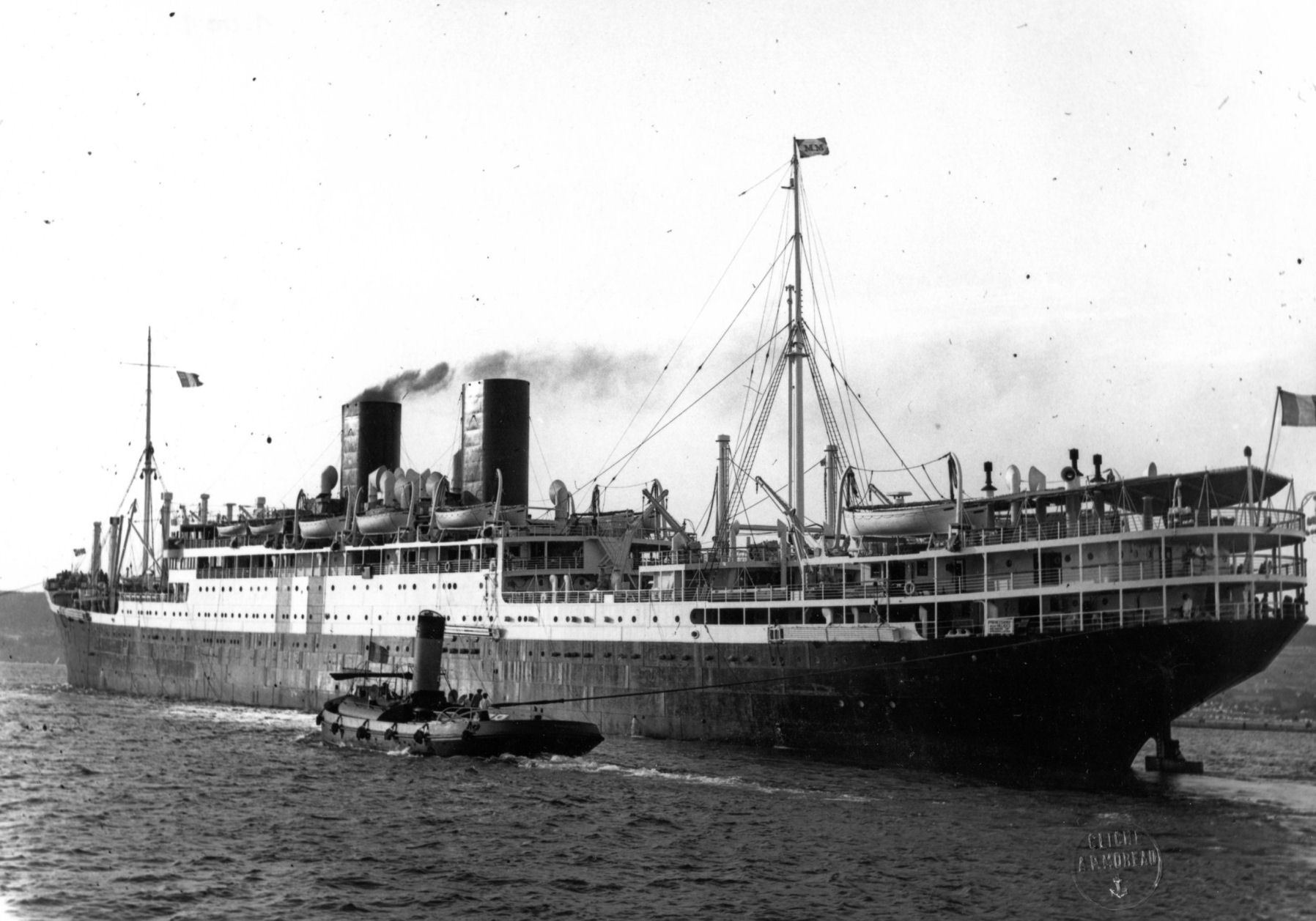
Le 27/2/1936, il s'engage pour 4 ans au sein du 2° Régiment d'Infanterie Coloniale. Le 18/3/1938, il embarque pour Shangaï à bord du vapeur d'Artagnan et rejoint le 16° RIC basé en Chine. Le 3/10/1938, la France est contrainte de quitter la Chine et le 16°RIC se replie en Indochine. Plusieurs postes d'affectation le mène à Nha Trang puis à Quinhen dans l'Amman, actuelle Quy Nhon au Viet-Nam.

Son dossier 21 P 279345, transmis par le SHD de Caen, nous indique que le soldat de 1ère classe JOLLIVET, en poste au "Dépôt de Transition de Saïgon", est admis à l'hôpital le 28 juin 1945. On lui diagnostique une "tuberculose pulmonaire bilatérale et enterite tuberculeuse", imputable à son service au sein du 16°RIC. Il décède le 4 juillet 1945 à l'Hôpital Graal de Saïgon situé au 14 rue de la Grandière.
Depuis le "coup de force " des armées japonaises, la France de Vichy n'exerce plus de fait l'Autorité sur les colonies d'Indochine. Le d'Artagnan sera réquisitionné par les Japonais et ensuite coulé par un sous-marin américain. L'armée japonaise opère une violente répression sur tous ceux qui remettent en cause son autorité et notamment les troupes françaises alors en poste en Indochine. Beaucoup sont contraints de fuir, sont arrêtés et emprisonnées dans les geôles japonaises ou ils sont martyrisés, torturés et pour beaucoup fusillés.
Au moment de son décès, l'Hôpital Graal est occupé par les forces japonaises. Certes, le soldats JOLLIVET n'est pas mort au combat mais de tuberculose comme de nombreux Poilus de 14. Contre qui la France se bat alors en Indochine? Les nationalistes Vietnamiens? Non ! La France résiste à l'armée japonaise, armée d'occupation de l'Indochine Française. D'ailleurs, son dossier militaire comporte la mention 39-45, affectant son décès non aux guerres de colonisation, non à la guerre dite" d'Indochine" visant à lutter contre le Viêt-Mihn, mais bel et bien à la Seconde Guerre Mondiale.
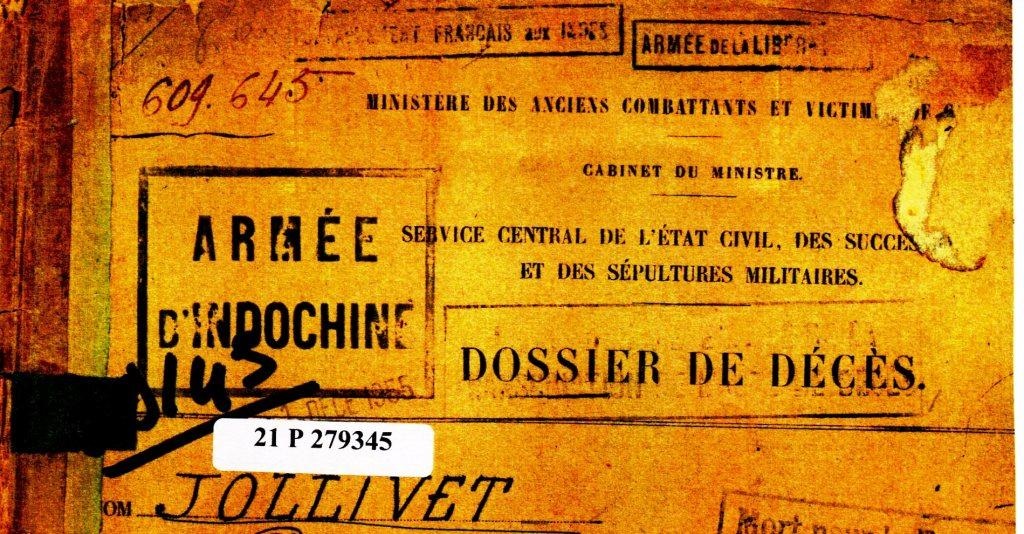
Pierre Marie JOLLIVET est en quelques sorte une victime du Japon impérial et fascite, comme d'autres l'ont été de l'Allemagne nazie. Le site Mémoire des Hommes le répertorie également sur la Seconde Guerre Mondaile. Il est déclaré "Mort pour la France", mention inscrite sur son acte de décès. Natif de Séné, ayant vécu à Séné jusqu'à l'âge de 20 ans, le nom de ce Siangot mérite d'être rajouté au Monument aux Morts de la commune.
Marins sinagots des FNFL
Village de pêcheurs, Séné sur les rives du Golfe du Morbihan a donné beaucoup à la "Royale" (marine nationale) et à la marine marchande. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, des marins sinagots ont rejoint les Forces Navales Françaises Libres. Qui étaient-ils et quels furent leurs actions?
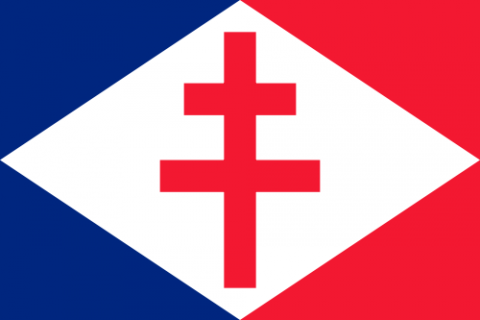
Note : https://www.marine-marchande.net/ on retrouve la carte d'identité de nombreux bateaux et cargos. Article rédigé après consultation des dossiers de résistant disponibles au Service Historique de la Défense à Vincencces.
BOURDIC Robert, Joseph , Marie, 16 P 81333, le mousse sinagot rejoint Londres
Comme nous l'indique sa fiche de résistant, Robert BOURDIC s'engage dès septembre 1940 et rejoint le Général de Gaulle à Londres.
Robert Joseph BOURDIC [3/2/1925-10/12/1982 Vannes] nait à Séné au village du Mouboul. Son père, Marcellin [26/41889-9/11/1968] est un pêcheur sinagot marié depuis 1922 à Françoise LACROIX [1/9/1899-31/7/1929], mère de famille qui décède prématurément. La famille compte alors 3 jeunes enfants, Joseph Gabriel, 1923, Robert et André Roger [27/2/1928-4/4/1961 Issy les Moulineaux]. La famille est pointée au Mourboul lors du dénombrement de 1926.
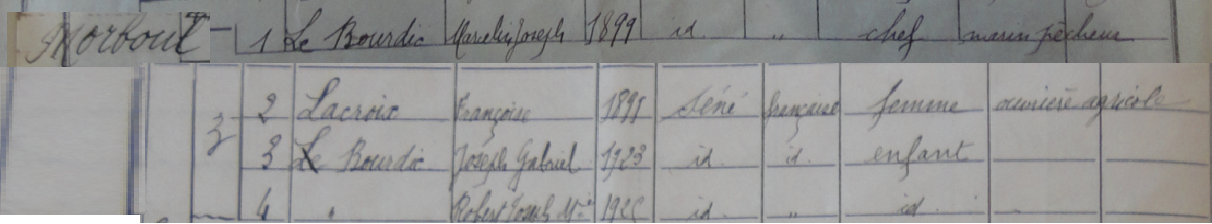
Au dénombrement de 1929 et de celui de 1936, Joseph, le dernier des garçons vit chez ses grands-parents, cultivateurs au village de Michote. [trouver où réside Marcellin Bourdic et ses enfants Robert et André?] Jusqu'à quel âge, le jeune Robert reste-t-il à Séné? On peut supposer que Marcellin est allé chercher du travail à La Rochelle comme de nombreux Sinagots de cette époque.
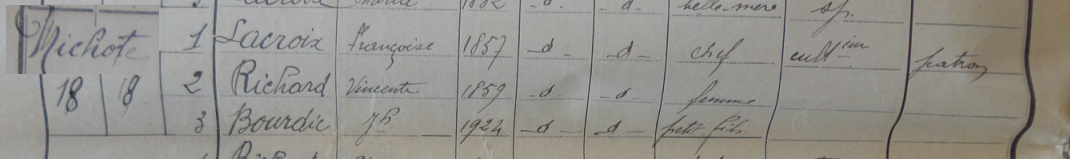
Le dossier de résistant consultable au Château de Vincennes, nous indique que Robert BOURDIC choisit à 15 ans de devenir marin. Il est alors inscrit maritime au quartier de La Rochelle.

Mousse à bord du chalutier Héron, de l'armement Castaing; puis à bord du Cassard, alors que la France a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie.
N'acceptant pas la défaite, le jeune marin BOURDIC rejoint les Forces Françaises Libres à Londres en septembre 1940. Il sert au titre de la Marine marchande des FNFL de septembre 1940 à juillet 1941.
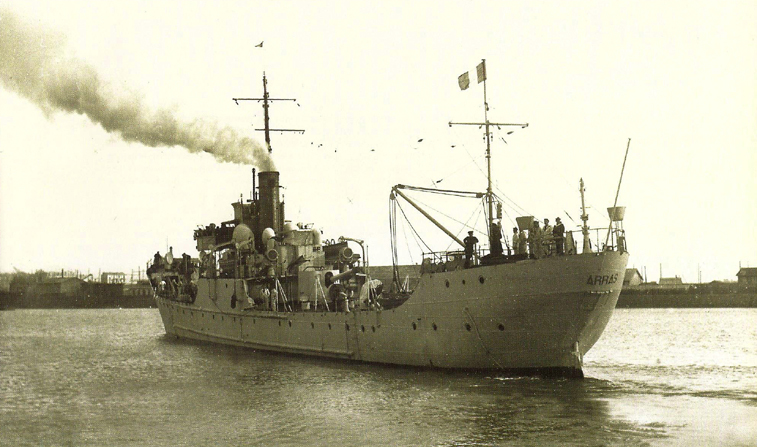
A partir de juillet 1941, il est affecté à bord de l'ARRAS, un de 5 avisos de cette classe, Amiens, Arras, Belfort, Coucy, Épinal. qui tombèrent entre les mains de la marine britannique. Ils devinrent des bâtiments-bases des FNFL. 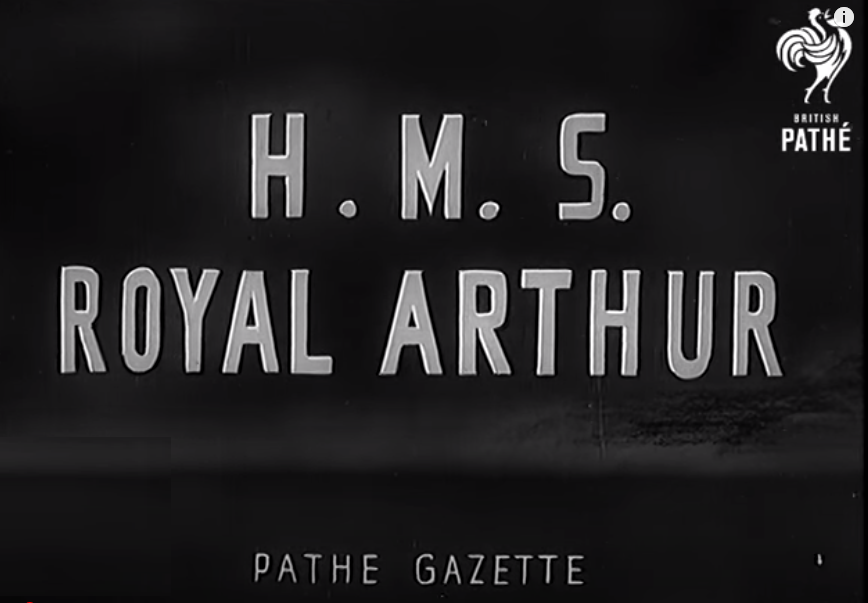
Il rejoint ensuite le centre de formation HMS Royal Arthur à Skegness. Le HMS Royal Arthur, est un établissement à terre de la Royal Navy , initialement à Ingoldmells près de Skegness , et plus tard à Corsham , Wiltshire . Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ancien camp de vacances d'Ingoldmells a été utilisé pour former principalement des matelots et des officiers de la branche des communications «hostilités uniquement» (pour la durée de la guerre uniquement) (signalistes, télégraphistes, codeurs et opérateurs sans fil).

Il est à nouveau sur le ARRAS et ensuite sur le D'ESTIENNE D'ORVES.
Cette corvette, ex HMS Lotus, J 495 K93 des chantiers Hill and Sons de Bristol, fut lancé en 05/1941. Elle fut transféré aux F.N.F.L le 23 mai 1942. Dans un premier temps elle assura l'escorte des convois le long des côtes de l'Afrique Occidentale Française, avant de s'engager pour la même mission le long des côtes des îles britanniques. Elle participa au Débarquement de Normandie du 06 juin 1944 avant de rejoindre la Méditerranée à partir d'août 1945. Elle porte le nom d'Honoré d'Estienne D'orves [1901-1941], officier de la marine frnaçaise, résistant, fusillé par les Allemands. Ellle était commandée par LV Fontagnères. A l'issue de la guerre, elle fut restituée à la Royal Navy en 05/1947.
Le jeune marin BOURDIC passe ensuite par la base navale écossaise sur la rivière La Clyde, sans doute le port de Greenhock où embarquèrent de nombreux marins français et où a été édifié un monument à leur mémoire.
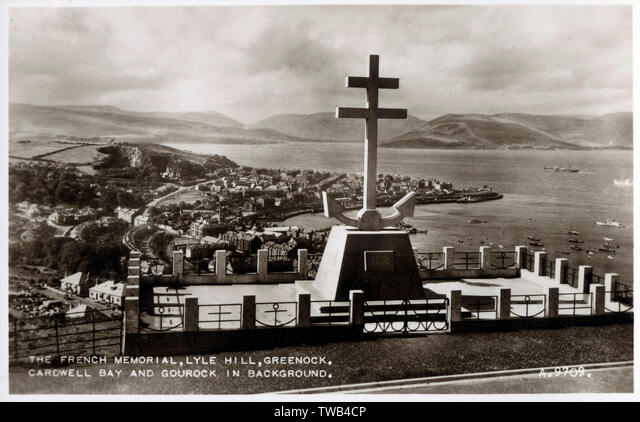
Ensuite, il retourne sur l'ARRAS. Pour former les équipages des FNFL, une École navale est créée à Portsmouth, d'abord sur le Courbet, puis sur le Président Théodore Tissier et ses deux annexes l'Étoile et la Belle Poule. Ce navire océanographique fut saisi le 3 juillet 1940 par la Royal Navy et aussitôt réarmé par les Forces navales françaises libres (FNFL) dans lesquelles il sert de bâtiment-école au profit des équipages des FNFL en formation au Royaume-Uni.. Après le fait d'armes en Libye à Bir-Hackeim, l'école navale adopte le nom de Bir-Hackeim. Elle disposait de barraquements à Southleigh Road, ville de Emsworth en banlieue de Portmouth. Le jeune marin BOURDIC y passe quelques mois avant de recevenir à Skegness.

Il est ensuite affecté à bord de La Combattante (Ex Haldon), un torpilleur des FNFL. Ce destroyer britannique de la classe Hunt a été offert par le Gouvernement britannique à la France libre en 1942. Il est alors matelot timonier.
Il doit tomber malade car il est affecté au Centre Médical FNFL, maison de santé de Beaconsfield en Angleterre. Il rejoint ensuite à nouveau le centre de formation de Portmouth Bir Hacheim. Il est ensuite affecté au sein des FNFL à Ayr en Ecosse. Il repasse par un centre médical avant de rejoindre début 1944 à Ayr, les nouvelles Forces Navales de Grande Bretagne (FNGB) issues du regroupement des FNFL avec les forces maritimes d'Afrique du Nord. En juillet 1945, il est sur la base de la Clyde. Sans doute en raison de son jeune âge et de son état de santé, il ne participe pas au Débarquement en Normandie.
Démobilisé en 1945, il était devenu Quartier Maître Timonier. Il se marie à La Rochelle le 10/12/1947 avec Simone Andrée Yvette BREUIL, dont il divorce le 19/1/1960. Il se remarie le 6/2/1965 à La Rochelle avec Anne Geneviève LE PENRU. Pour sa retraite, il reviendra en Bretagne où il décède à Vannes le 10/12/1982.
CRABOT Maurice, Joseph, Marie, 16 P 149679
Maurice Joseph CRABOT [19/5/1919-20/2/2000] nait au village de Kérarden. Son père, natif de Belle-Île, est marin chauffeur et sa mère ménagère.
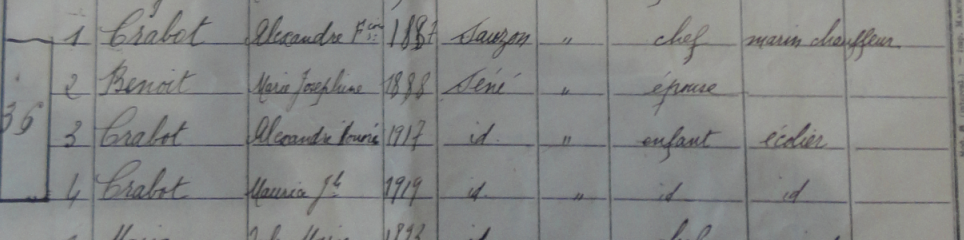
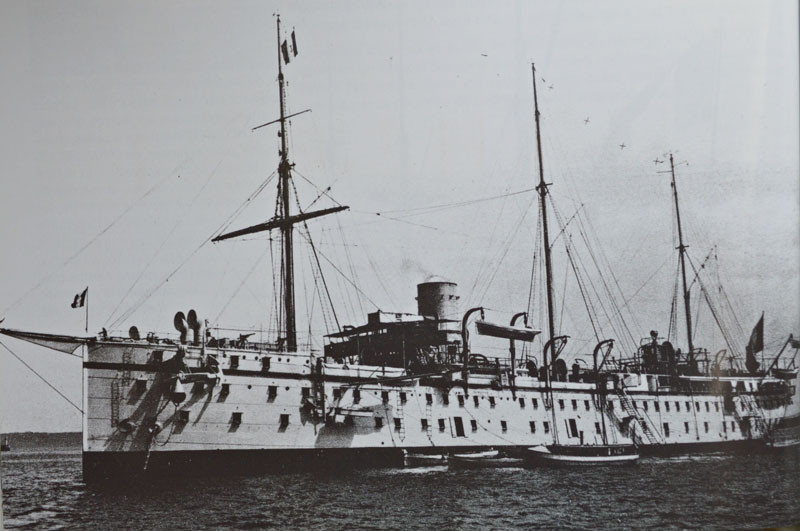
A l'âge de 20 ans; il fait son service national dans la Marine. D'abord sur le navire école L 'Armorique et puis sur le Mistral, comme nous l'indique sa fiche d'inscrit maritime.
Le Mistral : Lorsque la France signe l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940, le Mistral, basé à Brest. Il est commandé par le capitaine de corvette Guillaume Christophe Marie de Toulouse-Lautrec-Montfa. Après avoir participé à l'évacuation de Dunkerque, le bâtiment se réfugie dans la base HMNB Devonport. Le 3 juillet 1940, les Britanniques exécutent l'opération Catapult, ils saisissent les navires de guerre français dans les ports français et britanniques pour les empêcher de tomber entre les mains des Allemands ou des Français du régime de Vichy. Le commandant veut sabordé son bâtiment mais en est empêché par les Britanniques.2. Les Britanniques saisissent le Mistral et l'incorporent dans la Royal Navy, il a alors pour nom HMS Mistral. Il reçoit de l'artillerie britannique1. Il entre en collision avec le navire-citerne Black Ranger ; le Mistral subit des dommages mineurs tandis que le Black Ranger passe une courte période en réparation dans un chantier de la Clyde3. Finalement les Britanniques le restituent aux Forces françaises combattantes à Hartlepool1. Lors du débarquement de Normandie, le Mistral est gravement avarié par des tirs d'artillerie allemande dans la Manche au large de Quinéville, le 10 juin 1944. Il est déclaré comme perdu. Il est ramené à Cherbourg le 25 août 1945 par un équipage anglais, condamné le 24 novembre 1948, rayé le 17 février 1950 et mis en vente le 5 décembre 1952. Il est remorqué le 8 janvier 1953 à Brest pour démolition (source wikipedia).
En mars 1942, Maurice CRABOT rejoint les FNFL en Angleterre. Comment a-t-il gangé l'Angleterre? Il est géré par la Compagnie de Passage à Londres (CPL). Cette structure constitue l’étape intermédiaire entre les services d’immigration britannique et les dépôts français de la marine de guerre ou marchande.
Il sera affecté sur les quelques rares navires qui composent la marine des Forces Françaises Libres, dont l'ARRAS puis sur le torpilleur BOUCLIER, le HMS Nemesis, à nouveau le ARRAS puis le COMMANDANT D'ESTIENNE D'ORVES, une des neuf corvettes des FNFL: Mimosa, Alysse, Lobélia, Aconit, Renoncule, Commandant Détroyat, Roselys, Commandant Drogou. Il est alors matelot gabier. Ce navire tire son nom du commandant éponyme qui fut exécuté par les Nazis en aout 1941. Il est ensuite rattaché à la base navale sur la Clyde, ria d'Ecosse, où les marins français préparent le Débarquement. En mai 1944, il est à bord du chalutier Monique Andrée, transformé comme d'autres en dragueur de mines.
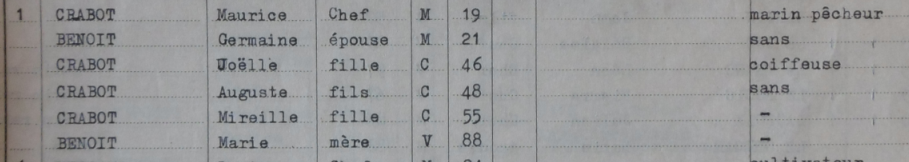
A la Libération, il est renvoyé dans ses foyers (RDSF) et il se mari le 19/6/1945 aec Germaine Louise BENOIT à Séné. Lors du dénombrement de 1962, la famille vit à Kérarden où il décède le 20/2/2000.
DORIOL Edouard, Toussaint, Marie 16 P 352010
Edouard DORIOL [1/11/1904-15/6/1988] nait à Montsarrac. Son père est marin et sa mère ménagère. Lors du dénombrement de 1926, la famille est recencée à Montsarrac. Les 3 garçons sont marins.
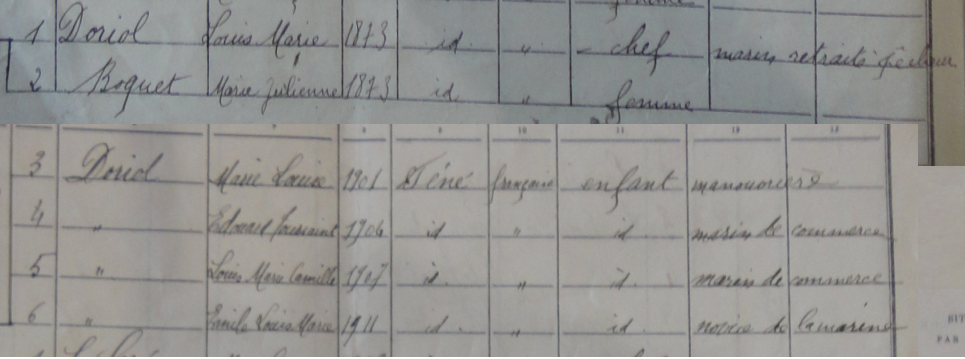
Edouard se marie le 4/7/1928 avec une fille de Séné, Nathalie PLUNIAN [8/1/1904-2/12/1993]. Pendant la guerre, il sera cuisinier à bord de différents navire de la marine marchande.

Quand éclate la guerre il est à bord du SAINTONGE, (FRA/1936/9640/152,4) un cargo pétrolier, construit à Odense en 1936 par HENNING MAERSK (Dnk) et armé par la Société Française de Transports Pétroliers. Il est réquisitonné par les Anglais à Belfast, le 17 juillet 1940, et transformé en navire auxiliaire. Il sera transféré aux forces navales françaises libres (FNFL) et déréquisitionné en 1945.
Il navigue en suite sur le NEVADA, puis le VILLE DE MAJUNGA (FRA/1931/4900/125,0), un cargo mixte lancé au Trait en 1931 par la Nouvelle Compagnie Havraise Péninsulaire. En avril 1940, ce navire participe à la Campagne de Norvège.. Le 13/06/1940, alors qu’il participe à l’évacuation du Havre, il est frappé par une bombe. Les dégâts importants nécessitent son remorquage vers Brest pour réparations. Le 01/03/1940, en route de Marseille vers l’Océan Indien via Le cap, il est arraisonné par les Anglais au large du cap de Bonne Espérance. 12/1942. Il s’occasionne une déchirure de coque de 80 m au cours d’un échouement devant Capetown. en avril 1945, il quitte le pavillon britannique et est restitué à sa compagnie. Démoli en 1959.

Edouard DORIOL rejoint ensuite le VILLE D'ORAN (FRA/1935/10172/147,5), son dernier navire par temps de guerre qui était tombé aux mains des Britannique en 1943.
Il décède à Vannes le 15 06 1988.
LE FRANC Jean, Vincent, Marie
Le site internet de la France Libre répertorie également Jean LE FRANC [24/8/1905-30/12/1972] , né à Séné au village de Brouel au sein d'une famille de cultivateurs. Sa mère, Marie Perrine LE CLOAREC [21/2/1862 Vannes- 31/8/1905 Séné Brouel] décède des suites de son accouchement. Son père Vincent Marie LE FRANC [1/5/1860 Cariel - 11/12/1921]. La famille quite Brouel. Le jeune Le FRANC va choisir la vie de la marine.
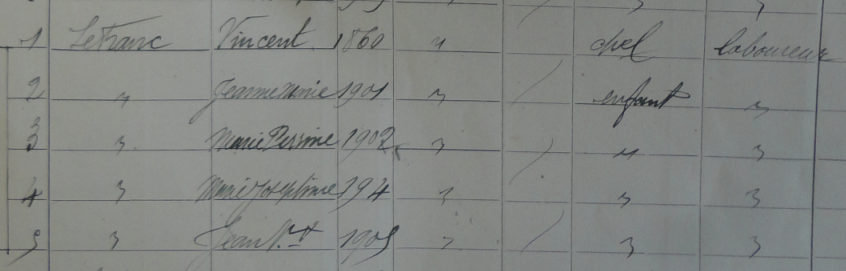
Selon le site France-libre.net, il fut graisseur dans la marine marchande. Il rejoignit Londres le 17/7/1940. Il est alors à bord du Forbin, puis du Jean L.D.

Le JEAN LD (FRA / 1936 / 5795 grt / 136,5) était un cargo lancé par les Ateliers & Chantiers de France, à Dunkerque. En 1936 il est affrêté par Louis Dreyfus, puis sous le nom de Bételgueuse en 1940 par la Compagnie Marseillaise de Navigation Coloniale. Changement de nom et création d’une nouvelle compagnie pour rendre moindre évidente l’origine juive de l’armateur. Le 21/01/1941, le JEAN LD est intercepté par les Alliés au large du Cap puis remis aux FNFL. Il sera restitué à la Libération à la Compagnie Marseillaise de Navigation Coloniale.
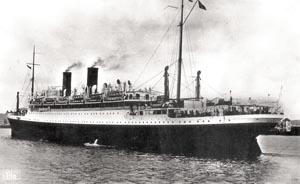
Il est ensuite à bord du CUBA, autre navire réquisitionné par la Royal Navy. Le CUBA (FRA/1922/11337/150,4 ) Paquebot Lancé à Newcastle en 1922 par la Compagnie Générale Transatlantique. Le 31/10/1940, venant de Fort de France avec 1259 passagers, il est arraisonné par le croiseur auxiliaire anglais MORETON BAY et détourné vers Freetown. En 11/1940, il est réquisitionné par le Ministry of war Transport comme transport de troupes. Le 06/04/1945, il est torpillé à l’entrée du chenal de Southampton par le sous-marin U1195, qui est détruit, avec tout son équipage, quelques instants plustard par le torpilleur anglais WATCHMAN.
Il rejoint ensuite le FORT BINGER (FRA/1919/5250/126), un cargo lancé à Stockton on Tees en 1919 sous le nom de CORNISH CITY (Gbr). En 1929, il prend le nom de FORT BINGER pour le compte des Chargeurs Réunis. En 09/1940, il est saisi à Pointe Noire par les Anglais. Le 18/05/1942, il est attaqué à la torpille par un sous-marin allemand, il parvient à le mettre en fuite après avoir tenté de l’aborder par deux fois. Son dernier bateau par temps de guerre sera à nouveau le JEAN LD.
Avant guerre, il s'était marié à Dunkerque, le 26/3/1936 avec Suzanne, Georgette ANDRIEUX, dont il divorcera le 27/5/1947. En secondes noces, il épousa à Montreuil, le 15/11/1954, Eugnéie FUCHS. Il décède dans cette ville de banlieue parisienne le 30/12/1972.
LE FRANC Vincent, Marie
Il nait le 29/4/1919 à Séné village de Moustérian de parents cultivateurs, patron de leurs terres et assez aisés pour employer un domestique.
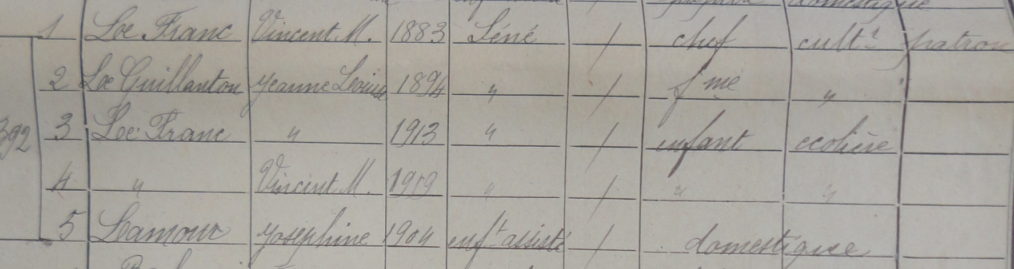
Matelot mécanicien 27 04 1943 5876 FN43 marine marchande.
Marié à Vannes le 25/2/1947 avec Joséphine CORBEL.
Décédé à Séné le 1/2/2007.
LIONDRE Jean Léon [28/02/1903 - 12/03/1942] 16 P 373548
Les sites des Français libres permet une recherche par commune de naissance. On y découvre le nom de Léon LIONDRE. Si le Minsitère a bien recensé les soldats des FFL ou des FFI, les marins des Forces Navales de la France Libre ne sont pas tous connus. L'Amiral Chaline en fait de longues recherches en vue de recenser les marins des Forces Françaises Libres
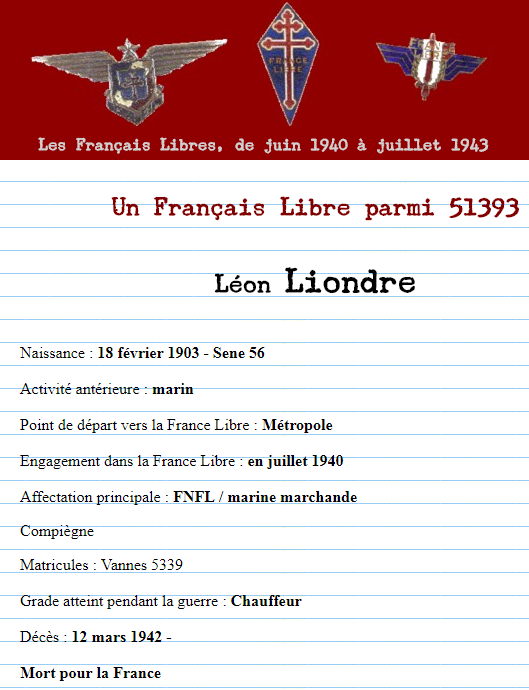
Leon Jean Louis LIONDRE est né à Séné à Kérarden le 28/12/1903. Son père, Jean Louis LIONDRE, né le 4/07/1872 à Séné, est marin de commerce et sa mère, Marie Françoise LE BRAZE, née le 10/7/1871 à Séné, est ménagère.
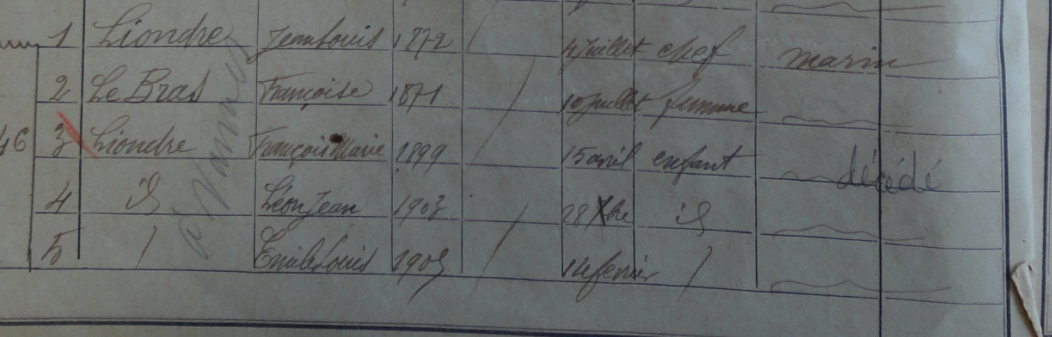
On retrouve la famille LIONDRE au dénombrement de 1906 installée à Kerarden Quand éclate la guerre, Léon LIONDRE est chauffeur, c'est à dire qu'il alimente la chauidière en charbon, à bord du paquebot Compiègne.
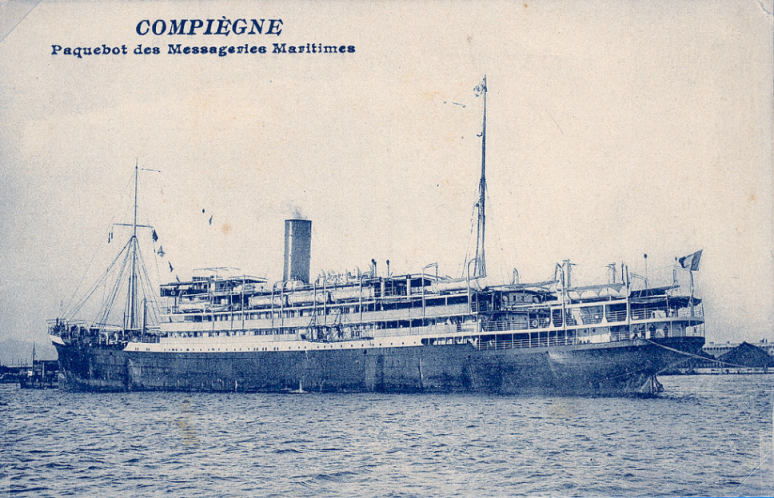
Pendant le printemps 1941, la Compiègne relie l'Indochine à Madagascar. Lors d'un convois, il est arraisonné par un croiseur britannique le 2/11/1941 au large des côtes sud-africaine. Menacé d'être coulé, le commandant du Compiègne reçoit de sa hiérachie jointe par radio, l'ordre de se saborder. Le commandant transforme l'ordre en saboter.? Le navire est alors capturé par la Royal Navy et tout l'équipage désertera et rejoindra les Forces Navales Françaises Libres.
La cote TTY801 des archives donne des documents [ à consulter]
COMPIEGNE, paquebot. – Activité et personnel : correspondance départ et arrivée (1940-1941), rapports sur l’arraisonnement du bâtiment (1940-1941), liste nominative de l’équipage (1941), fiches de renseignement après visite du
bâtiment (1940-1941), ordres de route (1940-1941). Dossier « désertion » :correspondance, note, listes nominatives (1940, 1942).
Lors du voyage du Compiègne vers l'Angleterre, le marin Léon LIONDRE est porté disparu en mer le 12 mars 1942. A son arrivé à Cardiff, la Croix Rouge enregistre le décès du marin. En 1946, le Ministère de la Marine enterine son décès et la mairie de Séné retranscrit également le décès de Léon LIONDRE. Toutefois, la mention "Mort pour la France" ne figure pas.
Dans le Tome V de l'Histoire des Forces Navales de la France Libre, du Capitaine de vaisseau André BOUCHI-LAMONTAGNE, la mention MPLF "Mort pour la France" figure aux côtés du nom de Léon LIONDRE.
PIERRE Joseph, Marie 16 P 476832 lire article dédié
Natif se Séné, ce jeune marin de commerce, profite de l'arraisonnement de son navire par les Britanniques près des Bermudes, pour rejoindre la France Libre. Une fois en Angleterre, il deviendra Quartier Maître timonier sur le sous-marin Curie. Il participe à plusieurs opération en Méditerranée, destruction de batterie à Port-Vendres, torpillage de plusieurs cargos allemands.
RAUD Emmanuel,Adrien, Marie GR 16P 500570
Emmanuel RAUD [5/8/1922-11/12/2003] nait au village de Kérarden. Son père est marin et sa mère ménagère. La famille est pointée lors du dénombrement de 1926, 1931 et 1936. Emmanuel est le frère de Constant, résistant au sein des FFI.
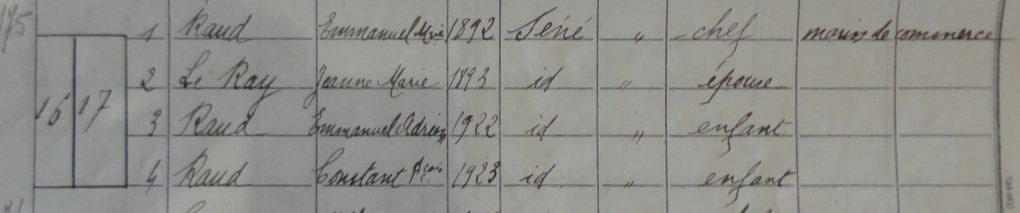
On sait que Emmanuel RAUD est matelot maître d'hôtel lorsqu'il rejoint le 1/7/1940 les FNFL qui lui attribuent le matricule CAS40 6297 FN41. Il est à bord du navire Daphné II, saisi à Grangemouth (GB) par les Britanniques en juillet 1940, qui l'a améne en Angleterre.

Le 18 mars 1941, en Mer du Nord, le cargo français Daphne II, qui navigue, sur lest, sous pavillon britannique, a quitté Londres la veille au sein du convoi côtier TG 32, à destination de la Tyne. Au cours de la nuit, alors que le convoi entre dans le chenal délimité par des bouées qui balisent un champ de mines d'un côté et des bancs de sable de l'autre, au large de la rivière Humber, une attaque aérienne se produit. Profitant du combat, des vedettes allemandes, basées à Ijmuiden, passent à l'attaque. La S 102 envoie une torpille sur un gros cargo et le rate. La torpille poursuit sa route et frappe le Daphne II dans la cale 3, à 01 h 20. Le navire, qui occupe la position n° 13, près du cargo Eddystone, portant la marque du vice-commodore, commence à couler par l'arrière. Des canots ayant été détruits par l'explosion, un radeau est mis à l'eau, sur lequel huit hommes prennent place. Le dernier canot, pendu à l'arrière, déjà rempli d'eau, peut être enfin mis à la mer et dix-huit hommes y prennent place. Le chalutier armé britannique Kingston Olivine recueille les rescapés puis prend en remorque le Daphne II. Un canot du destroyer Versatile vient recueillir les derniers rescapés. Le premier lieutenant et deux hommes (un canonnier et un matelot) restent à bord du cargo pendant le remorquage. Le remorqueur britannique Headman vient aider le chalutier et échoue le navire au sud de Bull, où il va se casser en deux, en eau peu profonde. Les huit occupants du radeau sont recueillis par le cargo britannique Corfish, du même convoi. Tout l'équipage, soit vingt-huit hommes, est sauvé et s'embarquera plus tard, sur le cargo français Egée.
FICHE TECHNIQUE du cargo DAPHNE II
Construit par les Ateliers et Chantiers de la Loire à Nantes (F)
Numéro de chantier 557
Mis en service en 1925 sous le nom de Rouennaise
Armé par l'armement Fernand Bouet à Caen
Acheté par la Société Navale Caennaise (G. Lamy & Cie) le 30 septembre 1928
Renommé Daphné
Déplacement : 1 969 tjb
Port en lourd : 2 850 tonnes
Longueur : 84,42 m Largeur : 12.40 m Tirant d'eau : 5,50 m
Puissance : 1 100 cv
Vitesse : 11 nd
Saisi à Grangemouth (GB) par les Britanniques en juillet 1940
Affecté au Ministry of War Transport
Renommé Daphne II
Géré par Chr. Salvesen & Co à Edimbourg (Ecosse)
Armé par les F.N.F.L.
Fin du navire : coulé le 18 mars 1941
Comme tous les candidats, il passe par la "CPL", Caserne de Passage à Londres puis il gagne la "Caserne" Surcouf, siège des FNFL à Londres, dans une ancienne école religieuse au 40 South Side Clapham Common.
Le 18/12/1943 il se marie à Wimbledon en Angleterre avec Béatrice Marjorie COOK.
Engagé volontaire pour la durée de la guerre au titre des FNFL à Londres le 1er juillet 1940. Il sert à la Marine en Grande-Bretagne jusqu'au 15 mars 1946. Il est démobilisé par le 2° dépôt à Brest le 7 juin 1946. Marié à une anglaise, il demeure au Royaume-Uni. Il décède le 11/1/2003 à Tooking, district de la banlieue sud de Londres localisé dans le borough de Wandsworth.
RICHARD Louis, Marie GR 16 P 509598-509600
Louis RICHARD [23/4/1897 -8/2/1975 Morlaix] nait à Barrarach. Son père, Louis Marie RICHARD [1854-1902] narif de Séné à Bil Lorois, était douanier, comme l'était son père, Jean Pierre RICHARD [1811-1877]. Leur aïeul était paludier. L'écart d'âge qui apparait dans la fratie au recencement de 1901 s'explique par le fait que son père, s'est marié en première noce avec Marie Vincente Kerloret [1855-1888] et en seconde noce avec sa belle-soeur, Françoise Mathurine Kerloret [1859-1939].
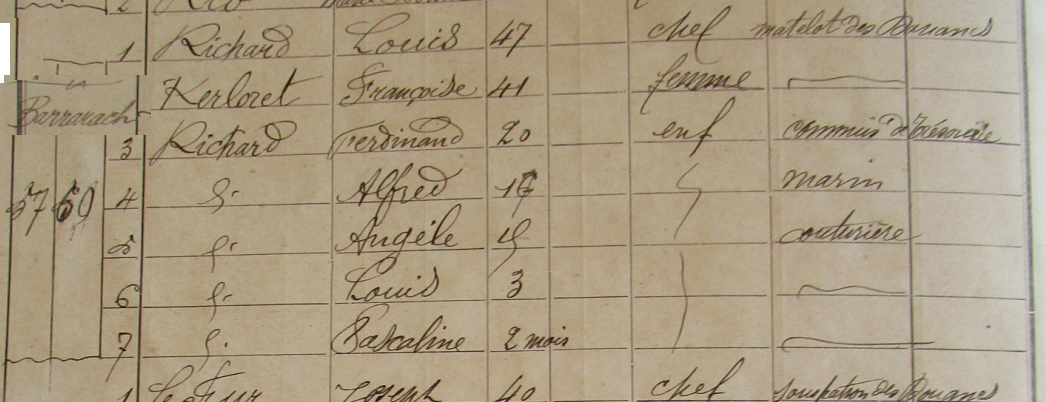
La fiche de matricule nous indique que Louis Marie RICHARD a fait la guerre de 14-18 dans la marine [aller voir au SHD de Lorient]. Il se marie à Locquénolé-Morlaix le 21/7/1926 à Marie Françoise GUHAUX.
A la veille de la seconde guerre mondiale, l'ancien poilu est maître d'équipage dans la marine marchande. Le 1/7/1940, il rejoint la France Libre alors qu'il doit être à bord du GROS PIERRE,

Le GROS PIERRE est saisi après l'Armistice par les Anglais alors qu’il se trouve à Milford Haven, port du Pays de Galles, et passe sous pavillon britannique. Le 26/05/1941, allant de Fraserburgh vers Sunderland, il est attaqué par des avions allemands et est contraint de s’échouer près de Sunderland pour ne pas couler. Il sera remis en service.
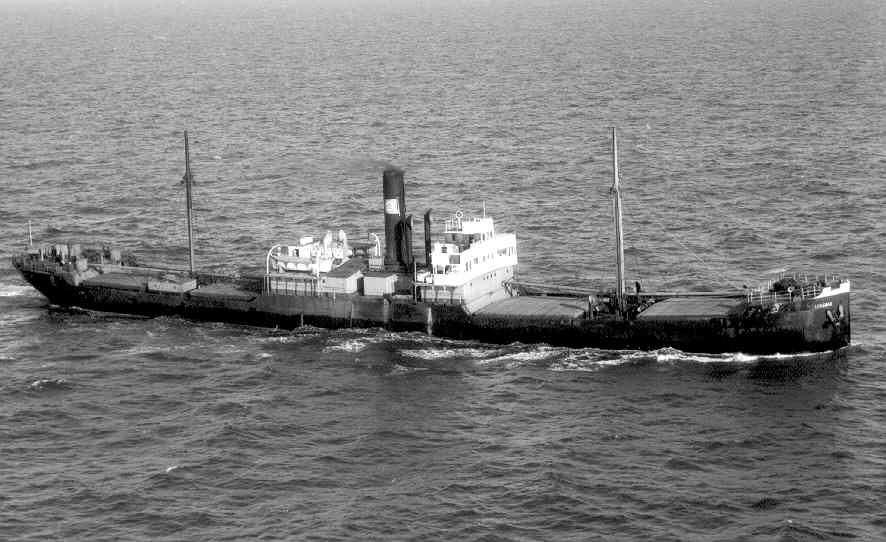
Par la suite, Louis Marie RICHARD est pointé à bord du SNA10 des la Société Nationale d'Affrêtements, de Rouen. La Société exploite les navires de la PLM (faisant partie de l’ex-flotte SNCF ou Chemins de Fer de l’Etat). En 1939, la SNA arme 5 navires : SNA 1, SNA 7, SNA 8, SNA 9 et SNA 10. Les autres navires sont en gérance, ce sont les 14 charbonniers de la Compagnie des Chemins de Fer du PLM, et immatriculés à Rouen.
SNA 10 Cargo de 2 921 t (1920-1959) ex-Lapeyrade, ex- Louis Nail ; 2 555 tjb ; 1 812 tjn ; construit par les Ateliers & Chantiers de la Loire en 1920. Inscrit au Lloyd’s Register en 1940, port d’immatriculation Rouen pour le compte de la Société Nationale d’Affrètement. Réquisitionné en 1940. Saisi par les Anglais à Liverpool le 17 juillet 1940, il intègre les FNFL, 5 officiers et 7 hommes d’équipage ayant rallié la France Libre. Il participe au ravitaillement des armées alliées lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Il devient le Léognan en 1957.
A la fin de la guerre, le marin RICHARD poursuit sa carrière dans la marine marchande. Il décède le 8/2//1975 MORLAIX.
Les FFI sinagots
Le Service Historique de la défense; SHD, a répertorié les dossiers de résistants. Il est possible de faire une recherche des combattants nés à Séné. Parmi celle liste on reconnait les deux frères LE GREGAM martyrisés par les Allemands à Bohalgo. On note aussi le nom d'une femme, Marie Augustine LEBRUN qui s'illustra dans la mission Savannah et le le réseau Overcloud. A Séné, village de pêcheurs et de marins, nombreux sont ceux qui rallièrent les Forces Navales Françaises Libres, FNFL. Wiki-sene dresse ici le portrait des autres résistants sinagots des "Force de terre Françaises Libres".
GR 16 P 22270 AUDRAN Léon, libère Soissons.
Léon AUDRAN [23/6/1921-17/2/2007] nait au bourg de Séné, d'une mère ménagère et d'un père main, second maîtretTimonier. Il devient gardien de la paix en poste à Soissons quand la guerre éclate. Il se marie à Soissons le 31/10/1942 avec Arlette Marguerite Louise CAPRON, dont il divorcera le 21/6/1950. Après le Débarquement, il rejoint le réseau des forces combattantes à partir de juillet 1944, au sein du Secteur D-n°2 de Soissons. Il participe à du transport d'armes et de munitions, à des sabotrages de lignes téléphoniques entre Soissons et Compiègne et à la libération de la ville de Soissons. A ce titre, il fut reconnu comme membre des Forces Françaises de l'Intérieur.
Il se remariera le 10/5/1951 avec Françoise Suzanne Renée MEIGNON. Il décède à Soissons le 17/2/2007.
GR 16 P 75975 BOTUHA Jean, libère Paris
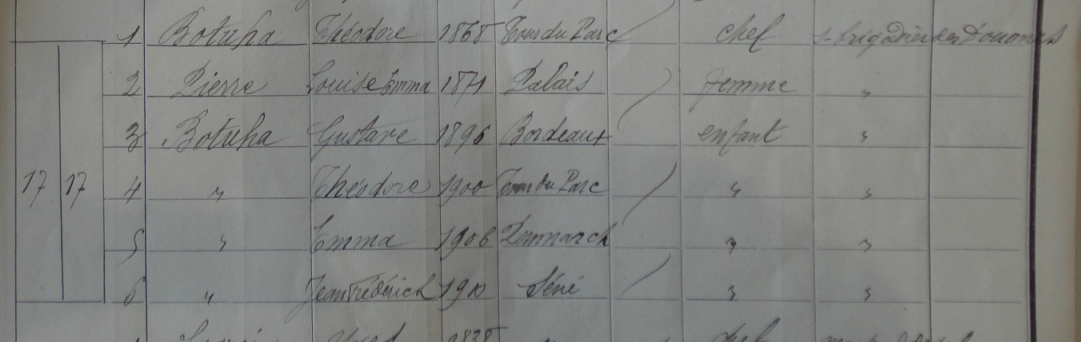
Jean Frédéric Louis BOTUHA [4/9/1910 Séné - 18/12/1984 Plaisir 78] est le dernier garçon du sous-brigadier Botuha en poste à Séné, où il vit à Michot en 1910. Après avoir fait son école à Bordeaux et occupé des postes à Le Tour du Parc, Penmarc'h, il fut nommé à Séné. Lors de la démobilisation, Jean BOTUHA est affecté à la gendarmerie de Paris-Vincennes. En 1943, il rejoint le réseau RIF Vengences au sein du groupe "Boulogne". Agent de liaison, il distribue des tracts et des journeaux, il prend part aux combats pour la libération de Paris le 25 août 1944.
Il s'était marié avec Alice Berthe CHEVALLIER à Boulogne le 24/10/1942.
GR 16 P 99818 CADERO André Pierre, combat à Bosegalo et libère Vannes.
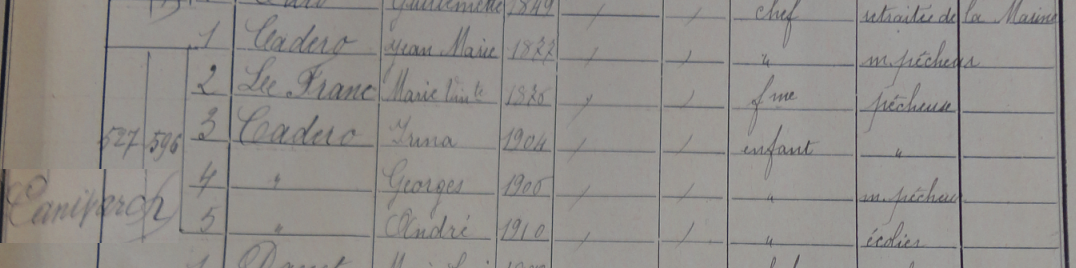
GR 16 P 156143 DANET Célestin Ange Marie, combat à Botségalo et libère Vannes
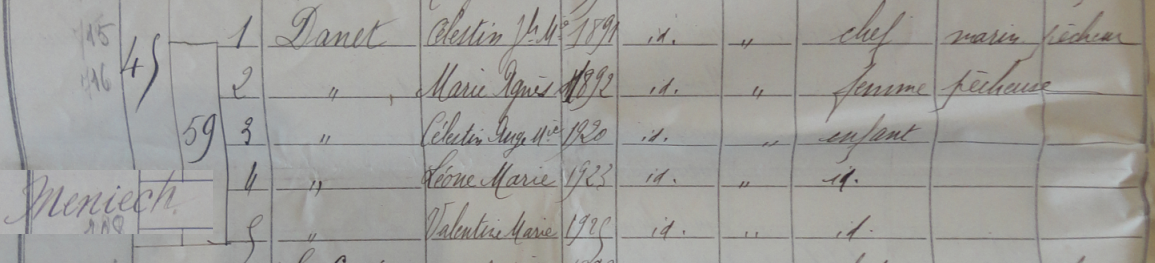
GR 16 P 161439 DEBARD, Eugène, combat dans les FFL du Levant
Eugène Albert Pierre DEBARD [27/10/1898 Cressignan - 22/7/1990 Ploemeur] nait au village de Gressignan chez ces grands-parents, là où sa mère est venue passer sa grossesse. En effet, son acte de naissance indique que ces parents vivent à Nantes. Son père Joseph est en effet gendarme dans cette ville. Sa mère, Marie RICHARD, est bien née à Pontivy car son père était également gendarme. Marie RICHARD est issue d'unne ancienne famille de paludiers singaots. Son père entrera dans la gendarmerie mais reviendra passer sa retraite à Gressignan, dans la demeure de son épouse.
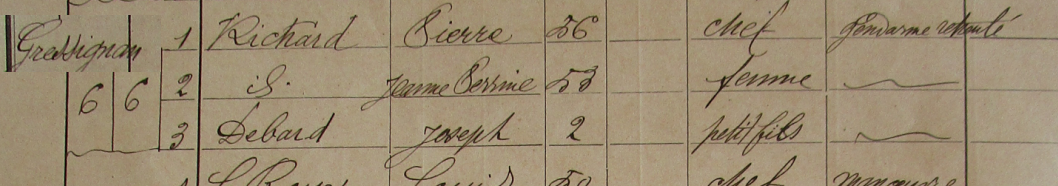
Lors du dénombrement de 1901, on retrouve bien le jeune Eugène DEBARD (l'officer fait une erreur et lui attribue le nom de son père) vivant chez ses grands-parents à Cressignan.

De la classe 1918, Eugène DEBARD est appellé sous les drapeaux en 1918. Il est mobilisé. A la fin de la 1ère Guerre Mondiale, il s'engage dans l'armée coloniale qui le mènera vers des opérations au Levant.
Il se marie le 12/1/1925 à Ploemeur. Il est dans les armées du Levant lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie.
Le 11/11/1940, le lieutenant DEBARD rejoint avec son unité les Forces Françaises Libres au Levant. Il sera démobilisé le 10/8/1946 après 27 années dans la coloniale.
GR 16 P 191355 DOURS, Guy [2/5/1911- 16/1/1989] Le fils du restaurateur de Bellevue résistant dans le Sud-Ouest
Avec un tel patronyme, on pense rapidement que Guy Bernard DOURS n'est pas un Breton de vieille souche. Son acte de naissance nous indique qu'il nait à Barrarach le 2/03/1911 d'une mère sinagote, Euphrasie Léontine MORIO qui a épousé le 26/7/1905 à Séné, Jean Vincent Brice DOURS, né à Rabastens le 13/11/1876.
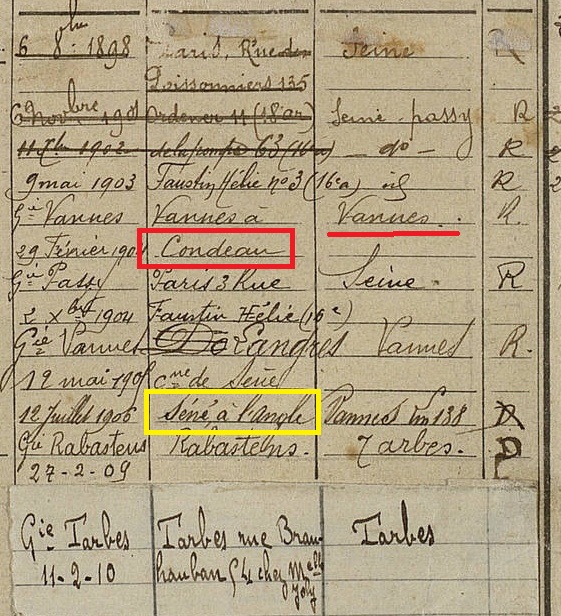
La fiche de matricule du père DOURS nous indique que ce Gascon est allé travailler à Paris comme garçon café, puis comme liquoriste. Il vient travailler à Vannes, précisément à Conleau et on pense qu'il fut recruté par Jean Marie LAPORTE , propriétaire de l'île de Conleau pour travailler au Grand Café. C'est là qu'il connait son épouse et ensuite ils s'établissent à Langle où naissent leurs 4 enfants. Lors de la naissance de Jeanne en 1906, lui et son épouse déclarent la profession de restaurateur. On pense qu'il a du reprendre le Café de la Terasse à Bellevue. En 1911, quand le futur résisitant nait, son père est redevenu garçon de café. Il est vrai que la Café de la Terrasse vient de laisser place à une nouvelle école à Langle-Bellevue.
La famille Dours repart dans les Pyrénées. Le jeune Guy DOURS est sans doute mobilisé en 1939, il a 28 ans. Après la Débacle, il rentre au pays. Dès le 3/05/1943, il rejoint la résistance jusqu'au 23/8/1944. Pendant ces mois dans la maquis, il participe à l'attaque d'un convoi allemand sur la route nationale à Casteralou et à l'attaque de la ruche route de Pau à Tarbes. Il participe à l'évacuation de l'ennemi à Bordeaux. Il est nommé lieutenant en septembre 1944 par le commandant Richou. Il intègre par la suite le 158° Régiment d'infanterie. Notre résistant sinagot sera décoré de la Croix de Guerre le 30 décembre 1948 par le général Dejussieu Pontcassal. On lit dans son dossier consulté au SHD de Vincennes l'éloge suivant:"Officier issu du maquis qui s'est toujours fait remarquer par son courage. Il a pris part comme chef de section aux opérations de libération du sud-ouest s'est particulièrement distingué au cours des violents combats de Trignac le 14 avril et de Saint Georges de Didonne les 15 et 16 avril 1945 par la libération de la poche de Royan".
Mécanicien en cycle de métier, marié le 25/2/1933 à Tostat (65) avec Alexandrine Yolande LANCEDE dont il divorcera le 7/7/1941, il s'était marié en seconde noce avec Louise Angèle CAZABAT le 20/7/1942. Il décède à Rabastens de Bigorre le 16/1/1989.
GR 16 P 207667 EDY, Roger Olivier, particpite aux combats sur la Vilaine.
EDY Roger Olivier [8/7/1910 Kergrippe- 6/8/1981 Lorient] a passé sons brevet élémentaire de capacité. Il est instituteur. Il fait son service militaire comme fantassin de 2° classe, élève au peloton de préparation à l'école des Aspirants. En juin 1940, il est fantassin de 2° classe élève au groupement spécial 57° RI Bordeaux. Il est démobilisé et renvoyé dans ses foyers le 26/9/1940. Il trouve un poste d'insituteur à Lorient, à l'Ecole des Quais jusqu'au 15/1/1943. Ensuite, il est insituteur replié à Brohan-Loudéac jusqu'à la Libération.
A partir deu 15 juillet 1944, il rejoint les FFI en tant que sergent-major au sein de la 5° Compagnie du 8° Bataillon sur front de la Vilaine, entre Péaule-Rieux-Bolouan, et ce jusqu'au 15 août 1944. Le lieutenant Joseph DRIOT précise: A particpé aux opération de surveillance dans le secteur de Brohan Loudéac puis a combattu dans le secteur de la Vilaine. A son actif, je mentionne séances d'instruction, convois d'armes avant la Libération, puis opérations sur la Vilaine.
Captinaie de Compagnie, Tonnerre et chef de Bataillon Caro. Démobilisé le 15/10/1944. Renoyé à ses foyers à Lorient, 11 cité du Polygone.
GR 16 P 254725 GICQUEL, Jean Marie combat à Botségalo et sur le front de la Vilaine
Jean Marie GICQUEL [22/9/1926 Ploeren - 23/3/2011 Séné] est né à la ferme de Kernipitur où ses parents sont cultivateurs.
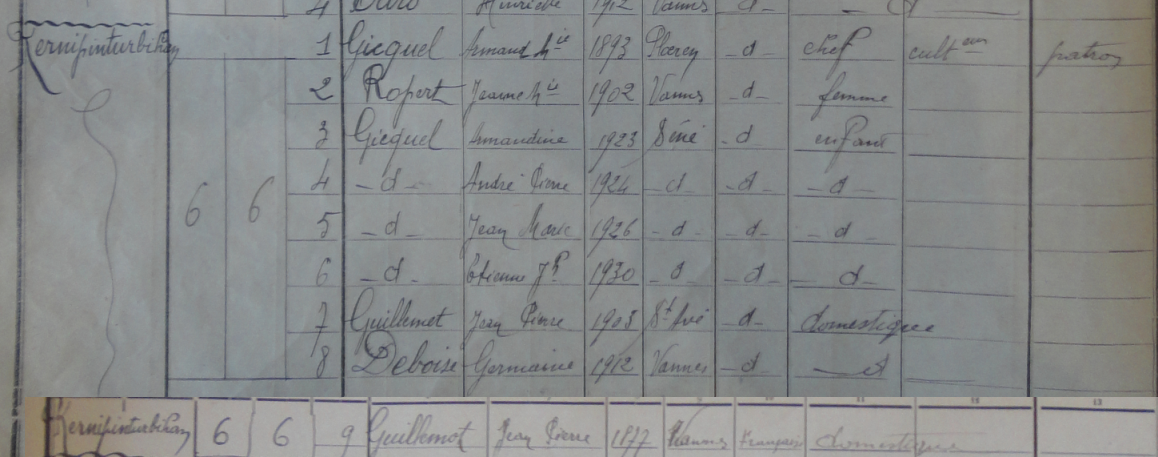
Le dénombrement de 1931 nous indique que son père, Armand GICQUEL [24/8/1893 Ploeren-13/3/1954], ancien combattant de 14-18, et son épouse Jeanne Marie ROPERT ont repris la ferme de Kernipitur. Au début de la guerre, les enfants Jean Marie et André sont aussi cultivateurs auprès de leurs parents. Aujourd'hui la demeure et les annexes de Kernipitur Bihan, sont toujours propriété de la famille Gicquel.
Après l'annonce du Débarquement, le jeune Jean Marie GICQUEL, âgé de 18 ans rejoint la Résistance. Du 10/6/1944 au 23/1/1945, il rejoint les FFI et combat notamment à Botségalo au sein du bataillon du Capitaine Gougaud. Ensuite il poursuit les Allemands sur la Vilaine.
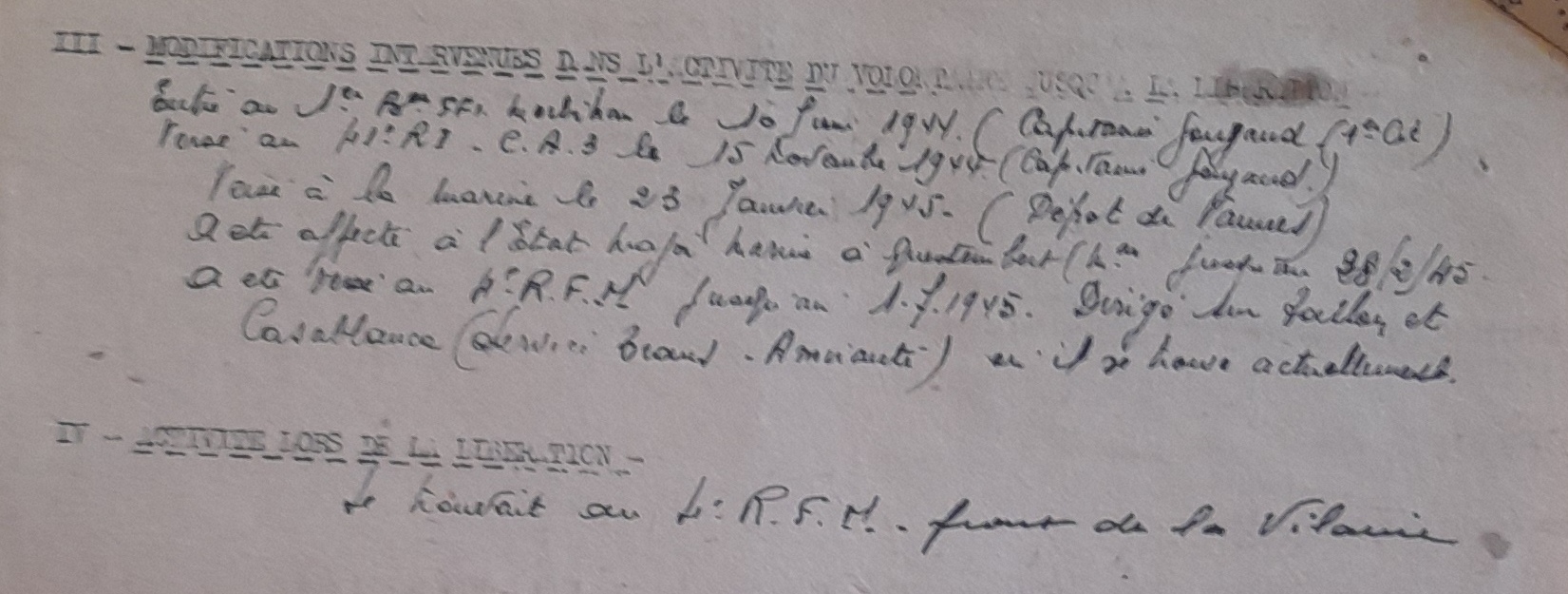
Il se marie à Nantes le 6/11/1953 avec Alphonsine GUYODO et décède à Séné le 23/3/2011.
GR 16 P 296530 HOUEE, Roger Jean Marie, combat à Botségalo et libère Vannes.
Roger Jean Marie HOUEE [13/9/1926 Séné - 16/2/1979 Vannes] ne porte pas un nom à consonnance sinagote.
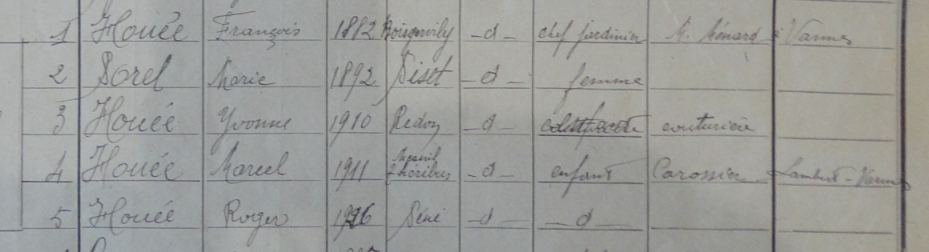
Il nait cependant à la ferme de Saint-Laurent ou ses parents originaire d'Île et Vilaine sont établis, lui en tant que jardinier et elle comme ménagère (femme au foyer). La famille est pointée lors du dénombrement de 1926 et en 1931. Ils donnèrent naissance à un jeune Sinagot qui va s'illustrer à la fin de la seconde guerre mondiale. La famille HOUEE est voisine de la famille LE BIGOT.
Après le Débarquement Roger HOUEE rejoint les FFI au sein de la 2° compagnie du 1er Bataillon entre le 7/6/1944 et le 10/8/1944. Son capitaine est Férié. Il prend part aux combats à Botségalo et participe à la libération de Vannes lors des journées du 5-6 août 1944. Il poursuit lors des combats à Billiers le 14/9/1944 et ensuite sur le front de la Vilaine. Il s'egage ensuite entre 9/1944 et 12/1945 au sein du 41° Régiment d'Infanterie.
Démobilisé, il se marie à Saint-Armel avec Germaine Marie Louise PETIT le 10/8/1954. Il décède à Vannes le 16/2/1879 dans sa maison au 24 rue de Saint-Tropez.
GR 16 P 346326 LE BIGOT, Gabriel Pierre Marie
Gabriel Pierre Marie LE BIGOT [6/1/1922-2/3/1993] nait au village de Saint Laurent où ses parents sont cultivateurs. La famille Le Bigot s'est déjà montré patriote lors de la 1ère Guerre Mondiale.
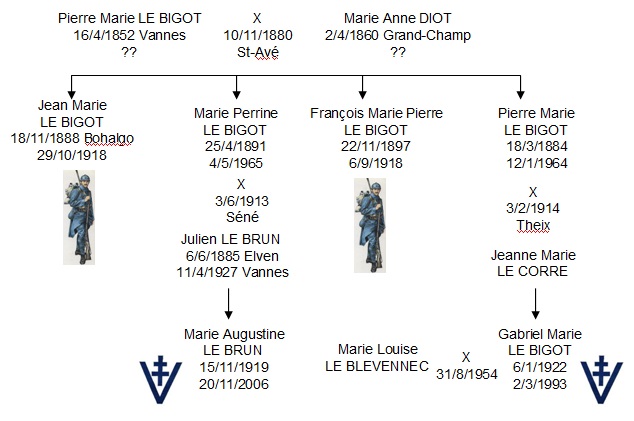
Gabriel LE BIGOT n'est autre que le cousin de Marie Augustine LE BRUN qui s'est engagée au sein du réseau Overcloud. Il était voisin de Roger HOUEE, également engagé dans les FFI.
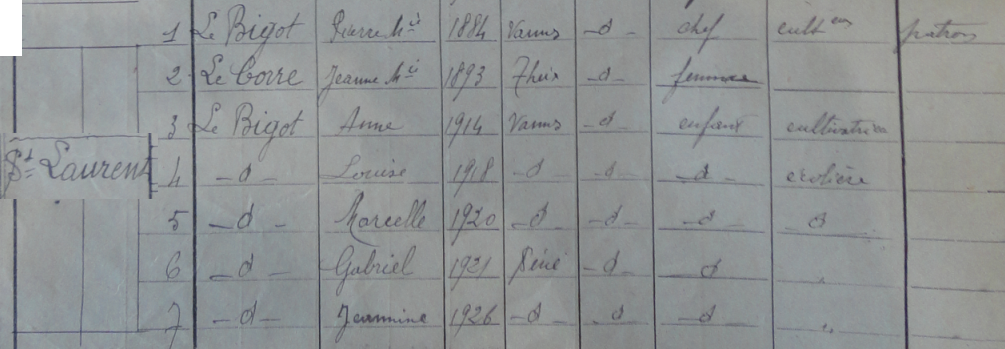
Lors du dénombrement de 1931, la famille est pointé à Saint-Laurent.
Quand il apprend le Débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, comme d'autres Sinagots et Morbihannais, Gabriel LE BIGOT rejoint les Forces Françaises Libres. Au sein de la 2° compagnie du 1er Bataillon du capitaine Ferré, il s'illustre en participant au combat à Botségalo, à des sabotages de voies ferrées et lors de la libération de Vannes. Avec ce bataillon, il poursuit les Allemands à Billiers et sur la Vilaine.
Après la guerre, il se marie à Séné le 31/8/1954 avec Agnès Marie Louise LE BLEVENNEC et demeure au 13 chemin de Saint-Laurent. En 1962, la famille Le Bigot est pointée au recencement.
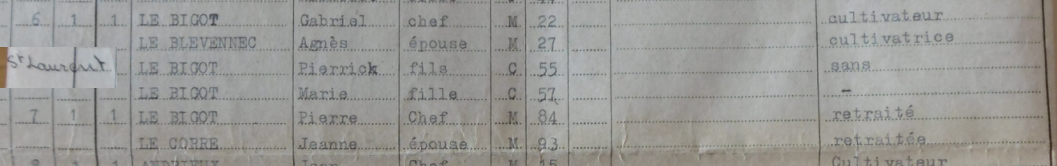
Il décède à Séné le 2/3/1993.
GR 16 P 352378 LE DUC, Jean Marie Homologué FFI
Jean Marie LE DUC nait au village de Montsarrac. Son père Jean Pierre LE DUC [20/7/1864- ] est marin de commerce et sa mère Marie Françoise LE YONDRE [8/9/1865 La Garenne- ] est ménagère. La famille est pointée à Montsarrac lors du dénombrement de 1906. Il est le cousin par sa mère de Léon LE YONDRE [28/12/1903-21/5/1943], marin des FNFL décédé en mer alors que son bateau rejoignait Londres.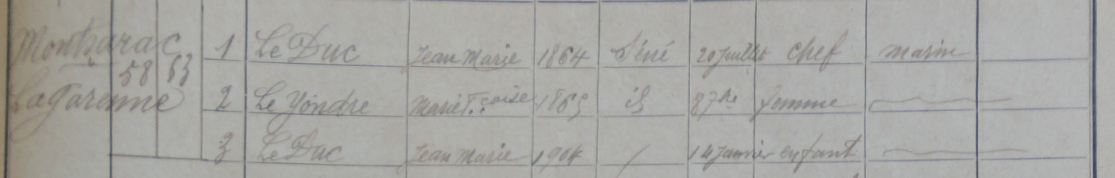
En août 1921, il s'engage dans la marine. Il renouvelle un contrat en août 1926, il est alors quartier-maitre. Il se marie à Séné le 8/9/1926 avec Eugénie Marie Louise LE GAREC [21/1/1916-26/7/1986], la fille du meunier de Cadouarn.. Il se rengage en août 1929. Il intègre alors la Garde républicaine à Saint-Nazaire et ensuite la Gendarmerie. Après un poste à Durtal (49), de juin 1940 au 1er octobre 1941, il est gendarme à Etel. Il sera libéré en octobre 1941 et "rentre dans ces foyers". A la retraite, il occupe la fonction de garde-champêtre entre octobre 1941 à janvier 1944, à Belz. Il rejoint la résistance en janvier 1944, au sein de la 6°compagnie du 2° bataillon du commandant Le Garec. Il rejoint l'Infanterie Motorisée.
A la Libération, il vit à Rennes. Le 10/6/1963, il divorce de son épouse et se remarie le 9/11/1963 à Nantes avec Emilie PLAQUEVENT [11/1/1922-4/71977]. Il décède à Carquefou le 11/7/1983.
GR 16 P 354499 LE GAC, Alexis François Marie, le fils du douanier sabote les voies ferrées
Alexis François Marie LE GAC nait aux Quatre-Vents. Ce jour-là, son père Léonard Marc Marie [12/4/1880 Theix - 20/5/1955] préposé des douanes est en poste à Groix depuis le 1/11/1905. Il s'est marié à Séné le 23/10/1906 avec Marie Célestine LE MENACH [26/4/1886- ], native de Séné et couturière.
Avant guerre, ce comptable est en poste à la Préfecture du Morbihan où il s'occupe d'organiser le ravitaillement. Il se marie à Vannes le 3/8/1942 avec Marie Louise LOTODE [22/12/1919-21/4/2012].
Pendant l'Ocupation, ses réflexions contre l'occupant lui valent des ennuis avec les Allemands et il perd son poste à la Préfecture. Dès septembre 1943, il rejoint le réseau du commandant Le Berrigot, alias Cadoudal et participe à des sabotages sur la voie férrée entre Vannes et Redon. Il est nommé adjudant. Après le 5/6/1944, il prend le maquis. Il participe au combat à Colpo, à des parachutages d'armes du 6 au 19/6/1944. Il combat à Botségalo et s'illustre en allant récupérer dans des conditions périlleuses une caisse avec des documents importants. Il est renvoyé à ses foyers le 30/9/1944.
GR 16 P 357471 LE GUIL, Edmond [9/4/1926-15/4/1991 Vannes]
Edmond Fernand LE GUIL nait à Michot, d'un père vendéen, officier de l'Infanterie Coloniale qui a épousé à Séné le 7/6/1925 Marie Madeleine RICHARD, cultivatrice à Michot. L'officer LE GUIL sera fait prisonnier pendant la Débacle. De 1940 ) 1944, la famille Le Guil vit sur Landevant. Après le Débarquement, il prend le maquis et rejoint la 2°Compagnie du 1er bataillon du Capitaine Ferré. Il change d'unité et rejoint le 20/6/1944, la 3° Compagnie du 1er Bataillon du Capitaine LHERMIER.
Il combat de Botsegalo le 21/6/1944 et prend part aux combat de Malechappe le 14/7/1944. Il particpe à la libération de Vannes le 5-6 août 194 il s'engage dans les armées et le 4 puis iau combat de Pen Han le 23/8/44 puis sur le front de la Vilaine du 24/8 au 15/11 19/44./
Ce fils de militaire s'engage le 5/9/1944 dans la 11° Compagnie du 3° bataillon du 41° régiment d'infanterie. Après guerre, il est en Extrêmùe Orient au sein du 43° Régiment d'Infnaterie Coloniale. Il est rapatrié le 11/1/1948 et rejoint la vie civile.
Il se marie à Arles, le 9/8/1960 avec Adrienne BOUCALARY et décède à Vannes le 15/4/1991.
GR 16 P 357717 LE HAY, Jean Marie [10/8/1910-24/9/1964] libère Bergerac
Voir article dédié à Jean Marie HAY, fils d'un Poilu de 14-18 Mort pour la France.
GR 16 P 345548 LE BARO, Jean Louis [20/11/1925-13/4/2009], combat à Boségalo et libère Vannes
Jean Louis LE BARO nait à Bellevue. son père Jean Louis [8/4/1893-24/4/1974] est marin pêcheur. Sa mère Marie Joséphine LOISEAU [10/10/1896 - 30/8/1975] est ménagère.Trop jeune pour être mobilisé en 1939, il n'a que 19 ans quand les Alliés débarquent en Normandie. Il rallie la 1ère compagnie du 1er bataillon du Capitaine Gougaud. Il combat à Botségalo le 21 juin 1944 et participe aux combats pour la libération de Vannes les 4-5 août 1944. Ensuite, il poursuit sur le front de la Vilaine du 15/9 au 15/11/1944. Le 2/9/1944 il s'engage dans les armées puis le 24/1/1945 dans la marine nationale.
Il se marie à Malestroit le 27/2/1954 avec Anne Marie Thérèse GUITTOU. Il décède à Vannes le 13/4/2009.
GR 16 P 347757 LEBREC, Auguste Joseph [23/1/1905-22/11/2000] avec les Américains fait la jonction avec les Soviétiques
Auguste Joseph LE BREC nait aux Quatre vents. Son père Prosper Emmanuel né à Saint-Armel (12/31869) est Brigadier des Douanes, ce jour-là en poste à Plomeur; il a épousé, Marie Louise DANION, née aux Quatre Vents (16/4/1872).
Le 11/11/1924, il devance son appel au service militaire au sein du 65° Régiment d'Infanterie de Vannes. Il gagne l'école de Saint-Maixent. De juillet à octobre 1925 il est en poste au Maroc. Le 15/5/1926 il est nommé sous-lieutenant. Le 25/5/1928 il est lieutenant dans l'Infanterie Coloniale.
Lors de la mobilisation, il fait partie des A.O.F de mars à juin 1940
Mobilisation des 481-486 régiments Coloniaux de à Fontenay Le Comte.
Conduite de renfort sénégalais de février à juin 1940. Ecoles de perfectionnement à Vannes, Coetquidan 2 périodes de 31 jours, 2 périodes à Meucon 25 et 15 jours.
Il se marie le 3/4/1934 à l'Île aux Moines avec Adrienne LE PIPEC. dont il aura un fils, Prosper né 14/12/1934.
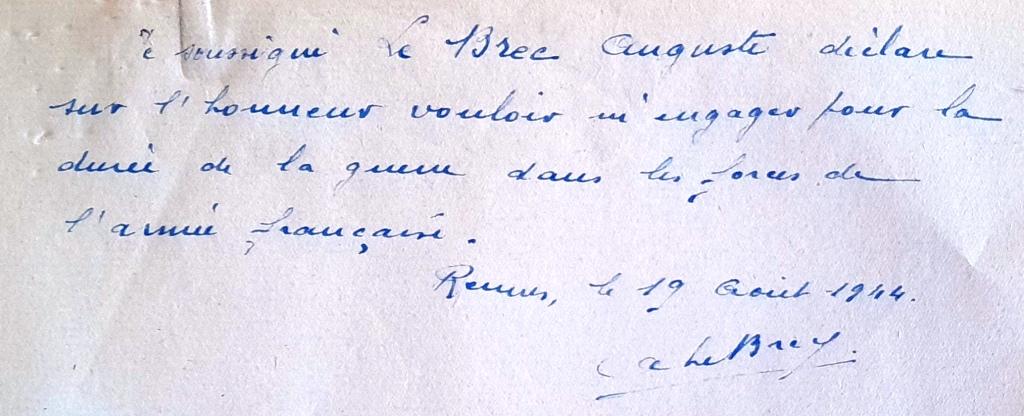
Au début de la guerre, il est instituteur à Arzon jusqu'au 31/7/1944. Du 1/8/1944 au 10/8/1944, il combat au sein du sein du 1er bataillon, du Commandant Hervé, 5° Compagnie du Capitaine Rouillard. Il s'illustre en méttant sur pied une section complète de 35 hommes à Arzon-Port-Navalo.
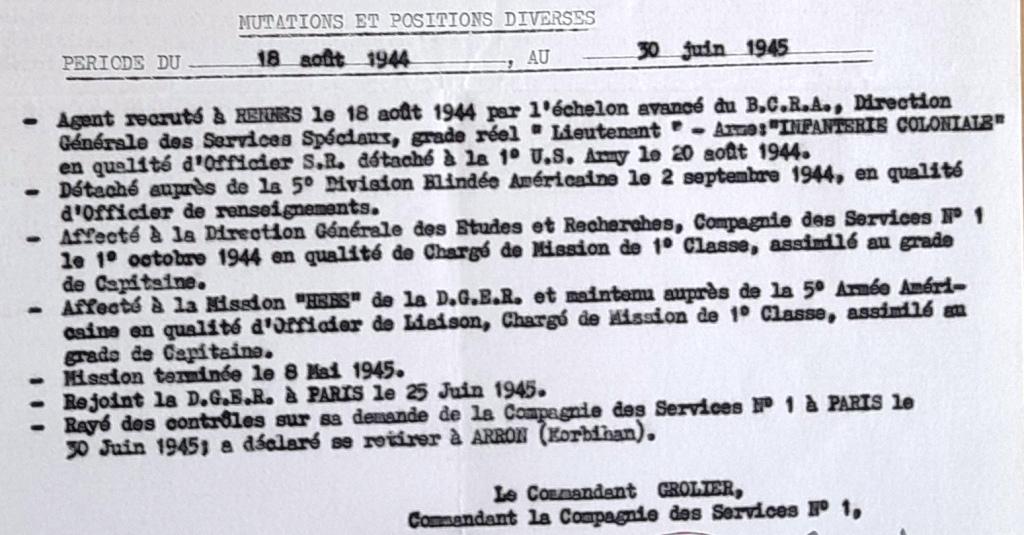
Repéré, il est affecté le 13/8/1944 à la BCRA de la Direction Générale de Services Spéciaux, comme officier de liaison avec l'armée américaine. 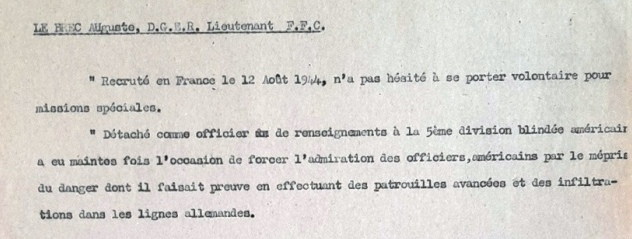
Parcours au sein de la BCRA:
Contacté le 12 août 1944 à Arzon par le Lieutenant Colonel Dessanguy et conduit le jour même à Vannes. Affecté par le Capitaine Guettary et le Lieutenant Mercader du BCRA pour entrer dans leur service.
A quitté les FFI de Sarzeau le 13 août. Entré au BCRA à la même date. Versé dans l'armée américaine comme officier de renseignements et détaché pour la 50° Division Blindée US le 1er septembre 1944.
Dans les Ardennes, près de Charleville les 5-6 septembre.
Passage de la Meuse et prise de Sedan le 7 septembre. Prise d'Arlon (Luxembourg) le 11 septembre.
Avancée au Luxembourg et prise de Mersch, Fels (Larochette) le 11 septembre.
Deplacement et reconnaissances journalières vers Brettenbach.
Du 1er au 17 octobre, opérations diverses reconnaissances dans le secteur de Faymonville en Belgique.
Du 20 octobre à la mi-novembre Schoppen, Qxxx?
De la fin novembre à la mi-décembre: la division est dans la forêt d'Heurtgenwald, xxx? , Gey,
Replis à partir du 17 décembre. Capture de parachustistes.
La division se fixe à la charnière d'Eupen et reprend l'offensive fin février.
Passage de la rivière Roër le 27 février. Prise d'Erkelenz où je trouve les services PG français, entrée à Krefeld
Fin mars Kempen, Viersen, Mönchengladbach Herford?,
Courant avril : armement de 1800 prisonniers français et patrouilles aux environs d'Hanovre, Gifhorn Héra?, Pusie?, nombreux prisonniers Boches. Le 4 mai liaison avec les Russes sur l'Elbe.
Après la capitulation allemande, il est instituteur à Lorient et réside Cité du Polygone. Il est cité à l'ordre du Corps d'Armé le 23 juin 1945 et reçoit la Croix de Guerre.
Il décède à Lorient le 22/11/2000.
GR 16 P 354309 LEFRANC, Julien Louis Marie 26.10.1912 Séné Morbihan FRANCE Homologué FFI
Julien Louis Marie LE FRANC nait à Bellevue. Son père est marin pêcheur et sa mère marchande de poissons. La famille s'agrandit et se déplace au village de Langle après guerre.
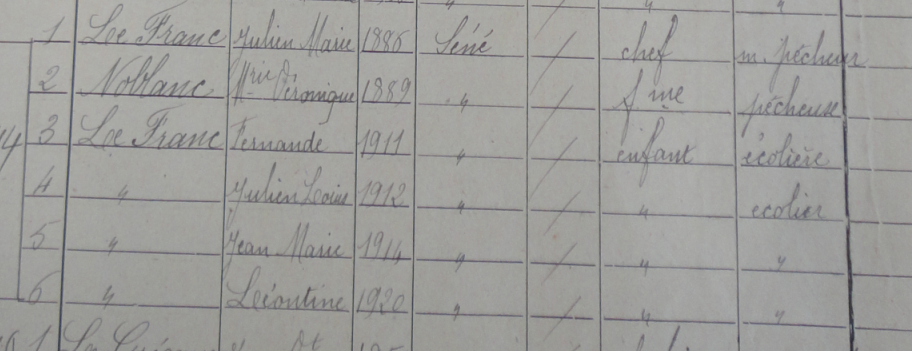
L'acte de naissance de Julien LE FRANC nous indique qu'il se marie à Arcachon le 9/6/1938, à la veille de la guerre avec Marie GAUYACQ. Il doit être mobilisé en septembre 1939. Après la Débacle et le retour au foyer, il rejoint la résistance du 1/4/1943 au 22/8/1944, sous le commandement du lieutenant colonel de LUZE. Ensuite il est incorporé au bataillon d'Arcachon du capitaine Duchez. Il participe au combat pour la libération d'Arcachon, du Barp, de Gradignan. Il combat dans le Médoc et à la pointe de Grave et participe à la libération de Saint-Nazaire entre le 22/8/1944 et le 8/5/1945. . I
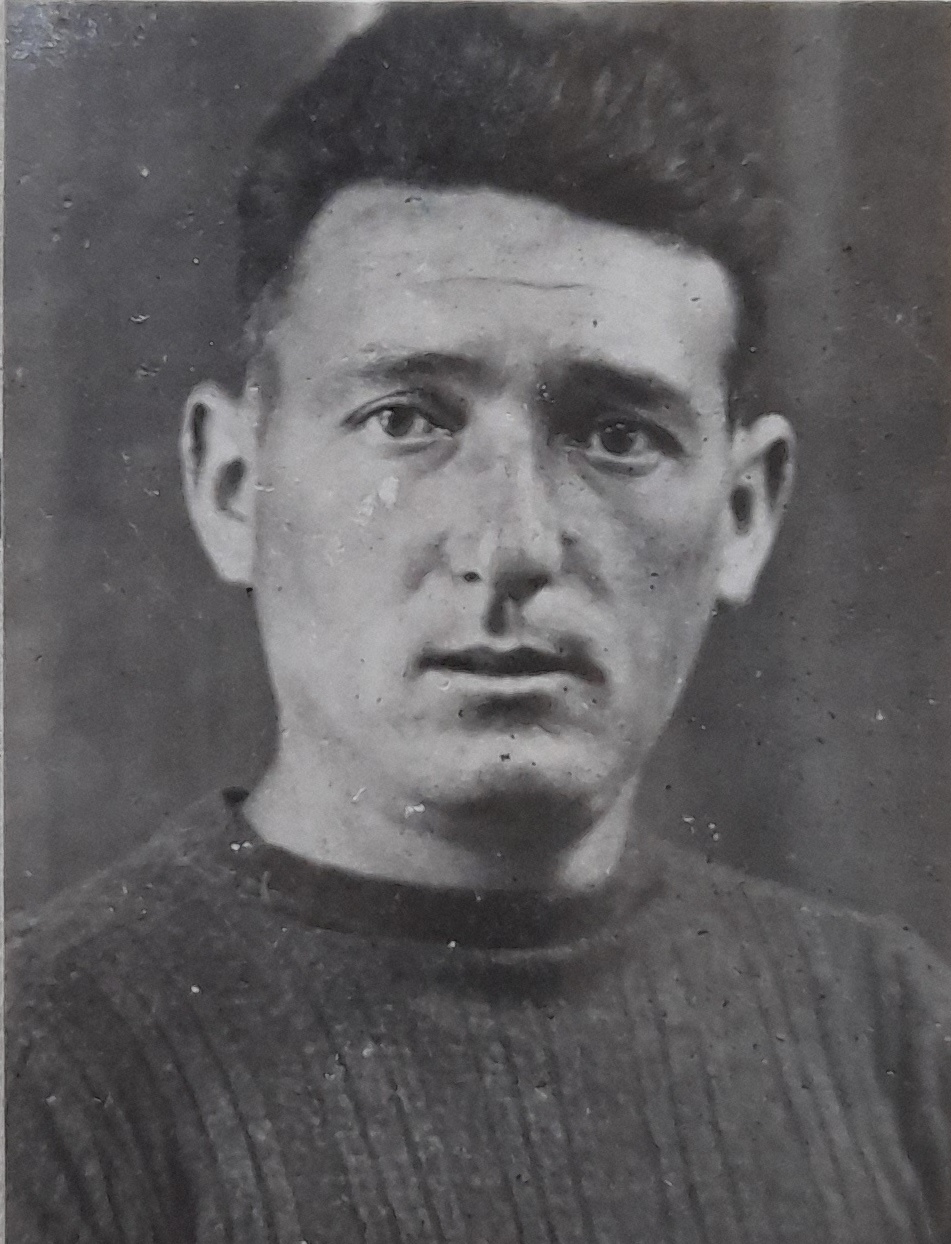
Cimentier puis bucheron, il décède à Bordeaux le 17/1/1965.
GR 16 P 365968 LEROY, André Pierre Marie [17/4/1928-14/2/1975] débute ses classes par la libération de Vannes
André LEROY nait au village de Langle. Son père Stanislas [28/4/1893-1/2/1966] est marin pêcheur et sa mère , Marie Rosalie MOREL [21/6/1902-27/4/1977] estpêcheuse. La famille est pointée lors du dénombrmeent de 1931.
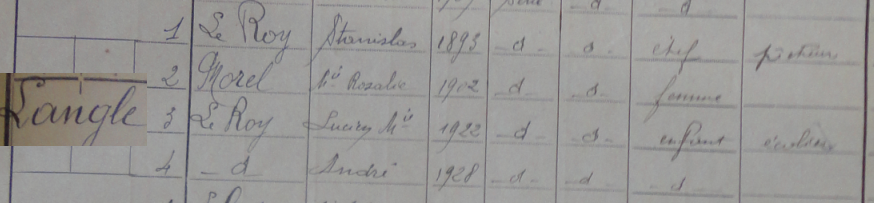
Le jeune Sinagot n'a que 11 ans quand la guerre éclate et 16 ans lorsque les Alliés débarquent en Normandie. Qu'à ce la ne tienne! Il participe au sein de la 6° Compagnie du 1er Bataillon des FFI à la libération de Vannes entre le 4 et le 10/8/1944 et ensuite combat sur le Front de la Vilaine. Le 28/11/1944 il rejoint le 41° rrégiment d'infanterie, 3° bataillon, 9° Compagnie.
Après la Capitulation allemande, le jeune résistant accomplit son service militaire qui le conduit en 1948 sur la base aéronavale Lartigue près d'Oran en Algérie.

Base Lartigue Oran : Initialement affectée à l'armée de l'air, elle a été cédée à la Marine en novembre 1940 et elle a accueilli desformations venues de France métropolitaine au moment de l'armistice, notamment des escadrilles de Dewoitine
D.520, Martin 167 réarmés en LeO 45 en 1941.
En novembre 1942, l'U.S. Army Air Force a occupé le terrain et y a installé un centre du COASTAL Command allié.
La base a été réarmée par la marine française en janvier 1944. Située à 111 m d'altitude la base était dotée de deuxpistes parallèles : une piste principale de 2 440 m, une piste secondaire, dite piste de secours, de 1 200 m3.
De retour en France, il se marie le 19/8/1950 avec Yvonne Françoise ROUX. Il décède à Vannes le 14/2/1975.
GR 16 P 424122 MOISAN, Louis Marie [8/2/1898-23/1/1984], l'ancien Poilu né à Séné, sabote à Paris le sligne des PTT
Louis Marie MOISAN nait à Séné, au Petit Poulfanc. Sa mère Marie Louise LE FRANC, native de Séné (15/11/1866) a épousé le 27/10/1885, Mathurin Marie, natif de Vannes (21/9/1856) est menuisier. En consultant les actes de naissance de leurs enfants, on en déduit que la famille s'établit au Petit Poulfanc peu avant la naissance de leur premier enfant, Jeanne (30/12/1887). La maman déclare alors le métier de cabaretière; à la naissance de Julienne (26/7/1889) elle déclare l'activité de débitante. Elle était sans doute au café du Poulfanc qui deviendra la café Penru, aujjourd'hui tabac Arze.
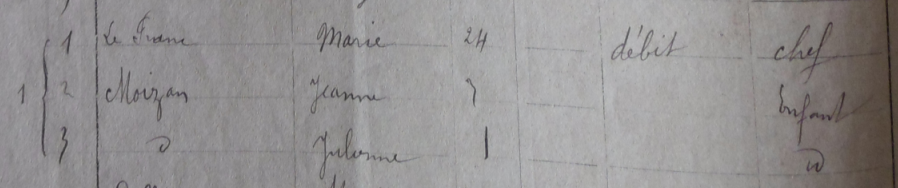
La famille est pointée à Séné lors du dénombrement de 1891 (mais pas en 1886, ni en 1901). Le père doit travailler sur Vannes. La famille Moisan va aller s'installer à Paris.
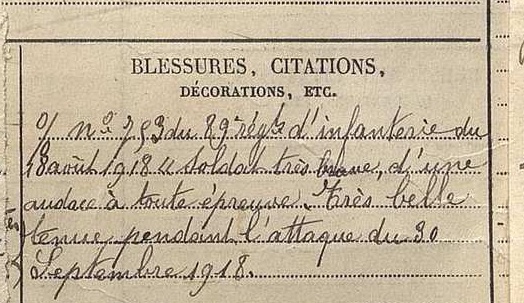
De la calsse 1918; il est mobilisé le 16/4/1917. Lors d'une attaque de son régiment il s'illustre et est cité. A l'issue du conflit, il continue son service militaire et il sera démobilisé le 23/5/1920.
Il se marie dans le XV° arrondissement de Paris le 25/4/1925 avec Louise POITRENAUD. Les mariés vivent au 21 rue Leroux dans le 7°.
Quand la guerre 39-45 est délcarée, il est à nouveau mobilisé du 7/9/1939 jusqu'au 28/6/1940. Il vit alors à Paris Rue de la Fédération.
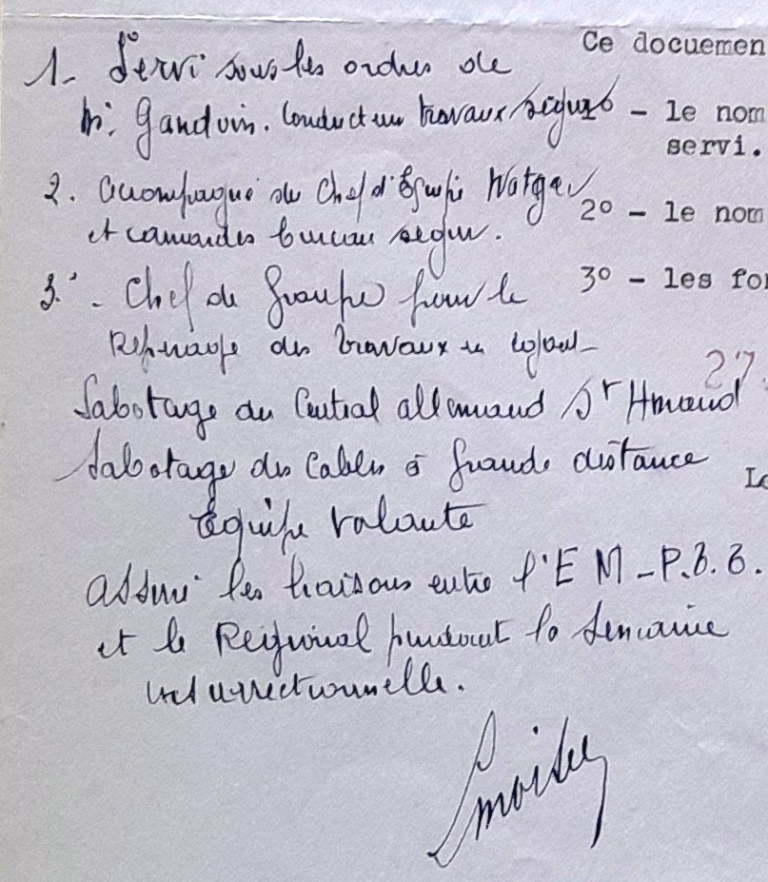
Sous l'Occupation, cet employé des PTT rejoint le réseau Action -PTT à partir du 15/7/1943, comme agent P1. Il est recruté par Gandoin. Le saborage des cables allemands du central de Saint Amand et des cables grnades distances sont à mettre à son actif le 8/6/1944. Il est membre de l'ésuipe volante en juin/juillet 1944. Agent de liaison pendant la période insurectionnelle.
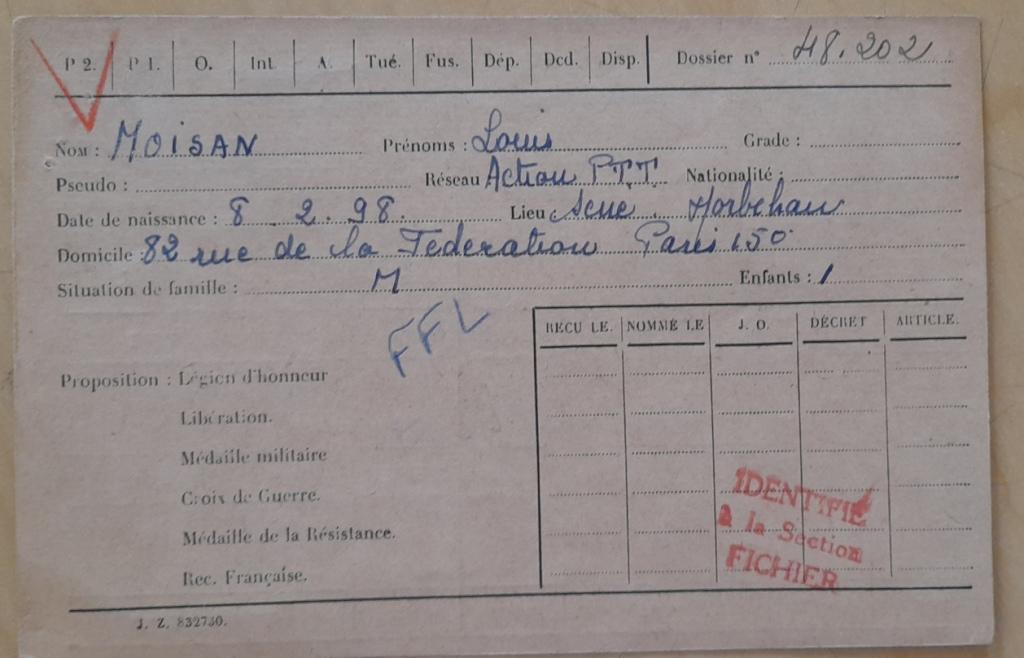
Il décède à Bondy le 23/1/1984.
GR 16 P 445819 NOBLANC, Adrien Victor Marie [16/6/1896 Gorneveze - 26/1/1971 Montrouge]
Adrien NOBLANC nait au village du Gorneveze. Il est l'enfant naturel de Marie Louise NOBLANC, né le 22/2/1874 On ne retrouve pas la trace de la famille au dénombrement de 1901. Mme NOBLANC, fille mère et son jeune garçon ont du quitter la commune et se sont installés à Paris. Adrien NOBLANC est pourtant Sinagot et il va porter haut le lieu de sa naissance.
Il se marie le 8/4/1920 avec Louise hHnriette FLANDRIN [24/8/1897-18/6/1979] dont il divorce le 14/10/1924. Il se remarie le 15/11/1924 avec Andrea BUCHERON [24///1894-16/6/1965] dont il aura deux enfants, Gisèle [1925-2000] et Marc Henri [1927-2000].
Noblanc Adrien, n° matricule 610.008, né le 16 juin 1896 à Séné, domicilié à Montrouge, rue de Bagneux n°77
a très activement pris part à la Résistance dans la clandestinité, assurant de dangeureuses missions de liaison.
Il a prix effectivment part aux combats de libération entre le 13 et le 25 août 1944 à la 32° compagnie du 2° bataillon du 61° groupement FFI dans la région de Montrouge et a fait l'objet d'une proposition de citation. Renseignement, harcèlement et combats dans le sud du département de la Seine, extra-muros.
Nommé adjudant le 18/8/1944.
Rentré dans ses foyers le 21/9/1944.
Il a recu par le GMP la carte n°47.619 des FFI de l'Île de France
L'ajusteur-outilleur, né à Séné, résistant, décède à Montrouge le 26/1/1971.
GR 16 P 500569 RAUD, Constant Dans le 1er Bataillon du Capitaine GOUGAUD
Constant RAUD [13/12/1923-26/11/2005] nait au village de Kérarden. Son père est marin et sa mère ménagère. La famille est pointée lors du dénombrement de 1926, 1931 et 1936. Constant est le frère de Emmanuel, résistant au sein des FNFL.
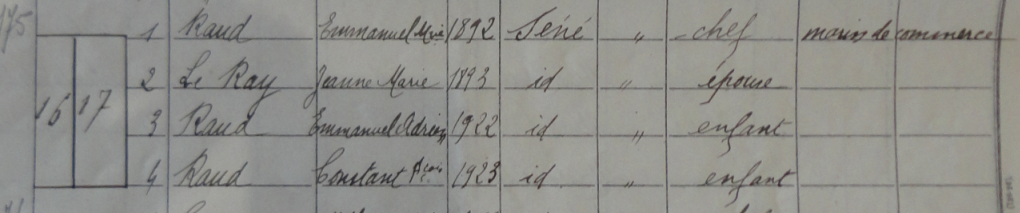
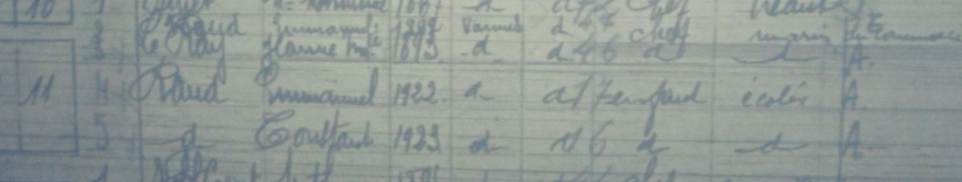
Après la Débacle et la démobilisation suivant l'Armistice, il rentre sur Vannes où il travaille comme mécanicien au garage CUSSOZ. Le 6 juin 1944,comme beaucoup de jeunes de sa classe, il rejoint le maquis.
Comme l'atteste cette pièce à son dossier, il rejoint le 1er Bataillon du Capitaine Gougaud. Il prend part au combat à Botségalo, puis dans le bois de Florange, à Plescop, à Saint-Avé, au Polygone et jusqu'à la libération de Vannes les 4-5 août 1944. Il poursuit avec son bataillon les combats sur le front de la Vilaine. Le 10/12/1944 il s'engage dans le 10° RAD, 4° groupe. Il continue la poursuite des armées allemandes et la libération du pays. Il est démobilisé le 12/10/1945 et rentre sur Vannes.
Il se marie à Séné le 19/10/1948 avec Bernadette Juliette JOUAN. Au dénombrement de 1962, il vit au village de Kerarden et exerce la profession de chauffeur poids-lourd, peut-être chez un des nombreux transporteurs installés Route de Nantes au Poulfanc. Il décèdera à Vannes le 26/11/2005.
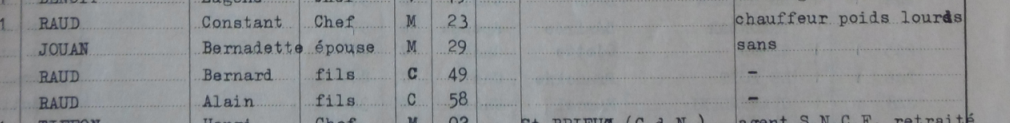
GR 16 P 519817 ROPERT, Pierre 14.10.1923 Séné Morbihan FRANCE Homologué FFI
Pierre ROPERT nait à Séné sur l'île de Boëdic ou son père est jardinier pour le compte de Passot, propriétaire de l'île. La famille Ropert est pointée lors du dénombrement de 1926.
Après le débarquement en Normandie, le jeune ROPERT, âgé de 21 ans rejoint la résistance. Il prend part au combat de Botségalo le 21 juin 1944 puis il combat les Allemands lors de la libération de Vannes le 4/8/44. Par la suite, il participe au combat à Billiers le 14/9/44 et continue sur le front de la Vilaine jusqu'au 15/11/1944. Il est alors affecté au 41° RI, 3° bataillon le 16/11/1944, sans doute démobilisé le 8 mai 1945.
Après la libération, il se marie le 22/5/1947 avec Désirée GUILLO. Il décède à Vannes le 12/5/1981.
I
Marie Augustine LE BRUN, Résistante
Le Service Historique de la Défense dresse la liste des résistants ayant eu leur dossier validé par les Autorités. On peut en faire une extraction par le lieu de naissance. Malheureusement, on n'aura pas dans ce groupe, d'éventuels Sinagots, ayant vécus à Séné mais non natifs de notre commune. Cette liste comporte 32 noms de natifs de Séné, reconnus résistants. Parmi eux, les deux Frères LE GREGAM, martyrisés par les Allemands et déclarés "Morts pour la France" [lire article dédié].
Si on prête bien attention, parmi ces 32 patronymes, figure le dossier : GR 16 P 348256 LE BRUN ép. SYLVAIN, Marie 15.11.1919 Séné Morbihan FRANCE Homologué FFC. Il s'agit bien d'une femme, Mme LE BRUN mariée à un certain SYLVAIN. Que sait-on de Mme LE BRUN, née à Séné le 15/11/1919. On commence par consulter en mairie son acte de naissance et sa présence sur le relevés du dénombrement aux Archives du Morbihan.
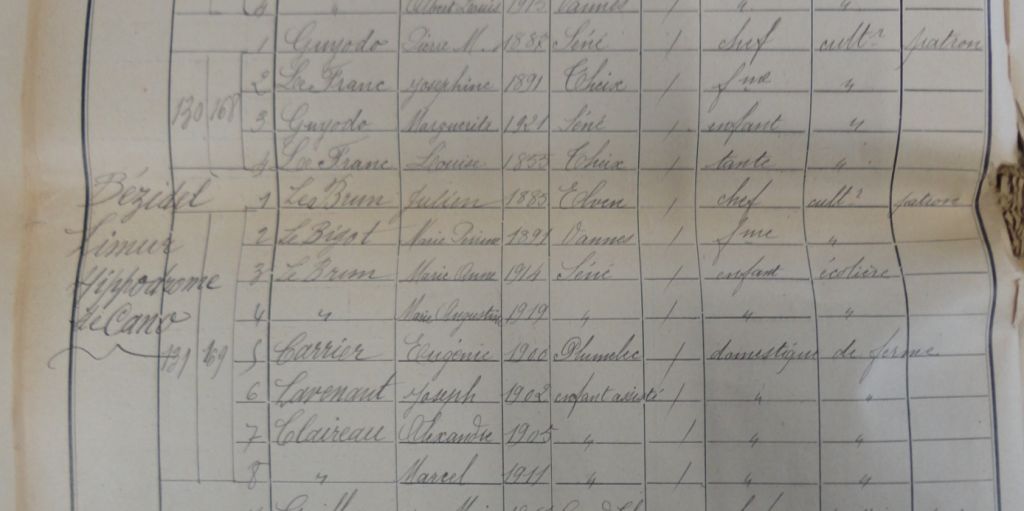
Une enfance marquée par la Grande Guerre...

Marie Augustine LE BRUN, est née à Bézidel à Séné, le 15/11/1919. La famille LE BRUN est pointée lors du dénombrement de 1921. Son père Julien Marie Alban LE BRUN [6/6/1885-11/4/1927] natif d'Elven, a été mobilisé lors de la Grande Guerre. Malgré les soins apportés par son épouse, Marie Perrine LE BIGOT [25/4/1891-1965], il décède de la tuberculose et sera reconnu "Mort pour la France". Son nom figure au Monument aux Morts de Vannes. Les LE BIGOT étaient cultivateurs à Bohalgo, Vannes, non loin de Séné. Vers 1910, ils s'établissent à Kernipitur à Séné. Perrine LE BIGOT est la soeur de deux soldats Sinagots dont les noms sont inscrits au monument aux morts de Séné : Jean Marie LE BIGOT [18/111888-29/10/1918] et François Pierre Marie LE BIGOT [22/11/1897-6/9/1918].
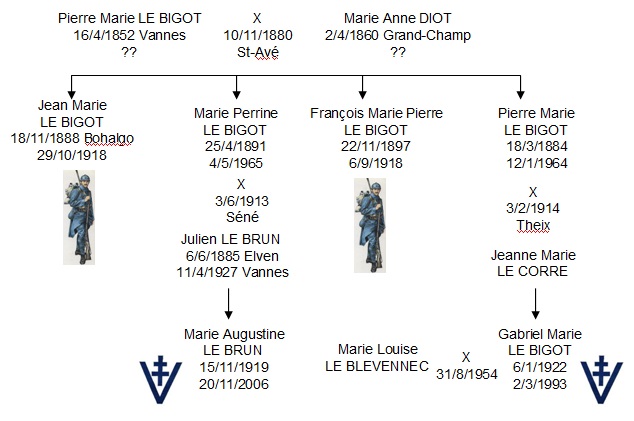
Un père Poilu de 14-18 mort de la tuberculose, deux oncles morts pendant la Grande Guerre, Marie LEBRUN sait depuis son enfance, ce que sa famille a fait pour défendre son pays. Son heure à elle va bientôt arriver.
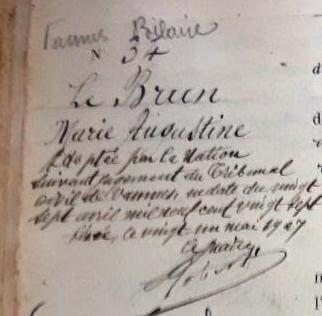
De ces années à Séné, son fils Lionel se rappelle un souvenir de famille:" mon grand-père n'a eu que deux filles à son grand regret. Il aimait suivre les épreuves de saut hippique qui avaient lieu à l'hippodrome de Cano, non loin de la ferme de Bézidel et amenait avec lui Marie Augustine qu'il considérait comme son "garçon"."
Vers 1925-26, la famille doit quitter Bezidel et trouve une ferme en métayage à Kerhon commune de Saint Nolff. Marie est scolarisée à l'école Saint Joseph de Saint Nolff. A la mort de son père, en 1927, Marie Augustine alors âgée de 8 ans, est "Adoptée par la Nation", en tant que fille de soldat mort à la guerre. La famille vient s'établir sur Vannes à Bilaire au nord de la gare ferrovière. Marie est scolarisée à l'école Sainte Marie rue Châteaubriand à Vannes. Vers 1933, elle obtient son certificat d'études et dévient apprentie couturière rue de Strasbourg. Elle obtiendra un prix de couture. Après son apprentissage, elle se met à son compte.

Avant guerre par l'entremise d'une amie, elle va danser sur Lorient dans les soirées organisées par la Marine. Elle y fait la connaissance d'André Désiré SILVAIN, [3/10/1918 Ciré d'Aunis-17- 8/1/2005 Vannes], son futur époux, qui suit une formation à l'Ecole de Marine et accomplit son service militaire. La famille SILVAIN est originaire de Picardie. Pendant la première guerre mondiale, elle a fuit l'avancée allemande, si bien qu'André naît en Charentes Maritimes où la famille est réfugiée. Comme son frère aîné, engagé dans la marine, André s'engage dans la Royale.
Quand la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie qui vient d'envahir la Pologne, Marie Augustine à tout juste 20 ans. Elle passe et obtient son permis de conduire. Elle souhaite s'engager comme ambulancière pour s'occuper des blessés au front. Cependant, la "Drôle de Guerre" et la "Débacle" des Armées françaises font changer le court des choses. Son fiancé est à Toulon au sein de la Gendarmerie de la Marine. Les Britanniques attaquent la flotte française à Mers El Kébir du 3 au 6 juillet 1940 [deux marins de Séné meurent lors de ce bombardement, lire article dédié]. Après l'Armistice, André SILVAIN est embarqué sur un croiseur au large d'Alexandrie en Egypte et rentre sur Toulon où la Marine française demeure à quai.
1ère occasion de s'engager dans la résistance : L'Opération Savannah.
Depuis l'Armistice de la France, le Royaume-Uni lutte seul contre l'Allemagne. Londres et le sud de l'Angleterre résistent au "Blitz". Les observations de terrain menées par la Royal Air Force indiquent que l’une des escadrilles de bombardiers allemands a la particularité de servir de « pathfinders » (« éclaireurs ») dont la mission est le marquage des cibles au moyen de fusées éclairantes ou bombes incendiaires permettant d’orienter les escadrilles conventionnelles vers les cibles à atteindre. En s’appuyant sur les renseignements glanés en France occupée par des agents de terrain, l’Air Ministry (Ministère de l’Air britannique) est en mesure d’identifier l’escadrille allemande comme étant la Kampfgeschwader 100 stationnée sur l’aérodrome de Meucon situé au nord de Vannes dans le Morbihan. L'opération est montée par le Deuxième Bureau du commandant Dewavrin et par le Special Operations Executive : il s'agit d'abattre les équipages (pilotes et navigateurs) de l'escadrille Kampfgeschwader 100, qui selon les renseignements, se rendent à l'aérodrome de Meucon, en groupe dans des autocars...
L'équipe est formée de cinq soldats français de la première CIA, Compagnie d'Infanterie de l'Air, des Forces Françaises Libres, FFL : Capitaine Georges BERGE [3/1/1909-15/9/1997] , commandant la compagnie, chef d’équipe; Sous-lieutenant de réserve Jean PETIT-LAURENT [3/12/1918-21/8/1989); Sergent chef Jean FORMAN [37/3/1915-17/11/1981] ; Sergent Joël LE TAC [15/2/1918-8/10/2005]; Caporal chef Joseph RENAULT [7/12/1916-12/2/1942 disparu en mer].
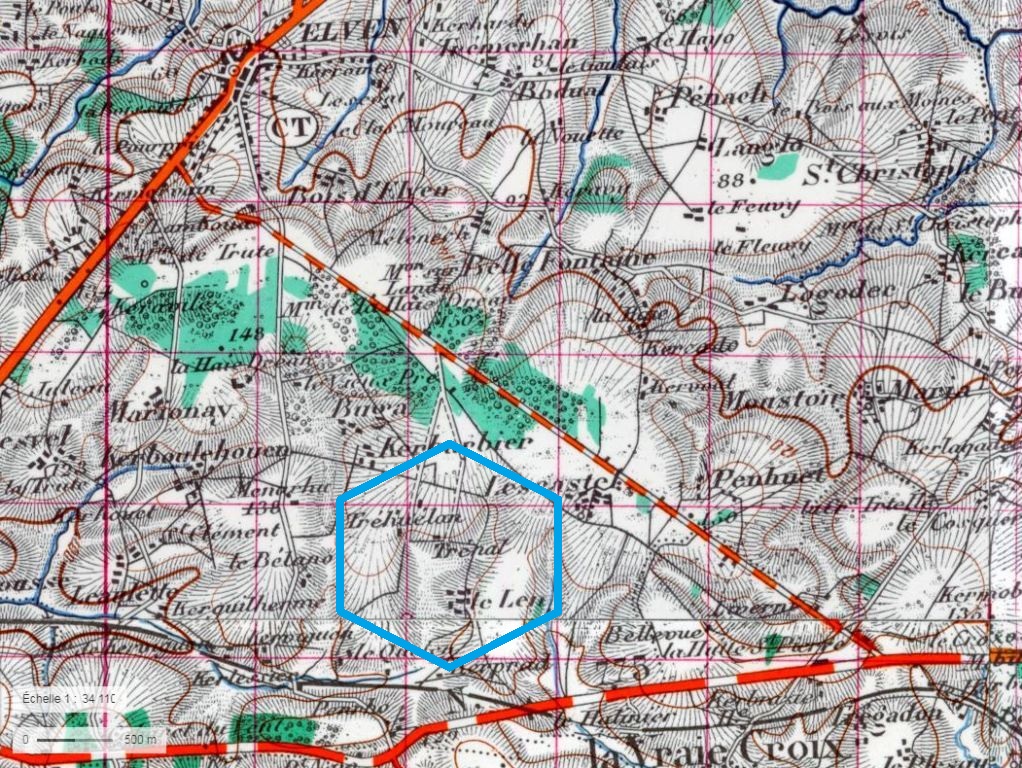
- Dans la nuit du 15 au 16 mars, l’équipe des cinq soldats français embarque dans un bombardier Whitley, en emportant avec elle deux conteneurs d'armement léger et un « piège routier » spécialement conçu pour sa mission. À minuit, elle est parachutée près d'Elven, aux environs de Vannes, sous couvert d'un raid de bombardement léger sur l'aérodrome. Le parachutage « blind » fut effectué de nuit et les 5 parachutistes français furent largués dans la campagne à l’ouest d’Elven du côté du Lenn et de Tréhuilan, à 8km de la Dropping Zone prévue.

- (Une stèle sera érigée non loin de leur atterrissage sur la route d'Elven à Questembert). Les 5 para se regroupent et prennent contact avec le vicaire d’Elven, l’abbé Jarnot et deux paysans, les frères François et Luis Renaud, qui organisent un gîte et une cache d'arme à Kerprado. Lorsque le réseau Overcloud qui succède à cete mission Savannah, tombera, François RENAUD sera déporté en Allemagen dont il reviendra à la Libération. À l'aube, les hommes enterrent leur équipement (parachutes et uniformes). PETIT-LAURENT et BERGE sont envoyés en reconnaissance. Ils montent les vieux vélos fournit par l'abbé Jarnot et les frères Renaud. Après deux jours de surveillances et de recherches, PETIT LAURENT et BERGE reviennent et rendent compte que les informations qu'ils ont recueillies ne concordent plus avec les renseignements parvenus à Londres : la plupart des militaires allemands logent maintenant dans de nouvelles baraques construites sur l’aérodrome, ou quittent Vannes où il logent à l'Hotel du Commerce et de l'Epée, rue du Mené, le matin, en voiture individuelle. Afin d'être convaincu de l'impossibilité de cette mission, BERGE renvoie PETIT LAURENT à nouveau en mission d'observation. Mais il ne revient pas ni le lendemain ni le surlendemain. BERGE décide d'abandonner le coup de main, mais il veut mettre à profit leur présence en France : chacun ira dans la région de France qu'il connaît le mieux et y recueillera le plus grand nombre de renseignements. Tout le monde se retrouvera, dans quinze jours, sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) où un sous-marin attendra pour ramener l'équipe en Angleterre. Joseph RENAULT reste en Breagne; Avec l'aide de l'abbé Jarnot d'Elven, il met en sécurité les explosifs non utilisés et réussit à se faire engager à l'aérodrome de Meucon; Joël LE TAC part à Saint-Pabu où réside sa mère, Yvonne LE TAC (résistante qui sera déportée). Georges BERGE va prendre des contacts près de Bayonne et Jean FORMAN fait de même sur Paris.
- Le 30 mars, BERGE, FORMAN et LE TAC sont au rendez-vous fixé. BERGE explique que RENAULT reste dans son pays. PETIT LAURENT manque à l'appel, il s'en expliquera à la Libération. Tous trois passent plusieurs nuits de veille infructueuses dans les dunes, à quelques kilomètres au N/O de la ville. Dans la nuit du 4 au 5 avril, le sous-marin Tigris est là, au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La mer est mauvaise. Les marins mettent à l'eau deux canoës, qui se retournent immédiatement. Avec le troisième, un marin anglais, Geoffrey Appleyard, réussit à atteindre la plage, charge BERGE et FORMAN et regagne le Tigris. Joël LE TAC doit rester sur la plage puis décide de regagner Paris en train pour rejoindre son frère Yves.
- Le 8 avril Yves et Joël LE TAC quittent Paris pour Vannes. Ils se rendent chez les frères RENAUD à Elven puis décident de faire un nouveau repérage près de l'aérodrome de Meucon et à Vannes dans l'espoir de mener à bien l'opération.
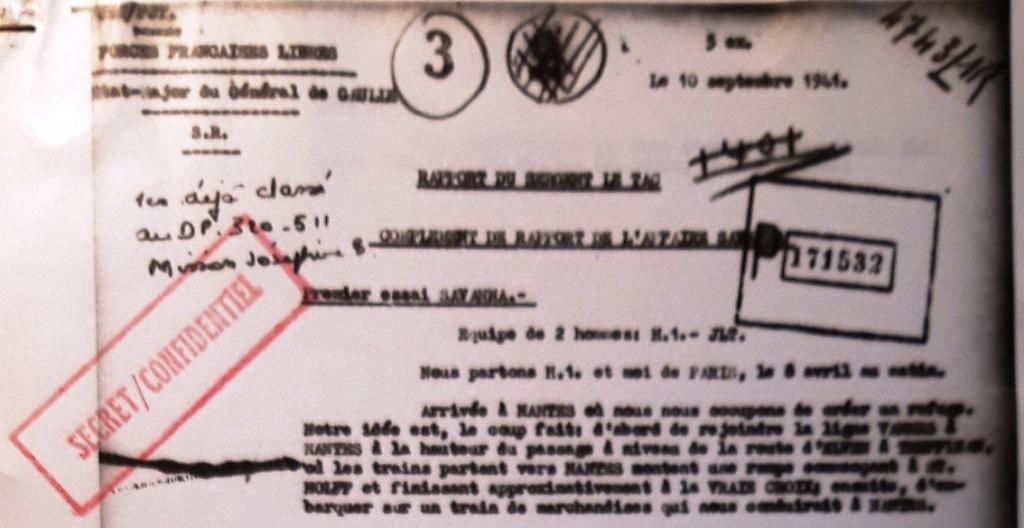
Lors de ce repérage, Yves et Joël LE TAC se rendent dans une ferme au nord de Vannes. Le dossier 16 P 295515 consultable au Service Historique de la Défense, SHD, à Vincennes, contient le rapport de Joël LE TAC faisant mention de la contribution de Marie LE BRUN.
1er essai SAVANNAH : A l'arrivée à Vannes, [le 8 avril] nous nous dirigeons immédiatement vers le lieu où doit s'exécuter l'attentat, pour faire des reconnaissances. Nous reconnaissons le terrain comme étant très favorable à cette action. Nous attendons une grande partie de la nuit et revenons vers Vannes sans avoir vu de cars, seulement, de temps en temps, une voiture de la Luftwaffe ou un motocycliste.
Nous demandons l'hospitalité à des paysans qui nous donnent les renseignement désirés, le ou les cars, ont changé de route. Ils passent désormais par la route nationalle N.167, allant à Locminé puis à Meucon, prennent la route N778, allant à Saint Jean Brevelay, à 2 km de Meucon et prennent à droite, le chemin ..qui se dirige vers l'aérodrome.
Nous renonçons à exécuter le coup et nous chargeons une persone contactée de faire l'enquête nécessaire.
Lionel SILVAIN, se souvient de ces évènements racontés par sa mère: "Un soir de printemp 1941, alors que ma grand-mère, (Marie Perrine LE BIGOT), prépare une bouillie de farine de blé noir, on frappe à la porte de la maison à Billaire. Deux jeunes gens, affamés, demandent l'hospitalité. Il s'agit des frères LE TAC". Les résistants ont frappé à la bonne porte d'une famille éprise de sa Nation. Ils vont manger et dormir et convaincre Marie Augustine de les aider dans leur repérages.
2ème essai SAVANNAH : Nous revenons le 22 avril à Vannes où nous recevons le rapport de la personne contactée. Par celle-ci, grâce à ses relations parmi le personnel des hôtels où habitait l'escadrille, nous pouvons établir que le seul moment possible de la nuit pour l'attentat est au retour de l'escadrille.
L'aller s'effectue en effet en plein jour (nous sommes en avril). Quant au retour, l'opération manque de surteté, le voyage s'effectuant à 4 heures du matin approximativement, parfois même à 5 heures, et le jour se levant seulement à 7 heures. Nous décidons de tenter l'opération et nous fasions le reconnaissance. Nous avons songé à un moment à placer l'engin en deux segments dans les rails du petit train départemental traversant le chemin mais l'aérodrome ne se trouvant qu'à & km, nous choisissons le croisement de la route nationale N.778 et du chemin comme lieu d'opération. Vers 4h, au lieu du ou des deux cars attendus, nous apercevons quatre cars excortés d'une voiture et de deux motos. Nous renonçons alors, H.1, la personne contactée à Vannes et moi à l'exécution du coup.
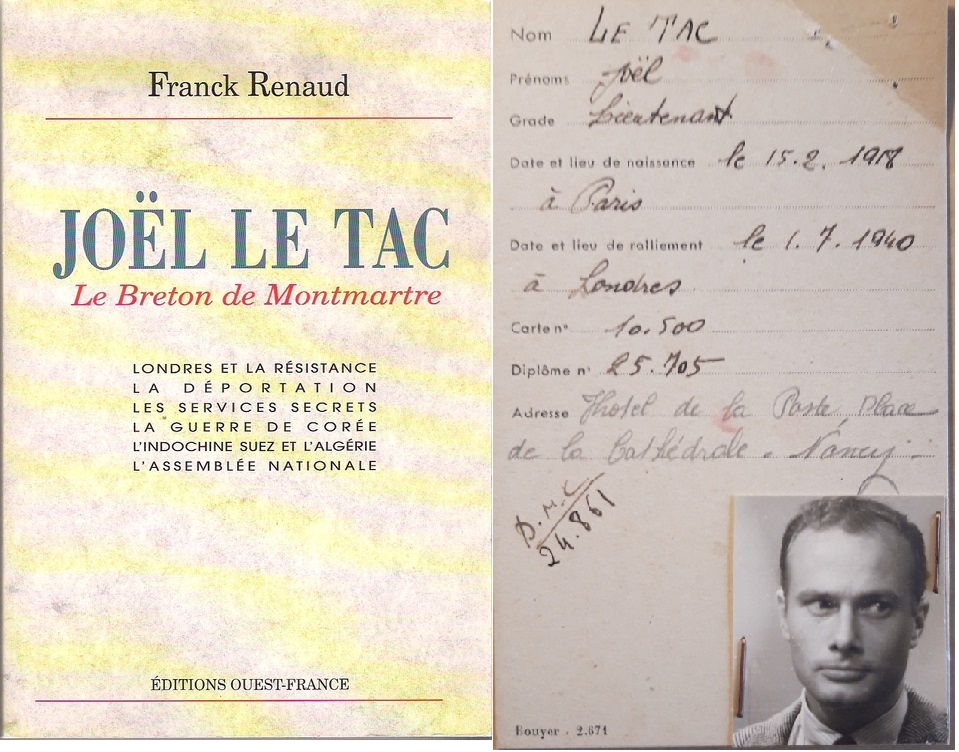
Dans son livre intitulé "Joël LE TAC, le Breton de Montmartre", Franck Renaud retranscrit le témpignage de Joël LE TAC et de cette rencontre. "En fin d'après-midi, le duo des LE TAC reprend à pied la route de Vannes. Mais le couvre-feu approche et il reste encore de la distance à abattre. "Nous sommes arrivés près d'un hameau fait de deux fermes et de leurs dépendances. Dans la cour, il y avait une grande et belle jeune fille d'environ 18 ans. Nous devions nous arrêter et stopper momentanément notre marche, sans regretter pour autant la petite halte que nous avions effectuées un peu plus tôt dans un minuscule auberge de campagne. On nous avait servi une succulente omellette. Au moment de ma déportation, elle a "alimenté plus d'une fois mes rêves d'affamés".

La jeune fille de la cour s'appelle Marie LE BRUN. Yves et Joël LE TAC comprennent en un tour de main qu'elle déteste les Allemands. Ils apprennent aussi que les "as" de la Luftwaffe sont bien transportés en car vers l'aérodrome. Mais l'itinéraire a été modifié...Sans donner plus de détails qu'il n'en faut sur leur activité, les deux frères lui demandent de les héberger dans la grange. Elle accepte et ils s'endorment côte à côte, dans la douceur du foin, écrasés par une vraie fatigue. Au petit matin, Marie LE BRUN leur apporte deux grands bols d'un lait brûlant et de larges tartines de pain beurrées. Les estomacs calés, ils saluent la jeune fille et s'en vont pour Vannes. Le train vers Nantes. Puis la ligne avec terminus à Paris. Retour au bercail pour les deux frères. Mais ils sont bien décidés à tenter une nouvelle fois l'opération Savanna si l'information obtenue en dernière minute se confirme. D'ailleurs, avant de quitter la Bretagne, il sont chargé Marie LEBRUN d'aller à la pêche aux informations.
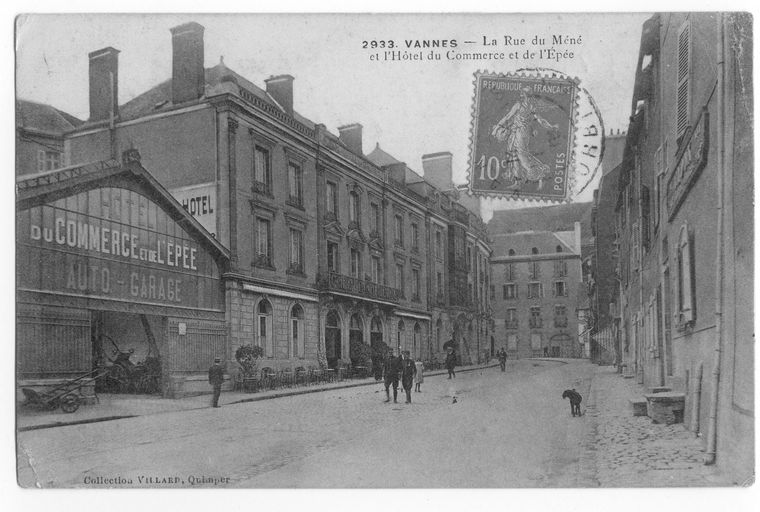
Pendant une quinzaine de jour, Marie LEBRUN va observer les aller retour des pilotes entre l'Hotel du Commerce et de l'Epée à Vannes et l'aérodrome de Meucon.
Yves et Joël LE TAC reviendront le 22 avril à Vannes. Leur informateur a bien travaillé : les aviateurs utilisent effectivement un nouvel itinéraire. "Nous pouvons établir que le seul moment possible de la nuit pour l'attentat est au retour de l'escadrille", écrira Joël LE TAC dans un rapport daté du 10 septembre 1941. Les deux frères effectuent une ultime reconnaissance pour envisager le modus operandi et le dispositif à adopter pour les charges explosives. Là au lieu du ou des deux cars attendus, nous apercevrons quatre cars escortés de deux voitures et de deux motos". Du coup, les LE TAC renoncent et décident de rentrer à Paris.

Lionel SILVAIN complète ce récit par celui que lui racontait sa mère : "d'entrée de jeu , ma mère est sollicitée pour particper à ces repérages qui vont s'étaler sur une quinzaine de jours (entre le 8 et le 22 avril). Elle part à vélo avec les LE TAC à Meucon près des ruines romaines faire des comptages d'avions en évitant les patrouilles canines allemandes. Marie LEBRUN se rend à l'Hotel du Commerce et de l'Epée où sa cousine qui y travaille lui dit que les officiers ne sont pas rentrés d'une mission aérienne, que les portes des chambres sont scellées. Il semble bien que la nuit précédente, les avions bombardiers allemands ont été détruits par les chasseurs anglais équipés de tout nouveau radar qui leur permettent de voler la nuit...[vérifier ce témoignage]
En parallèle, tout au long de cette période de répérage sur Vannes, Marie LEBRUN recherche activement des contacts pour constituer un réseau de résistants qui s'avèreront utiles pour la suite...
La base de Meucon restera active ....pendant la guerre. Le 13 octobre 1941, trois pecheurs de Séné, dont deux femmes, secouraient les pilotes Allemands, qui venaient de s'abimer entre l'Île d'Ars et l'Île de Boed . (Lire article dédié).
2° engagement au sein du réseau Overcloud...
Si l'opération Savannah n'a pas aboutit, elle fut pour autant la première opération aéroportée de parachutistes français sur le sol national occupé. Quelques semaines plus tard, alors qu'une première tentative a échoué pour des raisons techniques, l'opération "Joséphine" est à nouveau envisagée en juin 1941 sous le code mission Joséphine B. Cette fois, des Français avec à leur tête Joel LE TAC réussisent à faire exploser un central électrique de Pessac en Gironde, qui alimente près de Bordeaux la base de sous-marins allemands. Raymond CABARD, l’adjudant Jean FORMAN, le sergent André VARNIER, rejoints par Joël LE TAC parviennent à faire exploser la centrale dans la nuit du 6 au 7 juin 1941. Le 28 août Joël LE TAC est à Londres.
En octobre 1941, alors qu’il est promu sous-lieutenant, Joël LE TAC doit constituer une organisation clandestine articulée autour de l’action subversive. Le projet de mission OVERCLOUD prévoit l’infiltration en Bretagne du sous-lieutenant LE TAC et de son opérateur-radio, Alain de KERGORLAY [1920-2008] Le 14 octobre 1941, les frères LE TAC et de KERGORLAY débarquent sur la côte de Saint-Pabu et rejoignent à Paris, la secrétaire du réseau, Christiane FRAHIER [1918-1942] Tous les quatre ils décident de gagner la Bretagne et s’installent près Vannes, secteur dans lequel Joël LE TAC avait pu s’assurer d’un soutien local lors de l’opération SAVANNAH. [Il s'agit de la ferme de la famille LEBRUN à Bilaire]
Joël met à contribution ce temps passé dans la région vannetaise pour élaborer les modalités de structuration du réseau. Ainsi, il met sur pied dans la région de Vannes des groupements relativement cloisonnés
(Déclaration de Alain de KERGOLAY lors de son audtion à la Libération). De son côté, le radio de KERGORLAY s’efforce de contacter Londres avec son poste-émetteur. Le 30 octobre 1941, le premier message de la mission OVERCLOUD est transmis sous l’indicatif de Joël LE TAC, JOE depuis une ferme morbihannaise confirmant de fait, l’activation du réseau.
Sur le plan des transmissions, le réseau OVERCLOUD ne compte qu’un poste radio à l’automne 1941 qui émet de façon très irrégulière ce qui suscite l’agacement des services londoniens renforcé par le fait que l’opérateur Alain de KERGOLAY présente de sérieuses difficultés de chiffrage des messages à destination de Londres. De surcroît, le poste OVERCLOUD est fréquemment la cible des tentatives de détection par les véhicules allemands de goniométrie ce qui contraint l’opérateur-radio à interrompre immédiatement ses émissions en cours.
Au courant de novembre 1941, l’équipe se rend à Rennes afin de consolider les relations avec les embryons de résistance, les organiser, définir leur rôle respectif et enfin les incorporer à l’organigramme du réseau. Quant à l’opérateur-radio de KERGOLAY, il reste vraisemblablement sur Vannes à la ferme de Bilaire.
Lionel SILVAIN se souvient: "une cousine à ma mère, Lucienne habitait non loin de chez nous rue de Strasbourg. Elle voit circuler dans le quartier un véhicule monté en goniométrie qui essaie de réperer les émissions radio. Sa demeure et les maisons voisines sont fouillées. Les Allemands ne poursuivent pas la route vers Bilaire. La configuration des lieux à l'époque ne laisse pas penser qu'il y a plus loin d'autres habitations. Si bien que de KERGOLAY a le temps de fuir avec son équipement et sa radio."
De KERGOLAY sera arrêté par les agents de l'Abwehr allemande et accepte d'émettre, mais il se garde bien d'utiliser les clés d'identification garantissant l'authenticité des messages transmis.(Source Histoire de Résistance en France, Noguières, R. Laffont). Ainsi Londres apprend que son radio est tombé.
Le 31 décembre, un 2° radio, Pierre MOUREAUX arrive de Londres pour remplacer de KERGOLAY. Pierre Laurent MOUREAUX, né à Nancy le 13/4/1920, se trouve au Pays Basque quant le Général de Gaulle lance l'appel du 18 juin. Le 19 juin il embarque à Bayonne sur un navire belge le Léopold II et gagne l'Angleterre à Falmouht en Cornouailles. Etudiant, il parle allemand et anglais. Le 6 decembre 1941 il accoste près de Saint-Pabu en Bretagne et rejoint le réseau Overcloud.
Le 4 janvier, les frères LE TAC gagnent Londres lors de l'exfiltration de 5 résistants qui veulent rejoindre les FFL. Le 25 janvier 1942, Les frères LE TAC et Joseph SCHEIMAN débarquent sur Saint-Pabu. Yves LE TAC et SCHEIMANN vont sur Rennes, Joël LE TAC va sur Paris.
Dans le livre intitulé "Des Anglais dans la Résistance" de l'Anglais Michael R.D.FOOT et de J.L. CREMIEUX-BRILHAC, les auteurs avancent une explication à l'origine des arrestations des agents d'OVERCLOUD : "les Allemands avaient arrêté un étudiant, dénoncé par La Chatte, l'agent double française Mathilde CARRE [30/6/1908-30/5/2007] comme faisant partie du réseau Interallié, et avaient trouvé dans sa poche le schéma du réseau Overcloud. Ils avaient donc infiltré l'organisation bretonne et attendaient le retour des deux frères LE TAC pour lancer leur coup de filet".
Dans le dossier au SHD côte GR 28P2/25, le témoignage de Poumeau de Lafforest:
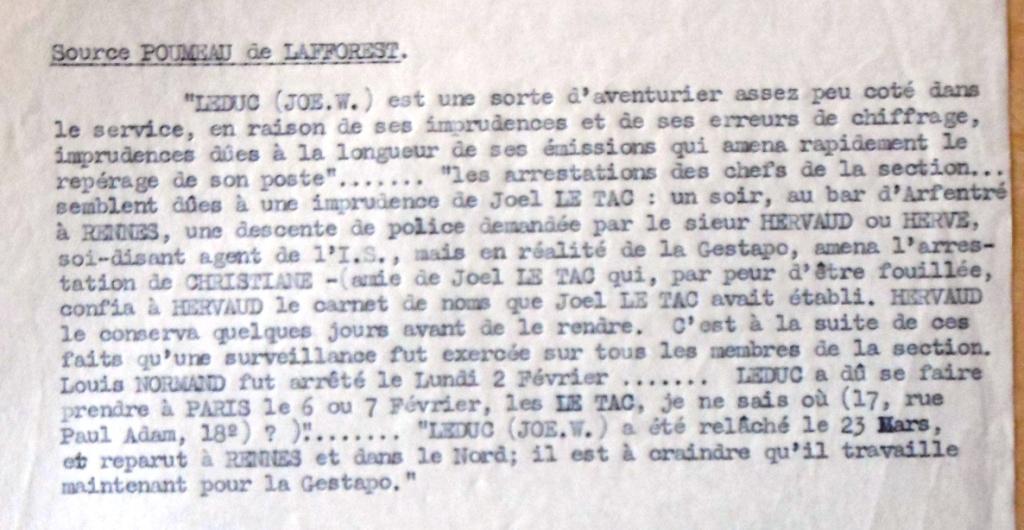
Début février commence alors une vague d'arrestations des membres du réseau OVERCLOUD. Le 2 février MOUREAUX est arrêté à Rennes. Il sera emprisonné en France à Angers puis Fresnes avant d'être déporté en Allemagne d'où il reviendra en décembre 1945.
Le 5 Joël LE TAC est arrêté. Il sera conduit à Angers puis Paris et la prsion de Frênes avant d'être déporté avec ses parents. Une quinzaine de membres du réseau tomberont. La plupart seront fusillés.
Le 27 janvier, Christiane FRAHIER [3/10/1918 Tours - 12/12/1942 Saint-Germain en Laye] est également arrêtée par la Gestapo et incarcérée à la prison de la Santé à Paris. Christiane est la fille du receveur percepteur de Montreuil, Adrien Frahier. Elle est a obtenu son brevet d'infirmière et par le l'anglais. Elle rejoint le réseau Overcloud en novembre 1941. Après son arrestation, elle y est interrogée et soumise à des conditions de détention terribles. Condamnée à mort, elle est conduite malgré tout à l'Hôpital La Pitié. Ces geôliers la relachent quelques jours avant son décès à Saint-Germain en Laye le 12/12/1942.
Elle sera reconnnue "Mort(e) pour la France" et déclarée membre des Force Françaises Combattnates au grade de Sous-Lieutenant à titre posthume le 23/3/1950. Depuis 1945, une place honore sa mémoire en la ville de saint-Germain en Laye.
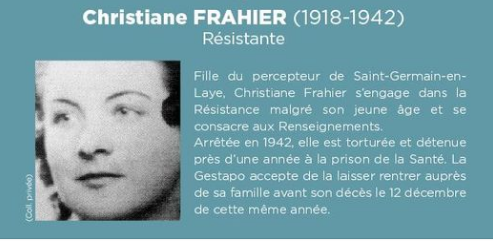
Tel aurait pu être le sort de Marie LEBRUN. Sa "chance" fut d'avoir conserver son vrai nom et de n'avoir pas adopté un nom d'emprunt. Elle ne sera pas retrouvée par les Allemands.
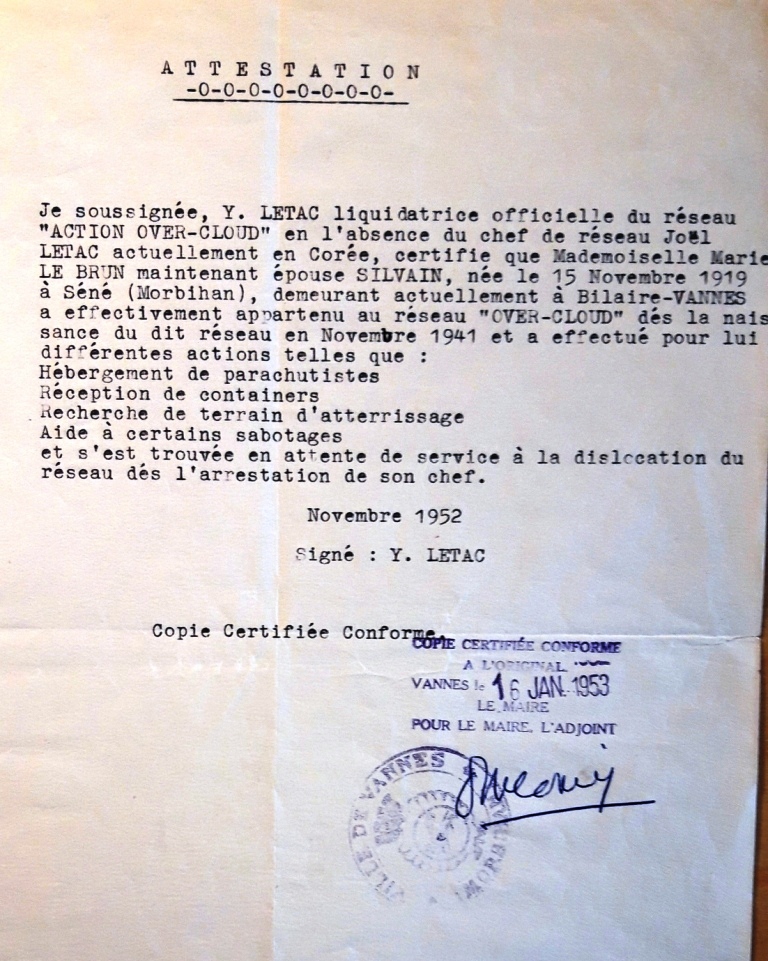
Lionel SILVAIN, son fils complète: "après la disparition du réseau Overcloud, ma mère va continuer à faire du renseignement; elle a fait également du transport d'armes pour les maquisards autour de Saint-Marcel après des parachutages. On y passe toute la garde-robe du soldat LE BRUN, dont les costumes, chemises et chaussures habillent les parachutés et les maquisards". Un jour en gare de Rennes ou de Redon, avec une autre femme résistante comme elle, elles transportent dans une valise des armes. Elles décident de confier leur valise à des officiers allemands avant de passer les contrôle de la gendarmerie française. Elle récupère ensuite leur valise".
.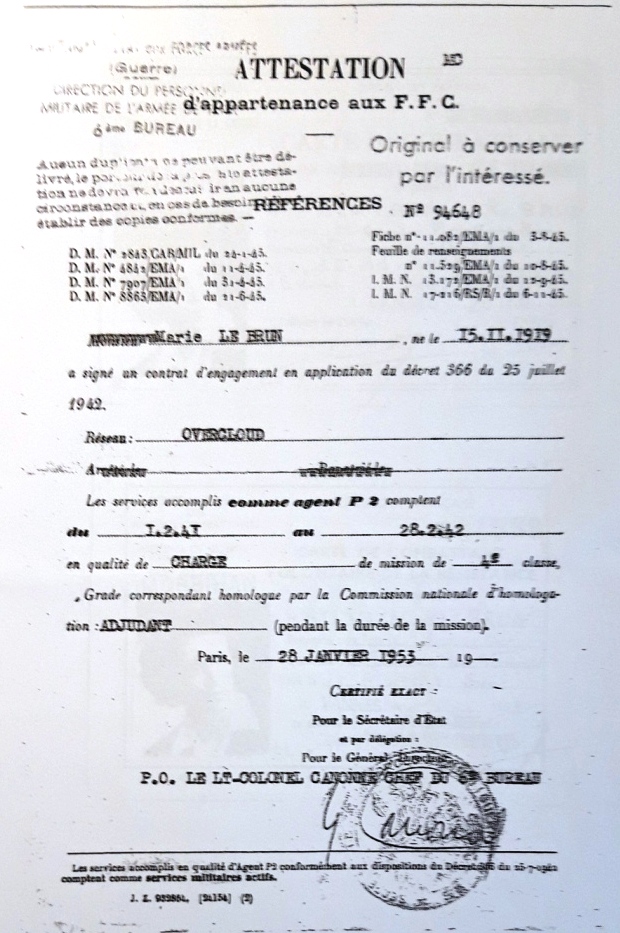
Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, la France est totalement occupée par les Allemands. Pour ne pas passer sous le contrôle de l'Occupant et pour ne pas rejoindre les Forces Navales Françaises Libres, les FNFL constituées autour de De Gaulle en Afrique du Nord, la flotte française de Toulon se saborde le 27 novembre 1942.
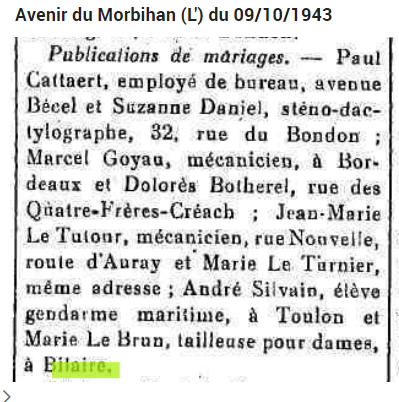
André Désiré SILVAIN est muté en tant qu'agent maritime à Pornichet, ce qui lui évite le STO. Il épouse sa fiancée à Vannes le 30/10/1943 à Vannes. Au cours de leur repas de noces, les jeunes mariés organisent une quête en faveur des prisonniers comme nous l'indique cette coupure de presse.
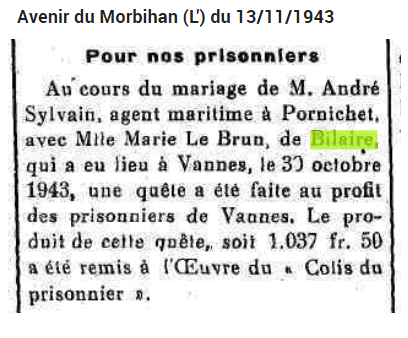
Marie Augustine tombe enceinte et sa grossesse est compliquée. En août 1944, alors que Vannes est libérée nait leur garçon, Lionel SILVAIN (1/8/1944) à la ferme de Billaire. Son père André SILVAIN est toujours gendarme maritime. Après la Libération, la jeunne famille vit chez la grand-mère. De 1948 à 1951 André SILVAIN s'engage à nouveau dans la marine dans une mission à Diego Suarez à Madagascar. Victime d'un accident avec un véhicule militaire, il sera amputée d'une jambe. De retour en France, il bénéficie d'une pension. Il passe un concours et décroche un poste de secrétaire aux Inscriptions Maritimes à Vannes. Sa femme, s'occupe de son jeune garçon et continue à confectionner, couper, assembler des tissus pour des vestes, pantalons, chemises et autres robes de mariées.
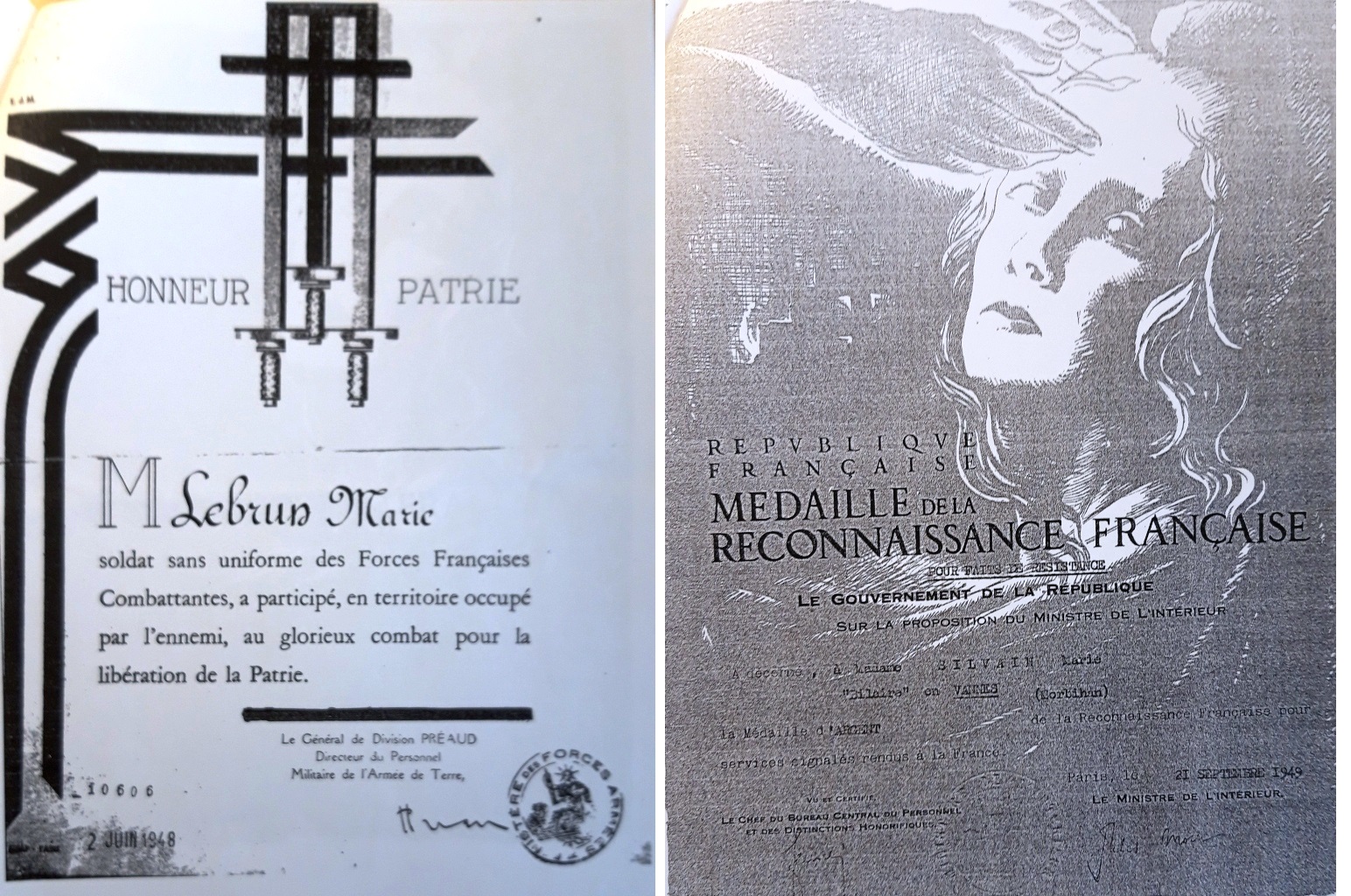
Le 2 juin 1948, Marie LEBRUN reçoit la distinction accordée aux résistants. Le 21 septembre 1949, elle reçoit la Médaille d'Argent de la Reconnaissance Française.
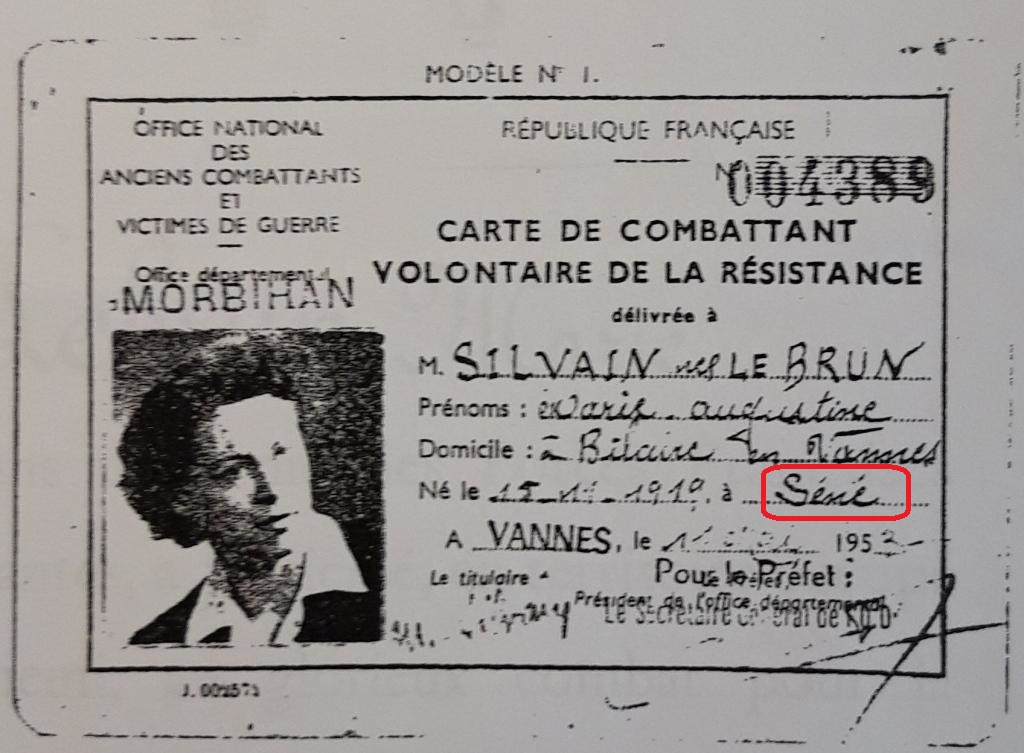

Elle entretiendra le souvenir de son engagement pendant la résistance avec d'autres résistants dy Pays de vannes. A la retraite de la grand-mère Marie Pierre LE BIGOT [1891-1965], puis après son décès, la famille peut demeurer à la ferme, alors que les terres sont relouées. Peu à peu, le métier de couturière rapporte moins. André SILVAIN part à la retraite au début des années 1970. Il décède à Vannes le 8/1/2005.
Marie Augustine LEBRUN, native de Séné, décède à Vannes le 20/11/2006 à l'âge de 87 ans.
Marie Augustine LEBRUN, hommage
Sur l'air de la chanson interprétée par Edith PIAF, L’Accordéoniste :

La petite écolière
Son père était soldat
Il revint de la guerre
Dans un bien triste état
Sa mère la fermière
Elle fut à son chevet
Avant d’avoir dix ans
Son père s’en est allé
Elle va à l’école
Travaille à la maison
La vie elle n’est pas drôle
Pour l’enfant de la Nation
La fille de la fermière
Le petite écolière
La voilà devenue couturière
De ses mains aguerries
Elle coud des habits
A 20 ans elle peut aider sa mère
Mais la guerre revient
La Débâcle survient
Elle ne sera pas ambulancière
Tout son être est tendu
Son souffle est suspendu
Dans son cœur sommeille une guerrière.
La belle couturière
Une journée de printemps
Elle accueille à Bilaire
Un group’ de résistants
Sans une hésitation
Elle se met en action
Fait du renseignement
Espionne les Allemands
Elle part à bicyclette
Du côté de Meucon
Efficace et discrète
Elle compte les avions
La fille du soldat
Elle prend part au combat
Elle est fière de servir sa Patrie
Au sein de son réseau
Elle abrite un radio
Elle défend sa France chérie
La Gestapo les serre
Il faut fuir de Bilaire
Ils tombent tous dans la souricière
Ils seront arrêtés
Ils seront déportés
Fusillés par tous leurs tortionnaires
La femme résistante
Echappe aux Allemands
Elle reste combattante
Et clandestinement
Elle cache à la ferme
De jeun’s parachutistes
Des bataillons en germe
Elle ne sent pas triste
Car tous ces maquisards
Aux côtés des Alliés
Combattront tôt ou tard
Pour notre Liberté.
La fille du soldat
La femme de combat
La jeune fiancée
Elle s’est mariée
Pour la Libération
Elle accouche d’un garçon
Elle croit toujours à la vie
Gardons nous d’oublier,
Toutes ses vies engagées
Sacrifiées, pour sauver la Patrie.
Pour sauver !
Pour sauver la Patrie !

Les DORIDOR victimes de guerre, Lorient, 1943
Le site internet MemorialGenWeb donne le nom des soldats morts pour la France pendant les deux guerres mondailaes et d'autres conflits. Il répertorie également quelques victimes de guerres. Une recherhce avec la commune de naissance permet de se rendre compte du sort dramatique qui frappa la famille DORIDOR de Séné.
La destruction de Lorient en 1943
Dasn la nuit du 14 au 15 janvier 1943, à 23h55, les sirènes de Lorient donnèrent l’alerte et quelques minutes après, on pouvait entendre distinctement les ronflements des moteurs d’une importante escadre aérienne. Cependant, les Lorientais n’en conçurent pas autrement d’inquiétude, car il était fréquent qu’au cours des opérations de mouillage de mines, les avions viennent survoler la Ville, salués par un feu nourri des batteries antiaériennes. Mais, vers 24h15, les fusées éclairantes s’allumèrent en grand nombre, annonçant un bombardement qui ne tarda pas à se produire. Plusieurs milliers de bombes incendiaires furent lancées ainsi que quelques bombes explosives sur la ville de Lorient.
Les quartiers atteints étaient ceux de la Nouvelle-Ville et de Merville. Plus de 80 foyers d’incendie éclatèrent simultanément et, après avoir dirigé sur les lieux tous les moyens de secours dont on disposait et jugé de la gravité de la situation, le Directeur de la Défense Passive fit appel aux pompiers de la Marine française, puis aux corps de sapeurs-pompiers de Vannes, d’Auray, d’Hennebont et de Pontivy dans le Morbihan, de Quimper, de Quimperlé et de Concarneau dans le Finistère. Les effectifs ainsi utilisés étaient imposant. Plus de 350 officiers, sous-officiers et sapeurs, participèrent à la lutte contre le feu avec 12 autos-pompes, 10 motos-pompes, sans compter un fort détachement de pompiers allemands avec leur matériel.

Malgré tout, la situation était critique. Dans les quartiers denses, le feu gagnait de maison en maison. On décida d’adopter une politique sévère qui fut féconde en résultats. Les immeubles isolés ou entourés de jardinets furent abandonnés au feu, tous les efforts étant dirigés sur les points où il y avait danger d’extension. Le 15 janvier, à 11h30, les corps de pompiers venus de l’extérieur pouvaient ramasser leur matériel et regagner leurs casernes.

120 maisons, dont deux églises, étaient détruites par le feu ou par explosions. L’émotion causée par cette agression n’était pas calmée lorsque, le même jour, à 19h30, une nouvelle attaque se produisit, avec une violence accrue. Le bombardement se poursuivit pendant deux heures, sans interruption. On peut considérer que le nombre d’avions assaillants était de 200.
Les quartiers atteints étaient principalement ceux de l’intra-muros et de Kerentrech. Les bombes incendiaires pleuvaient littéralement sur la Ville. Dès le début de l’attaque, on pouvait dénombrer plus de 400 foyers d’incendie. Le Théâtre, l’Hôtel des P.T.T., l’Hôpital Bodélio, brûlaient. Les pompiers de l’extérieur furent à nouveau appelés.
Bientôt, les bombes explosives succédèrent aux bombes incendiaires.
Vers 22 heures, le centre de la Ville était un immense foyer. La lutte contre le feu était difficile. Par suite de la rupture de la conduite principale de 600 m/m alimentant la Ville, touchée en plein par une bombe, et d’une panne générale d’électricité, l’eau manquait. Il fallut faire des établissements dans le bassin à flot, mais de nombreux incendies ne pouvaient être combattus. Les pompiers, qui venaient de lutter pendant toute une nuit et une journée, faisaient l’impossible. L’Hôtel des P.T.T. put être préservé, grâce au dévouement du personnel.
Un fort vent du Sud-Est activait les flammes. L’atmosphère était irrespirable. Au milieu de la fumée et des flammèches transportées par le vent, des gens à peine vêtus, une valise à la main, dans laquelle ils avaient entassé, très vite, pêle-mêle, les objets les plus chers, fuyaient, éperdus. D’autres, assis sur une malle sauvée à grand peine, regardaient sur la rue brûler les maisons.
Dans les postes de secours, on soignait les blessés, les pompiers aux yeux gonflés et rouges.
La lutte se poursuivit toute la nuit, toute la journée du 16, la nuit du 16 au 17, la journée du 17.
Le 18, on put faire le bilan de cette terrible soirée : 800 nouveaux immeubles étaient détruits. On comptait 14 morts et 20 blessés, mais sous les décombres, il restait des corps dont le nombre n’était pas connu.
Lorient vécut les journées qui suivirent le 15 janvier, dans une atmosphère de panique. Quoique l’ordre d’évacuation ne fut pas donné, de nombreuses personnes quittaient la Ville en toute hâte et, sur les routes, on pouvait voir, se succédant sans interruption, les véhicules les plus disparates, du car spacieux à la voiture à bras, où de pauvres gens avaient entassé toutes leurs richesses.
Cependant, on espérait encore. On ne pouvait pas comprendre que la malheureuse ville était condamnée et qu’elle allait mourir inévitablement.
On compta que 12 tués et plusieurs blessés. Leur noms ont fait l'objet d'acte civil de decès. Ainsi on peut lire les noms de la famille DORIDOR victimes du bombardement de Lorient le 15 janvier 1943.
Joseph Louis Marie DORIDO [9/5/1901-15/1/1943] fils d'une famille de pêcheur de Langle, avait épousé le 16/6/1925 à Séné, Marie Albertine LE FRANC [26/3/1903-15/1/1943]. En 1926, naissait à Séné, Madeleine Marcelle Marie DORIDOR [3/11/1926 - 15/1/1943]. Après le décès de son beau-père, Vincent Marie LE FRANC [19/5/1875 -* ], la famille Dordior accueillit la belle-mère Anne Marie MOREL [27/5/1876-15/1/1943] sous son toit à Bllevue. En 1931, le dénombrement ne montre plus que les parents à Séné. Joseph DORIDOR et sa famille sont partis sur Lorient. Qu'est-ce qu amena les Doridor à aller s'installer à Lorient?
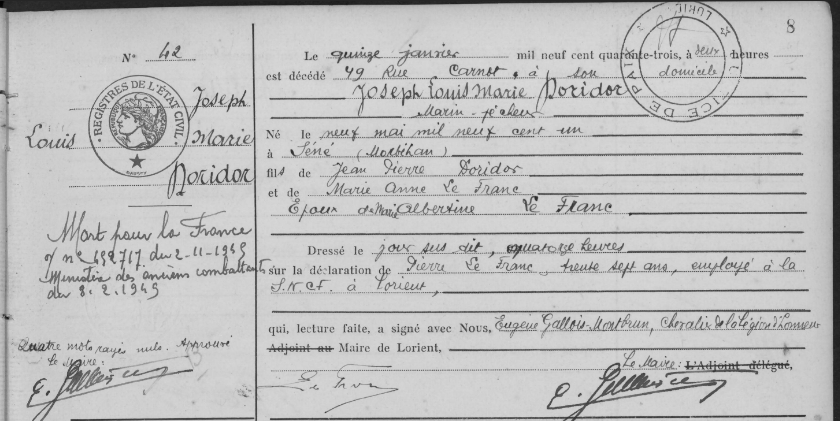
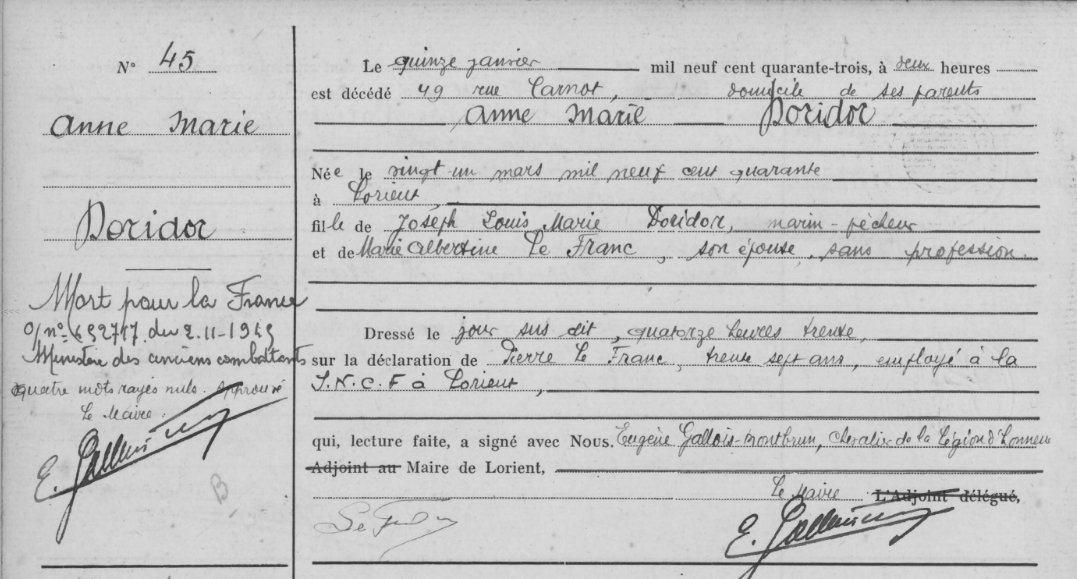
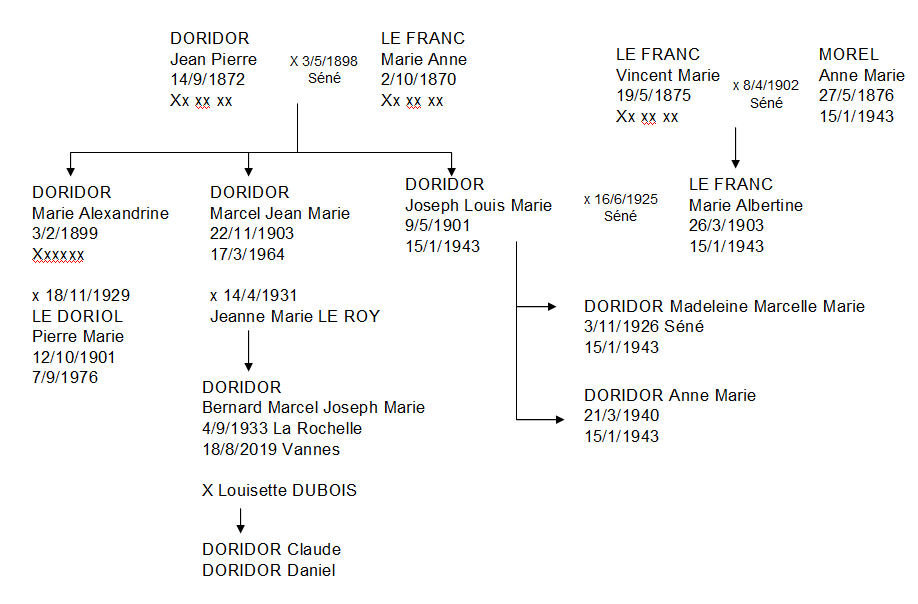
Cette nuit du 15 janvier 1943, la famille qui vit au n°49 de la rue Carnot à Lorient, est surprise dans la nuit, dans son sommeil, par les bombardements. Elle n'a pas le temps de fuir. Leur appartement est détruit par les bombes. Aux côtés de son père, de sa mère, de sa grand-mère qui avait suivi sur Lorient et de sa petite soeur, la dernière de la famille, Anne Marie DORIDOR [21/3/1940- 15/1/1943] compte parmi les victimes. Les 5 Sinagots ont été déclarés "Morts pour la France" en tant que victime de guerre.
Il y a sans doute eu d'autres Sinagots de passage à Lorient ou vivants dans ce port militaire, victimes des multiples bombardements qu'à subti la sous-préfecture.
Ainsi, Jean RICHARD se souvient : "mon oncle André RICHARD et son épouse Féline MOREL vivaient rue Traversière à Lorient et furent blessés pendant un bombardement". Leur fille Andrée RICHARD, à Bubry, née le 6/12/1939, complète ce souvenir: "mon père était directeur au port militaire de Lorient. en septembre 1940, j'avais 9 mois, m'a-t-on dit, un bombardement a cloué mon père 9 jours dans le coma. Il fut trépané et il en resta sourd. Quant à moi, jeune bébé, j'ai reçu un éclat d'obus dans la fesse gauche. Cela m'a handicapé toute ma vie. Je n'ai marché qu'à l'âge de 5 ans. L'ancienne poissonnière en retraite, âgé de 81 ans, à la mémoire intacte, n'a pas oublié cette blessure d'enfance qui se rappelle encore à elle. En février dernier (2-2020), on m'a amputé de la jambe gauche, celle qui reçu l'éclat d'obus allié!
ROBERT Eugène, prisonnier de Vichy en Indochine
On se souvient que Ferdinand ROBERT, capitaine des douanes en retraite à Séné, devint maire de Séné de 1919 à 1928. Son petit-fils qui dans son enfance venait voir son grand-père à Séné, finit par s'établir à sa retraite à Moustérian dans la maison de son grand-père. Il s'est illustré par son engagement dans l'Armée Française pendant la Seconde Guerre Mondiale et dans la Résistance.
Le texte qui suit provient de : http://www.france-libre.net/; Il a été complété et illustré.
Eugène Louis Léon ROBERT, [6/8/1911- 14/6/2003], puisque c'est de lui dont il s'agit, naquit à Nantes où son père, Louis Marie ROBERT [7/12/1884 Lans Le Bourg-72- 1925] est marin et sa mère, Thérèse Louis Marie LE BOURHIS, ménagère.
Extrait du bulletin municipal 2001 : "Sa mère commerçante, l'a confié très tôt à ses grands-parents paternels, retraités à Séné. Son père, Louis Robert était capitaine au long cours. Eugène a passé toute son enfance, jusqu'à lâge de 7 ans au bord du golfe."

Eugène ROBERT à gauche sans chapeau,
lors du mariage des Penru à Cariel, le 2 septembre 1930
Louis Marie ROBERT est capitaine sur le Montmorency en 1925, quand il contracte une maladie lors d'un voyage vers Valparaiso au Chili. A quelques jours de l'arrivé au port, il décède à bord. Son corps sera ramené en France.
Le jeune Eugène ROBERT fait son lycée à Nantes puis obtient une license de droit à Rennes. Il entre à l'Ecole des Contributions Indirecte. Par la suite il intègre l'administration des finances avec un premier poste en région parisienne.
Vers 1931 il effectue son service militaire et sortira officier de réserve.
Son grand-père Ferdinand décède en 1937 à Séné [lire article dédié].
Il se marie à Vanves (Seine) le 4 juillet 1938 avec Eugénie Marguerite AUDIAT. En août 1939, naissance de son fils aîné Jean Louis à Vanves.
Décoré pendant la Campagne de France :
Lorsque la guerre est déclarée contre l'Allemagne nazie, il a 28 ans et il est incorporé. Pendant les combats de la Campagne de France, qui précédèrent l'Armistice, il s'illustra dans son régiment et fut à plusieurs fois cités :
1/Journal Officel du 10/6/1940 page 44198 Armée :
ROBERT Eugène, lieutenant, jeune officier de réserve plein d'allant volontaire pour toutes les missions périlleuses. Le 9 mars 1940, rencontrant une patrouille ennemie, l'a rapidement manoeuvrée. S'est jeté hardiment sur un soldat allemand pour le capturer.
2/ Journal Officiel du 16/5/1940 page 3621 :
Pour Chevalier (pour prendre rang du 10.4.40) ROBERT Eugène Louis, lieutenant, officier doté d'une grande bravoure et d'un coup d'oeil admirable, entraîneur d'homme magnifique. Le 17 mars 1940, a par une intelligence et prompte maneouvre, permis le décrochage d'une partie du groupe temporaire serré de près par l'ennemi; a été blessé au bras au cours de l'action. Cette citation comporte attribution de la Croix de Guerre avec palme. Cette blessure lui permet de revenir à la maison en convelesence.
3/ Ordre 1526 C du 20.5.43 (Division)
Officier remarquable de bravoure et d'audace. Commandant le groupe franc du bataillon - a eu une conduite exemplaire au cours de la campagne de Somme - S'est particulièrement distingué à l'attaque de Longueau, les 24 et 25 mai 1940 et à la défense de Foumecamps, le 7 juin où il fut grièvement blessé au retour d'une mission périlleuse.
Le lieutenant de réserve, Eugène ROBERT est fait prisonnier pendant la Campagne de France puis libéré après l'Armistice. Il a du retourner travailler au sein du Ministère des Finances.
Le 18 juin 1940 : Appel du Général De Gaulle.
Décembre 1940, naissance de son second enfant Françoise. La famille est conduite en province chez les beaux-parents dans le village de Milly (Nièvre) où ils resterons jusqu'à la Libération.
Une fois sa famille en sécurité, Eugène ROBERT se porte volontaire pour partir en Indochine où le Gouvernement de Vichy souhaite renforcer son administration depuis que la colonie est occupée par le Japon. Il pense pouvoir De Gaulle à Londres rejoindre plus facilement depuis les Colonies que depuis la France...
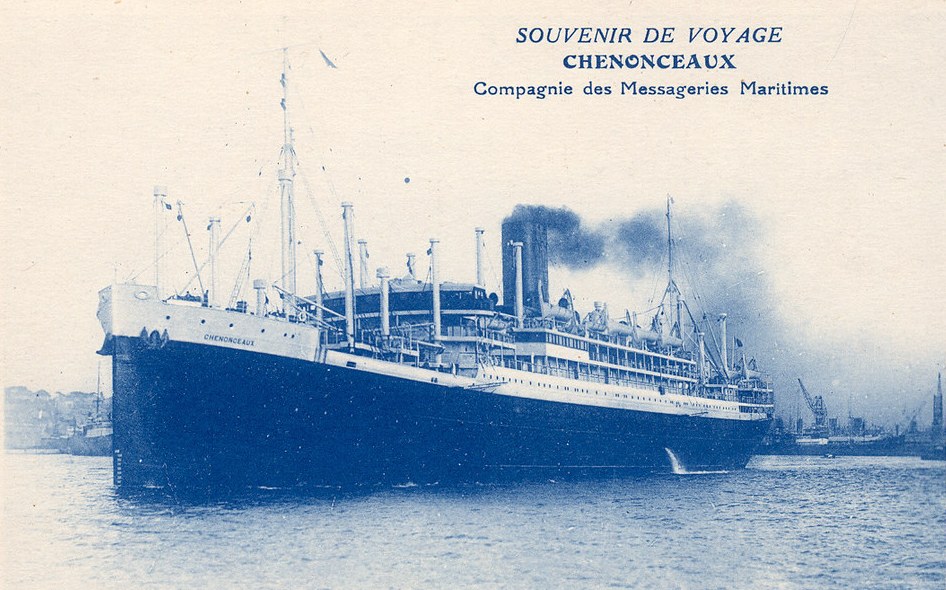
Le départ pour l'Indochine :
En février 1941, il embarque sur le Chenonceaux pour l'Indochine et y arrive après plusieurs escales en mai 1941.
Depuis lʼArmistice du 22 juin 1940, lʼamiral Jean Decoux est nommé gouverneur général de lʼIndochine française (Vietnam, Laos, Cambodge) par Pétain. Il applique la politique de Vichy et collabore avec les forces dʼoccupation japonaises. La « souveraineté française » est maintenue officiellement.
Eugène ROBERT est affecté dans un service à Hanoï dépendant du Bureau des Statistiques Militaires (BSM), dirigé par le colonel Maupin, créateur du réseau gaulliste « Maupin-Levain ». Eugène ROBERT rejoint la Résistance d'Indochine et prend part à ces renseignements clandestins et informe le consul américain Reed des menées japonaises en Extrême-Orient. .
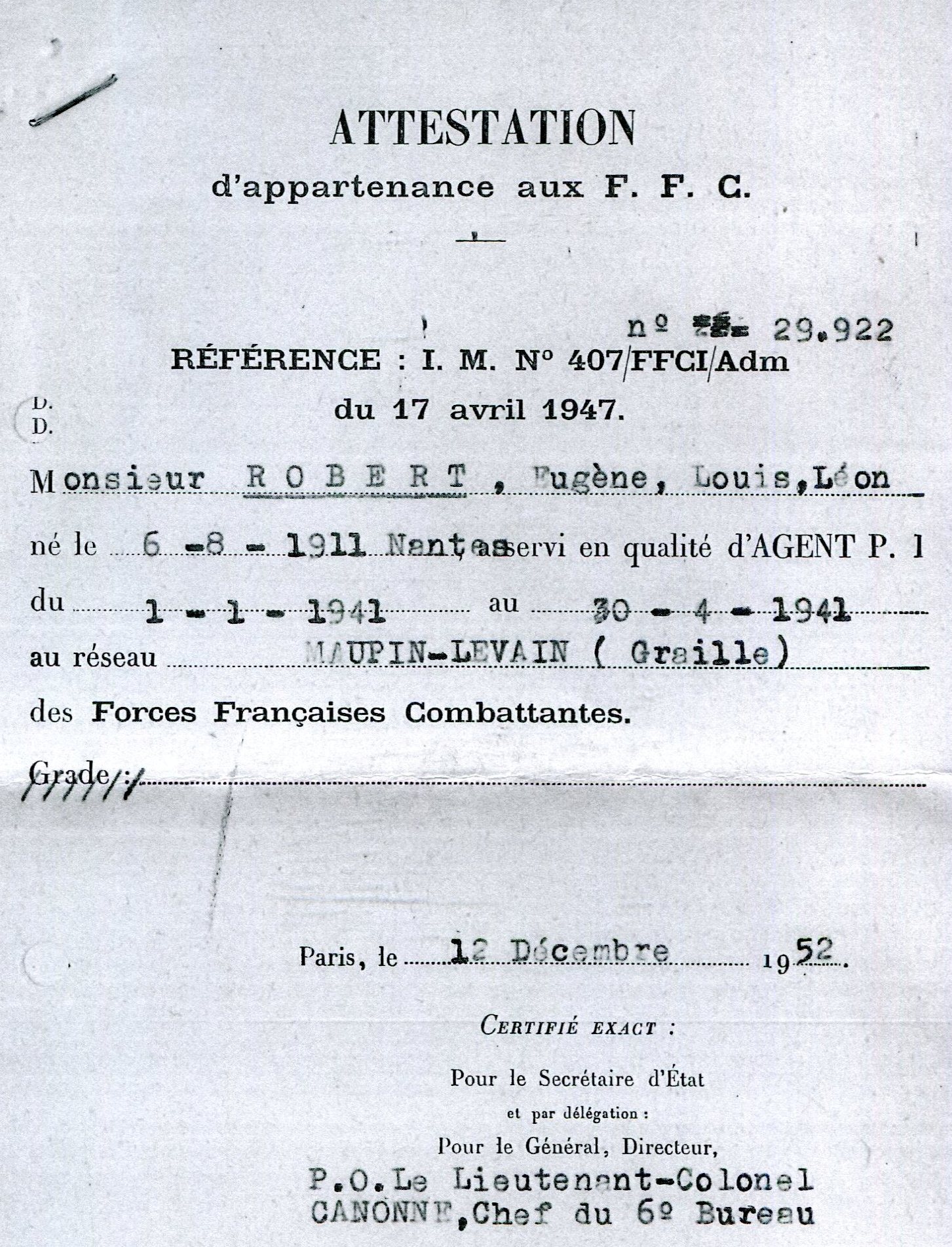
La tentative de passage clandestin de la frontière :
Désireux de rejoindre les Forces Françaises Libres, FFL, il décide de passer en Chine, avec des documents sur l’armée japonaise en Indochine pour les Américains. Il quitte Hanoï en voiture pour la ville de Bac Minh où il monte dans un train pour Lang Son, près de la frontière chinoise. Alors qu'il se dirige vers la frontière par des sentiers, il est capturé le 9 janvier 1942 par une patrouille de Bang Trang qui le conduisent au poste de Dong Dang. Il est incarcéré à Langson, après avoir réussi à faire disparaître les documents.
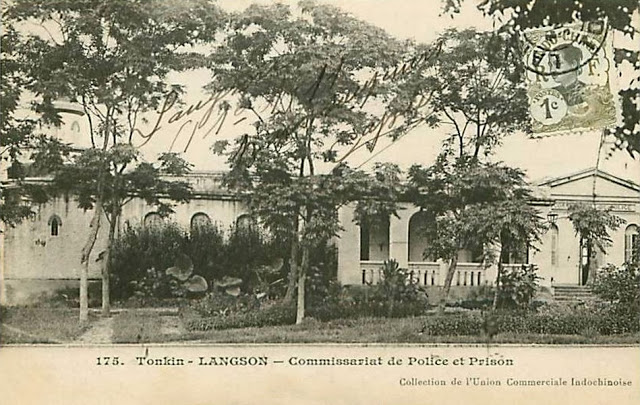
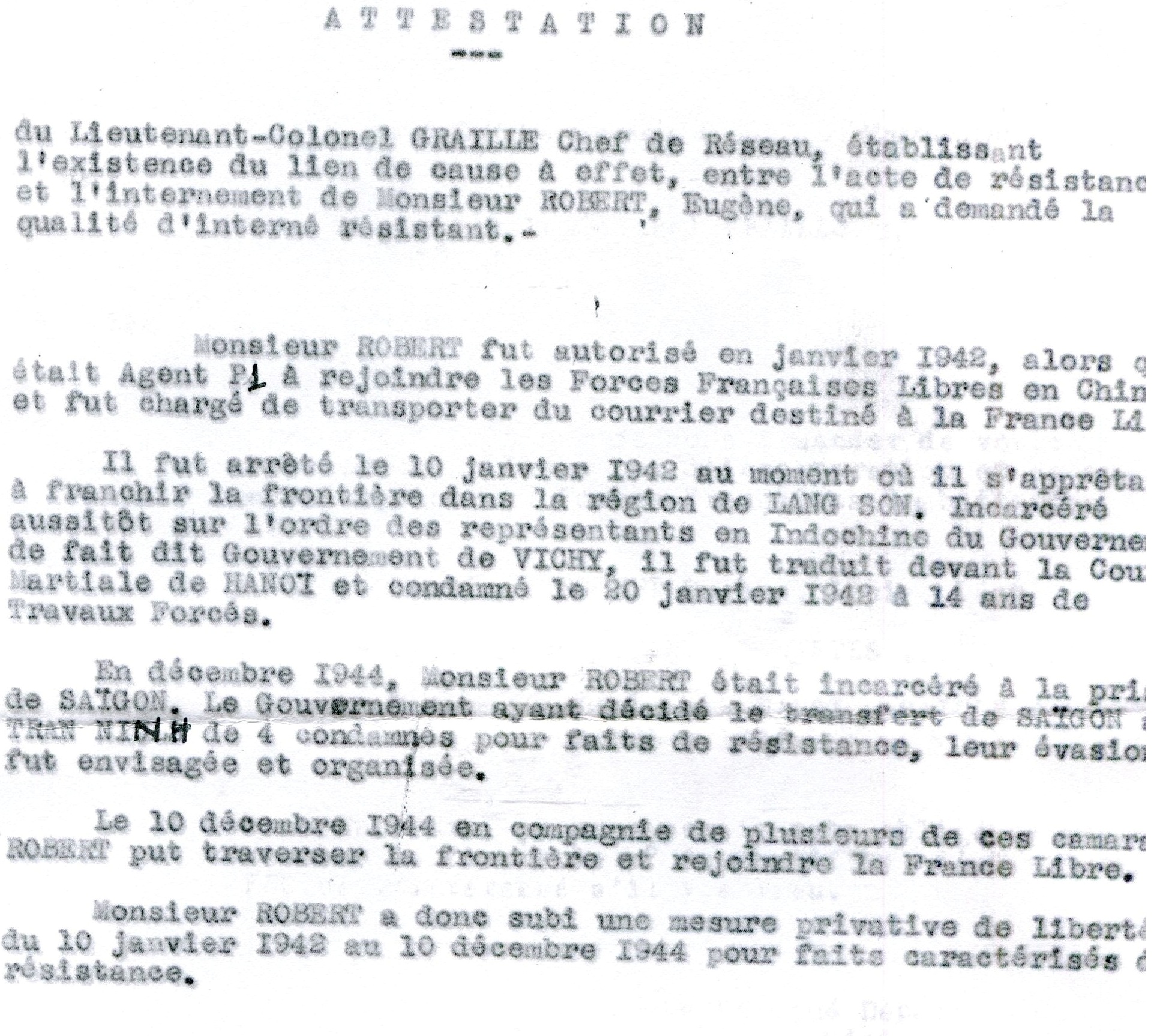
.
Prisonnier gaulliste aux mains de l'Etat Français en Indochine :
Le procès :
Traduit devant la cour martiale de Hanoï le 20 janvier, sur l’accusation d’« acte de nature à nuire à la Défense Nationale et avoir tenté de prendre du service dans une armée étrangère, avec franchissement de frontière » – et non de haute trahison, comme l’avait d’abord envisagé l’amiral Decoux -, il est jugé à huis clos, afin d’empêcher que les Japonais n’apprennent qu’ils sont espionnés par des officiers français, mais aussi parce que les juges ont reçu des instructions, afin que l’accusé ait la peine maximale. Seuls les médecins qui ont soigné sa dysenterie à Langson sont autorisés à témoigner, mais ils rendent compte de son état déplorable au moment de son arrestation, ce qui constitue une circonstance atténuante.
1er internement :
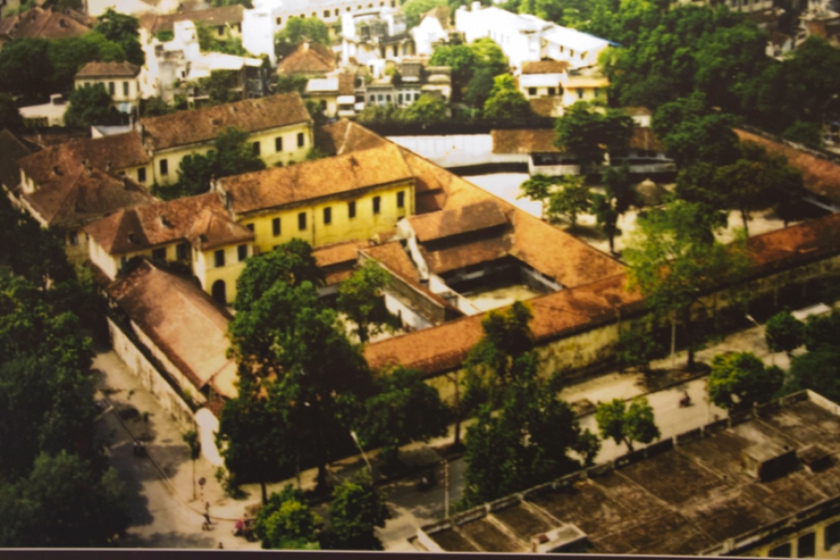
Condamné à 14 ans de travaux forcés, « plus les peines annexes, dont la confiscation des biens présents et à venir», Eugène ROBERT est emprisonné à la Maison Centrale de Hanoï, où il reçoit le n° 57 227 comme un droit commun, dans une cellule de 8×8 m, qu’il partage avec quatre Européens et dix Asiatiques, autour d’un seau hygiénique et une cruche d’eau, dans la saleté.
Les promenades [ont] lieu le matin, dans une cour carrée de 10 mètres de côté dont les murs hauts de 6 mètres [sont] peints en noir : 25 détenus y [évoluent] ». Puis il est déplacé dans la cellule n° 4 et fait la connaissance d’autres prisonniers gaullistes, parmi lesquels William Labussière, le sergent métis Emile Greiveldinger (condamné à deux ans le 1er septembre 1941) ou le docteur Georges Béchamp.
En août 1942, le nouveau directeur interdit, sous peine de sanctions, au capitaine Guiol, adjoint de Maupin au BSM de Hanoï, de continuer ses visites à ROBERT sous prétexte de « nécessités de service ». Ces menaces à l’égard des visiteurs se poursuivent jusqu’à la fin de 1944. Ainsi, en janvier 1944, le contrôleur Kerneis est mis en disponibilité pour avoir rendu visite à son compatriote ROBERT.
En septembre 1942, l’inspecteur des affaires politiques Del, lors d’une visite des installations de la prison, décide de faire remplacer le grillage, en haut de la porte de la cellule, qui permettait une relative aération, par une plaque de tôle pleine et sépare le groupe des gaullistes en deux : ROBERT reste avec Greiveldinger, tandis que le lieutenant Richard et Pierre BOULLE sont mis au secret.
Profitant de ce que Greiveldinger, libérable sous peu, est autorisé à se rendre en ville, sous bonne garde, pour y recevoir des soins dentaires, ROBERT met au point, avec son aide, un plan d’évasion.
La première évasion :
Le 12 janvier 1943, à 6 heures 30, lors de son quart d’heure de promenade, il dresse un échafaudage avec deux bancs laissés dans la cour pour y prendre les repas, grimpe dessus et saisit un tuyau, à six mètres du sol. Parvenu grâce à lui sur le toit du bâtiment principal, il passe dans la cour du gardien-chef, puis, par son escalier et sa terrasse, atteint un autre toit, d’où il descend par les grilles défendant les fenêtres des appartements des gardiens. Après un rétablissement sur le mât du pavillon au-dessus du porche d’entrée, il se laisse tomber de quatre mètres dans la rue, entre le gardien et la sentinelle, s’enfuit en direction du Palais de Justice avant qu’ils aient pu réagir et se cache dans un confessionnal, dans la cathédrale. Le tout en une demi-heure.
Pendant ce temps, l’alerte a été donnée. Un quart d’heure après, des patrouilles armées parcourent les rues, des barrages ont été installés, avec des mitrailleuses en batterie, les voitures sont arrêtées et fouillées, les hôtels et les domiciles de personnes fichées par la Sûreté visités, de même que les bordels européens et tonkinois, qui sont des endroits discrets où se cacher.
Retranché sur le toit de la cathédrale, ROBERT attend la nuit pour chercher un refuge. Le soir venu, quand le bedeau monte sonner les cloches pour la dernière fois de la journée, il se faufile à l’extérieur et se dirige vers la rue Duvilliers, où demeure l’adjudant Fauvel, sur l’aide duquel il sait pouvoir compter. Ce dernier a déménagé, mais ROBERT obtient sa nouvelle adresse, rue des Vermicelles. Quand il le retrouve, il l’envoie prévenir le lieutenant-colonel Despeaux, chez qui il pense trouver de l’aide, avant de rejoindre le domicile puis la cache promise par son contact à l’extérieur, Orsini.
Toutefois, Despeaux a lui aussi déménagé, et c’est le lieutenant-colonel d’artillerie Pig, fidèle maréchaliste, qui reçoit la confidence de Fauvel et prévient l’état-major. Pendant ce temps, contact est pris avec Orsini, qui accepte de le cacher, avant de l’aider à passer en Chine.
Toutefois, le lendemain matin, la Sûreté, prévenue suite à la dénonciation de Pig, arrête ROBERT et le couple Fauvel, puis Orsini et Despeaux. Les époux Fauvel seront condamnés à six mois de prison. Quant aux Orsini, faute de preuve, ils seront internés administrativement.
Au cours de leur enquête, les autorités tentent d’établir l’existence d’un « complot gaulliste » ; mais, devant le mutisme de ROBERT, qui résiste à dix heures d’interrogatoire ininterrompu, ils doivent abandonner. Il est finalement reconduit à la maison centrale.
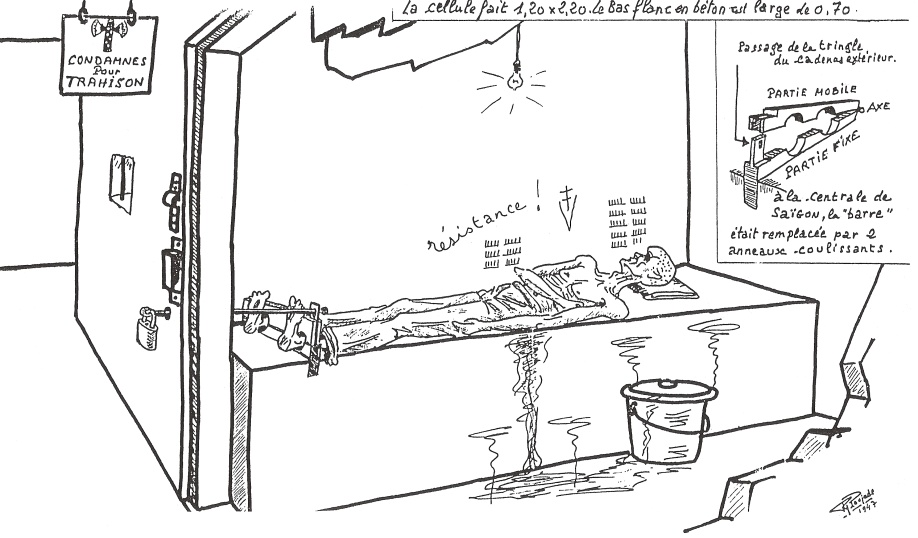
Le nouvel internment :
On l’enferme pendant 60 jours dans une cellule de 2,20 m. de long et 1,50 m. de large, allongé sur le béton, les chevilles fixées au bat-flanc, sous la surveillance permanente d’un garde, aussi permanente que la lumière au plafond. On l’appelle la « barre d’Indochine ». A l’origine, on y enfermait les Indochinois condamnés à mort la veille de leur exécution. Un seau hygiénique est déposé dans la ruelle du bat-flanc pour les besoins naturels. Tous les matins, un nettoyage au jet d’eau rince la geôle et le prisonnier. Au repas, un quart de riz et un morceau de pain de maïs.
En février 1943, l’amiral Decoux fait isoler en cellules spéciales les condamnés pour « trahison », les gaullistes devant être transférés dans les locaux disciplinaires de la prison. Vêtus d’un bourgeron gris de bagnard, ils n’ont droit qu’à deux sorties d’un quart d’heure chacune par jour. Fin mars 1943, ROBERT se voit infliger un mois de cachot supplémentaire pour s’être plaint de n’avoir pas reçu sa ration journalière de nourriture.
Le transfert vers Saïgon :

Enfin, le 17 mars 1943, le gouverneur général prend la décision de transférer les prisonniers gaullistes à Saïgon, loin de la frontière chinoise, pour éviter toute nouvelle tentative d’évasion. Le soir du jeudi 1er avril, ROBERT est ainsi extrait de sa cellule, alors qu’il souffre toujours de dysenterie, et conduit en train, enchaîné, jusqu’à la Maison Centrale de Saïgon, où il arrive quarante-deux heures plus tard. On l’enferme dans la salle 8, réservée aux détenus récalcitrants. Les derniers « dissidents » de la maison centrale de Hanoï sont transférés à Saigon en juin 1943.
En novembre 1943, BOULLE, Huchet, Labussière, Richard et ROBERT sont placés en isolement dans le « bâtiment S » pour « contrecarrer la propagande gaulliste » parmi les autres détenus. A la fin du mois, convoqué à la Sûreté pour une affaire d’identité judiciaire, Labussière tente de s’évader avec l’aide de ROBERT, mais il est rapidement repris et condamné à 60 jours de fers au cachot.
En avril 1944, suite à l’intervention d’amis auprès de fonctionnaires du ministère à Vichy, afin qu’il bénéficie de conditions plus humaines, l’amiral Decoux adresse au gouverneur de Cochinchine une note l’interrogeant sur l’état de ROBERT. A partir de cette date, le comportement de l’administration pénitentiaire à l’égard des gaullistes s’infléchit. ROBERT obtient ainsi le 10 juin 1944 l’autorisation d’être hospitalisé.
La seconde évasion :
Pendant ce temps, à Hanoï, les réseaux du capitaine Marcel MINGANT et d’André LAN préparent une évasion collective, en liaison avec leurs correspondants à Saïgon. A la fin de 1944, Lan se rend à Saïgon avec Tastagnière, du commissariat de la gare de la ville, pour les informer des grandes lignes du projet : l’évasion de l’ensemble des gaullistes doit avoir lieu lors d’un « transfert de sécurité » qu’ils vont eux-mêmes provoquer. C’est ainsi que l’amiral Decoux, par ailleurs complètement ignorant du complot, ordonne le transfert de Pierre Boulle, Eugène Robert et William Labussière dans la prison de Tran Ninh (actuel Xieng Khouang-Laos), par crainte d’un débarquement américain ou britannique en Cochinchine. Chargé du transfert, le commissaire Tastagnière se voit confier la composition de l’escorte et le voyage en chemin de fer.
Le 28 novembre, l’inspecteur de la Sûreté Bréat, adjoint de Tastagnière, vient prendre les détenus, avec les gendarmes Massac et Moustier, et les conduit en train jusqu’à Hué, où ils sont pris en charge par l’inspecteur Vanderbrouck, venu d’Hanoï, qui ignore tout du complot.
Suite aux bombardements alliés, la voie est endommagée, et les voyageurs doivent effectuer plusieurs transbordements avant Vinh, où ils arrivent le 30 novembre, en fin de matinée. Là, reçus par un inspecteur de la garde indochinoise, ils apprennent que des pluies torrentielles ont ravagé la route et que 17 ponts ont été détruits. L’ingénieur des travaux publics chargé des réparations appartient à l’équipe Mingant-Lan et fait son possible pour empêcher l’arrivée des prisonniers à leur prison. Logés par le résident dans un hôtel de Cua Lo, une station balnéaire à une vingtaine de kilomètres de Vinh, ceux-ci commencent à s’impatienter et écrivent aux instigateurs du projet d’évasion.
Quand il apprend leur situation, qu’il croyait réglée depuis longtemps, André LAN se rend avec deux amis, Dassier et Tisserand, en auto à Vinh où il organise la fuite des prisonniers. Profitant du sommeil de l’inspecteur Vanderbrouck, Labussière et ROBERT embarquent avec les gendarmes à bord de la 11 Citroën de Dassier, Boulle et Tisserand dans le cabriolet de LAN.
Après le passage de plusieurs bacs, sous le contrôle de postes de la Garde indochinoise, qui se contentent de relever les numéros des plaques d’immatriculation (faux), les deux véhicules parviennent vers huit heures du matin à Hanoï, où les fugitifs sont cachés, avant que l’alerte ne soit donnée. Pendant ce temps, les deux gendarmes de l’escorte se présentent à l’état-major pour rendre compte de l’évasion des « prisonniers gaullistes ». Félicités par le lieutenant-colonel Cavalin, ils ne se voient pas moins infliger une peine de soixante jours d’arrêt, « pour la vraisemblance ».
Le 4 décembre, Labussière et ROBERT parviennent à échapper de justesse à six inspecteurs de la Sûreté, qui avaient trouvé la maison où ils étaient cachés, et trouvent refuge dans les locaux du BSM, auprès du capitaine Levain. Ils apprendront plus tard qu’en fait, ces inspecteurs avaient été envoyés, à la suite d’une dénonciation, par le chef de la Sûreté, Arnoux, qui se proposait de les faire passer lui-même en Chine pour donner des gages de résistance.
L’arrivée clandestine du commandant de Langlade, délégué pour l’Extrême-Orient du Gouvernement Provisoire de la République Française,GPRF permet de débloquer la situation. Apprenant sa présence au BSM, Mingant l’informe de la présence de Pierre Boulle, qui avait été son adjoint en Malaisie en 1940-1941, et des autres fugitifs à Hanoï.
Pierre Boulle quitte Hanoï pour le Laos à bord d’un avion ambulance. Puis un avion anglais le dirige le 8 décembre vers Kunming, d’où il rejoint Calcutta, siège du quartier général de la France Libre.
Le retour en Europe
Quant à ses compagnons, conduits sur le terrain de Xieng Khouang,(aéroport de Phonsavan au Laos) ils s’envolent le 13 décembre à bord d’un avion Douglas C-47 Skytrain, surnomé "Dakota", et atterrissent à Yunnan Fou (aujhourd'hui Kumming, Capitale du Yunnan en Chine) . Le lendemain, ils repartent eux aussi vers Calcutta.
Labussière est affecté à la mission française en Chine.
De son côté, ROBERT quitte l’Inde le 5 janvier 1945 pour Londres puis, de là, Paris, où il arrive le 21 janvier.
Il rentre revoir sa famille dans la Nièvre qu'il avait quitté en février 1941. En décembre 1945, alors que la France se remet difficilement de ces années de guerre, Mme ROBERT, née Audiat décède lors de l'accouchement de 2 jumelles.
Il devient membre de l’Assemblée consultative comme représentant de la résistance en Indochine.
En 1946, il est nommé Trésorier Payeur en Guyane puis il est muté aux Etablissements des Indes en 1948 puis au Niger et au Mali.
Le retour à Séné :
Le 28 juin 1952 il s'est remarié à Paris XVIII°, avec Roberte Yvette GOUBERT GAEBELE. Il revient en France en 1960 après l'indépendance des Colonies et il fait valoir ses droits à la retraite.
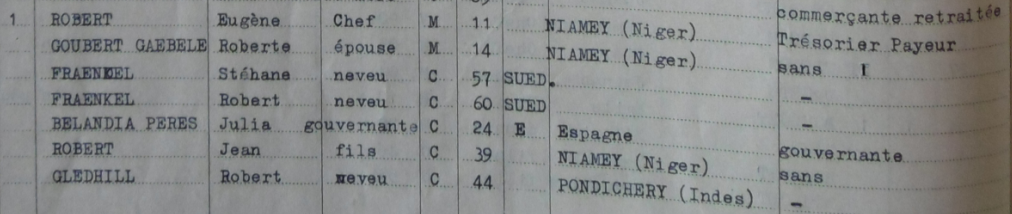
Au recencement de 1962, il apparait avec son épouse, son fils Jean Louis, (sa fille Françoise ést étudiante à Rennes) et des proches. La famille occupe alors la masion familiale à l'entrée du village de Moustérian.

Pour ces 90 ans, un article lui est consacré dans le bulletin munipal. Il décède à Vannes le 14 juin 2003. Il est inhumé à Séné. Eugène ROBERT était Officier de la Légion d'Honneur.
ENIZAN, déportés,1945
Un cimetière est bien un lieu d'histoire. Quelque fois, une pierre tombale comporte quelques mots à la mémoire du défunt. Plus rarement, la pierre tombale renvoit à une histoire passée qui va au délà de la famille pour toucher la communauté entière de Séné.
Tel est le cas de la tombe de la famille LE DRESSAY où figure deux plaques avec des inscriptions.

La première se lit encore sans difficulté dans le gris de la pierre :
Marie Anne LE DRESSAY épouse ENIZAN 1886 -1966.
La seconde est plus altérée par la pluie et les années. Il faut la lumière rasante d'un soleil automnal pour parvenir à déchiffrer l'inscription sur deux colonnes :
Lieutenant Louis ENIZAN, mort pour la France le 1-4-1945 à Mauthausen (AUTRICHE) à l'âge de 19 ans, Mort pour la France,
Lieutenenant Anne Marie ENIZAN épouse CORMERAIS le 15-3-1945 à Ravensbruck à l'âge de 23 ans
Lieutenant Alfred CORMERAIS le 6-4-1945 à Buchenwald à l'âge de 26 ans.
On comprend vite le destin tragique de la famille ENIZAN qui a perdu deux de ses enfants et un gendre en déportation. On est saisi au coeur en lisant que les jeunes mariés Anne Marie et Alfred sont morts à quelques jours d'intervale, dans un camp de concentration allemand.
Qui étaient ces 3 lieutenants de la Résistance française et quel fut leur destin respectif ?
Le dénombrement de 1906, nous indique que Marie Anne LE DRESSAY [19/07/1886-12/12/1966] vivait à Moustérian. On lit que son futur mari n'est autre que le domestique de la famille, Isidore ENIZAN, natif de Gourin [3/08/1885-9/02/1968 Nantes].
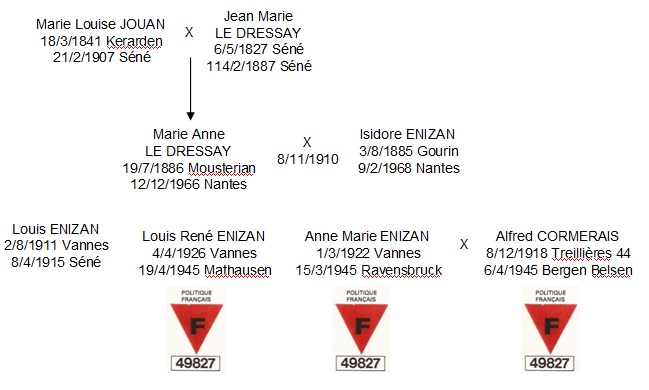
La fiche de matricule de Isidore ENIZAN nous dit qu'il était enfant assisté. C'est encore une exemple d'accueil par une famille de Séné d'enfant orphelin, comme il y avait souvent avant guerre. Son acte de naissance nous précise que sa mère mendiante le met au monde de père inconnu.
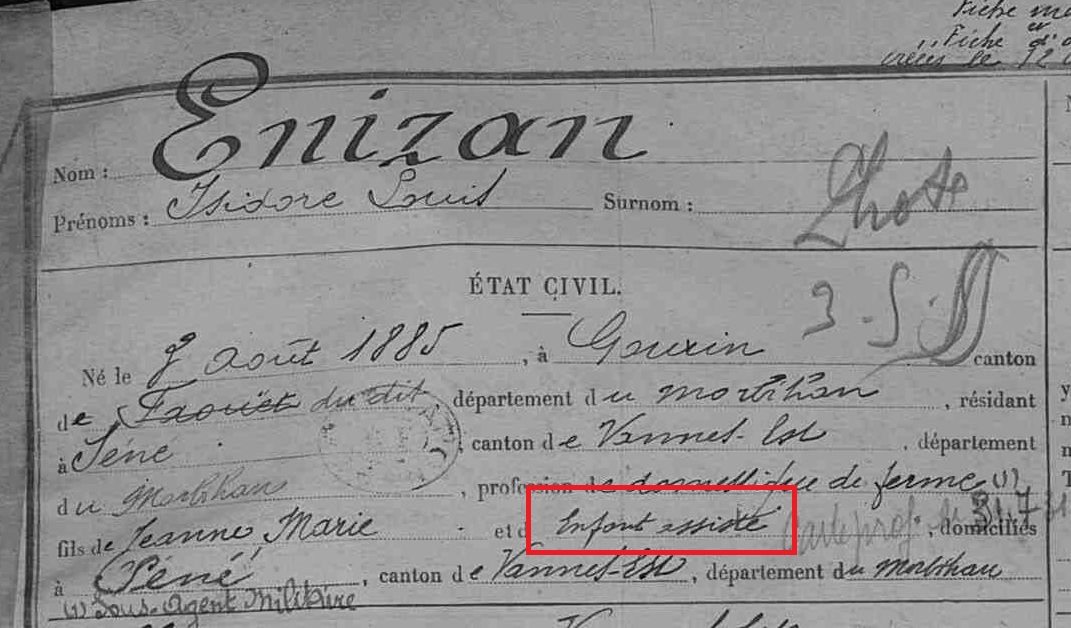
Après son retour de la conscription, les jeunes fiancés se marient à Séné le 8/11/1910. Isidore ENIZAN est sous-officier au 116° Régiment d'Infanterie de Vannes et Marie Anne LE DRESSAY est cultivatrice à la ferme familiale à Moustérian.
Leur premier garçon Louis ENIZAN [2/08/1911 Vannes- 8/4/1915 Séné] décède pendant la guerre, son père étant au front. Le jeune couple avait quitté Séné avant guerre. Cependant, Marie Anne ENIZAN, née Le Dressay, est revenu vivre au bourg où leur premier enfant est inhumé le 8/04/1915.
Lors de la mobilisation, Isidore ENIZAN sera affecté au 316°Régiment d'Infanterie. Sa fiche de matricule nous dit que lors des combats de l'Ourcq dans la Marne, il sera porté disparu. Il est fait prisonnier et rentrera dans les foyers en avril 1919.
Après guerre le couple est établi à Vannes rue Madame Lagarde comme le prouve la naissance de leur premier enfant, Anne Marie née le 1/03/1922. Isidore ENIZAN est voyageur de commerce rue de Closmadeuc, lorsque nait son garcçon, Louis Renée le 4/04/1926.
Le site Internet "Mémoire des Hommes" accorde la mention de "Mort pour la France" à Louis ENIZAN,, lieutenant dans les FFI. Anne Marie ENIZAN s'est vu accordé la mention «Mort en déportation» par arrêté du secrétaire d'État aux anciens combattants en date du 12 novembre 1987.
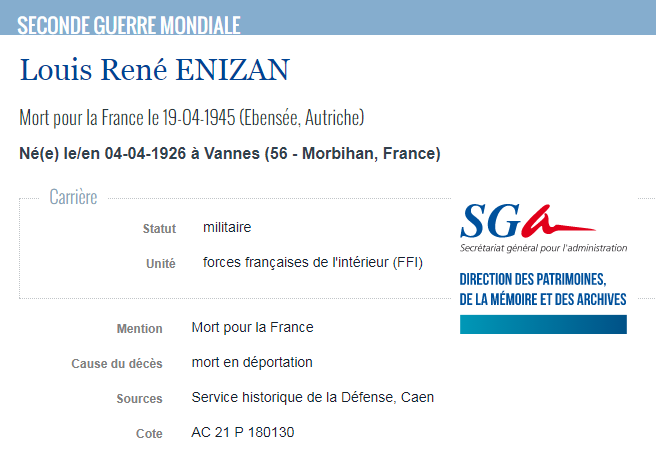
A l'âge de 19 ans, Louis René ENIZAN a rejoint les Forces Française de l'Intérieur, la résistance combattante. Son dossier 16P 209801,consultable au SHD de Vincennes, nous précise son parcours de résistant jusqu'à son arrestation.
Louis René EIZAN, jeune apprenti patriote:
On y apprend qu'il rejoint l'Armée des Volontaires à Nantes. Il est arrêté 3 fois par la police française sur ordre de la Gestapo.
Louis René ENIZAN jeune résistant:
Toute en exerçant son apprentissage de boucher, il recrutait le plus possible de résistants (il en aurait recruté au moins une centaine d'après des renseignements recueillis auprès du Lieutenennt Colonel Souva, l'un de ses chefs. D'autre part, il quitta son métier de boucher à Angers pendant deux mois pour se mettre à la disposiiton de M. Dequaille à la surveillance des voies ferrées ou plutôt pour le ssaboter le cas échéant. M. Desquailles est aujourd'hui lieutenant au CSM de Nantes.
Sur Angers il opère ses actions dans la résistance avec sa soeur et son beau-frères. Passé au Bureau des Opérations Aériennes (BOA) fin novembre 1943, il participe à des parachutage d'armes et de munitions dans le Maine et Loire.
Traqué, il est arrêté à Saint Saturnin (Maine et Loire) le 18/2/1944 à 3 heures du matin par la Gestapo. Incarcéré à la prison à Angers puis à Compiègne; le 10 mars 1944. ENIZAN Louis, est déporté de Compiègne le 6 avril 1944 vers le Kl Mauthausen. (Matricule: 62372) puis transféré à Melk, puis Ebensee où il décède le 19 avril 1945.
Louis René ENIZAN, déporté à 22 ans:
"La ville de Melk se trouve en Basse-Autriche. Le 21 avril 1944, arrivent 500 des 10000 détenus qui travaillent au projet ""Quartz"", c'est-à-dire à la construction d'une usine souterraine de roulements à billes pour la firme Steyr, Daimler et Puch. Si l'usine est pratiquement achevée, elle ne produit jamais un seul roulement à billes. Le 15 avril marque la fin de l'évacuation de ce Kommando vers Mauthausen ou Ebensee.
Le camp de concentration d'Ebensee, en Autriche, fut une annexe du camp de concentration de Mauthausen. Ouvert le 18 novembre 1943 et libéré le 6 mai 1945, il est situé à l'extrémité sud du lac Traun à environ 75 km au sud-ouest de la ville de Linz.

Déportés transportant des corps trouvés au moment de la libération du camp d 'Ebensee
Anne Marie ENIZAN, sa soeur ainée, née le 01/03/1922 à Vannes déclare la profession d'employée de bureau quand elle épouse à Légé (Loire-Atlantique) le 23/4/1942, Alfred CORMERAIS [8/12/1918-6/4/1945], boucher de son métier, comme son beau-frère.
Le parcours de résistant de Anne-Marie ENIZAN se confond avec celui de son mari Alfred CORMERAIS et de frère, tant les trois jeunes patriotes oeuvraient ensemble dans la clandestinité.
Le groupe de résistant s'établit à Angers, au 6 rue Denfert-Rochereau. Le 1er février 1943, Anne Marie ENIZAN, épouse CORMERAIS, accouche d'un garçon nommé Alain. Le 1er février 1944, la Gestapo voulu l'arrêter à son domicile mais prévenue par son frère, ils réussirent à s'échapper et se réfugièrent à Origné, commune de Saint Saturnin sur Loire, à une vingtaine de km d'Angers où ils se cachent chez M. Hector Léon DUFLOT [15/09/1881 Chaumont sur Loire - 17/08/1944 Alkoven-Autriche] avec son enfant. DUFLOT, les époux CORMERAIS, ENIZAN seront finalement arrêtés le 18 février à 3 heures du matin avec Mlle BINIO. A son arrestation la Gestapo confie l'enfant à une sage-femme qui reste toutefois à disposition de la Gestapo. [rechercher le parcours de l'orpheilin Alfred Cormerais]. Le 7 mars elle quitte la prison d'Angers pour le fort de Romainville puis fin mars pour l'Allemagne. Sur les cinq personnes arrêtés, quatre décèderont en déportation, seule Mlle BINIO de Nantes reviendra.
Elle sera déportée à Ravensbrück le 30 mars 1944, et décédera dans ce camp le 15 mars 1945, elle avait 23 ans. Son mari, subira le même destin tragique.

Femme au travail dans le camp de Ravensbruck
Ravensbrück est le nom de l'ancienne commune d'Allemagne située à 80 km au nord de Berlin dans laquelle le régime nazi établit de 1939 à 1945 un camp de concentration spécialement réservé aux femmes et dans lequel vécurent aussi des enfants.
Le camp est construit sur les bords du lac Schwedtsee (en), en face de la ville de Fürstenberg/Havel dont il fait partie depuis 1950, dans une zone de dunes et de marécages du Nord du Brandebourg.
Succédant en 1939 au camp de Lichtenburg, il devient rapidement le centre de détention de femmes le plus important du pays : au moins 132 000 femmes et enfants y sont déportés, dont 90 000 sont ensuite assassinés. Le camp fournit en main-d'œuvre féminine l'ensemble des industries d'armement allemandes et les mines de sel, sur place ou au sein de l'une des 70 antennes disséminées de la mer Baltique à la Bavière. Les détenues proviennent de tous les pays d'Europe occupés par l'Allemagne, le plus grand groupe national étant composé de Polonaises.
À partir d'avril 1941, des hommes y sont également détenus, mais dans un camp annexe.
Un livre mentionne le nom de Anne marie CORMERAIS.
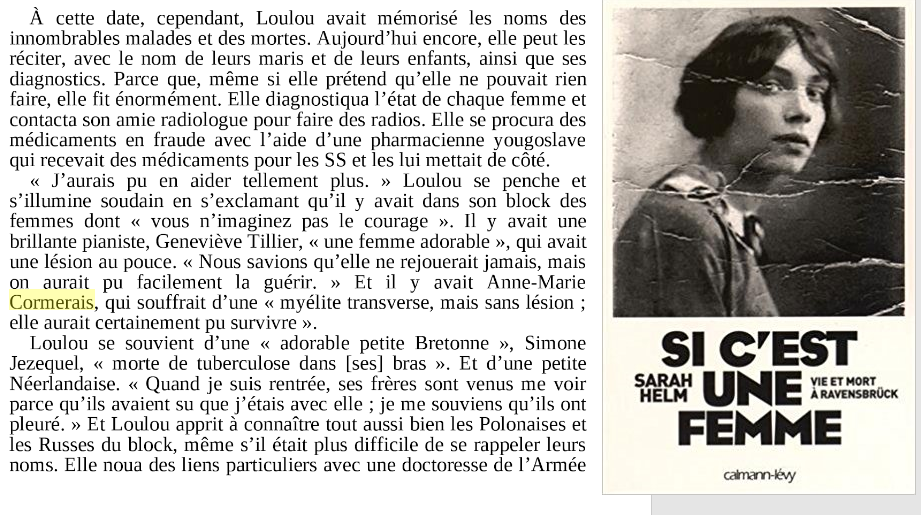
Dans le dossier consulté au SHD de Vincenne, le témoignange du docteur Zimmet, qui prisonnier, était au contre son gré service des nazis:
Dr P. don Zimmet 19 rue Babuty Annemasse Haute-Savoie
Génève le 26 août 1945
Cher Monsieur
Mon amie et camarade de déportation, la Comtesse Y de la Rochefoucauld m’a transmis votre lettre adressée à Malmö.
Je m’excuse d’avoir tant tardé à vous répondre mais je suis tombée malade en arrivant de Suède à Paris et je viens seulement de rentrer chez moi.
J’ai très bien connue votre fille, Anne Marie CORMERAIS. Je l’avais vue à Romainville, puis je l’ai retrouvée à Ravensbrück. C’était une très gentille camarade dévouée pour les amies et nous parlant souvent avec émotion d’un très jeune enfant qu’elle avait dû laisser tout petit à la maison.
Elle était au block 32, le block des N.N. et des condamnés à mort. Elle était à la même table que moi. Elle avait été désignée pour aller travailler à l’usine Siemens (on y fabriquait des pièces détachées d’appareils de radio). Je l’ai un peu perdue de vue au mois d’octobre, car les personnes travaillant dans cette usine ont été changées de block. J’ai appris ensuite qu’elle était tombée malade, une congestion pulmonaire ou une pneumonie et qu’elle avait été transportée au block10, le block où l’on mettait les tuberculeux ou celles que l’on soupçonnait de tuberculose). Ensuite elle a dû avoir une myélite ou une radiculite car elle avait une incapacité partielle des deux jambes. Mais je pense que c’était une hypovitaminose avant tout.
Elle avait comme tout le monde beaucoup maigri, mais je ne pense pas qu’elle fût tuberculeuse. Le fait de se trouver au block 10 l’avait beaucoup frappée. Nous nous arrangions avec quelques autres camarades pour aller les réconforter et lui apporter parfois ce que nous pouvions avoir en cachette, légumes crus, lainages, chaussettes etc…
Mais ces brutes, à partir du moins de mars ont inauguré un système qui en cruauté dépasse tout ce que l’on n’a vu depuis des siècles : la destruction des malades et des boches inutiles. Un camion, donc le 3 mars, est venu chercher les malades du block 10 pour les emmener soi-disant dans un groupe de baraques situées à 500 mètres du camp. Mais hélas ce n’était pas à un hôpital ou à une infirmerie qu’on les emmenait mais à la chambre à gaz. Cher monsieur, je pleure en vous écrivant ces mots, vous qui êtes déjà si éprouvé. La petite Anne Marie a été emmenée avec le premier convoi.
Mais je puis affirmer, Monsieur, qu’elle ne se doutait pas qu’on allait la gazer. Elle n’a donc pas eu l’appréhension en étant embarque puisqu’elle croyait qu’elle allait dans une autre baraque.
Si ces camarades avaient su, comme nous l’avons appris par la suite, la destination que prenaient ces convois de malades, nous aurions pu peut-être la faire fuir et la camouflet jusqu’à la libération. Mais nous ignorions de raffinement.
Depuis ce jour du 3 mars ou environ 800-1000 personnes malades et femmes à chevaux blanc furent gazées. Tous les 3 jours environ, un contingent partait pour ce fameux camp appelé par les Boches Jugend-lager, camp de jeunesse.
Je vous devais la vérité cher monsieur. Je n’ai pas eu l’occasion de soigner officiellement la petite Anne Marie car les Allemands avaient utilisé mes connaissances en m’employant comme chiffonnière et débardeur. Mais je m’en étais clandestinement occupé et lui avait fait passer quelques médicament que j’avais volé dans les wagons que je déchargeais.
Je pense, cher monsieur, que vous avez fait inscrire le petit orphelin, de mon côté si vous voulez bien m’envoyer son identité, l’identité de ses père et mère, leur date d’arrestation et de déportation, je pourrais lors d’un prochain voyage à Paris le signaler à notre association. Donnez-moi je vous prie des nouvelles de vous-même et de l’enfant. Sa photo si possible.
En souvenir de ma petite camarade Anne Marie permettez-moi, Monsieur, que je vous embrasse tristement de tout mon cœur.
Dr P. don Zimmet.
Alfred Louis Marie CORMERAIS, est né le 08/12/1918 à Treillières (Loire-Inférieure). Il est pupille de la Nation. Il est boucher de métier. Il est mobilisé puis fait prisonnier. Il est rappatrié en 1941 pour raison de santé souffrant d'un ulcère à l'estomac. Il a épousé Anne Marie ENIZAN à Légé (44) le 23/04/1942. Il rejoint le réseau Libération Nord puis après le déparquement rejoint les FFI. Il est arrêté le 17 ou18 février 1944 par la Gestapo de retour de mission de Nantes sans que l'on sache le lieu excat. . Il est interné à la prison d'Angers puis il est déporté le 12 mai 1944 de Compiègne vers le KL Buchenwald. (Matricule: 51565). Il sera transféré ensuite dans les camps de Dora Komando de Dora Block 130. Il décède dans le train qui le mène au campt de Bergen-Belsen le 6 avril 1945. Il est présumé inhumé près de la gare de Buchlotz (Hanovre). Son nom a été ajouté au monument le 11/11/2013 au monument de Buchenwald.
Bergen-Belsen, parfois appelé Belsen, était un camp de concentration nazi situé au sud-ouest de la ville de Bergen, près de la localité de Belsen, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Celle, en Basse-Saxe (Allemagne), dans la lande de Lunebourg. Il a été ouvert en 1940 pour interner les prisonniers de guerre français et belges mais a accueilli à partir de l'été 1941 plus de 20 000 prisonniers soviétiques.
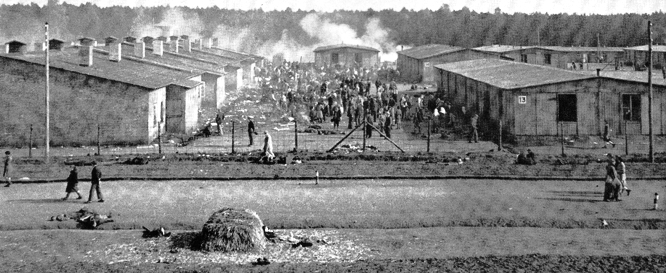
EPILOGUE:
L'acte de naissance de Marie Anne LE DRESSAY comporte la mention marginale de son décès à Nantes le 12/12/1966. La plaque mortuaire sur la tombe au cimetière indique que son inhumation eut lieu à Séné, son village natal.[à vérifier]
La plaque portant inscription du nom de ses enfants et de son gendre sur sa tombe symbolise la réunion posthume d'une famille meurtrie par la barbarie nazie.
NB ; D'autres Sinagots furent déportés mais seront libérés, ils s'appelaient LE RAY, SEVENO ou LE ROI.
39-45 : Combattre pour libérer la France : 3/3
SECONDE GUERRE MONDIALE : Combattre pour libérer la France 1942-45
Après l'Appel du Général de Gaulle, des Français et des Sinagots ont choisit de continuer à combattre le régime nazi.
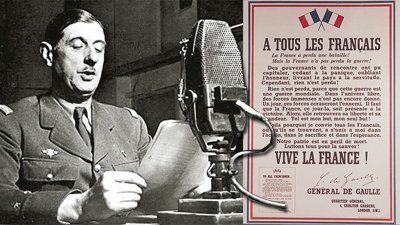
Qui étaient-ils et dans quelles circonstances ont-il payé de leur vie leur combat pour notre Liberté ?
Patern LESCOUBLET [3/06/1920 - 26/03/1943] des Forces Navales de la France Libre
Jean Marie Joseph GILLET [7/05/1909 - 8/12/1943] des Forces Navales de la France Libre
Roger Edouard LE GREGAM [10/01/1923-18/07/1944] et Jean Fortuné Louis LE GREGAM [7/02/1916-18/07/1944] des Forces Françaises de l'Intérieur. Lire article dédié aux frères LE GREGAM.
Marcel Joseph CROLAS [26/05/1923 - 8/11/1944] des Forces Aériennes de la France Libre.
Pierre Marie JOLLIVET [30/1/1905 Séné - 4/7/1945 Saïgon] Sinagot "Mort pour la France"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patern LESCOUBLET [3/06/1920 - 26/03/1943] des Forces Navales de la France Libre
Il faut être attentif en feuilletant les registres d'état civil en mairie de Séné.
On lit que Patern LESCOUBLET né le 3 juin 1920 à Vannes était domicilié à la Croix Neuve avant la guerre. On apprend qu'il était quatier maître chauffeur de 2° classe à bord du bateau SERGENT GOUARN et qu'il décéda à bord le 26 mars 1943. On note la mention "Mort pour la France".
L'acte est dressé à Casablanca. On pense alors à un navire des Forces Navales de la France Libre.

On recherche sur les sites "Mémoire des Hommes " si le marin est bien répertorié. Oui, il est bien "Mort pur la France".
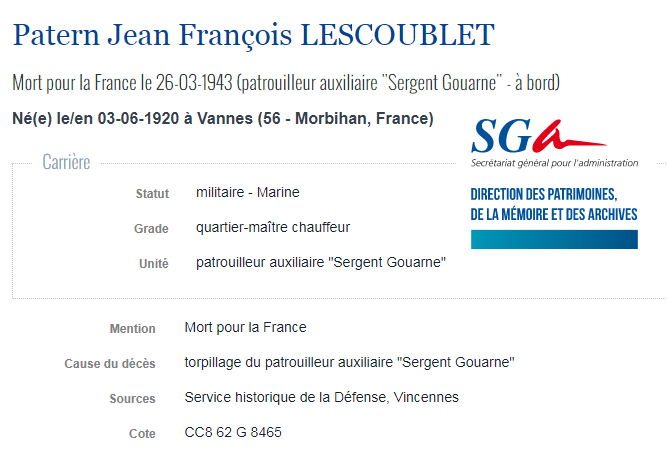
Le site MemorialGenWeb qui répertorie les noms des soldats portés sur des monuments aux morts précise les circonstances de sa disparition.
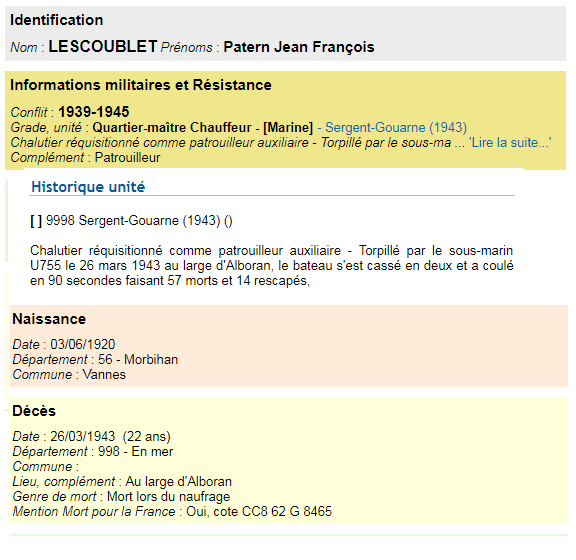
La marin ESCOUBLET est à bord du chalutier SERGENT GOUARN, réquisitionné à Fécamp en septembre 1939, et qui a rejoint les F.N.F.L au début de l'occupation. Le 26 mars 1943, alors qu'il participe à l'escorte d'un convoi d'Oran à Gibraltar, il est torpillé au large d'Alboran par le sous-marin nazi U755. Le bateau s'est cassé en deux et a coulé très rapidement faisant 57 morts et 14 rescapés.
Alboran est une petite île à mi-distance entre la côte méditerranéenne du Maroc et l'Espagne. Selon le rapport de Walter Göing commandant du sous-marin, il a torpillé le Sergent-Gouarne par 36.01N 02.29W, le bateau s'est cassé en deux et a coulé en 90 secondes. Le U 755 a lui-même été détruit par un avion anglais deux mois plus tard le 28 mai 1943.

L'U-755 sous le feu d'un Lockheed Hudson Mark V, le 28 mai 1943.
A Paimpol, un monument a été érigé à la mémoire des marins de la marine marchande des Forces Navales de la France Libre.

Jean Marie Joseph GILLET [7/05/1909 - 8/12/1943]
En novembre 1942, l'opération Torch est déclanché. Les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Les troupes françaises des colonies finissent par rejoindre la Gouvernement de De Gaulle. L'Algérie sert désormais de tête de pont à un futur débarquement en Italie et en Provence.
Après l"Armisitice, le PROTEE ne recevant aucun ordre, décide de rejoindre la force X à Alexandrie. Il reste longtemps immobilisé dans ce port, avec les autres bâtiments français qui s’y sont regroupés. Enfin, six mois après le débarquement allié en Afrique du Nord, la force X rallie les Forces navales françaises libres, FNFL.
Le 18 Décembre 1943, le sous-marin le PROTEE appareille d’Alger. Cette seconde mission au large des côtes de Provence fait partie des opérations préliminaires au débarquement des alliées dans le sud de la France qui aura lieu le 15 Août 1944.
La traversée Alger-côtes de Provence s’étant effectuée par gros temps, le Protée avait reconnu la côte quelque part entre Cassis et Toulon, puis, ayant déterminé sa position par observation périscopique des hauteurs, avait mis le cap sur Marseille et avait pénétré le champ de mines de Cassidaigne dont les services de renseignements alliés ignoraient l’existence.


Le Protée sous marin mission
Le 23 Décembre 1943, deux convois allemands font route sur Marseille.
Le premier est le convoi 5306 composé des péniches Tubingen, Wittenberg et Pouvoir, escortées par les dragueurs M6041, M6044, M6045 et M6047 qui a appareillé de La Ciotat à 9h00 (heure allemande) et arrive à Marseille à 12h25.
Le second est le 5308 qui vient de Gènes et comprend le paquebot Imérethie II et les pétroliers Foligno et Bitonto sous escorte des sous-marins allemands UJ 2208, UJ 2210, R 198, R 200 et R 212. Ce convoi entra à Marseille entre 13h10 et 13h40.
Le Protée, ayant perçu un de ses convois, aurait pénétré dans le champ de mines en chassant une position d’attaque.
Côté allemand, le sous-marin ne fut à aucun moment repéré et n’a pas été engagé par les navires de la 6ème Sicherung Flottille.
Pour mémoire, les secteurs ST (Camarat) et SU (Toulon) étaient occupés par le Curie et le Casabianca. Le 25 Décembre, un ordre radio d’Alger prescrivit au Casabianca de relever le Curie qui rentrait à la Maddalena et au Protée de relever le Casabianca devant Toulon.
Le 22 Décembre, le Casabianca coulait devant Toulon l’ UJ 6076 et le 27 Décembre toucha devant Camarat le Chisone qui put être ramené à Toulon. On retrouvera son épave dans un des grands bassins à la libération.
A bord du Protée, la Maitre Timonier, Jean Marie GILLET né à Séné le 7/05/1909 à Moustérian. Le dénombrement de 1921 nous donne la composition de sa famille. Son père était marin pêcheur comme sa mère Jeanne Marie LE GUIL. Il était le cousin de P'tit Jean, passeur à Barrarach. Son acte de naissance porte la mention marginale de son mariage le 2/04/1935 avec Marie Joséphine LE PORT.
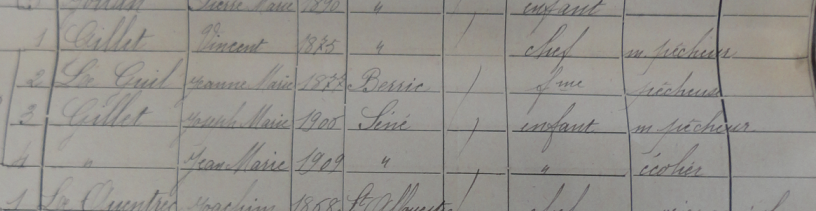
Jean Marie GILLET disparait dans l'explosion du sous-marin le Protée au large de Cassis en décembre 1943. Les autorités retiendront la date du départ d'Alger comme date officielle de son décès.
Une plongée effectuée par Henri Delauze à bord du Remora 2000 en 1995 a permis de localiser l'épave au large de Cassis sur la plateau des Blauquières à 130 m de profondeur et a confirmé la thèse avancée par la Marine américaine depuis les années 1950 de l'explosion d'une mine, aucun combat avec un sous-marin allié ne figurant dans les archives allemandes. L'épave e a été déclarée « sépulture maritime » par la Marine Nationale.

74 victimes dont 3 Britanniques
Cdt au 19.12.1943 : LV Georges MILLÉ
Etat Major : LV Frédéric. VIÉ - I.M Louis LAUBIE - EV René DUBOIS - EV Robert ETIENNE
Equipage : GILLET Jean - L’HERMITE Jean-Yves - VARLET Georges - CASE Jean - CUFF Pierre - LE FOLL Noël - LABBE Joseph - BURTEY René - RIOU Albert - CATHOU Roger - VILLALARD Frédéric - CAMENEN Joseph - GUENVER Victor - BRIANT Marcel - AUBERT René - PUJOLS André - JOUANJEAN Olivier - LE GOULM Henri - JAGOT Pierre - MARTIN André - BASSARD René - RAVARD - SEBIRE Pierre - LAGAT Jacques - BARBIER Jean - FORTUNY Michel - KERVAREC Mathieu - BUONO François - BULBER Etienne - NICOLAS Albert - PERON Jean-François - CURTET Gilbert - CECCALDI Pierre - JOUAN Auguste - FAROULT Raphaël - LECLEACH Eugène - GIRAULT Emile - QUILLIEN Joseph - PAPENHOFF Georges - JARDIN Pierre - KERLOCH Raymond - BOUVIER Louis - CHAPUIS René - BLANDAMOUR André - BARRES Georges - LEFEBVRE André - VOILLAT Robert - THEVENARD René - POIROT Séraphin - GUILLOU Ernest - LE DUC Joseph - SEILER Auguste - ROUSSEAU Robert - FRELIN André - BONJEAN André - BAZIN Pierre - LABORIE Maurice - ANDRE Louis - LE CHANTOUX Yves - LAMOTTE André - FAVALI André - MOURET Guy - MAGGIOTTI Paul - BARBREAU Marcel - MAURICE Paul - VIAUD Lucien -
Equipe de liaisons Britanniques : Lt Adrian N. DE WAEL - Acting leading signalman USHERWOOD John - Acting leading -télégraphist COLLIER Dennis -

Un monument en souvenir de l"équipage du Protée a été érigé à la Seyne sur mer où a été construit le sous-marin. Un Monument National des Sous-Mariniers a été inauguré à Toulon, le 28 novembre 2009


Marcel Joseph CROLAS [26/05/1923 - 8/11/1944]
Marcel Joseph CROLAS est né à Theix le 26 mai 1923, comme son père Maurice. La famille CROLAS déménage à Séné ou elle déclare l'activité de cultivateur à Kerhuileu au dénombrement de 1931. La famille emploie deux domestiques.
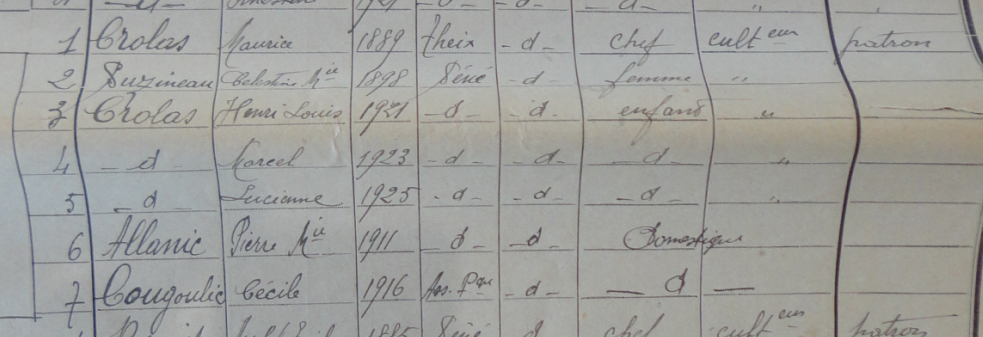
Quand l'Allemagne Nazie envahit la Pologne, la France puis l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Le jeune Marcel CROLAS n'a que 16 ans. Après l'Armisitice le 22 juin 1940, la Bretagne et Séné sont occupés par les troupes allemandes. Séné abrite même des soldats allemands.
Marcel CROLAS rejoindra De Gaulle en Angleterre et il incorpore le groupe de bombardement II/23 comme mécanicien.
Les escadrons français dans la Royal Air Force, compteront jusqu'à 3 500 Français, dans l'immense majorité des Forces aériennes françaises libres, FAFL. Il y avait le Groupe de bombardement lourd 2/23 Guyenne et le 346th Squadron formé tout deux sur bombardier modèle Halifax en 1944.



Le site "Mémoire des Hommes" indique que Marcel CROLAS décède le 8 novembre 1944 à Londer Borough "tué en service aérien commandé". L'acte de décès retranscrit à Séné donne quelques informations supplémentaires, notamment l'orthographe exacte du lieu du décès : Londesborough dans le Yorkshire.
Cette localisation permet de trouver la trace de l'accident d'avion survenu lors d'un exercice entre un bombardier Halifax et un chasseur Hurricane.
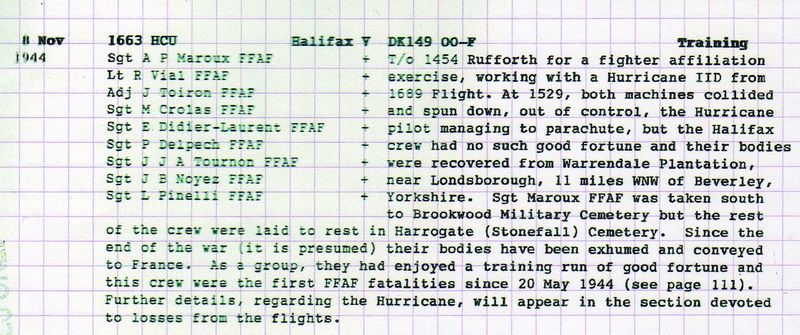
"Au cours de l’après-midi du 8/11/1944, l’équipage du bombardier Halifax DK149 de l’unité 1663 Heavy Conversion, décolla de Rufforth à 14H54 pour entreprendre un vol d’entraînement.
Le vol devait inclure un exercice simulant l’attaque d’un Hurricane contre le bombardier. Cet exercice avait pour but de tester la communication des membres de l’équipage entre eux afin de diriger le pilote pour qu'il prenne des mesures d'évitement.
Aussi les artilleurs tiraient à blanc sur le combattant pour simuler un avion ennemi qui les attaquait.
Au cours de l'exercice, le Hurricane a heurté le Halifax à 15 h 29, ce qui a fait perdre tout contrôle au bombardier.
Malheureusement, aucun des membres de l'équipage de Halifax n'a réussi à se dégager de l'avion avant de s'écraser dans un champ de la plantation de Warrendale, près du village de Londesborough, et tous ont été tués.
Les historiens de l'air Albert Pritchard, Eric Barton et Ken Reast ont localisé de petits fragments sur la surface du site de l'écrasement en 2001 avec l'autorisation du propriétaire, confirmant l'emplacement de l'accident.
Le Hurricane est devenu incontrôlable mais le pilote a réussi à s’éjecter de l’appareil et il a atterri en toute sécurité. L'accident fit 7 victimes :
Pilot - Sgt Alexandre P/R Mauroux FAFL (30972), aged 25. Buried Brookwood Cemetery, Surrey.
Navigator - Lt Robert M L Vial FAFL, aged 31. Initially buried Harrogate Stonefall Cemetery, Yorkshire. Burial location now believed to be in France.
Bomb Aimer - Adj Tustin E Toiron FAFL, aged 30. Initially buried Harrogate Stonefall Cemetery, Yorkshire. Burial location now believed to be in France.
Flight Engineer - Sgt Marcel J M Crolas FAFL, aged 21. Initially buried Harrogate Stonefall Cemetery, Yorkshire. Burial location now believed to be in France.
Wireless Operator / Air Gunner - Sgt Edouard Didier (or Sidier)-Laurent FAFL, aged 24. Initially buried Harrogate Stonefall Cemetery, Yorkshire. Burial location now believed to be in France.
Air Gunner - Sgt Pierre Fernand Delpech FAFL, aged 21. Buried Brookwood Cemetery, Surrey?
Air Gunner - Sgt Jacques J A Tournon FAFL, aged 23. Initially buried Harrogate Stonefall Cemetery, Yorkshire. Burial location now believed to be in France.
Passenger (mechanic) - Sgt Jean B Noyes FAFL, aged 25. Initially buried Harrogate Stonefall Cemetery, Yorkshire. Burial location now believed to be in France.
Nous sommes en novembre 1944, on peut penser que le flight Engeneer CROLAS a sans doute participé aux bombardements durant le D-Day le 6 juin 1944 où tous les bombardiers ont été mobilisés.
Selon son acte de décès, le jeune Sinagot, âgé de 21 ans, était domicilié en dernier lieu à Toulouse Francazal avant de partir pour Londres. Il a fait preuve de courage, d'un sens patriotique exemplaire et a perdu la vie pour nous rendre notre liberté.
Son coprs fut enterré au cimetière de Harrogate Stonefall puis transféré en France, sans précision.
[Vérifier si la tombe au cimetière de la famille CROLAS a acceuilli sa dépouille.]
Bien sûr d'autres Sinagots ont participé aux combats menant à la Libération de la France. Lire l'article sur les résistants "de l'armée de terre" et les résistant des FNFL.

Le Colonnel Bourgouin, commandant le 2° RCP- SAS entre dans Vannes libérée
La version de MATEL Robert 2/4
Deux Sinagots échappent à leur exécution, 1944 2/3
Dans le cadre de l'instruction à l'encontre de Léontine LE LYONDRE épouse LAFOURNIERE, pour les faits de "Dénonciation de Patriotes à l'ennenmi", Robert MATEL fut entendu par le juge LE STRAT, en tant que témoin, le 7 décembre 1944. Tel fut sa déposition qui faisait suite au procès verbal du 10/9/1944 devant la gendarmerie.
LE TEMOIN:
Robert MATEL [24/4/1918 Lorient- 17/11/1971 La Rochelle] devient orphelin à la suite du décès de son père Julien Marie MATEL [15/8/1894 Pluvigner - 5/12/1918 Lorient]. Son père, blessé pendant la guerre a été réformé courant 1917. De retour dans ses foyers, âgé de 26 ans il se marie [date?] avec Marie Louise COUGOULAT qui lors de la naissance de son fils, déclare ne pas savoir signer. A sa mort, son père n'est pas déclaré "Mort pour la France".
Sa mère, Marie Louise COUGOULAT [trouver ses dates] se retrouve veuve avec un enfant à charge. Après l'Armistice, la vie doit être très difficile pour cette jeune mère, sans doute sans réel métier [elle ne sait pas signer]. La famille ne semble pas pour autant avoir "fait parler d'elle" avant le début de la guerre 39-45. Ainsi, plusieurs articles de presse révèlent des condamnations pour vol de Mme COUGOULAT, veuve MATEL.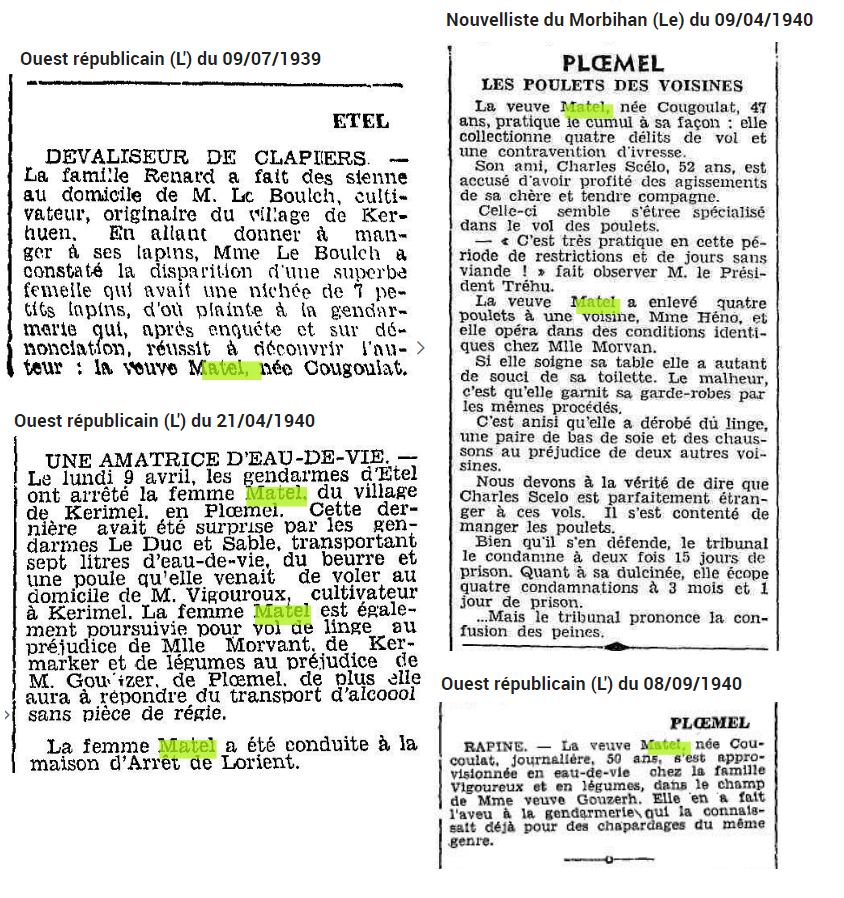
Cette coupure de presse relate en janvier 1941, un vol de bouteille d'alcool par un certain Robert MATEL à Carnac. Mme Cougoulat habitait autour de Ploemel et Etel. La localisation et la rareté du nom Robert MATEL plaident pour lui attribuer ce délit.
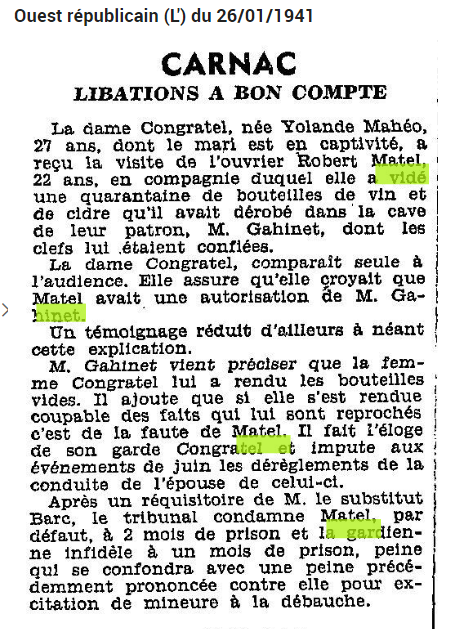
A la veille du conflit, Robert MATEL est âgé de 26 ans, célibataire, et déclare travailler comme employé de chemin de fer à Landaul-Mendon. Comme beaucoup de Français de sa génération, il déclare avoir rejoint le maquis à l'été 1944 et appartenir au 1er Bataillon de Guer en tant que caporal. L'association des anciens résitants du Pays de Guer ne répertorie aucun résisitant au nom de Matel, mais tous n'ont pas fait reconnaitre leur actes dans la résisitance. Par ailleurs, comme il travaille sur le secteur de Landaul, on s'attend plutôt le voir au sein d'un bataillon de cette zone et non sur Guer, à l'opposé du Département. Sa participation à la résisitance reste à étayer. Ses soucis judiciaires en juin 1944 viennent discréditer son engagement dans la résistance.
En effet, à la veille de la Libération de Vannes, Robert MATEL, vient d'être condamné par le Tribunal Correctionnele de Nantes pour le vol de vélos. Que fait-il à Vannes en juillet 1944, loin de son lieu de travail? Ne devrait-il pas être en prison? Est-il en fuite?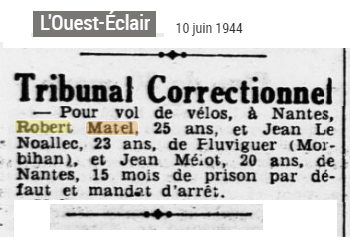
Lors du procès, en mars 1945, il est détenu en vertu de ce jugement du Tribunal de Nantes qui le condamnait à 13 mois de prison pour avoir acheté 900 Fr un vélo volé. La peine parait aujourd'hui sévère, mais à la Libération, la pénurie de tout donne beaucoup de vlaeur au moyen de locomation qu'est le vélo. Il s'évadera de la prison mais sera repris comme le précisent ces coupures de presse de décembre 1946.
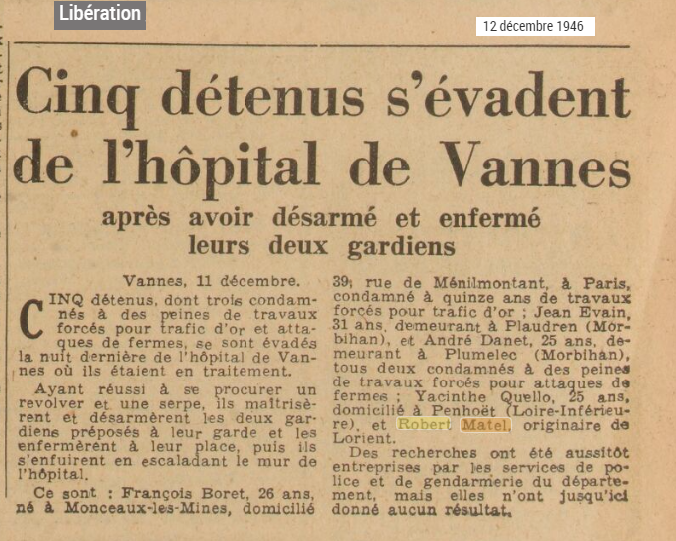
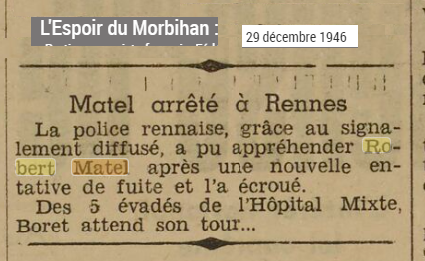
Après le procès et sa libération de prison, on perd sa trace. Son acte de naissance permet de retrouver son lieu et date de décès à La Rochelle en 1971.
SON TEMOIGNAGE:
"Je me nomme MATEL Robert, 26 ans, employé de chemin de fer, demeurant à Landaul-Mendon. Je confirme mes déclarations précédentes faites au cours des enquêtes officieuses.
1-Le dimanche 30 juillet 1944, vers midi, je me suis rendu chez dame LAFOURNIERE, tenancière du Café de la Belote, rue de Strasbourg à Vannes, pour avoir une explication avec elle et avec sa bonne. Jean LEGO m’avait dit la veille que la dame LAFOURNIERE avait vendu des patriotes.
Jean LEGO, 38 ans, est employé du Comité de Répartition des Boissons. Nous sommes en tant de geurre et de rationnement. Au sein de cet organisme il cotoie l'ensemble des débits de boissons de Vannes. Il témoignera lors du procès de Léontine LE YONDRE, épouse LAFOURNIERE. On y apprendra que sur ces indications, Robert MATEL se rend au café de 'La Belote" car selon LEGO, un cheminot lui a dit qu'on y dénonaçait les patriotes.
Je n’avais pas l’intention de l’abattre à cet endroit, chez elle, tout auprès de la gare et da la caserne allemande ; il y avait d’ailleurs un train d’Allemands en stationnement à la gare. Je voulais seulement emmener la dame LAFOURNIERE pour qu’elle soit interrogée par le Lieutenant ?
J’ai donc pris un vin blanc et j’ai laissé la dame LAFOURNIERE et sa bonne manger leur déjeuner puis j’ai demandé à la débitante de me suivre.
Simone PASCO: il s'agit de la bonne, employée de la débitante. Agée de 21 ans née le 18/1/1923 à Clermont sur Oise. Elle s'adonne parfois à de la prostitution. Elle contaminera un soldat allemand et finira à l'hôital pendant les journées du 30-31 juillet 1944. Elle en sera pas entendue lors du procès, retenue à l'hôpital de Rennes suite à son acocuchement. Son enfant nait le 5/3/1945 et décède à Mordelles le 10/8/1945.
Je lui ai dit qu’il ne faudrait pas qu’elle fasse un signe d’intelligence aux Allemands que nous rencontrerions car dans ce cas je pourrais faire usage de mon révolver. Je lui avais parlé de la pochette qui avait été trouvé en même temps qu’un papier portant la mention GICQUEL R. et je lui avais demandé ainsi qu’à sa bonne si cette pochette leur appartenait. Elles avaient toutes deux répondu négativement.

J’ai conduit la dame LAFOURNIERE au café de la Rabine, (actuellement le bar-restaurant L"Atlantique) j’ai attendu mon lieutenant LE FLOCH pendant environ 20 minutes, c'est-à-dire, plutôt que j’ai laissé la dame LAFOURNIERE dans le café pendant que j’allais chercher LE FLOCH au café des Colonies. A mon retour, j’ai dit à a débitante dans LAFOURNIERE qu’il fallait retourner chez elle pour voir à qui appartenait la pochette. De nouveau, j’ai demandé à la débitante et à sa bonne à qui appartenait cette pochette. Je supposais que le papier indiquant le nom de GICQUEL qui était joint concernait un patriote qui aurait été dénoncé. De nouveau, j’ai obtenu des réponses négatives.
J’ai alors invité la dame LA FOURNIERE à me suivre à la Madeleine, nous sommes entrés au café RUAULT. J’avais l’intention de faire interroger la dame LAFOURNIERE par mon lieutenant que je pensais trouver un peu plus loin dans le bois de Kerlhuern. Dans le café j’ai rencontré la dame RUAULT et MAHE que je ne connaissais pas encore. J’étais habitué à consommer au café RUAULT, qui était une maison de patriotes, aussi ai-je parlé à la dame RUAULT dans l’arrière cuisine, c’est sans doute ce qui a fait penser à ma prisonnière que la débit RUAULT était un débit de patriotes. C’est aussi, je suppose la raison pour laquelle la dame LAFOURNIERE a dénoncé la dame RUAULT.
Mme veuve RUAULT, né Marie Madeleine BRIERE [31/5/1891 Plescop-1/4/1952 Vannes] a épousé le 6/6/1922, Alfred François marie RUAULT dont elle a eu un fils Alfred né en 1923 qui témoignera. Veuve, elle est la tenancière du café de la Madeleine, au 46 avenue Hoche ou 4- Place de la Madeleine.
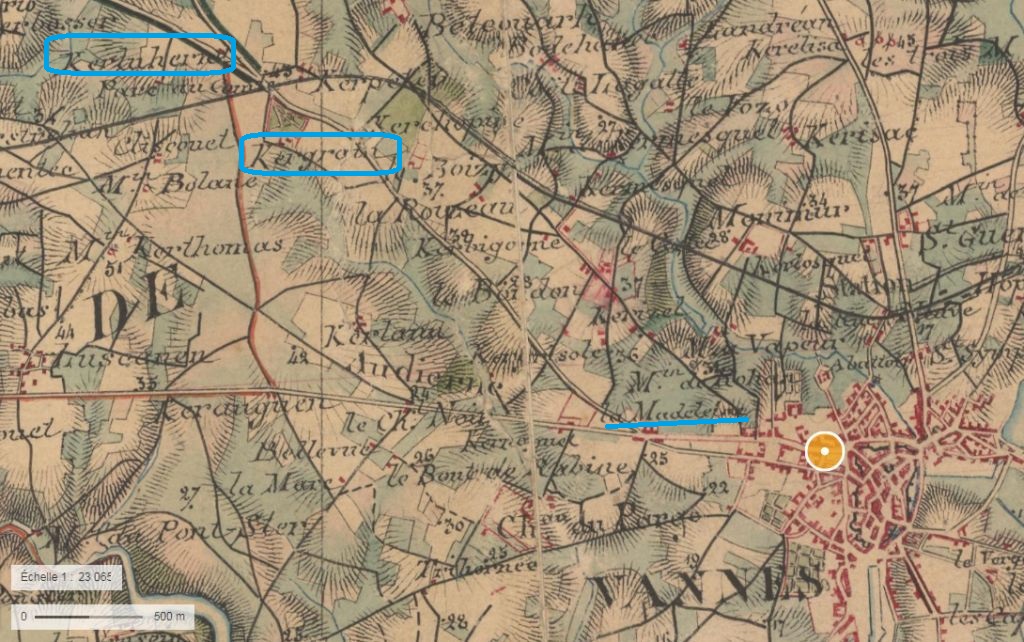
En quittant la café RUAULT, j’ai conduit la dame LAFOURNIERE dans le bois de Kerluherne ; je devais y retrouver mon lieutenant LE FLOCH. C’est pourquoi j’ai cherché dans le bois pendant un certain temps en faisant quelques détours. J’ai sorti ma mitraillette de sa cachette qui était trop près de la grande route, mais je n’en ais pas lmenacé ma prisonnière. Je l’ai seulement menacée de mon révolver. Celle-ci m’a alors affirmé qu’elle n’avait jamais vendu de patriotes et qu’elle n’avait rien fait de mal. Comme je n’avais pas d’ordre pour l’abattre, je l’ai laissé tranquille, puis je suis allé un peu plus loin pour cacher ma mitraillette dans un endroit moins exposé que celui dont je l’avais tiré.
J’ai fait une déclaration d’amour à la dame LAFOURNIERE pour avoir des relations sexuelles avec elle ; la dame LAFOURNIERE a accepté sans difficulté. C’est d’ailleurs elle qui m’en a parlé la prmeière. Elle m’a proposé également une somme d’argent sans en indiquer le chiffre mais j’ai refusé, je ne lui ai pas demandé 20.000 francs, contrairement à ce qu’elle a déclaré. Je suis revenu avec la dame LAFOURNIERE jusqu’à la Madeleine. Je suis resté route de Sainte-Anne dans un café pour attendre mon lieutenant et j’ai laissé la dame LFOURNIERE s’en aller. J’ignore ce qu’elle a fait par la suite.
Vers 18 heures, LE CAM et MAHE que j’avais rencontrés dans un café en ville, m’ont demandé si je voulais les accompagner au café de la Belote pour voir la blonde LAFOURNIERE afin de nous rendre compte « de la tête qu’elle faisait ». Aucun de nous trois n’était armé ; nous n’avions pas l’intention par conséquent de tuer la débitante. D’ailleurs nous pensions bien qu’il y avait des Allemands chez elle.
De fait, lorsque nous sommes entrés nous avons constaté que 5 Allemands se trouvaient au café de la Belote. Nous avons consommé un vin blanc chacun qui nous a été servi par la bonne mais nous n’avons pas entré ni proféré des menaces concernant la dame LFOURNIERE. A un moment donné nous nous sommes aperçus de la disparition de celle-ci. Nous avons alors réglé les consommations et nous nous sommes éloignés.
Je suis retourné au maquis de Camors tandis que mes deux camarades restaient faire la fête dans le quartier, ne se doutant pas que les gendarmes allemands étaient en train de les chercher. J’ai appris que MAHE et LE CAM avaient été arrêté peu après, près du pont de chemin de fer.
2-le lundi 31 juillet 1944 :
Le lendemain matin, je suis revenu de Camors. J’ai retrouvé en ville mon lieutenant LE FLOCH ainsi que LE LAN et son beau-frère DAGOUASSAT également patriote.
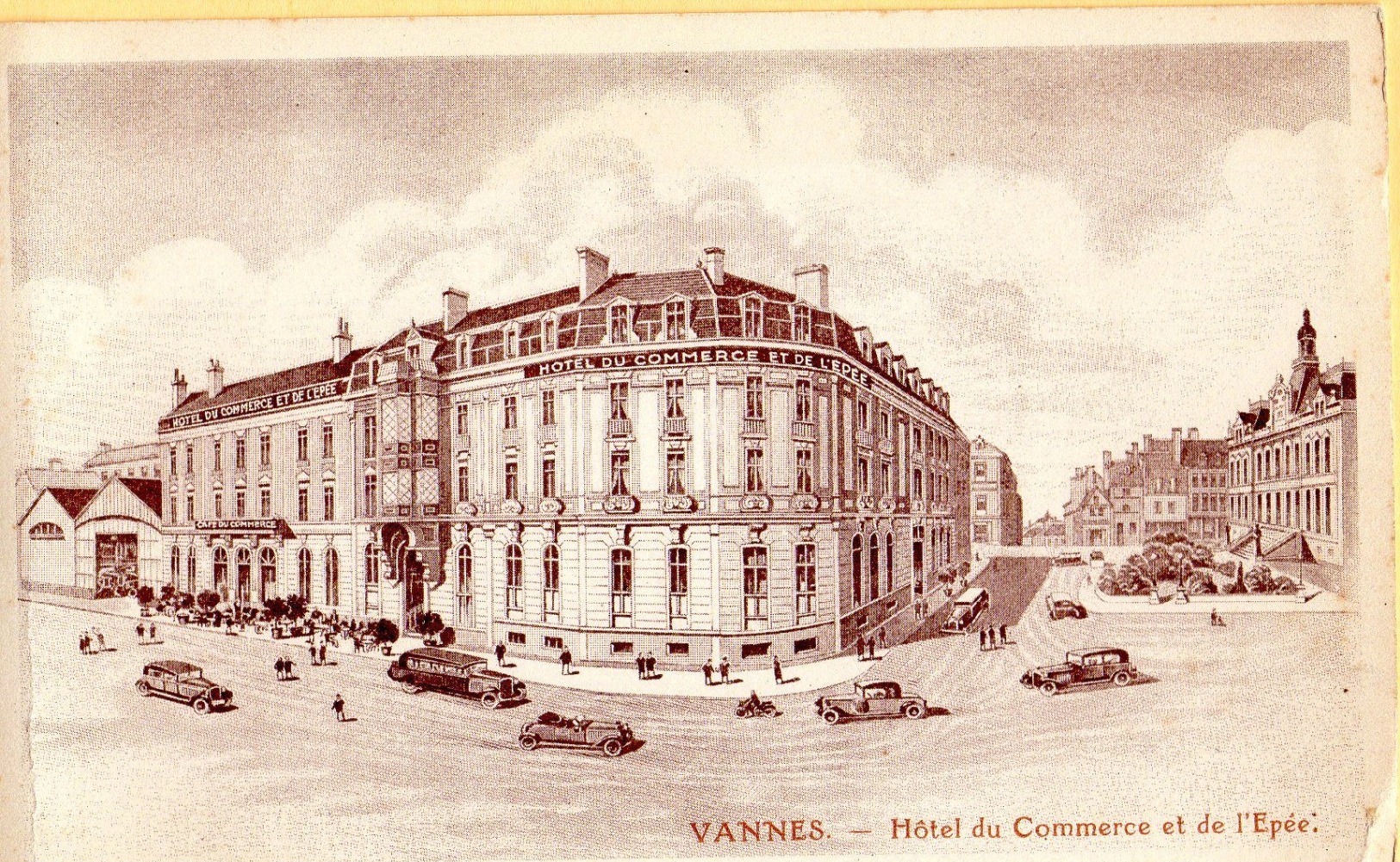
Vers 11 heures, je passais devant le café du Commerce avec DAGOUASSAT et LE LAN. LE FLOCH marchait devant nous à environ une vingtaine de mètres. A ce moment, une voiture allemande s’est arrêtée devant les marches qui conduisent à l’abattoir, auprès du garage Lambert.
Les lieux de l'arrestation : A l'époque la rue du Mené démarrait "en haut" près de la Place de la mairie et englobait donc l'actuelle rue Joseph Le Brix. A l'emplacement de l'annexe de la mairie, une ancienne conserverie REGAL avait laissé place au n°1 rue du Mené au garage Lambert & Dupré qui devint ensuite une concession Renault au n°7 rue J. Le Brix. Il y a toujours un petit escalier qui descend vers le parking en contre-bas. Sur cette photo, la façade du garage et à droite, on aperçoit la rampe de l'escalier qui descendait sur une rue qui menait tout droit vers l'ancien abattoir qui était situé à l'emplacement de l'actuel Palais des Arts.
M. LAUSDAT, représentant de matériel automobile pour le garage Lambert et Maître BROUSSEY, avoué rue Richemont, se trouvaient à l'entrée de ce garage. Mr LAUSDAT ayant assisté à la scène nous la décrit de la façon suivante:"Vers 11 heures, le 31 juillet 1944, une auto allemande se présente à notre garage. Elle est conduite par un officeir allemand, accompagné d'un adjudant. A peine a-t-elle stoppée, que ce dernier sort précipitamment de cette voiture et tire plusieurs coups de feu sur un cyclistte [Robert MATEL] descendant la rue Joseph Le Brix, celui-ci s'aperçoit du danger, se ramasse le plus possible sur son vélo et accélère pour éviter d'être touché. Vers le milieu de la rue du Mené, il reçoit une serviette de cuir, lancée par un autre allemand, qui cherche à le faire tomber. Il réussit à continuer sa route et à rejoindre la rue du Four où il fut cueilli quelques heures parès cette poursuite.
C'est à hauteur de l'hotel du Commerce et de l'Epée, qui fut tenu avant-guerre par Henri Ménard, le maire de Séné, qu'eut lieu l'arrestation des deux Sinagots, LE LAN et DAGOUASSAT.

[Retour au témoigange de Matel] Des officiers allemands sont descendus de l’auto ; presqu’immédiatement, ils ont tiré sur moi et mes camarades ainsi que sur LE FLOCH. J’ai été atteint de 4 balles dans la cuisse droite et la hanche. J’ai eu le bassin traversé. LE FLOCH a été atteint au ventre et j’ai appris qu’il était décédé peu après des suites de ses blessures ; mes deux autres camarades sont été fait prisonniers.
Le lieutenant LE FLOCH: beaucoup d'interrogations sur ce résistant.
Selon le caporal MATEL, il est son supérieur au sein de son bataillon de Guer. Les archives de la résistance du Morbihan sont disponibles sur site Mémoire des Hommes. On y trouve la liste des membres des 9 bataillons par secteur géographique. On y recence 19 résistants au nom de Le Floch avec leur date de naissance. Notre lieutenant LE FLOCH est-il un d'entre eux? Un certain Maurice LE FLOCH né le 21/5/1906, âgé de 38 ans à l'été 1944 est répertorié au sein du 9° Bataillon autour de la commune de Guer. [Vérifier son dossier au SHD de Vincennes]. A moins que le Lieutenant LE FLOCH ne soit le nom d'emprunt du résistant.
Le lieutenant Le Floch était-il présent dans la fusillade? LE LAN dit que MATEL ne trouve pas le lieutenant au rendez-vous au café de la Rabine ni au café des Colonies. MATEL lui dit que le Lieutenant Le FLOCH les précédaient rue du Mené au moment de la fusillade et fut tué. Les a-t-il rejoint?
Dans la fusillade, MATEL a-t-il vraiment blessé ou tué des Allemands? Les régistres de l'Etat Civil à Vannes ne montrent aucun soldat allemand mort le 31 juillet 1944 alors que certains sont répoertoriés lors des jourtnées du 4-5-6 août pour la Libération de Vannes.
Le Lieutenant LE FLOCH a-t-il été tué? MATEL l'affirme, comment le sait-il? Personne n'ira vérifier ce point avant le procès. On ne trouve mention d'aucun Français décédé ce jour là dans les registres. Si LE FLOCH avait été blessé et soigné dans un hôpital de la ville, il aurait eu connaissance du procès et serait venu témoigner. L'Etat Civil de Vannes indique un certain Joachim Joseph Marie Le Floch, natif de Riantec le 21/3/1903 et décédé à Vannes à l'hôpital militaire du Grador le 1/9/1944. Vérification faite auprès des archives militaires de Limoges, il n'a pas été admis le 31 juillet 1944 mais bien avant. On ne trouve aucune trace d'un décès d'un LE FLOCH sur le site Memerial GenWeb ni sur le site Mémoire des Hommes. L'assocation des anciens résitants du Pays de Guer ne répertorie aucun lieutenant LE FLOCH qui plus est, blessé ou mort à Vannes.
Lorsque l’automobile s’était arrêtée devant l’escalier de la rue de l’Abattoir, j’avais vu une femme habillée en militaire allemand en sortir puis descendre les escaliers. Cependant je n’ai pas pu distinguer très nettement ses traits puisque les Allemands m’ont visé aussitôt et que je me suis enfui à toute allure. J’ai crû que c’était la dame LAFOURNIERE sans que je puisse toutefois l’affirmer car j’ai dû m’enfuir précipitamment. [L'enquête démontrera que femme LFOURNIERE se traouvait alors à Auray]
J’ai réussi en m’enfuyant à abattre trois Allemands [abattre ou tiré sur 3 feldgendarmes ou exagération?] et j’ai atteint le quartier de la Petite Garenne où j’ai été rejoint par les militaires allemands. Ne voulant pas être fait prisonnier par eux, je me suis tiré une balle de révolver sous le menton. Auparavant, j’avais sauté dans une cour alors que je me trouvais au deuxième étage d’une maison. J’ai été fait prisonnier dans le jardin de l’hôtel du Bras d’Or. A cet endroit les Allemands m’ont frappé à diverses reprises puis ils m’ont conduit à la Feldgendarmerie rue de la Fontaine. [identifier le batiment et le n° de la rue]
Ils m’ont enfermé dans la chambre de torture où ils m’ont frappé et torturé pendant environ deux heures. La porte s’est trouvée ouverte à différents moments. J’ai vu la dame LAFOURNIERE passer dans le couloir à deux reprises différentes. Je suis certain qu’à ce moment elle m’a vu et reconnu.
Peu après la dame LAFOURNIERE a été introduite dans une autre pièce où j’avais la figure en sang ; les Allemands lui ont demandé si elleme reconnaissait pour être son agresseur de la veille. Elle a répondu sans hésitation affirmativement. Elle a ajouté que je « vendais » mon pays et qu’au contraire les Allemands défendaient la France ; Elle a dit également que je ne l’avais quand même pas tuée. J’ai ensuite été de nouveau battu et torturé pour que je donne le nom de mes camarades de maquis et de mon lieutenant mais j’ai toujours refusé de donner toute indication. J’ignore si la femme LAFOURNIERE est restée dans la salle lorque j’ai été frappé à la deuxième fois car je ne me rendais plus compte de ce qui se passait autour de moi.
Peu après, j’ai été emmené au Bois de Kerlhuern par les feldgendarmes dans une voiture automobile, il y avait trois autres voitures qui suivaient celle où je me trouvais. Les Allemands voulaient savoir où j’avais caché ma mitraillette.
Je n’ai jamais parlé aux feldgendarmes de LE ROUX ; je ne le connaissais d’ailleurs pas ; mon lieutenant n’était pas LE ROUX mais LE FLOCH. Je n’ai donc pas pu indiquer aux Allemands la ferme de Kergrains comme étant l’habitation de LE ROUX . Je n’ai pas non plus parlé de LE ROUX que je ne connaissais pas de tout, je le répète, à la dame LAFOURNIERE. La dame RUAULT connaissait LE ROUX mais c’est une bonne patriote et elle n’a certainement pas parlé de lui.
La ferme de Kergrain: la famille LE ROUX habitait au nord ouest de Vannes, au delà de l'actuelle zone Laroiseau, dans une ferme au lieu-dit Kergain non loin du bois de Kelhuerne. Marie Anne LE CAM, veuve LE ROUX, 57 ans, avait un garçon, Auguste LE ROUX né le 28/9/1917. La consultation de son dossier au SHD GR 16P 365.460, nous apprends que Auguste LE ROUX fut démobilisé à Auch le 18/8/1940. Rentré au pays, il reprend son travail d'ébéniste chez Danto Frères à Trussac Vannes. Résistant depuis le 13/10/1943, Il est dépositaire d'un dépôt d'armes et de munitions depuis décembre 1943 au 6 juin 1944. Le 6 juin est est nommé chef de groupe par le capitaine Gougaud. Il combat à Botségalo le 21/6/1944 puis prend part aux combats à Billiers le 14/9/1944 et ensuite sur le front de la Vilaine du 18/9/44 au 15/11/44. Engagé volontaire au 1er septembre 1944, affecté au 41° Régiment d'Infanterie, 3° Bataillon CA3 le 16/11/1944 après la dissolution du 1er bataillon des FFI.Démobilisé le 15/9/1945.
Le 31 juillet ; les Allemands ont obtenu de moi une seule indication : que les armes venaient de chez LE PAPE. L’adresse de LE PAPE ne m’avait pas été demandée fort heureusement d’ailleurs. C’est grâce à cela qu’ils m’ont laissé tranquille jusqu’au mercredi 2 août. A cette date, ils m’ont demandé quelle était l’adresse de LE PAPE car ils l’avaient retouvé disaient-ils et il avait avoué mais que son adresse avait été perdue et qu’ils l’avaient oubliée. Je leur ai alors répondu, qu’ils n’avaient pas besoin de chercher tant et qu’il n’y avait qu’un seul PAPE, le PAPE de Rome.
Je devais être fusillé le 4 août à heures 30 mais la ville a été délivrée quelques heures auparavant.
Lecture faite, persiste et signe approuvant la rature de treize mots nuls.
2 Sinagots échappent à leur exécution, 1944 1/4
Emile MORIN aura collectionné pendant de nombreuses années les vieilles cartes postales et les vieilles photos de Séné. Dans son livre "Le Pays de Séné" il nous a fait le commentaire des plus intéressantes pour en savoir plus sur le patrimoine et l'histoire de notre commune.
Ainsi cette photo accompagnée de ce commentaire :
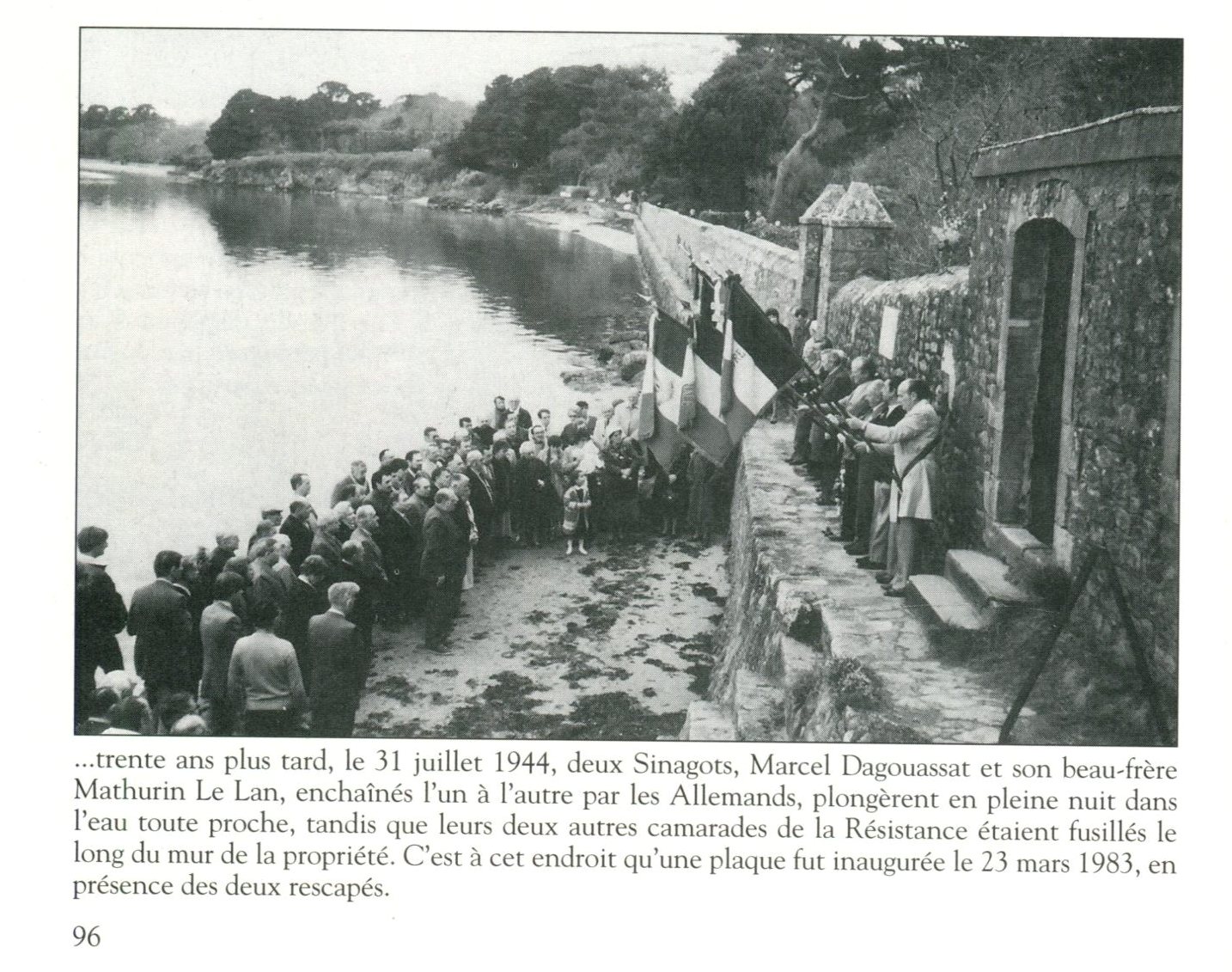
"le 31 juillet 1944, deux Sinagots, Marcel DAGOUASSAT et son beau-frère Mathurin LE LAN, enchainés l'un et l'autre par les Allemands, plongèrent en pleine nuit dans l'eau toute proche, tandis que leurs deux autres camarades de la Résistance étaient fusillés le long du mur de la propriété. C'est à cet endroit qu'une plaque fut inaugurée le 23 mars 1983, en présence des deux rescapés."
Un hasard heureux me fait rencontrer Pascal DAGOUASSAT, fils de Marcel DAGOUASSAT, qui me fait le plaisir de me lire le témoignage sur cet évènement écrit par son oncle Antoine LE LAN. Ce texte est intégralement repris ici, avec des sous-titres pour en faciliter la lecture, annoté et illustré. Antoine LE LAN choisit de mettre par écrit ses souvenirs sous la forme d'une lettre posthume adressée au Capitaine Georges GOUGAUD [ 7/11/1924 Thionville-15/7/1944 Saint-Avé], chef des maquisards de la 1ère Compagnie des FFI, fusillé par les Allemands.
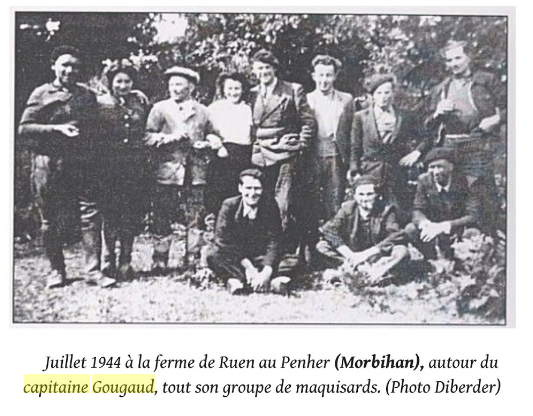
Lettre de notre père au capitaine Gougaud
"Voici les faits authentiques de mon passage dans la 1ère Compagnie du maquis, jusqu'à mon versement dans la marine.
REJOINDRE LE MAQUIS
Dans les premiers jours de Juin 1944, des amis de Séné sont venus me demander si je voulais rentrer dans le maquis. Le lieu de rendez-vous, Langle à Séné d'où je suis parti avec deux autres Sinagots, Conleau-Arradon en bateau, puis à travers champ direction Plescop où nous sommes arrivés dans la soirée dans une ferme, nous étions assez nombreux au rendez-vous.
La section des Sinagots a été dirigée vers le maquis de Treulan, c'est là que j'ai fais votre connaissance ainsi qu'avec les gars qui étaient déjà installés dans le bois, j'ai vu que tout était organisé.
Quelques jours plus tard, nous avons eu un parachutage, c'est là que j'ai eu ma première arme, un fusil canadien, puis ce fut la bataille de Botségalo, [là où furent tués le 18 juin 1944, les Frères GREGAM] après l'accrochage avec les Allemands, ce fut le déplacement vers le bois de Florange colonne de un.
Dans la nuit, beaucoup d'entre nous tombaient de fatigue, il fallait enlever ce qu'ils avaient de compromettant, si bien que je me suis retrouvé à Chapelle-Neuve avec un bazooka, une mitraillette avec ses balles et ses chargeurs, une dizaine de kg de haricots, plus mon fusil et je n'étais pas le seul dans ce cas.
Nous sommes arrivés épuisés dans la soirée, nous n'avons rien mangé depuis la veille, sauf quelques-uns un morceau de pain par-ci, une bouteille de cidre ou de l'eau par là que les gens nous donnaient en passant, car il ne fallait pas s'arrêter, la colonne devait bien faire mille hommes.
Après quelques heures de repos, il a été décidé de se remettre en compagnie séparée, je suis avec vous et ceux qui restaient de la 1ère Compagnie, se rapprochant de Vannes, nous avons fait plusieurs étapes dans des secteurs, dont je ne me rappelle pas les noms, tout ce que je sais, j'ai vu en vous un chef, dévoué au ravitaillement et la sécurité de vos hommes.
Nous sommes descendus, dernière étape dans le bois de Kéral pas loin de Plescop pour la prise de Vannes.

Quelques jours plus tard, me trouvant de garde dans un chemin avec un autre Sinagot, un jeune fils de fermier entre 8 et 10 ans, arrive en courrant tout essouflé et nous prévient que de nombreux allemands se trouvent dans son village à quelques centaines de mètres d'où nous étions, encerclant les maquisards, je vous fais prévenir, aussitôt rassemblement, nous nous arrêtons plus loin le long d'un talus à côté d'un champs de blé.
Etant aux trois quarts encerclés, vous avez décidé avec les responsables de faire un vote à vive voix, étant peu nombreux, je crois que nous étions vingt-sept ou vingt-huit, il a été décidé en accord de camoufler provisoirement les armes et de repartir par groupes de deux ou trois.
Je suis parti avec deux autres gars, dont un para en direction de Saint-Avé à la tombée de la nuit, moi et Jean Doriol, coiffeur à Vannes avons décidé de rentrer chez nous pour nous changer de vêtements, avec l'intention de se revoir les jours suivants.
LES PROTAGONISTES
Antoine LE LAN [15/3/1925 Séné - 9/6/1999 Philboreau 17] nait au sein d'une famille de pêcheurs de Gorneveze, comme nous l'indique son acte de naissance et le dénombrement de 1931. Il est le portrait craché de son mère Mathurin, aussi tout le monde l'appelle du prénom de son père. En juillet 1944, il a 19 ans.

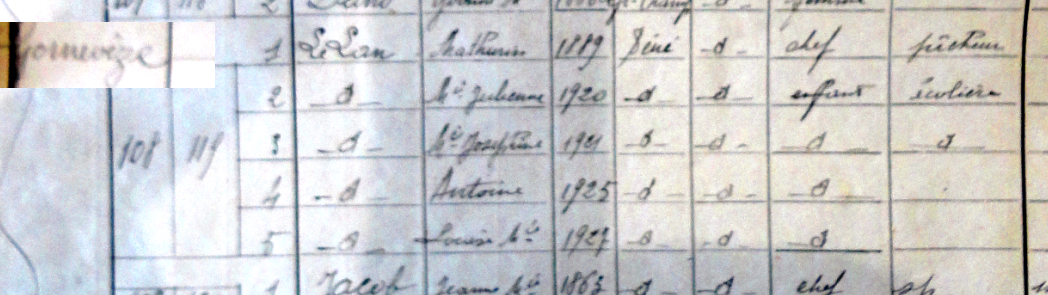
Marcel DAGOUASSAT, [17/9/1918 - 25/8/1988] nait à Quimperlé. Son père, Jules est un ancien combattant de la Première Guerre Mondiale dans la marine qui décède le 20/1/1919.
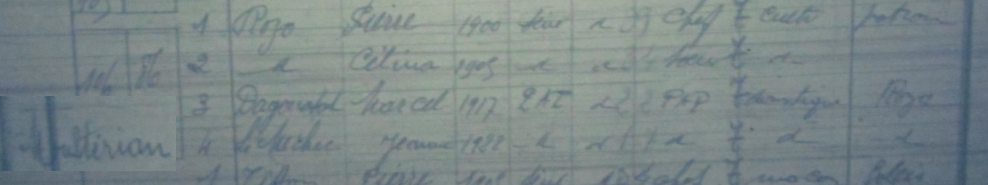
Le jeune Marcel est placé par l'assistance publique à Séné. Après d'autres familles d'accueil, il est domestique de ferme à Moustérian chez Pierre Louis Marie ROZO [22/8/1900-29/4/1988] et sa soeur Celina ROZO [1/1/1905-28/12/2002]. Les Rozo emploient également une autre jeune domestique, Jeanne LE MECHEC [5/11/1922-6/7/1988] qui épousera son patron le 9/10/1937. Par la suite Marcel DAGOUASSAT se mariera à Séné avec Marie LE LAN. En juillet 1944, il a 26 ans.

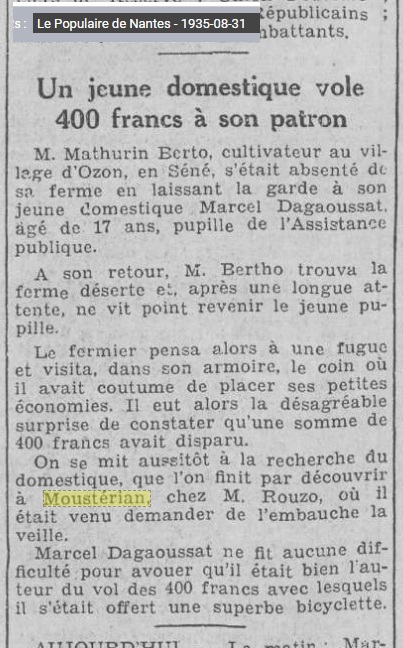
LA MISSION : nous sommes le 30 juillet 1944 à Vannes.
Quelques jours plus tard, mon beau-frère [Marcel DAGOUASSAT] ayant rencontré à Vannes un gars de la résistance qui cherchait quelqu'un de sûr pour une mission délicate, lui parle de moi. Le lendemain 31 jullet 1944, rendez-vous est donné dans les landes de Séné avec ce gars qui dit s'appeller Robert MATEL, je lui apprends que je fais parti de la 1ère Compagnie que je dois rejoindre dès que possible, lui demande des renseignements au sujet de sa mission. Il me cite les noms de ses chefs, parle de Saint-Marcel et autre lieu que je connaissais, je décide de le suivre.
La mission était de descendre à 12H15 à Vannes au Café de la Belote, une femme blonde espionne, un officier de la Felgendarmerie et un des chefs de la Gestapo. Quelques jours auparavant alors que j'étais avec vous, nous étions prévenus qu'une femme blonde espionnait pour les allemands, rentrant dans les villages se faisant passer pour une soeur ou une femme de maquisard, demandant des renseignements, nous avons décidé d'éliminer ces trois personnes.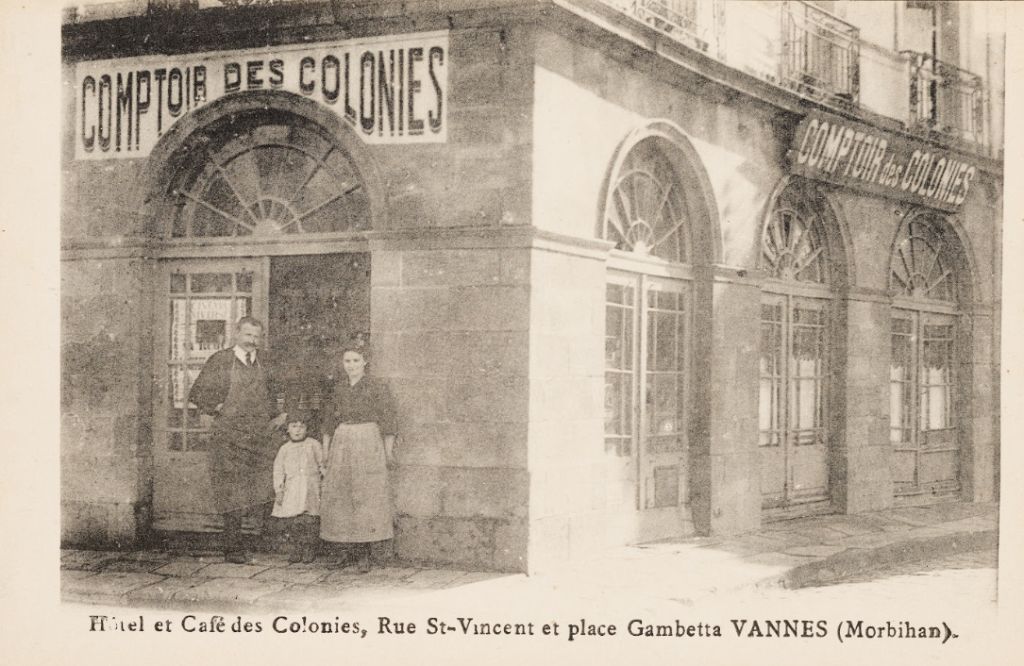
Nous partons à bicyclette avec mon beau-frère [Marcel DAGOUASSAT] que nous récupérons un peu plus loin, il est environ neuf heures du matin, nous partons en direction de Vannes quand à mi-chemin la roue avant du chargé de mission [Robert MATEL] crève, n'ayant ce qu'il faut pour la réparation, l'on décide de faire route à pieds séparément, rendez-vous est donné aux Café des Colonies où l'on doit trouver un gars pour les derniers renseignements. Le Café des Colonies est fermé, nous rentrons au Café de l'Océan.
[Le café des Colonies correspond à l'actuel Gambetta à droite du café l'Océan, toujours existant]
Le gars n'est pas là. La mission est à faire coûte que coûte, il faut faire réparer son vélo et récupérer les armes à côté du chemin de fer, nous repartons à pied séparément, bicyclette à la main et remontons la rue Thiers, je regarde l'heure à l'hôtel de ville, il est 10h35, nous avons tout le temps pour faire la réparation chez Roussel, rue du Roulage. [actuelle rue de la Tannerie].
L'ARRESTATION
Nous n'avons pas été loin, aussitôt passé le virage pour descendre la rue du Menez, [cette rue démarrait au début de l'actuelle rue Joseph LE BRIX et descendait jusqu'en bas de l'actuelle rue du Mené], une voiture noire vient en sen inverse, s'arrête à notre hauteur à côté du cinéma Royal (actuellement la librairie Cheminant). Deux hommes sortent de la voiture s'engouffrent dans une maison à côté, je crois qu'en ce temps-là c'était une coutellerie, un officier allemand saute dans la rue révolver au poing suivi de getapistes révolver au poing également. Ils tirent sur Robert (MATEL) qui a pris la fuite, me trouvant à une vingtaine de mètres derrière lui je tente de fuir, je [Antoine LE LAN] n'ai pas eu le temps de passer le pied par dessus de la selle que mon beau-frère [Marcel DAGOUASSAT] se trouvant derrière moi me crie "descend" [pour qu'il s'arrête et que les Allemands ne tirent pas ].
Deux fedgendarmes sortis de l'hotêl à côté [peut-être l'Hotel du Comerce et de l'Epée, où logeait des gradés allemands] m'avait braqué leur mitraillette dans le dos, aussitôt embarqués dans la voiture de la gestapo, mon beau-frère et moi sommes conduits rue des Fontaines, fouilles complètes, vêtement lacérés et les coups.
N'ayant rien trouvé de compromettant, ils nous rendent nos vêtements, conduis un par un dans le bureau de la gestapo où se trouve sept à hui officiers allemands, plus deux femmes allemandes (souris grises), l'une des femmes m'interroge en me demandant pourquoi les Allemands l'avaient arrêté, si je connaissais les noms des chefs du maquis, les lieux, me proposant si je leur donnait des renseignements, d'être déporté au lieu d'être fusillé, me donnant même tous les tuyaux pour m'évader d'un train (c'était-y pas beau çà). Au bout d'un moment, ne voyant qu'elle ne pouvait rien obtenir par la douceur, me font sortir encadré par des Allemands, mon beau-frère ayant subi l'interrogatoire par les mêmes femmes, me rejoint dans une autre pièce où nou ssommes frappés sans ménagement avec tout ce qui leur tombait sous la main. Ils nous mettent à la fenêtre qui donne dans la cour d'en face à la population en nombre qu'ils ont ramassée. C'est là que nous apercevons MATEL qu'ils ont réussi à prendre et trainent dans la cour
[Robert MATEL, blessé, s'était réfugié au fond d'un puit près de l'église de Saint-Patern].
Quelques temps plus tard, ils le font rentrer dans la pièce où nous sommes, dans un triste état. Je l'ai su à la Libération qu'il avait deux balles dans la cuisse et une balle dans la tête qu'il a eu le temps de se tirer avant d'être pris. Ils nous mettent face à face, trois Allemands nous prennent la tête, nous demandant si l'on se connaissait, nous cognent la tête l'une contre l'autre jusqu'à ce que MATEL tombe à leur pied inanimé, ils le transporte dans une pièce à côté.
Mon beau-frère et moi restons sous les coups, jusqu'à deux ou trois heures de l'après-midi, puis nous laissent un moment tranquille, reviennent nous chercher et nous descendre dans une cellule sous la felgendarmerie.
L'EXECUTION
Un peu avant la nuit, ils remontent dans une pièce, nous menottent tous les deux, poignet à poignet, [les deux beaux-frères sont donc attachés l'un à l'autre mais avec une main libre] nous font descendre dans la cour, passons une petite porte à l'opposé de la rue des Fontaines, un camion allemand nous attend, les soldats font le mur de l'arrière du camion à la porte, il ne fait pas encore nuit.
Ephéméride : nous sommes à l'heure allemande, soit l'heure d'été, dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 juillet 1944, le SHOM nous indique qu'en Arradon, marée est basse autour de minuit.
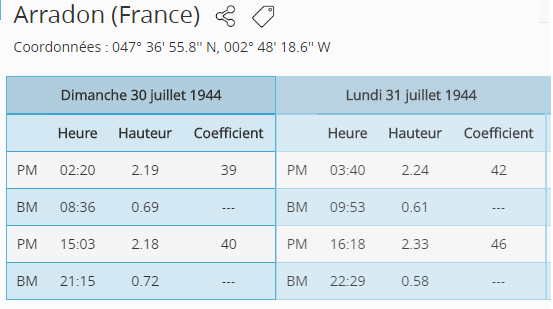
Arrêt plus loin, devant la prison de Vannes et embarquent deux gars enchainés comme nous, il fait nuit quand nous démarrons. Je vois par l'arrière du camion, entre les soldats qui nous accompagnent que nous roulons sur la route d'Auray. Après avoir été arrêté par les barrages allemands pour contrôle, un peu plus tard, nous roulons sur les chemins brousailleux, le camion s'arrête, les Allemands nous font descendre et nous bousculent sur le sentier. je vois que c'est une propriété, bien qu'il fasse nuit, il y a un beau clair de lune, je vois un château et à côté une statue blanche.
[En juillet 1944, les Alliés se rapprochant de Vannes par le nord, les Allemands décident-ils d'aller exécuter leur prisonniers non à Saint-Avé, au champ de tir du polygone, où furent fusillés un grand nombre de résistants, mais dans leur "résidence d'été" en Arradon au château de Porcé demeure du Comte de la Revelière à Penboch, qui abrite dans la chapelle Sainte Marguerite, un stock de munitions. Le château sera dynamité et détruit avant leur départ]

Quelques dizaines de mètres plus loin, nous descendons les marches et nous arrivons sur la grève, la mer est là avec des îles. Ils nous mettent tous les quatre au mur, les Allemands se mettent en face de nous, un officier arrive, donne des ordres, ils prennent les deux plus près du lieu choisi pour l'exécution, ils envoient au bord de l'eau sur notre droite à une dizaine de mètres et nous laissent avec une sentinelle.

LA FUITE
Mon beau-frère qui se trouve sur ma gauche a aperçu de son côté un trou noir dans les bois et m'incite à partir, je ne bouge pas, la sentinelle me tient la mitraillette dans les côtes, les premières rafales claquent, les deux gars s'écroulent, l'un deux n'est pas mort sur le coup, à genoux sur les goémons, il les insulte, les Allemands tirent une deuxième rafale pour l'achever, l'Allemand qui nous tenait sous le canon de sa mitraillette inquité par cet imprévu se détourne pour voir ce qui se passe, je pousse l'Allemand et nous courrons vers ce trou noir que l'on a vu sur notre gauche, sautons le parapet pour escalder la barrière, en haut il y a du barbelé, on se laisse tomber sur le sable, les rafales de mitraillette claquent et c'est la chasse à l'homme, tous après nous. Nous courrons en direction d'un quai que l'on aperçoit au loin, on glisse et tombe souvent sur les goémons, aussitôt relevés, pas blessé ? L'on remet ça, les roches s'éclairent sous les rafales, nous gagnons du terrain, car eux aussi doivent tomber avec leur bottes ferrés. Voyant çà deux d'entre eux courrent sur le parapet qui longe le mur, nous dépssent, tirent en notre direction, l'étau se ressere, ne voyant qu'une issue pour se sauver, que la mer, nous sautons.
A LA MER
Les Allemands arrivent sur le rivage et continuent de tirer, nous plongeons de temps à autre la têt esous l'eau et nageons. L'eau est blanche sous les rafales, nous nous éloignons doucement en direction de l'île la plus près, au bout d'un moment nous n'avançons plus, le courant nous ramène à terre. C'est là que je reconnais le clocher del'île d'Arz et me situe. Nous nagions face au courant de flot, sachant quel'île Drennec est inhabitée, je décide de nager vers l'île d'Arz, mon beau-frère est fatigué, il a le crane défoncé par les coups de chargeurs de mitraillette "Stenn" reçus à la Felgendarmerie et a perdu beaucoup de sang, je le réconforte un moment et repartons vers l'ile d'Arz. Après beaucoup de peine, nous réussissons à prendre pied sur l'île. Nous partons sur la gauche de l'île, frappons à plusieurs portes sans réponse, ce n'est que de l'autre côté de l'île que l'on nou souvre enfin, nous fait entrer.
1ers SECOURS : les frères Evain
Ce sont des jumeaux de la classe 42 qui ne se sont pas rendus à l'appel de la déportation. Jean et Pierre EVIN, fils du père Evin, dit le bossu, aidés de leurs parents, aussitôt tenailles et scie à métaux pour nous libérer de nos chaines. Mon beau-frère tombe évanoui, un peu d'eau de vie, des vêtements secs et nous volià sur pieds.
La famille Evain pour notre sécurité et la leur car l'île n'est pas sure, nous propose une embarcation pour nous rendre dans une autre île. [Ils rament et croisent la barque de Louis Le Franc et son jeune garçon]. Nous montons dans l'embarcation et nous dirigeons vers l'île de l'Herne, le vent faîchit, la mer grossit, vu la fragilité de l'embarcation, nous coulons à pic entre les deux îles, nous nous dirigeons à la nage vers l'Herne. Dans le mauvais temps, nous avons perdu contact l'un avec l'autre et c'est mon beau-frère qui arriva le premier.
2èmes SECOURS : le gardien de l'île de L'Herne - Jules LE MENACH [16/12/1888 Séné - 18/9/1959 St-Armel à Tascon
Nous rentrons dans l'île, il y a un gardien [ Joseph MARTIN ?] qui a une embarcation, il nous emmène vers l'autre île de Tascon, où j'ai un oncle qui est fermier (Jules LE MENACH, frèe de sa mère), arrivés chez lui, il nous fait comprendre qu'il ne peut nous garder longtemps, les Allemands sont venus dans l'île quelques jours plus tôt, cherchant les terroristes, l'ont emmené avec un autre cultivateur entre l'île et le continent, puis les ont relachés.
3° SECOURS : des pêcheuses de Séné
Voyant que partout où l'on arrivait, les gens de peur de représailles ne voulaient nous garder. Je vais avec mon beau-frère sur la pointe de l'île, nous apercevons un canot avec des filles de Séné qui s'en vont faire leur marée, on leur fait des signes, elles nous prennent à bord, non sans peur et nous ramènent vers Séné pour prendre le bateau de mon père seul havre de sécurité.
RETROUVAILLES EN FAMILLE DES FUGITIFS
Nous mettons à la voile, mon père [Mathurin LE LAN] s'étant caché dans l'île de Boët avec ma soeur [Antoine à trois soeurs, Julienne, Joséphine et Louise] et sa fille alors âgée de deux ans, nous rejoint, nous laisse un copain qui se trouvait avec eux et nous partons vers les îles du Golfe. Le 2 Août, alors que nous donnions un coup de filet pour se nourrir; mon beau-frère [Marcel DAGOUASSAT] est pris de douleur insupportables au côté, nous le réconfortons et le mettons à l'abri dans le sinago.
4° SECOURS : le vieux médecin et le boucher de l'Ile D'Arz.
Mon copain, connaissant une vieux médecin de l'île d'Arz [le docteur BARBIER], part aux renseignements, il est décidé de ramener mon beau-frère la nuit car le village n'est pas sûr, il y a des collabos, mon beau-frère a une pleurésie, c'est la femme d'un boucher de l'île nommé Thérèse MACE qui les soignera et les prendra sous son toit.
Marie Thérèse MACE [13/10/1921-25/5/2015] épouse du boucher Roger TANGUY [1/1/1913 Pleugriffet-1/1/1978 Vannes].
Ayant eu quelques renseignemens sur des Sinagots et que la bataille décisive se prépare pour la Libération de Vannes. Je rejoins la section des Sinagots et serai avec vous, dans la première compagnie, pour la libération de Vannes, ai continué à vos côtés sur le front de la Vilaine, jusqu'à janvier 1945 où j'ai été vesé au 4ème Régiment des Fusiliers Marins."
Ainsi s'achève le témoignange d'Antoine LE LAN.
Antoine LE LAN poursuivit un temps avec la Résistance. Il fut ensuite marin-pêcheur à La Rochelle. Il décède à Philboreua le 9/6/1999.
LES DEUX RESISTANTS EXECUTES
Une recherche sur Internet et on trouve sur le site http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr qui donne des précisions sur les deux résistants qui furent exécutés ce 31 juillet 1944 en Arradon.
Albert LE CAM, GR 16 P 348590 et AC 21 P 588578
Albert LE CAM est né à Vannes le 19/3/1910. Il se marie avec Eugenie Louise CLERO [24/5/1917 >Lorient - 2/1/1972 Lorient]. Après le Débarquement il rejoint les FFI. Arrêté le 30 juillet 1944 près deu pont de la gare à Vannes, sur dénonciation, il est fusillé à Penboch le lendemain. Cité par Décret du 14/1/1961 à l'Ordsre de la Libération. Mort pour la France.
Alexis MAHE né le 12/12/1824 à Vannes REF : GR 16 P 383834

Son dossier militaire transmis par le Service Historique des Armées nous apprend qu'il était boucher avant de s'engager dans les Forces françaises de l’Intérieur (FFI), au sein du 1er Bataillon, 11° Compagnie.
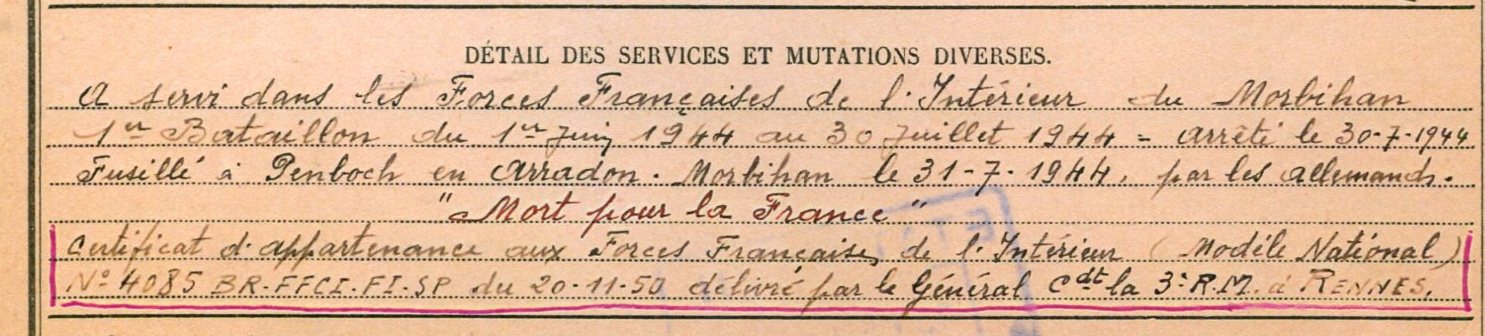
Alexis MAHE se rendit en compagnie de deux camarades FFI, Robert MATEL et Albert LE CAM dans un café de Vannes tenu par une jeune femme devenue agent de renseignements au service des Allemands. Robert MATEL était venu précédemment seul pour l’exécuter, mais avait succombé à ses supplications. Celle-ci l’avait dénoncé et lorsqu’il est revenu avec ses camarades Alexis MAHE et Albert LE CAM, ils furent cernés par des feldgendarmes.
Robert MATEL parvint à s’échapper, mais Alexis MAHE et Albert LE CAM furent rattrapés, arrêtés et conduits à la prison de Vannes, place Nazareth.
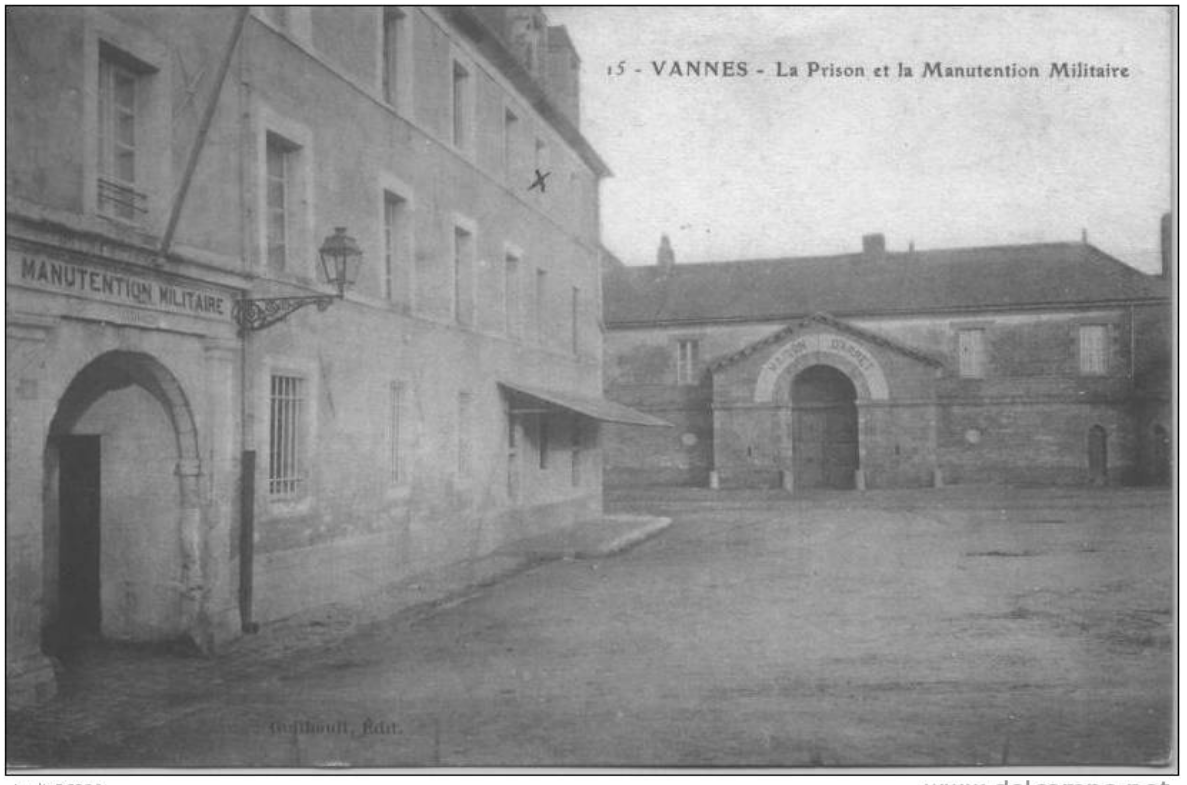
Le lendemain, Robert MATEL qui se trouvait en compagnie de deux jeunes gens de Séné (Morbihan), Mathurin LE LAN et son beau-frère, Marcel DAGOUASSAT, fut reconnu dans une rue de Vannes par la dénonciatrice qui circulait à bord d’une voiture allemande. Les trois jeunes gens furent arrêtés. Robert MATEL blessé, fut torturé et condamné à mort, mais fut sauvé par la Libération de Vannes.
Vers 23 heures, une camionnette allemande emmena sur la plage de Penboc’h à Arradon (Morbihan), enchaînés deux par deux, Alexis MAHE et Albert LE CAM, Mathurin LE LAN et Marcel DAGOUASSAT. Les deux premiers furent abattus à coups de révolvers. Leurs corps auraient été découverts par Emile IZAN, ostréiculteur à Penboch, qui avait entendu la sauvage fusillade nocturne. Ils étaient dans un fossé recouverts de barbelés et de feuillage, lacérés de coup de lame. Ce certificat établi par la mairie d'Arradon, indique que leur corps furent retrouvés le 20 août 1944. Alexis MAHE fut inhumé à Vannes.
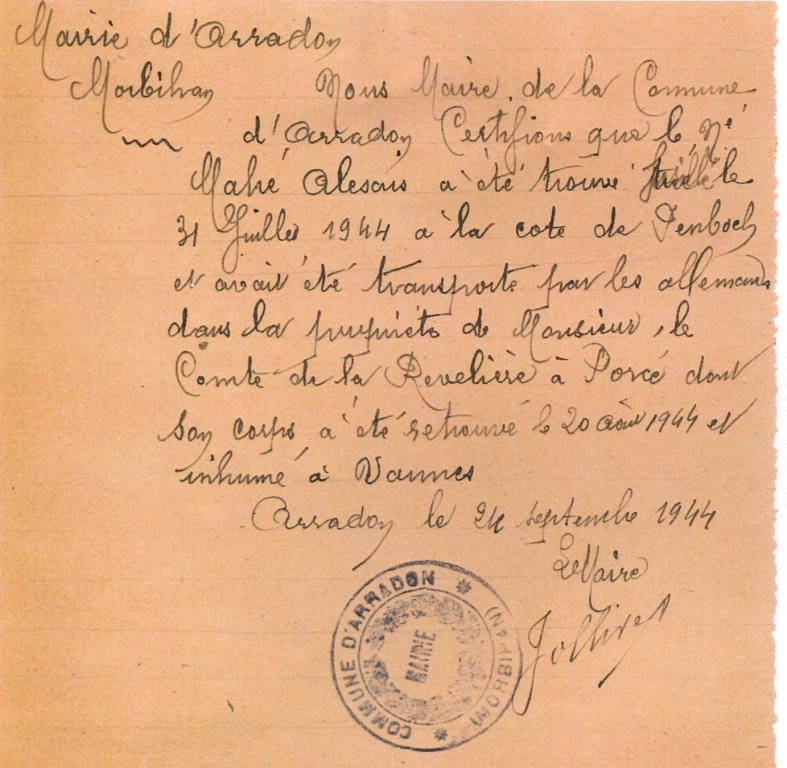
Le 9 septembre 1963, le minsitère lui attribua le titre "Dinterne Résistant" en plus de celui de "Mort pour la France". Une plaque a été apposée sur le lieu de leur exécution à Penboch, Arradon, à la mémoire d’Alexis MAHE identifié sous le prénom « Louis », son prénom d'usage et d'Albert LE CAM.
Le nom d'Alexis MAHE figure aussi sur la stèle dédié aux « Résistants - Déportés politiques - Fusillés, érigée sur le plateau de la Garenne à Vannes. Le corps d'Albert LE CAM fut enseveli au cimetière de Calmont, dans le carré militaire rang 3 tombe 51.

LE PROCES :
Le Café de la Belote, rue de Strasbourg à Vannes, derrière la gare était près de l'actuel Café de la Petite Vitesse. Sa tenancière était Léontine LE YONDRE, marié sous le nom de LAFOURNIERE.
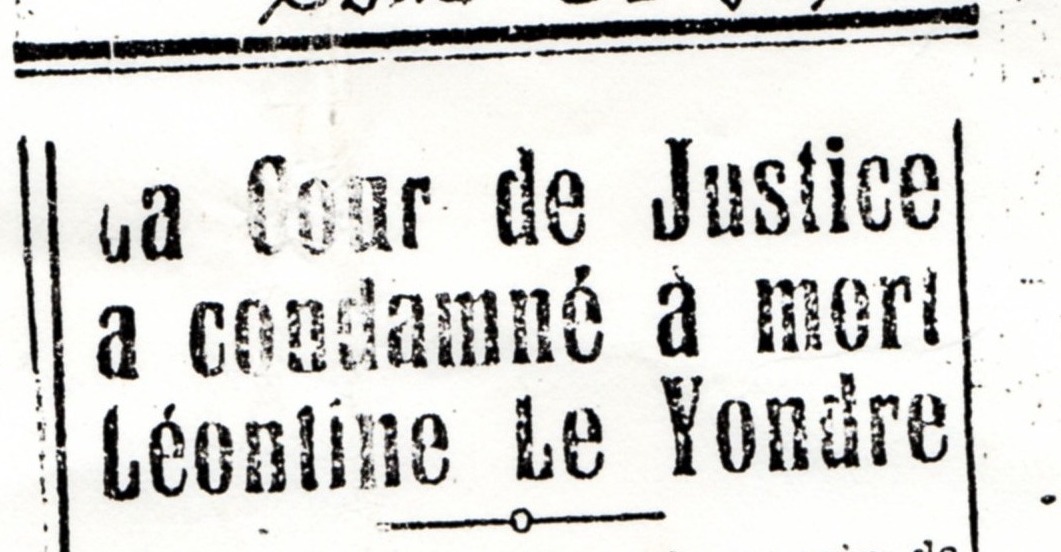
Son procès eut lieu à Rennes en 1947.
Les frères LE GREGAM, résistants,1944
Le monument aux morts de Séné compte à ce jour 6 noms de soldats Morts pour la France pendant la Seconde Guerre Mondiale et le nom de deux résistants, deux frères : Roger, Edouard LE GREGAM [10/01/1923 - 18/07/1944] et Jean Fortuné LE GREGAM [ 1916 - 18/07/1944], également Morts pour la France. Sur leur tombe au cimetière, une plaque mortuaire informe le visiteur de leur dramatique destin.
Qui étaient-ils et dans quelles circonstances sont ils morts pour la France ?
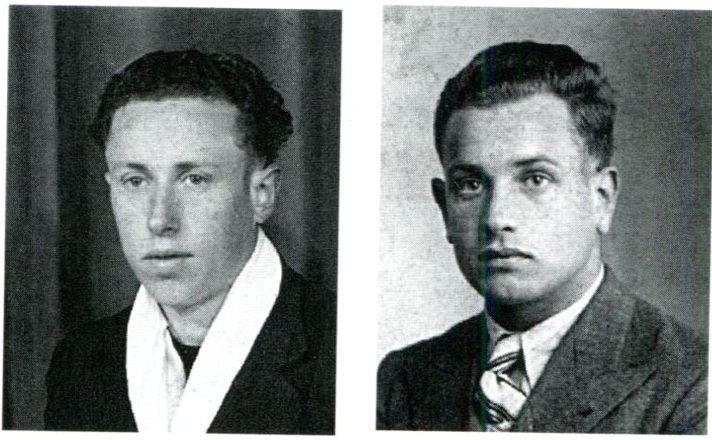
Roger et Jean étaient les deux uniques garçons Ferdinand Pierre Marie LE GREGAM [19/12/1881 - 24/04/1955] et de Marie Césarine DORIOL [2/02/1885-19/11/1976] qui s'étaient marié à Séné le 17/02/1914.
Le dénombrement de 1921 nous indique que Jean est né à Sauzon (Belle Ile en Mer). Son acte de naissance stiupule que sa mère réside bien à Séné.
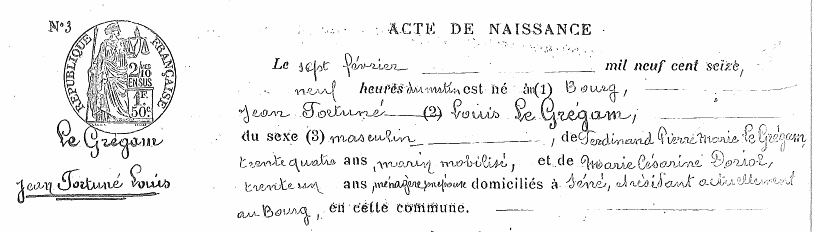
Son père est marin et sa mère ménagère. En 1921, la famille est établie au village de Montsarrac à Séné.
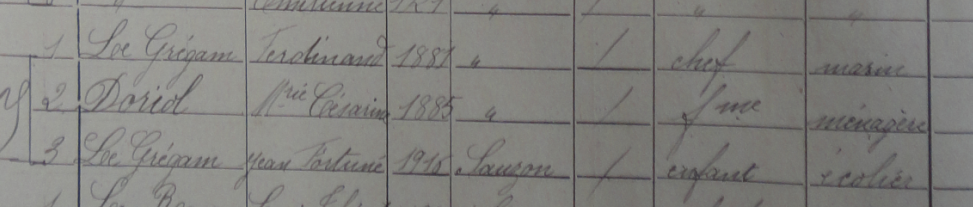
Au dénombrement de 1931, les deux frères figurent au registre. On note qu'ils avaient 7 ans de différence. Jean, l'ainé est né pendant la guerre en 1916. Roger, le cadet naitra en 1923. Le père est marin de commerce.
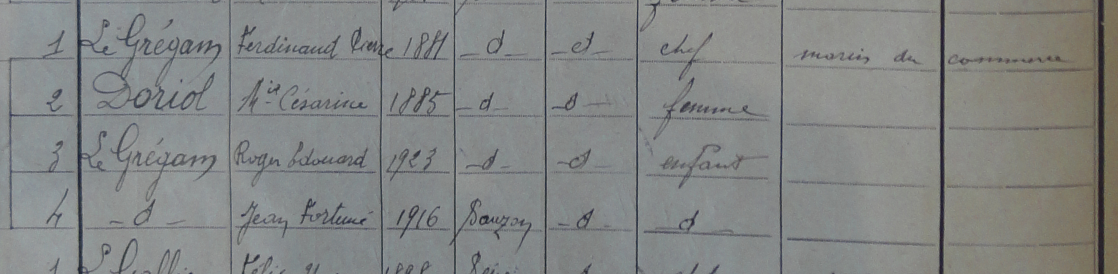
Les dossiers au archives de la défense [16P269408 pour Jean et 16P269409 et 16P346895 pour Roger nous indiquent que Roger LE GREGAM, réfractaire au Service de Travail Obligatoire, rallie la résistance en avril 1944. Avec son frère Jean, il participe au réseau "Navarre" en qualité d'agent protecteur d'un poste de radio et d'agent de liaison. Il s'illustre "plusieurs fois au péril de sa vie à trnasporter du matériel sur les routes constamment surveillées par les patrouilles allemandes".
Article écrit à partir de http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article176767 enrichi et illustré.
Au début du mois de juin 1944, le 2e Régiment de chasseurs parachutistes (RCP) ou 4e SAS (Special air service) des Forces françaises libres (FFL) fut largué dans le secteur de Plumelec-Sérent-Saint-Marcel-Malestroit (Morbihan). Sa mission était de fixer les troupes allemandes stationnées dans le Morbihan, afin d’empêcher ou au moins de retarder l’arrivée des renforts allemands sur le front de Normandie. Plusieurs milliers de résistants appartenant aux Forces françaises de l’intérieur (FFI) et aux Francs-tireurs et partisans français (FTPF) furent regroupés et armés dans le camp de Saint-Marcel qui recevait chaque nuit des parachutages d’hommes, d’armes, de munitions et de Jeep.


Le commandant Pierre Bourgoin, chef du 4e SAS et le colonel Morice, chef des FFI du Morbihan, établirent leur quartier général à la ferme de La Nouette située sur le territoire de la commune de Sérent. Dans la nuit du 17 au 18 juin 1944, considérant que cette concentration devenait très dangereuse et qu’il fallait plutôt privilégier la guérilla, le commandement interallié donna, mais trop tard, l’ordre de dispersion.
Le 18 juin 1944, le camp de Saint-Marcel où étaient stationnés un peu plus de deux mille FFI encadrés par deux cents SAS, fut attaqué en force par la Wehrmacht. Après avoir livré combat durant toute la journée en infligeant de lourdes pertes aux troupes allemandes, parachutistes SAS et FFI se replièrent en bon ordre et se dispersèrent.
Après cette dispersion, la Feldgendarmerie, la Wehrmacht appuyée par de nombreux détachements de soldats russes, géorgiens et ukrainiens rassemblés dans les « unités de l’Est », les agents de l’Abwher (service de renseignements de la Wehrmacht) et du SD (Sicherheitsdienst-Service de sûreté et de de la SS), ainsi que les agents français de la FAT 354 (Front Aufklärung Truppe) et les miliciens du Bezen Perrot, se lancèrent dans une traque implacable des parachutistes SAS, des FFI-FTPF, de leurs dépôts d’armes, et de tous ceux qui les hébergeaient et les ravitaillaient.
Rafles, arrestations, tortures, et exécutions sans jugement de SAS et de résistants, incendies de fermes, pillages et massacres de civils se multiplièrent dans tout le département du Morbihan.
Le 11 juillet 1944, François Munoz, un agent français du Front Aufklärung Truppe (FAT 354) de Pontivy commandé par Maurice Zeller, se présenta dans le café d’Auguste Gillet à Guéhenno (Morbihan), où étaient attablés Alain Le Cuillier de Vannes, Roger Le Grégam et son frère Jean Le Grégam. Vêtu sous son imperméable d’un uniforme de sous-lieutenant parachutiste, Munoz déjoua leur méfiance en leur présentant des documents pris sur le sous-lieutenant SAS Jean Pessis qui venait d’être arrêté et leur déclara qu’il cherchait à rejoindre le capitaine SAS Marienne. Il engagea la conversation avec eux et réussit au fil de la conversation à apprendre que Marienne se trouvait à Kérihuel en Plumelec (Morbihan) et à se faire indiquer le lieu sur une carte.
Aussitôt après, les quatre hommes furent arrêtés et conduits à Locminé (Morbihan). Détenus dans l’école des filles où des policiers du Sicherheitsdienst (SD) s’étaient installés, ils y furent interrogés et sans doute torturés. Le 18 juillet 1944, Roger et Jean LE GREGAM firent partie des quatorze détenus de Locminé exécutés dans le bois de Coët-Kermeno à Botségalo en Colpo (Morbihan).
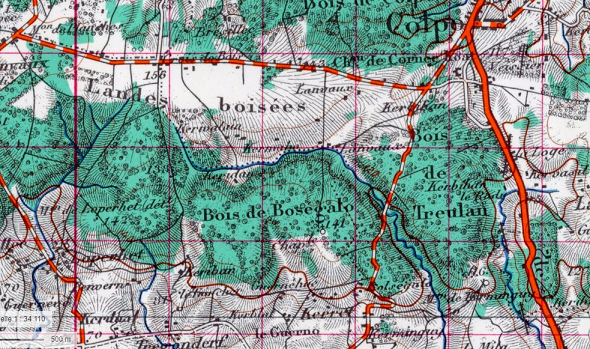
Archives Morbihan 88J1 Corps des résistants Botsegalo 18-22/07/1944
Selon l'acte de décès en mairie de Colpo, les corps furent retrouvés le 23 juillet vers 15 heures et les actes de décès établis le lendemain.
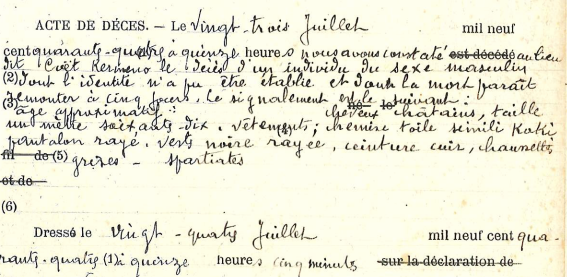
Ils restent anonymes jusqu'au jugement du tribunal de Vannes en date du 27/11/1944 qui reconnait en ces deux corps, ceux de Roger LE GREGAM et jean LE GREGAM.
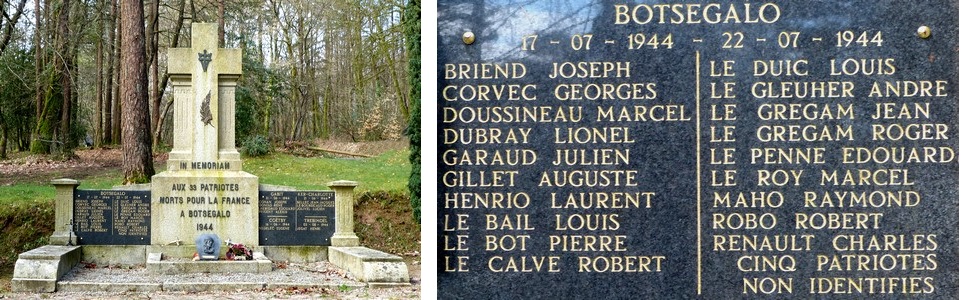
Les noms de Roger et Jean LE GREGAM sont inscrits sur le monument commémoratif de Botségalo à Colpo et sur le monument aux morts de Séné. A Montsarrrac, une place porte le nom des frères LE GREGAM.
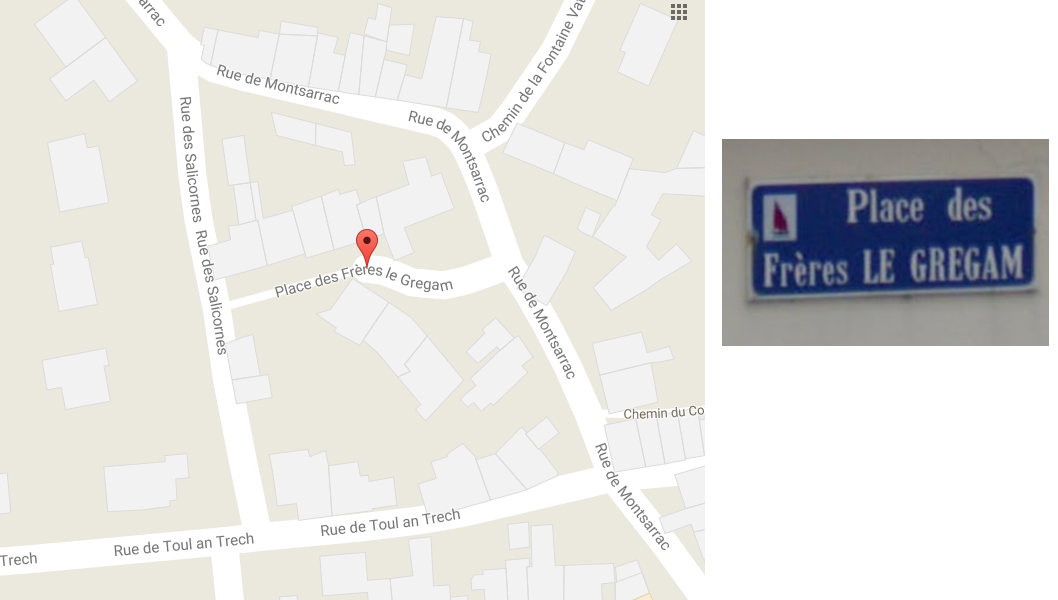
39-45 : Deux pêcheurs victimes de mines : 2/3
SECONDE GUERRE MONDIALE : coulés par des mines
Deux marins natifs de Séné périrent sur leur bateau à cause de mines flottantes mouillées en mer dans le dessein de nuire à la marine ennemie. Dans ces deux cas, il semble que ces 2 marins étaient partis en mer pour pêcher...victimes colatérale de la guerre maritme.
Jules Benjamin BARRO [9/10/1912-26/06/1942]
Raymond LE FRANC [9/07/1914 - 11/01/1943]
Jules Benjamin BARRO [9/10/1912-26/06/1942]
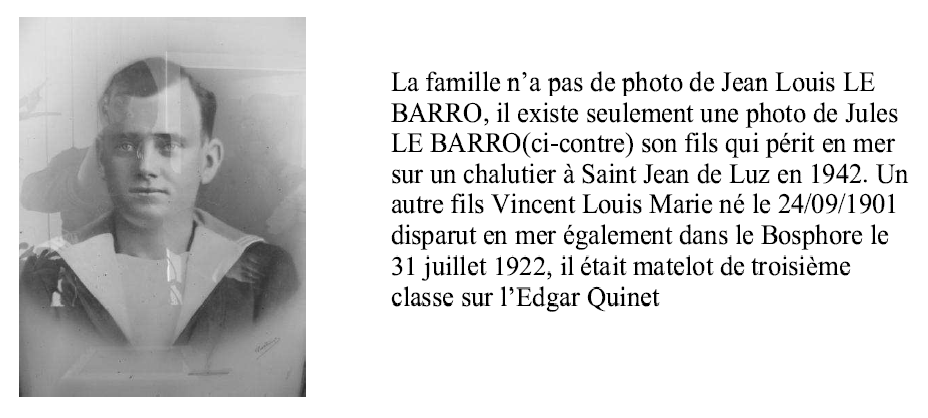
Dans son histoire du village de Gornevèze, L. Brulais évoque le décès de Vincent Louis BARRO qui disparu en mer lors de l'opération extérieure menée par les Alliés au large de ce qui allait devenir la Turquie (lire article dédié pages marins). La famille Barro sera une nouvelle fois endeuillé en 1942 avec la disparition en mer de leur benjamin.
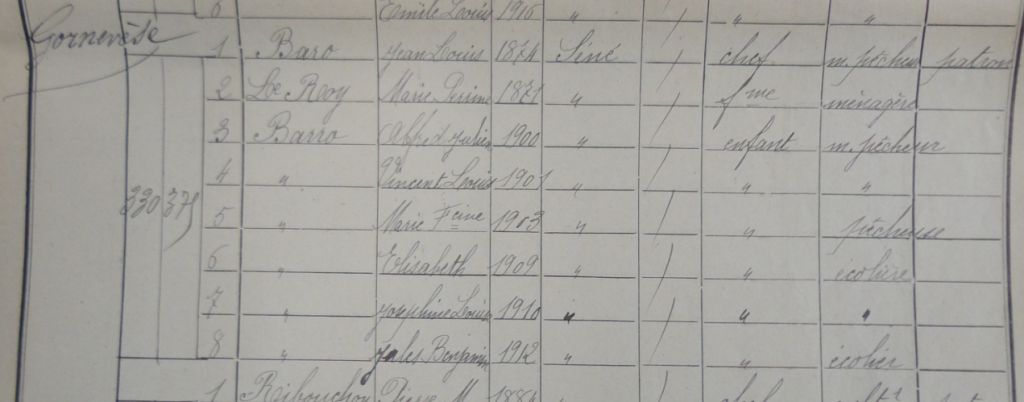
Jules Benjamin BARRO est le plus jeune des garçons de la famille. Né le 9 octobre 1912 au village de Gorneveze, il sera mobilisé en 1939 dans la marine française. [passer au SHD de Lorient].
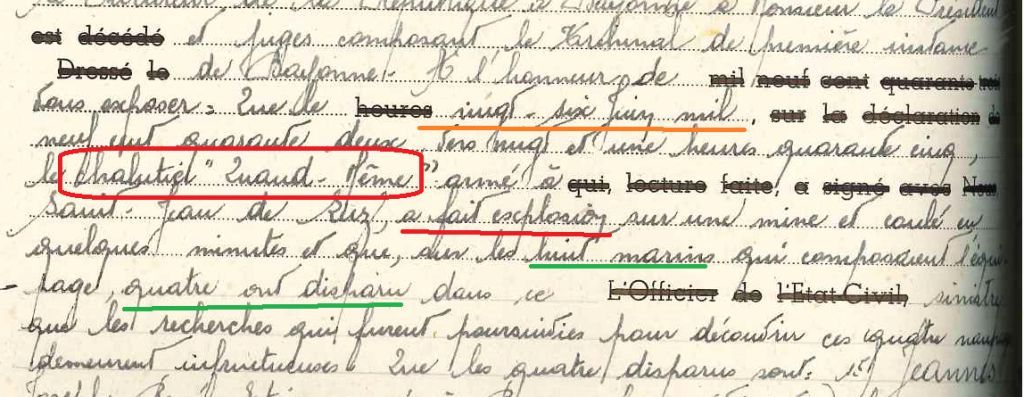
En 1942, il est à bord d'un chalutier Quand-Même reconverti en remorqueur avec pour port d'attache Saint-Jean de Luz. Le 26 juin 1942, le Quand-Même navigue au large de Boucau quand il heurte une mine et explose. Sur les huits marins à bord, quatre disparurent comme nous l'indique l'acte de décès de Jules BARRO retranscrit dans sa commune de résidence à Ciboure dans les Pyrénées Atlantique. [dans l'attent de disposer des archives Joncour]
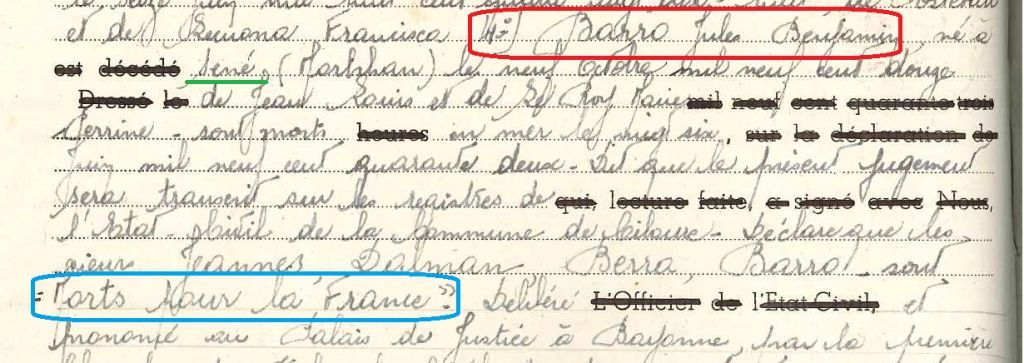
Engloutis avec Barro par l'explosion, le marin breton Joseph, René, Etienne JEANNES [15/xx/1915 à Beuzec-Cap-Sizun -Finistère] et deux marins espagnols, Salvador DALMAN [La Cellere 24/03/1897-26/06/1942] et Pedro Marcelino BERRU [18/06/1898 Fontarrabia - 26/6/1942. Ils furent tous les quatres déclarés "Morts pour la France".
La présence de marins espagnols permettrait d'écarter l'hypothèse selon laquelle le Quand-Même opérait dans le cadre de la marine de L'Eta Français de Vichy. La présence d'Espagnols à bord rend plus plausible une sortie en mer pour pêcher, d'autant que le port de Saint-Jean de Luz était un port de pêche.
Cette coupure de presse confirme l'hypothèse émise.
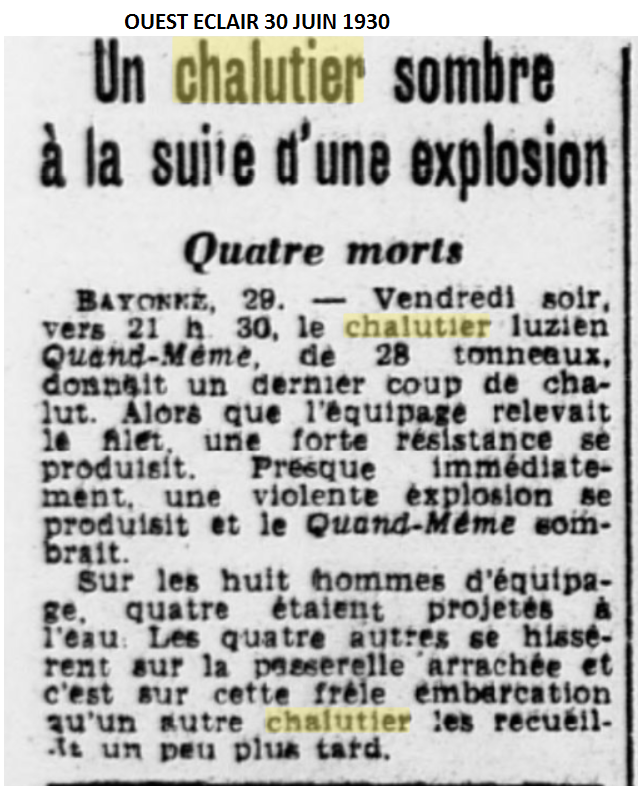
Cet article du Nouvelliste du Morbihan du 1er juillet nous donne le noms des rescapés : la patron Barreau, les marins Lefranc, Barnes et Bénito qui furent recueillis par le chalutier Zorlon.
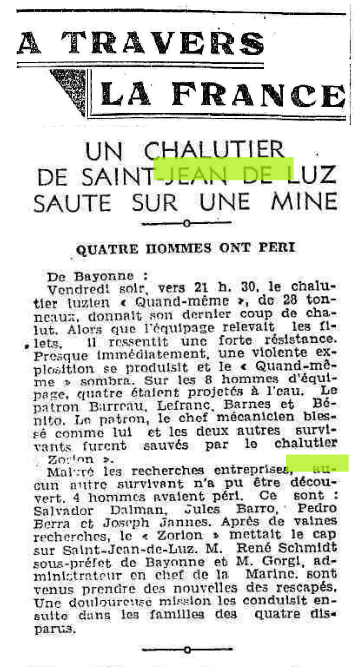

Le nom de Jules BARRO fut gravé sur le monument aux morts de Ciboure, la ville où cet enfant du Pays de Séné s'était établi. Dès le mois d'août 1942, le gouvernement français décorait le patron du chalutier, Patern Barreau du quartier de Vannes [vérifier si il était de Séné], Chevalier de l'ordre du Mérite Maritime comme nous le rapporte Ouest-Eclair.
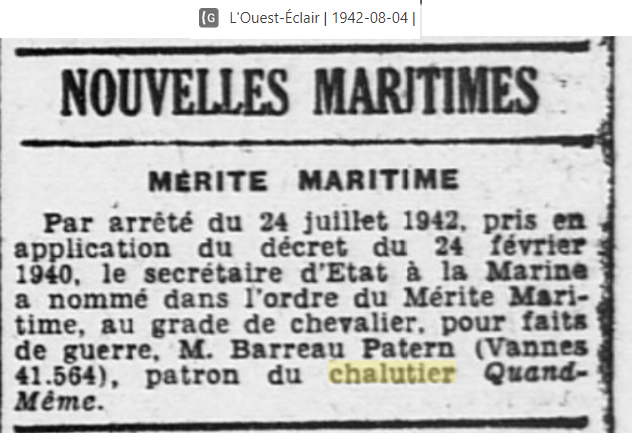
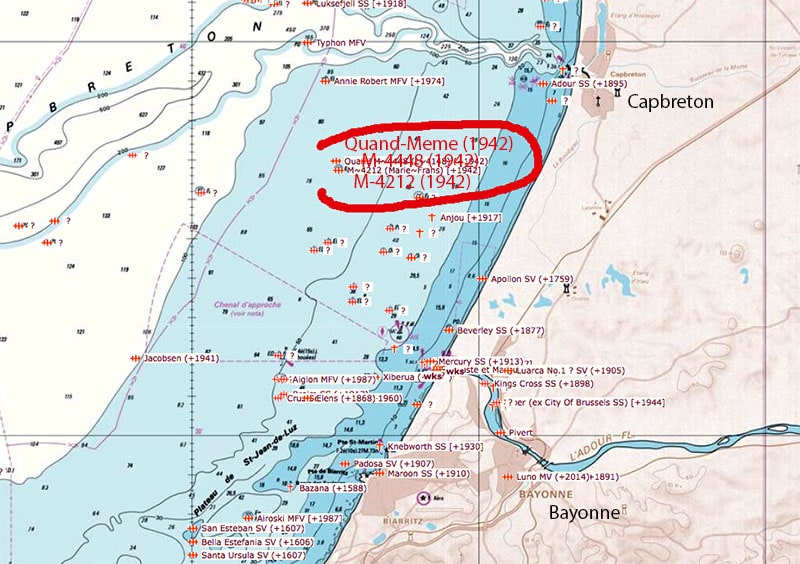
L'épave du Quand-Même a été localisée par des plongeurs et répertoriée sur les cartes marines.
Ironie de l'histoire, la mine qui fit exploser le Quand-Même ce vendredi 26 juin 1942, fut mouillée le 5 juin 1942, au large des côtes basques, par le Rubis, un des sous-marins des Forces Françaiises Libres, lors de sa 15e mission entre le 27 mai et le 14 juin 1942. 
Raymond LE FRANC [9/07/1914 - 11/01/1943]
Le site Mémoire des Hommes donne son nom sans précision. En parcourant les registres de l'état civil de Séné, on finit par identifier Raymond LE FRANC né à Bellevue; le 9/07/1914 au sein d'une famille de pêcheurs. La mention "Mort pour la France" y figure.
La famille LE FRANC apparait bien au dénombrement de 1931 et compte 4 enfants.
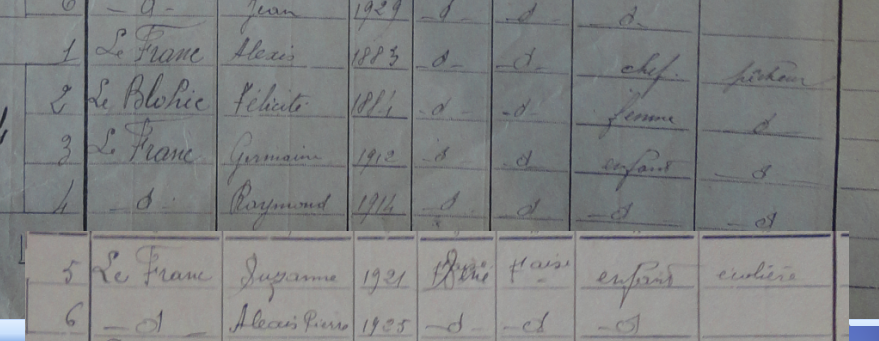
L'acte de décès de LE FRANC Raymond nous indique que sa disaprition ne sera authentiifiée que par un jugement du tribunal en date du 4/04/1944 retranscrit à Séné. On y apprend que le 11/01/1943, le chalutier Amadi aperçoit pour la dernière fois le chalutier vapeur MARIE ROSE et que des débris de sa coque seront retrouvés. Le jugement statue sur la disparition de tout l'équipage, 11 marins dont Raymond LE FRANC.
Marie-Rose - Chalutier à vapeur Date du naufrage 11 janvier 1943
Le "Marie-Rose" avait été construit à Boulogne en 1911 au chantier Baheux frères. D’une longueur de 23,10m, une largeur 6,06m et un creux de 3m, il jaugeait 91,92 tx en brut. Chalutier doté d’une machine à vapeur Caillard & cie de 180cv, il avait été immatriculé à Boulogne (B 4075) le 21 janvier 1911. "Marie-Rose"fut rachetée par la société d’armement G Gauthier & E et A Gautier fils & Cie de Lorient et immatriculé dans ce même port (L 973) le 7 avril 1930. En 1935 E & A Gautier frères & Cie devinrent propriétaires uniques du navire.
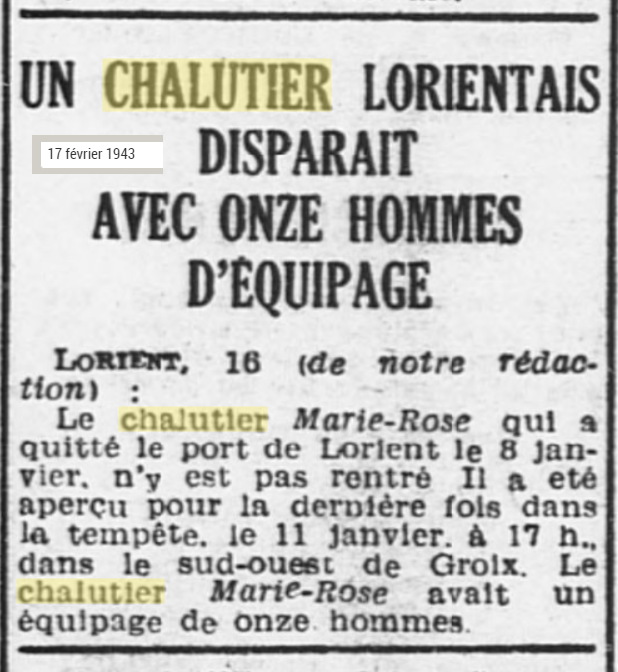
"Marie-Rose"fut déclaré perdu corps et biens le 11 janvier 1943 sans que l’on ne connut exactement la cause de sa perte : tempête, mine ou torpille ?
Source : auxamrins.net

Sauvetage de 4 aviateurs allemands, 1941
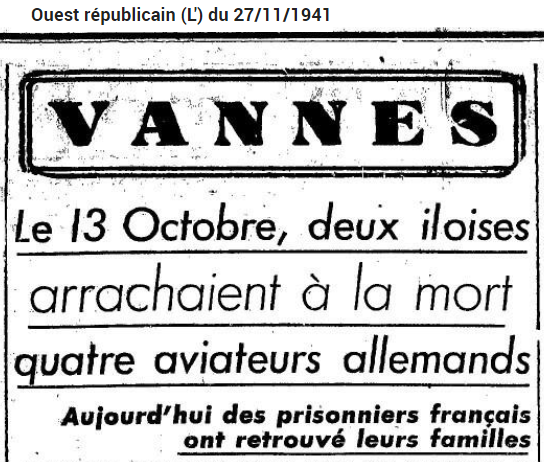
Le titre de cet article de l'Ouest Républicain du 27 novembre 1941 annonce le sauvetage par deux habitantes de l'Ile d'Arz de quatre aviateurs allemands. On va y apprendre que Ange LE FRANC, marin sinagot, a également participé au sauvetage.
L'article est reproduit ci-après avec des annotations complémentaires :
"Un petit bateau de la Compagnie Vannetaise de Navigation vient de nous conduire à l'île d'Arz.
Le vent et la pluie qui, l'instant d'avant, nous fouettaient la figure, s'apaisent subitement. Une étrange impression de calme nous surprend. Nous sommes cinq journalistes venus pour féliciter deux humbles femmes qui, le 13 octobre dernier, arrachaient à la mort quatre aviateurs allemands.
M. Gouzerh, ostréiculteur à Vannes, qui sera pour nous un guide précieux, désigne une zone située à 800 mètres du débarcadère. Deux pieux, des tronçons de murets émergent.
[Nous sommes à l'île d'Arz à la pointe de Béluré]
- Le point de chute de l'avion est à environ trente mètres à droite de l'embarcation qui vient vers nous. (Il hèle celui qui la conduit) : "C'est, nous dit-il, un de ceux qui participèrent au sauvetage, M. LE FRANC, un marin-pêcheur de Séné".
- "Si nous étions arrivés à marée basse, poursuit M. Gouzerh, nous apercevrions très distinctement une des ailes de l'avion".
Dans ce paysage pacifique, où tout est douceur et quiétude, on évoque mal les péripéties d'une catastrophe.
Mme HERVE, qui la première donna l'alerte, nous fait un récit émouvant du sauvetage au cours duquel elle manisfesta un courage et un esprit de décision remarquables.
Le 13 ocotobre, peu après sept heures, Mme HERVE, qui se trouvait à proximité de la pointe de Béluré, entendit le bruit d'un avion volant excessivement bas. L'appareil rasa sa maison, à environ une quinzaine de mètres au dessus de la toiture. Elle suivit du regard sa direction, perçut les ratés du moteur et, quelques secondes plus tard, au loin dans le brouillard, un bruit mou de chute dans l'eau, puis des cris.
[Nous sommes le 13 octobre et la France vit à l'heure allemande, soit l'heure d'iver. A 7 heures du matin, le jour ce lève à peine]
Sans pouvoir situer le lieu de l'accident, elle pensa aussitôt au secours à apporter à l'équipage.
Pour arriver à temps, une seule solution : mettre en marche la vedette de M. Gouzerh, ostréiculteur, amarrée au débarcadère. Fort heureusement, elle connaissait la conduite du moteur pour en avoir observé le maniement par les hommes du chantier où elle travaille. Une difficulté surgit, les embarcations pour atteindre la vedette sont échouées. Mme Hervé alerte sa vosiine, Mme RIO, propriétaire du Café du Cap.
Les protagonistes :
Mme Anna LE BOURDIEC (22/11/1891-16/10/1968) mariée à Emile François RIO (7/05/1890-24/08/1936). Mme Anna RIO était la femme d'un ancien combattant de la Grande Guerre, François Emile RIO qui décéda de ces mutilations de guerre et fut reconnu "Mort pour la France". Son nom est inscrit au monument aux mort de l'Ile d'Arz. Elle tenait le café à la cale de l'Ile d'Arz, dit "Café du Cap". Elle a eu deux enfants, Emile, mobilisé dans la marine et Jeannette.

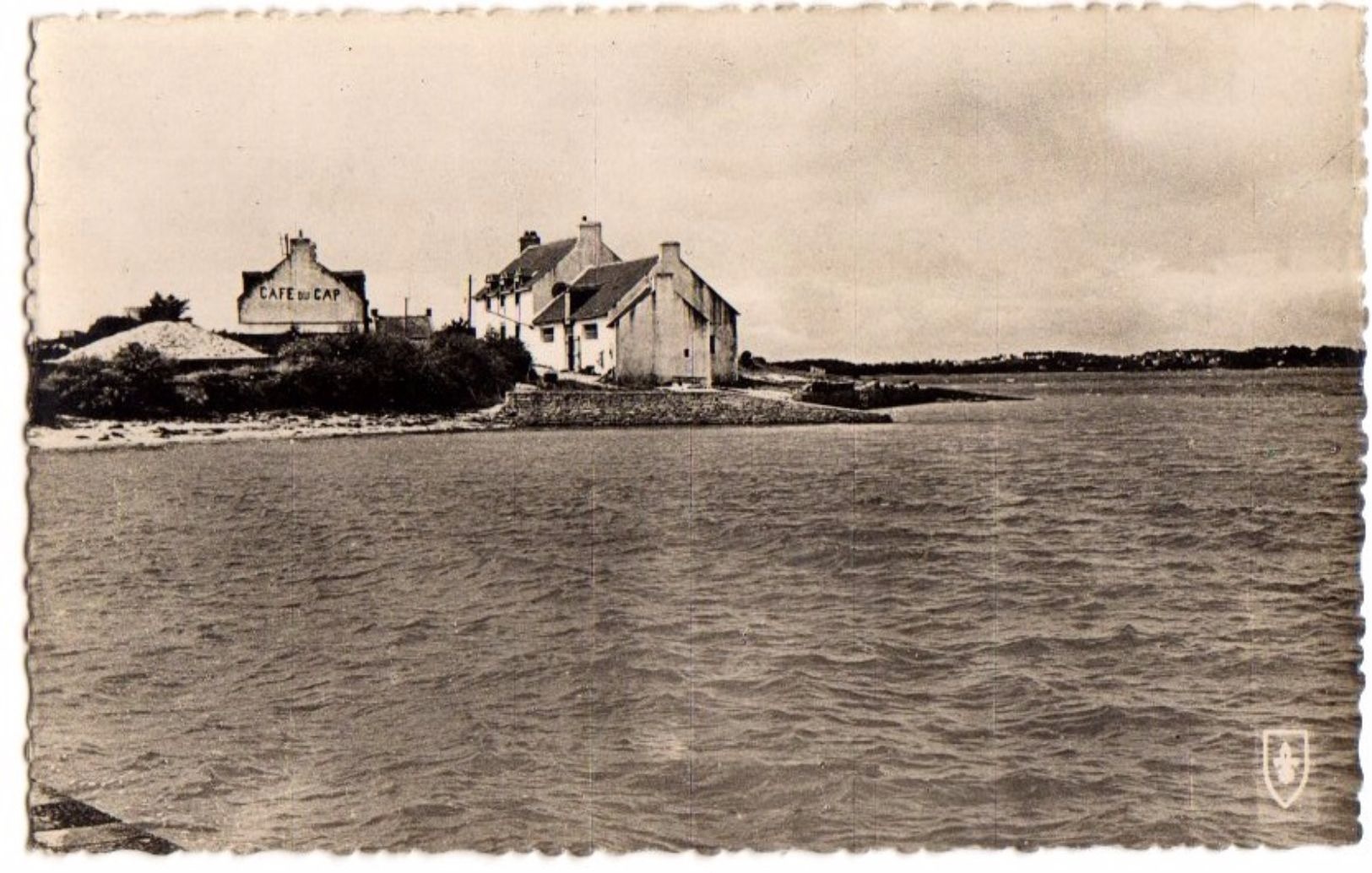
Mme Jeanne LE GUEN (16/07/1912 Baden - 29/11/1988 Baden) mariée à André HERVE (13/03/1907 Baden - 6/05/1980 Vannes). Jeanne HERVE, né à Baden comme son mari André, étaient avant guerre agriculteurs à Baden dans la ferme familiale. Le jeune couple préfère embaucher chez Gouzerh, ostréiculteur et devient garde de parc à huître sur la rivière d'Auray. Plus tard Gouzerh leur propose de s'installer sur l'île d'Arz, dans une masion à la pointe de Béluré, pour s'occuper des concessions d'huîtres plates autour de l'île. André HERVE fut mobilisé en 1939, fait prisonnier et interné dans un Stalag près de Prague. Il fut libéré en novembre 1941 à la suite de ce sauvetage.

Ange LE FRANC [19/08/1898-31/05/1977] était employé par l'ostréiculteur Gouzerh et travaillait sur les concession près de l'Escobes, entre ile d'Arz et ile de Boëd, comme le rapporte cet article de presse.
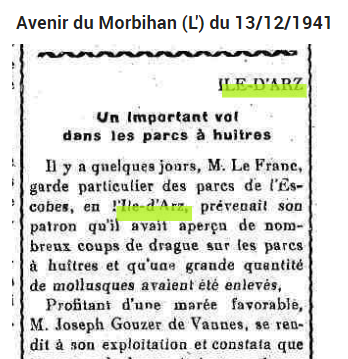
On le retrouve avec sa famille nombreuse au dénombrement de 1931 avec son épouse Marie Rose LE FRANC [19/03/1902-16/08/1974).
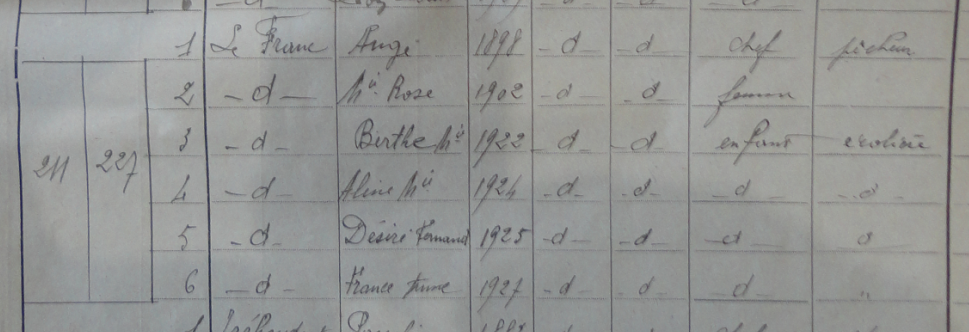
Retour à l'article de presse.....
Conservant toute sa maîtrise, en attendant l'arrivée de Mme RIO, elle téléphone à la Kommandature de Vannes, alertée par les S.O.S. de l'avion en détresse. Elle signale l'accident, en situe le lieu, et, rassure les autorités allemandes en leur disant qu'elle apportera d'urgence des secours aux naufragés.
[Mme RIO a bien reconnu un avion allemand]
Les deux femmes poussent le bateau sur la vase et se mettent à l'eau pour le faire flotter.? Mme HERVE a mis le moteur en marche. Mme RIO a saisi la barre de l'embarcation qu'elle dirige vers le point indiqué par les fusée signaux des aviateurs auxquelles répondent ceux de Meucon.
[L'aérodrome de Meucon est occupé par l'armée allemande. Pendant la guerre, un groupe de bombardiers de l'armée Allemande s'y installe et développe les infrastructures de l'aérodrome. Durant la "Blitz", des bombardiers allemands décollaient et allaient déverser leurs bombes sur les villes anglaises, accompagnés par des Heinkel 111, bimoteurs basés à Meucon, chargés du balisage de nuit des objectifs". La tour de contrôle a vue la lumière des fusées de détresse de l'avion allemand qui devait sans doute atterrir à Meucon ou venait de décoller et qui, victime d'une panne a choisi d'amerrit sur le plan d'eau du Golfe du Morbihan. En effet en ocotobre 1941, le Blitz est fini et on ne dénombre ps de combat aérien au dessus de Quiberon, Lorient ou Saint-Nazaire]

Un He-111 du KGr100 devant un hangar typique du terrain de Vannes.
Aujourd'hui encore, un grand nombre de ceux-ci sont encores visibles

Aérodrome de Vannes-Meucon en 1941.
Le Heinkel He-111H du 2 Staffel Kampfgeschwader 100 codé 6N-NK, en extérieur.
Les deux femmes sont pleines de craintes à l'idée d'accoster avec une vedette lourde, d'un maniement qu'elles ne connaissent pas, un bombardier peut-être chargé de bombes, prêtes à exploser sous un choc maladroit.
[Nous sommes en 1941, en zone occupée et qui plus est, en zone cotière interdite. La presse est muselée et le régime nazi voit dans ce sauvetage spontanné de deux habitantes de l'Ile d'Arz, une occasion de montrer l'acceptation de l'Occupation. Nos deux héroïnes n'ont sans doute pas mesuré le danger encourru. Filles de l'ïle aux Capitaines, habituées à l'entre aide entre marins, à porter secours aux marins naufragés, leur humanité les a tout naturellement porté au secours avant tout d'Hommes, quand bien même étaient-ils aviateurs de la Luftwaffe.]
Sur le lieu du sinistre, elles rencontrent un pêcheur de Carriel en Séné, qui, comme elles, a suivi les péripétie de l'accident et répond à l'appel des fusées.
[Solidarité des "gens de mer" prompt à porter secours aux naufragés]
L'avion, en partie summergé, porte trois hommes à l'avant. Un quatrième git dans la carlingue.
Pris par M. LE FRANC dans sa plate, puis embarqués dans la vedette avec l'aide de Mme HERVE et de Mme RIO, les quatre aviateurs, dont trois blessés, (un très grièvement ) atteignent au jour la pointe de Béluré.
[Le rôle de Ange LE FRANC de Séné a été minimisé par le journaliste. Sa plate est plus facile a manier et peut s'approcher de la carlingue de l'avion abimée en mer pour charger les 4 aviateurs avant de les transférer sur la vedette de M. Gouzerh.]
Un coup de téléphone pour demander une ambulance, et le bateau gagne Vannes pour y déposer les victimes de l'accident.
Le colonel aviateur, qui était à bord s'étonne de ce que la pesante embarcation de sauvetage soit montée par des femmes. Celles-ci répondent que depuis l'absence de M. Hervé, prisonnier de guerre, elles sont dans l'obligation de remplir de lourdes tâches.
- "Soyez tranquille, répond le colonnel, votre mari ne tardera pas à revenir. Je vous en donne la certitude".
[Qui était ce colonnel, oberst en allemand, qui visiblement parle le français et qui promis d'intercéder en faveur des deux sauveteuses ?]
Un adieu, et l'officier allemand emporte une adresse de stalag que Mme Hervé lui a communiquée.
Le lendemain, les sauveteurs étaient appelés à la Kreiskommandantur, où les plus vifs compliments leurs furent adressés. En récompense de son geste courageux, Mme RIO exprima le désir de revoir son fils, échappé de Mers-El-Kebir, à bord du cuirassé Strasbourg et depuis à Toulon. Mme Hervé eut la promesse que bientôt son mari la rejoindrait.
[Après l'armistice du maréchal Pétain, la Grande Bretagne seulle en guerre contre l'Allemagne nazi craint que la flotte de la marine nationale d'Afrique du Nord passe au mains des Allemands et du 3 au 6 juillet 1940, elle bombarde les navires français faisant de nombreux morts parmi les marins français. En octobre 1941, l'autre grande parrtie de la flotte française demeure dans le port de Toulon. En novembre 1942, la flotte de Toulon se sabordera pour ne pas tomber aux mains du régime nazi qui a décidé d'occuper tout le territoire français, suite au débarquement en Afrique du Nord des Alliés].
Ce récit, commencé sur la plage, s'est terminé chez Mme HERVE. Son mari nous reçoit. Nous le félicitons sur sa bonne mine.
[Nous sommes le 27 novembre et depuis le 13 ocotobre, l'ordre de libération a été donné et excuté]
"- Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre libération?
- A vrai dire, nous répond M. Hervé, j'y croyais à peine. Nous étions trois prisonniers dans la même situation. Les deux autres avaient réellement sauvés quelqu'un; mais, moi ?
-Vous, votre femme, a sauvé quatre hommes.
- On a l'habitude, répond M. Hervé. L'aventure que je vais vous raconter est à peine croyable. Récemment, trois gamins de 2, 3 et 5 ans, décidaient d'aller embrasser leur grand-mère à Arradon. Ils embarquèrent sur uneplate. Au large, le vent soufflait, la barque tangauit, les petits criaient. Inévitablement, la dérive allait les entrainer vers les courants. Ma femme, alertée par les cris, saute dans une barque et parvient à ramener les imprudents chez leur mère.
M. Hervé évoque ensuite ses souvenirs du camp. Il était employé dans une ferme, à 100 kilomètres de Prague.
Dans le débit RIO, où se poursuit la conversation, le fils de la maison, grâce au courage de sa maman, [Emile RIO] a obtenu une permission exceptionnelle de trente jours et aussi l'exceptionnelle autorisation de pénétrer en zone interdite.. Il nous raconte l'Odyssée de son bateau le Strasbourg au cours de l'affaire de Mers-El-Kebir.
RIO tremble encore de rage, à la pensée qu'il fut pris, ainsi que ses camarades, dans un véritable piège à rats. Impossible de fuir, impossibilité de rendre les coups reçus.
Une douzaine de prisonniers, pêcheurs ou cultivateurs de l'Ile d'Arz, sont actuellement retenus en Allemagne.
Autour de nous, plusieurs jeunes gens se sont attablés pendant une courte pause de leur travail. Une conversation générale s'engage sur le retour possible de leurs camarades. Et tous de souhaiter qu'il se réalise prochainement.
Les ilois sont des gens heureux.
Les iloises le seront plus encore lorqu'elles aurotn retrouvé leurs hommes."
Ainsi finit l'article de l'Ouest Républicain.
Les Autorités Allemandes utiliseront ce sauvetage spontanné effectué par un Sinagot et deux Ildaraises pour organiser une cérémonie en leur honneur devant la mairie de Vannes, le dimanche 14 décembre 1941, à laquelle participèrent les maires de l'époque, nommés par le Préfet : M. Germain pour Vannes, M. Layet pour Séné et M. Laniel pour l'Ile d'Arz.
L'importance donnée à ce sauvetage s'explique par le souhait de montrer l'acceptation de l'occupation et parce qu'il fait suite à la rencontre entre le maréchal Goring et le maréchal Pétain à Saint Florentin.
Source Wikipedia : L’entrevue de Saint-Florentin est une rencontre entre le maréchal Pétain, chef de l'État français de Vichy, et le Reichsmarschall Göring dans la gare de Saint-Florentin - Vergigny dans l'Yonne le 1er décembre 1941. Les deux parties se sont rencontrées pour tenter de négocier quelques avantages : Göring souhaitait tirer avantage de l’empire colonial français en Afrique du Nord, dans le cadre des opérations militaires allemandes en cours dans la zone libyenne ; Pétain souhaitait améliorer la vie quotidienne des Français, notamment à propos des prisonniers de guerre. Il apparaît que l'entrevue n'a donné aucun résultat.
La cérémonie est filmée et un reportage passe aux actualités de l'époque. Mme Jeanne HERVE et Mme RIO, et M. Le FRANC comme l'indique l'article ci-dessous et comme le montre la video, refusèrent une enveloppe remise par les Autorités allemandes qu'elles donnèrent spontanément au Comité Départemental d'Assistance aux Prisonniers de Guerre du Morbihan.

Cette capture d'écran montre Mme Rio et Mme Hervé, sans doute M. Le Franc, et à gauche peut-être le Capitaine Goring en uniforme et le capitaine Rio qui récupère les enveloppes.
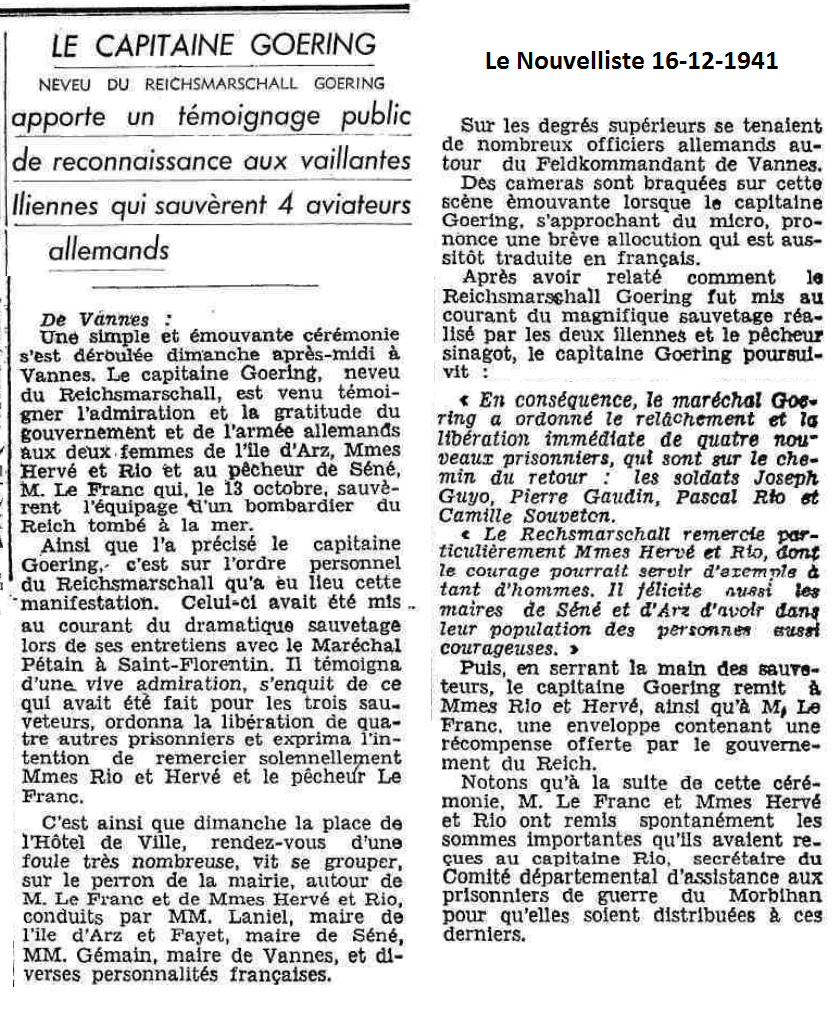
Le film d'actualité parle de 5 soldats qui seront libérés. L'article, quant à lui annonce un 2° groupe de 4 soldats libérés : Joseph GUYO, Pierre GAUDIN, Pascal RIO et Camille SOUVETON qui s'ajoutent à Emile RIO et André HERVE (à vérifier)
Le site http://www.absa3945.com donne quelques précisions sur l'identité des quatre aviateurs à bord du Heinkel 111.
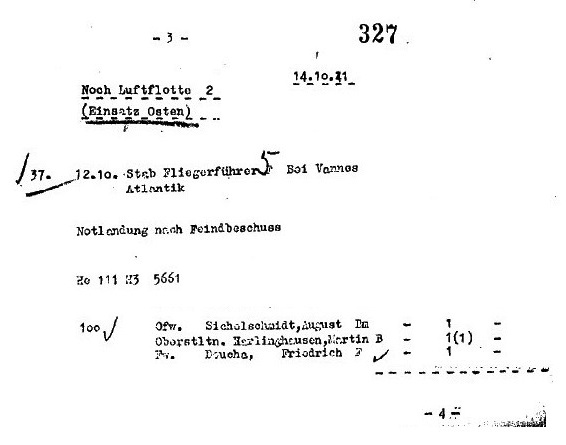

Ce type de bombardier allemand Henkeil He III H3 faisait partie de l'escadrille KGR basée à Vannes/Meucon. Le rôle de cette escadrille était notammment le marquage d'objectifs pour les bombardiers allemands en Angleterre .Il pouvait emmener aussi 2 tonnes de bombe et servit au trnasport de passagers.
A-t-il été abattu lors d'un combat aérien ?
La composition des passagers de l'avion semble peut conforme à une opération militaire mais plutôt à un transport d'officiers. En effet ce jour-là, le pilote était Friedrich DOUCHA, deux autres membres identifiés sont Martin HARLINGHAUSEN [17/1/1902-23/3/1986) (photo ci-dessus) qui finira général de la Luftvaffe et pour qui passa trois dans un hopital en convalesence et un dénommé August SICHELSCHMIDT. Mystère sur le quatrième membre d'équipage. Etait-ce un neveu de Hermann Goring ? Ce qui pourrait expliquer l'importance donnée à l'évènement.
39-45 : La bataille de France : 1/3
Les soldats de Séné qui ont perdu leur vie pendant la Seconde Guerre Mondiale, peuvent être présentés sous trois volets militaires.
Le premier rassemble les soldats décédés pendant la Campagne de France, et les combats menées par les armées françaises jusqu'à l'Armistice du 22 juin 1940.
Le second réunit tous les soldats morts en combattant sous le drapeau de la France de Vichy.
Le dernier groupe rassemble les hommes qui ayant suivi l'Appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940 combattire à ses côtés jusqu'à la Libération.
Sur notre monument aux morts figure une plaque commémorative des Sinagots morts pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elle a servi de point de départ pour les recherches. Cette plaque comporte 8 noms et vont va lire que la liste des soldats natifs de Séné, morts pour la France est bien plus longue.
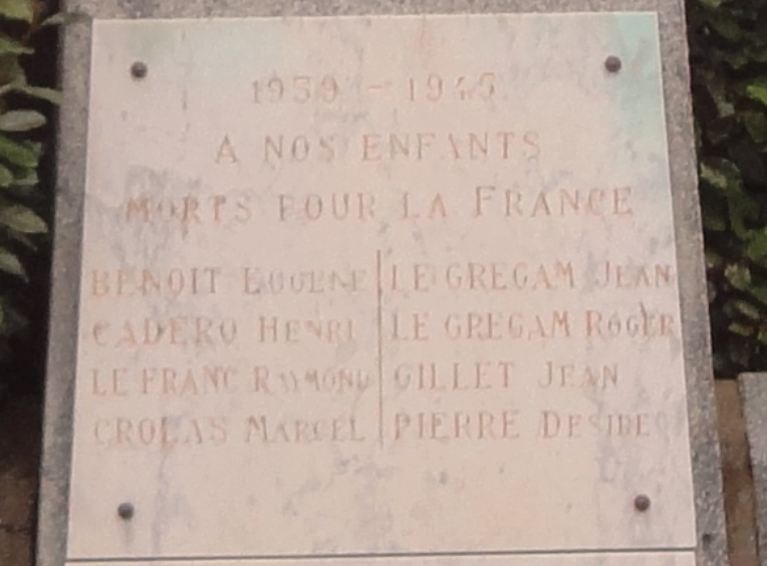
SECONDE GUERRE MONDIALE : De la déclaration de guerre à l'Armistice de 1940.
Qui étaient ces Sinagots qui perdirent la vie durant la Campagne de France et les premiers combats jusqu'à l'armistice voulu par Pétain ?
Louis Marie TREHONDART [20/03/1910 - 15/05/1940 ]
Louis Désiré PIERRE [3/08/1913 - 2/06/1940]
Pierre Vincent Marie LE PLAT [16/05/1914 - 15/06/1940]
Eugène Claude BENOIT [28/07/1910 - 20/06/1940]
Jean Henri LE PRIELLEC [6/11/1919 - 3/07/1940]
Henri Célestin Marie CADERO [1/07/1909- 6/07/1940]
André Louis Marie LEGEIN [2/10/1915-22/05/1940]
Marcel Yves Louis Marie LACROIX [13/09/1902 - 23/04/1951]
-----------------------------------------------------------------------------
Louis Marie TREHONDART [20/03/1910 - 15/05/1940 ]
Le site "Mémoire des Hommes" nous indique que Louis Marie TREHONDART, né à Séné le 30/03/1910 est second maitre mécanicien à bord du dragueur Duquesne II.
Le Duquesne II, chalutier réquisitionné et codé AD16 est en patrouille au large de l'embouchure de l'Escaut en Mer du Nord. En effet, le vendredi 10 Mai 1940, l'Allemagne envahit les frontières belges, hollandaises et luxembourgeoises. Pour faire face à cette invasion, le commandement français de la 7e Armée (Giraud) décide d'envoyer des troupes pour participer à la défense des Pays-Bas, et en particulier de la Zélande (Zeeland). Deux divisions d'infanterie seront déployées avec pour objectif de controler aussi longtemps que possible les bouches de l'Escaut (Schelde). Elle reçoivent un appui naval.
Le 15/05/1940, le Duquesne II saute sur une mine magnétique dans la passe de Welingen devant Fiessingue (Wlissingen) en Flandres hollandaises. On compte une vingtaine de disparus dont Louis Marie TREHONDART, natif de Séné.
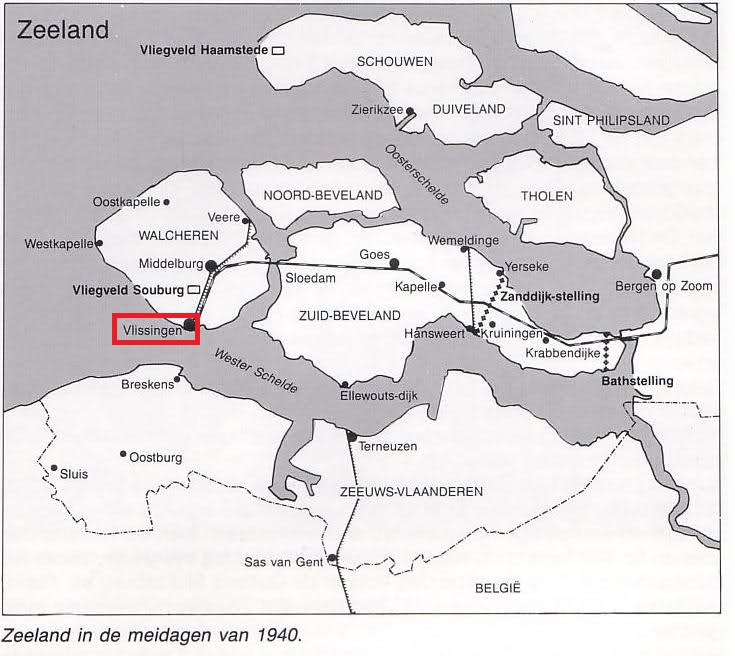
Louis Marie TREHONDART était né à Séné, au Ranquin d'un père, Louis Marie TREHONDART, capitaine au long cours et d'une mère, Marie marguerite ROLLAND, ménagère. La famille, qui compte depuis plusieurs générations des marins à Séné, est pointée par le dénombrement de 1911.
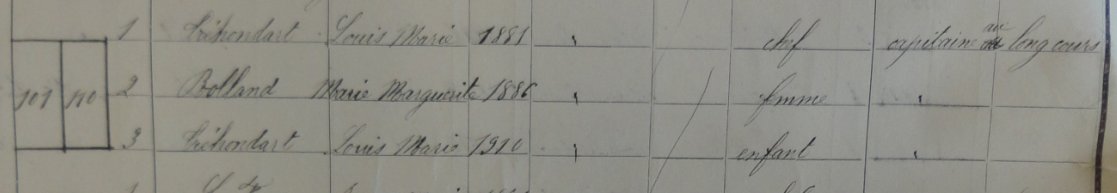
Avant guerre, après son parcours de marin [aller au SHD de Lorient consulter sa fiche], il habite au Havre, 7 rue Linnée, où il s'est marié le 19/06/1936 avec Marie Louise ERCHET, comme nous l'indique la mention marginale sur son acte de naissance.
Son nom a été inscrit au monument aux morts de la ville de Dieppe.
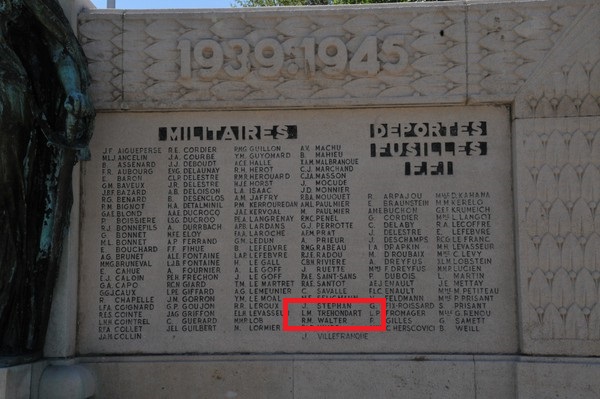

Pierre Vincent Marie LE PLAT [16/05/1914 - 15/06/1940]
Pierre Vincent Marie LE PLAT est né au "Petit poulfanc" où sa famille résidait au début du siècle dernier et à la veille de le 1ère Guerre Mondiale. Son père, Pierre Marie LE PLAT est natif de Noyalo (12/10/1876) au sein d'une famille de pêcheurs. Il se marie à Séné le 2/1/1902 avec Marie Perrine GACHET née à Séné (22/1/1882) d'un père maçon et d'une mère ménagère. On le sait, le nord de Séné est favorable à l'accueil de nouveaux habitants, hier comme aujourd'hui.
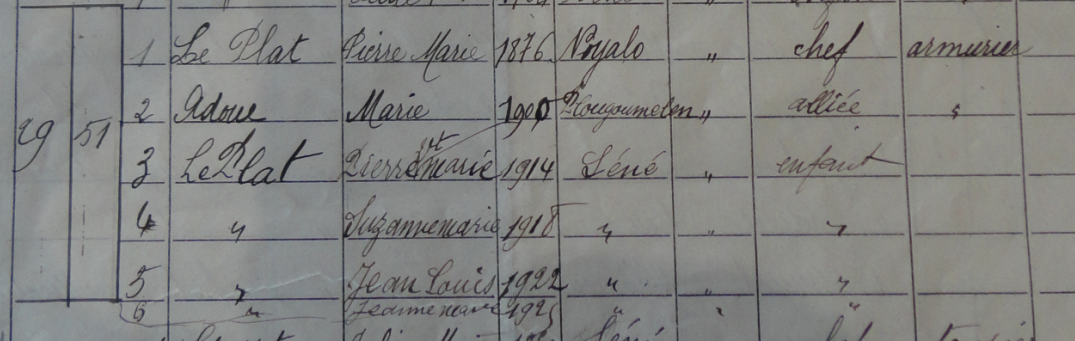
Après guerre, on retrouve au dénombrement de 1921 et 1926 (ci-dessus) et 1931, la famille LE PLAT établie au Poulfanc ou au Versa. Pierre Marie perd sa femme et il se remariera le 28/11/1928 avec Marie Josèphe ROUXEL [8/3/1899-21/4/1953].
En 1934, Pierre Vincent Marie LE PLAT, l'aîné de la famille, alors mouleur sans doute à la forge de Kerino, part effectuer son service militaire. De retour, il entre dans le corps des sapeurs pompiers aux chemins de fer. Il est affecté à Frétéval dans le Loir et Cher (41).
La guerre contre l'Allemagne nazie est déclarée. Pendant la "Drôle de Guerre", il se marie à Fréteval le 27/4/1940 avec Lucienne Madeleine Paulette GIRARD. Il est mobilisé au 5e Régiment du Génie à Versailles. Pendant la Campagne de France, son détachement reçoit l'ordre de détruire des ouvrages d'art sur la Seine et le canal latéral entre Saint-Julien-les-Villas (10) et Mussy-sur-Seine (10).
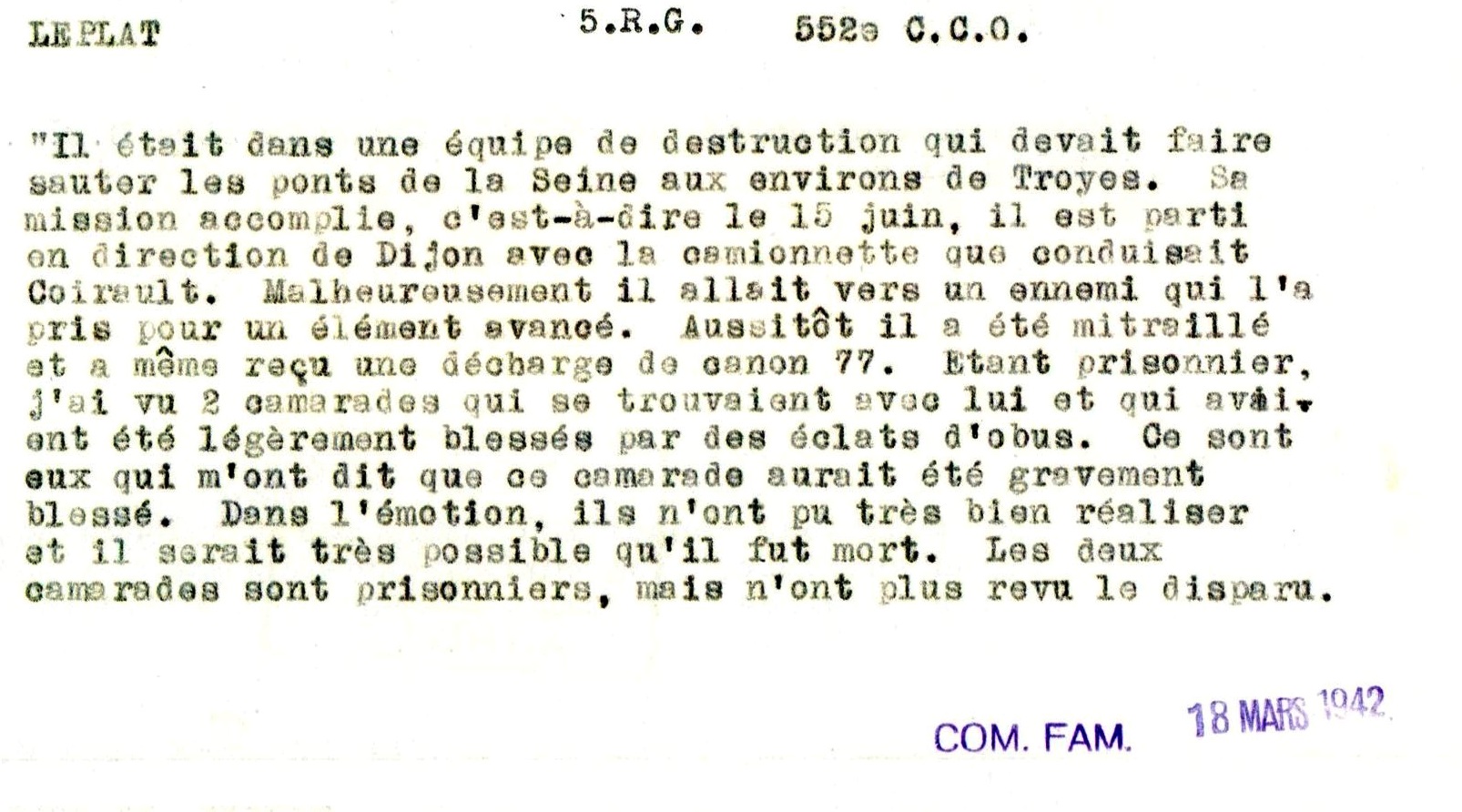
Le 15/6/1940, il revient de mission à bord d'une camionnette en route vers Dijon (21). La Croix Rouge recueillera auprès de prisonnier en Allemagne ce témoignage sur les circonstance de son décès. La camionnette est mitraillée par des soldats allemands et touchée par un tir de canon de 77. Ses camarades sont faits prisonniers. Grièvement blessé et d'abord considéré comme disparu, Pierre Vincent Marie LE PLAT, succombe de ses blessures le 15 juin 1940.
Son dernier domicile connu était au n°15 rue de la gare à Fréteval (41). Un acte de décès est dressé à Montbard (21) - Inhumé le 17/6/40, route de la mairie à Montbard (21) puis le 20/9/1940 au cimetière communal de la même localité. Par décision du Ministère en date du 28/9/1942, le soldat Piere LE PLAT a été déclaré "Mort pour la France".
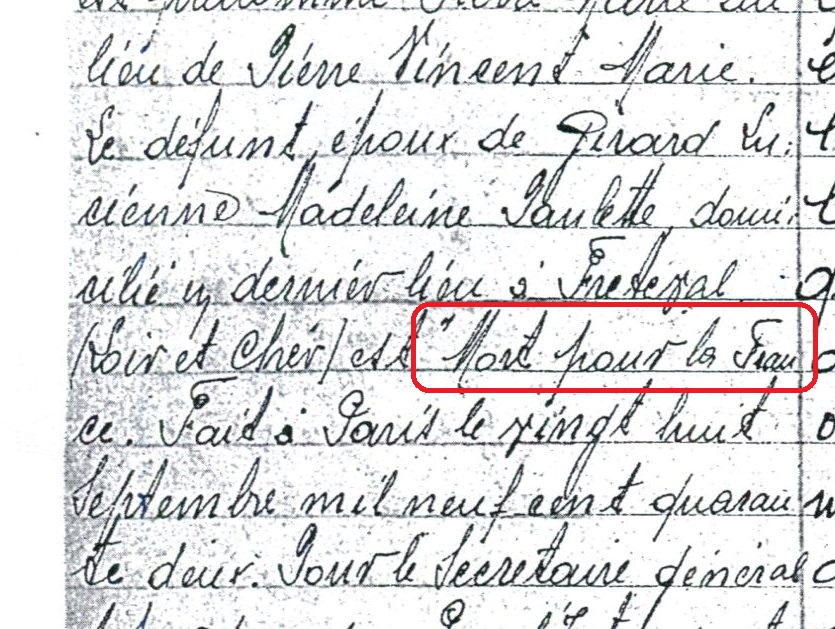
Une plaque commémorative honore sa mémoire sur la tombe familiale du cimetière communal de Séné (56). Il appartient désormais à la ville de Séné de l'inscrire au monument aux morts.

Louis Désiré PIERRE [3/08/1913 - 2/06/1940] :
Le site "Mémoire des Hommes" nous indique que Louis Désiré PIERRE décède à Warhem le 2 juin 1940. On consulte une carte de géographie pour situer Warhem au sud de Dunkerque. Dunkerque ! On pense tout de suite à la "poche" de Dunkerque et au film de Christopher Nolan...
Louis Désirée PIERRE était natif du du Meniech à Séné. Avant guerre, il s'est marié le 18/04/1938 à Locminé avec Paule Gilberte DUPUIS et le couple s'est domicilié à Mauron, place du Champs de Foire où sera enregistré son décès. En marge de son acte de naissance à Séné, figure la mention "Mort pour la France".
On le retrouve au dénombrement de Séné en 1921. Il est le fils du marin pêcheur Lucien et de Jeanne Marie MORIO, ménagère.
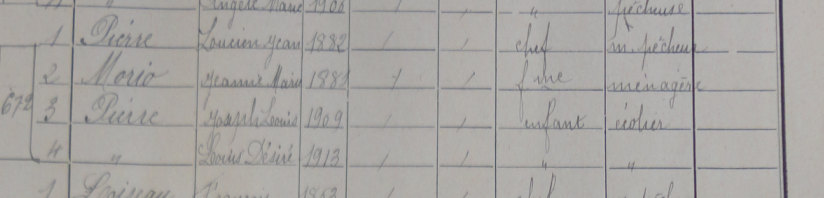
Le site "Mémoire des Hommes" indique qu'il est lieutenant au 137° Régiment d'Infanterie. Une recherche sur internet nous donne les noms de régiments qui prirent part aux combats dans la poche de Dunkerque. Le 137° y figure.
La Croix Rouge recuillis des témoignanges auprès des prisonniers français en Allemagne qui nous apportent quelques précisions:
1-Vu pour la dernière fois par le sous lieutenant Le Blay au Pont de Reuty Meulen près de Teteghem (Nord) le 1/06/40 vers 15H30. Signalé blessé le même jour vers 16H00. S'adresser à l'adjudant Gourmelin prisonnier.
Renseignement donné par le sous-lieutenant Le Blay Oflag XB le 9 aout 1941.
2-Au cours du bombardement du 1er juin 1940 sur nos position, le lieutenant PIERRE a été blessé au genou par une rafale. Ramené dans notre tranchée par les soldats Auffret Jean et Jean Fer, l elieutenant nous a donné l'ordre de se rendre au de se sauver s'il nous était possible. Donc le lieutenant PIERRE est reté dans cette tranchée, blessé mais non tué. Qu'est-il arrivé ensuite, je ne peux vous le dire. Lieu et heure: à Teteghem, près de Dunkerque, le 1er juin 1940, vers 11heures.
Renseignement donné par : Le Lièvre jean, Roullé Emile, Moelo Alain, Bellec François, Benoit Alain, Allain Louis, 37 RI 2°Cie Stalag IID, le 3 aout 1941.
3-Blessé à l acuisse le 2 ou 3/6/40 à Teteghem près de Dunkerque, abandonné sur le terrain lors de la retraite.
Renseignement donné par Gouy Bernard, le 10/8/1941
4-A été blessé sur le terrain alors que sa Cie se repliait sur Teteghem à env. 3-4 km de Teteghem, ai bord d'un canal, dans l'après-midi du 1er juin 1940. Le P.C. du Colonel était à Teteghem même.
Renseignement donnés par Praud Eugène, n°51987 du stalag IiD.
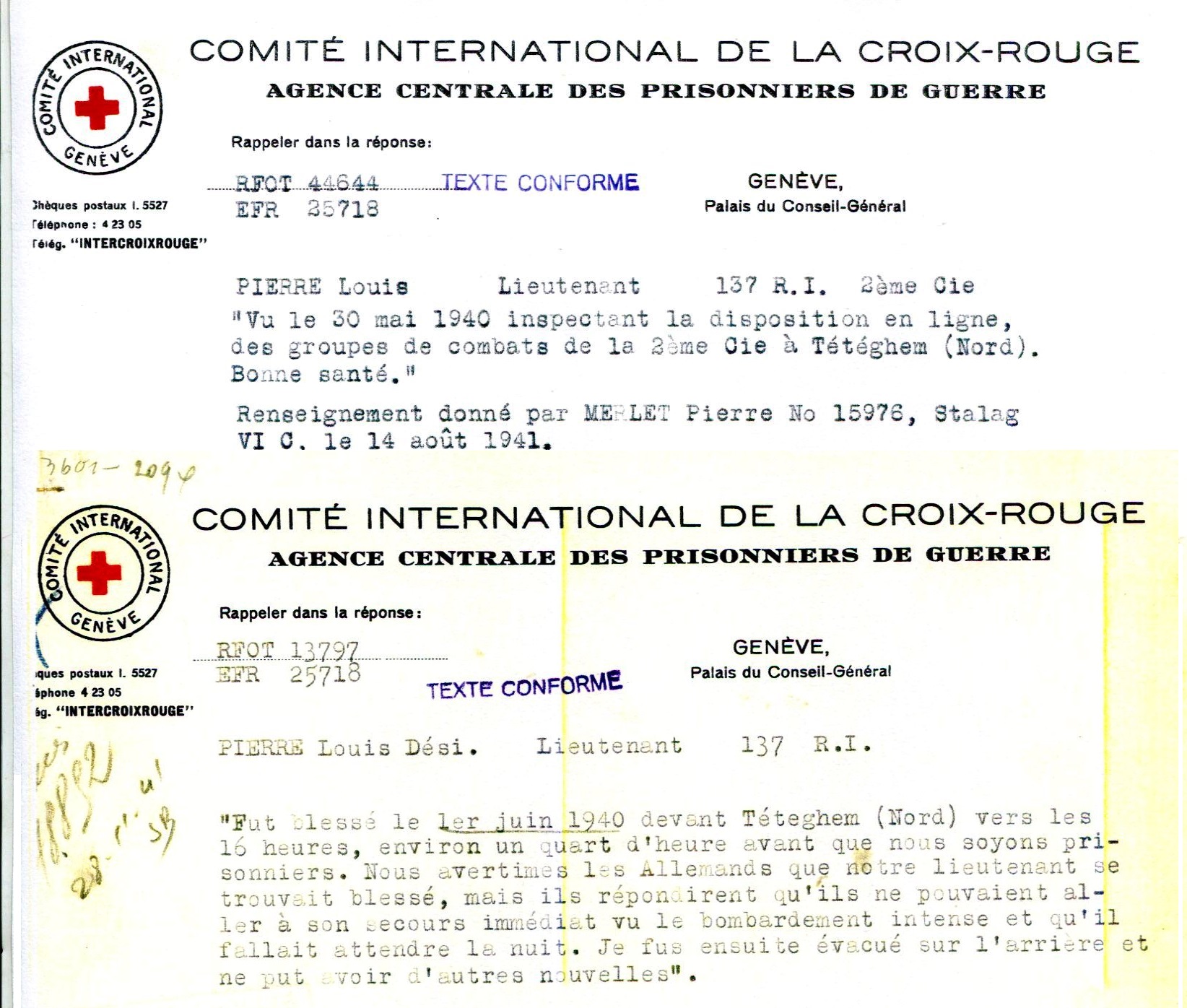
Louis Désiré PIERRE fait donc partie de ces soldats qui se sacrifièrent pour permettre aux soldats britanniques de retourner combattre depuis la Grande Bretagne et à d'autres soldats français de s'embarquer également.

Le film de Christopher Nolan fait impasse du sacrifice des soldats français. Le soldat PIERRE de Séné a combatu jusqu'au 2 juin 1940 pour retenir les soldats de la Wermarcht. Le 5 juin l'évacuation est achevée. Le 18 juin, depuis Londres, De Gaulle appelle à la résistance. Les soldats français passés en Angleterre constitueront le noyau des troupes qui, 4 ans plus tard, débarqueront en Normandie.
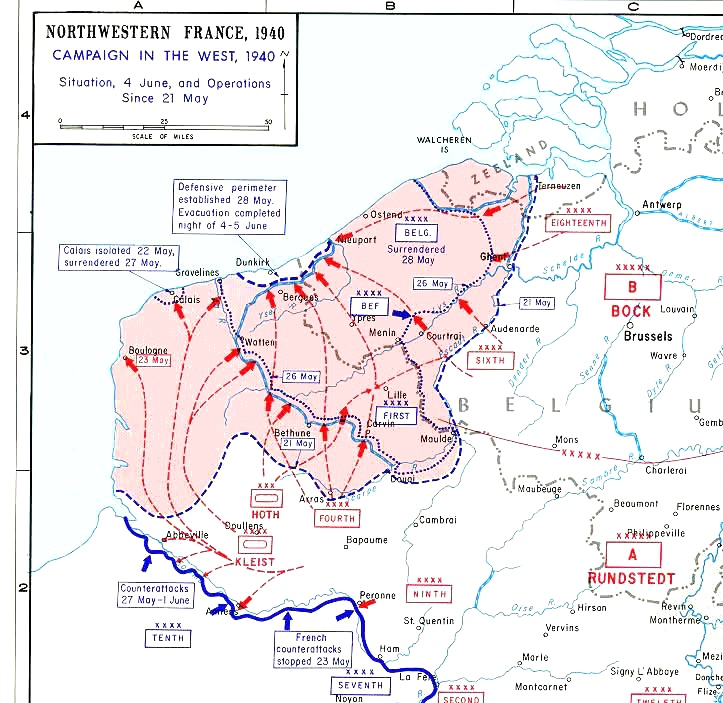
La tombe de Louis Désiré PIERRE a été restauré au cimetière de Séné.
André Louis Marie LEGEIN [2/10/1915-22/05/1940]
Le site internet memorial genweb nous permet de retouver ce soldat en faisant une recherche par localité de naissance. Par contre, le site "Memoire des Hommes" le donne natif à Vannes. Les registres de Séné permettent de confirmer qu'il est bien natif de Séné.
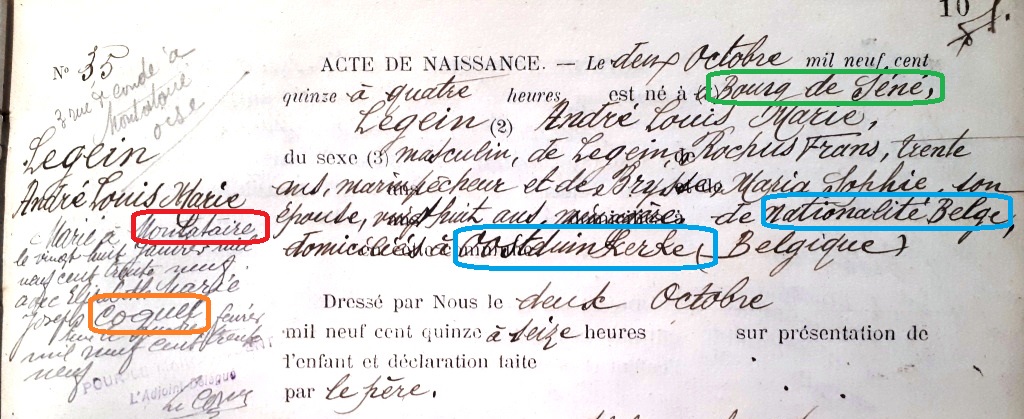
Les parents d'André LEGEIN sont belges et le père est pêcheur. Ils déclarent leur enfant à Séné et leur commune de résidence en Belgique à Ostdiunkerke. Mais que faisait cette famille de pêcheurs belges à Séné en 1915 ? Les armées allemandes ont envahi la Belgique et la famille Legein est sans doute réfugiée à Séné !

Ces quelques cartes postales anciennes montrent les pêcheurs flamands de Oosdiunkerke en train de pêcher notament la crevette comme nos pêcheurs singaots.. Une raison pour accueillir la famille de Rochus Frans LEGEIN.
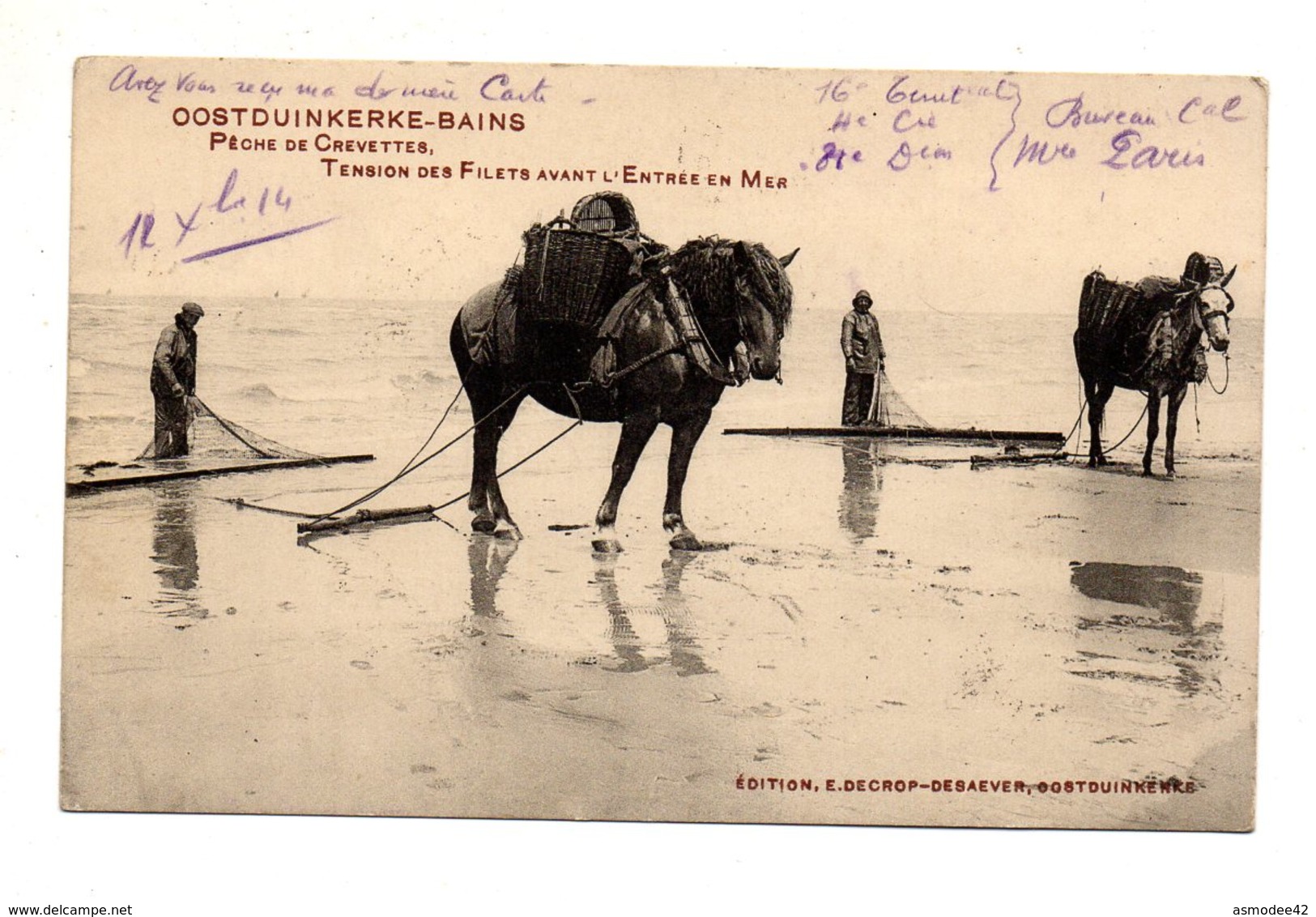
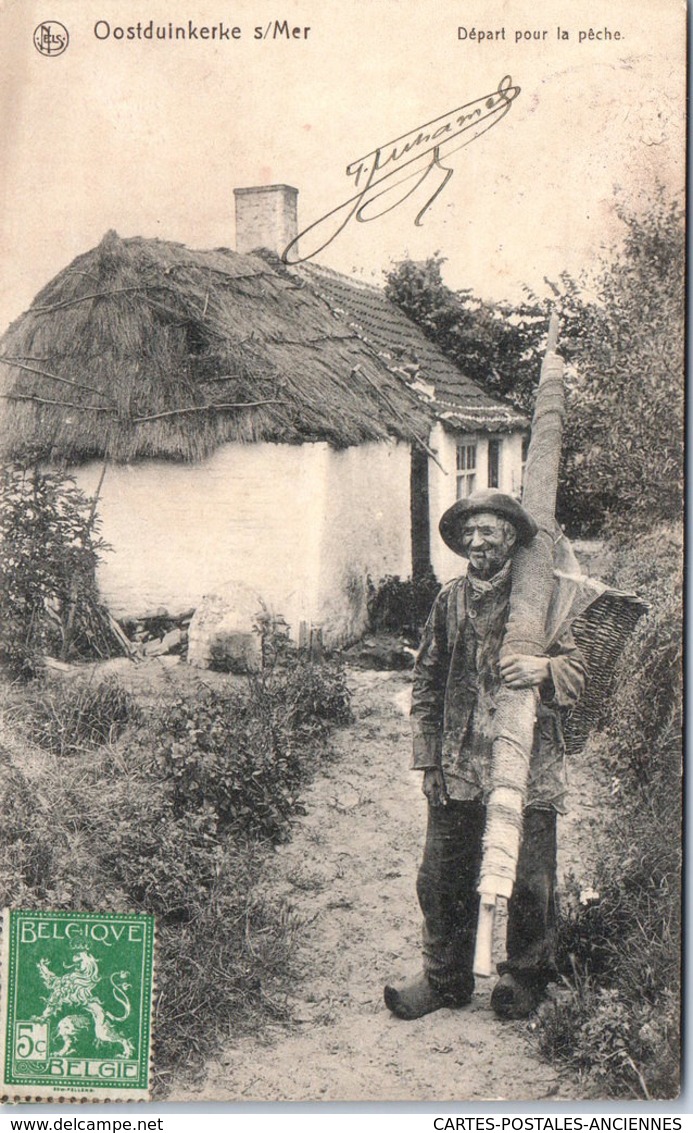
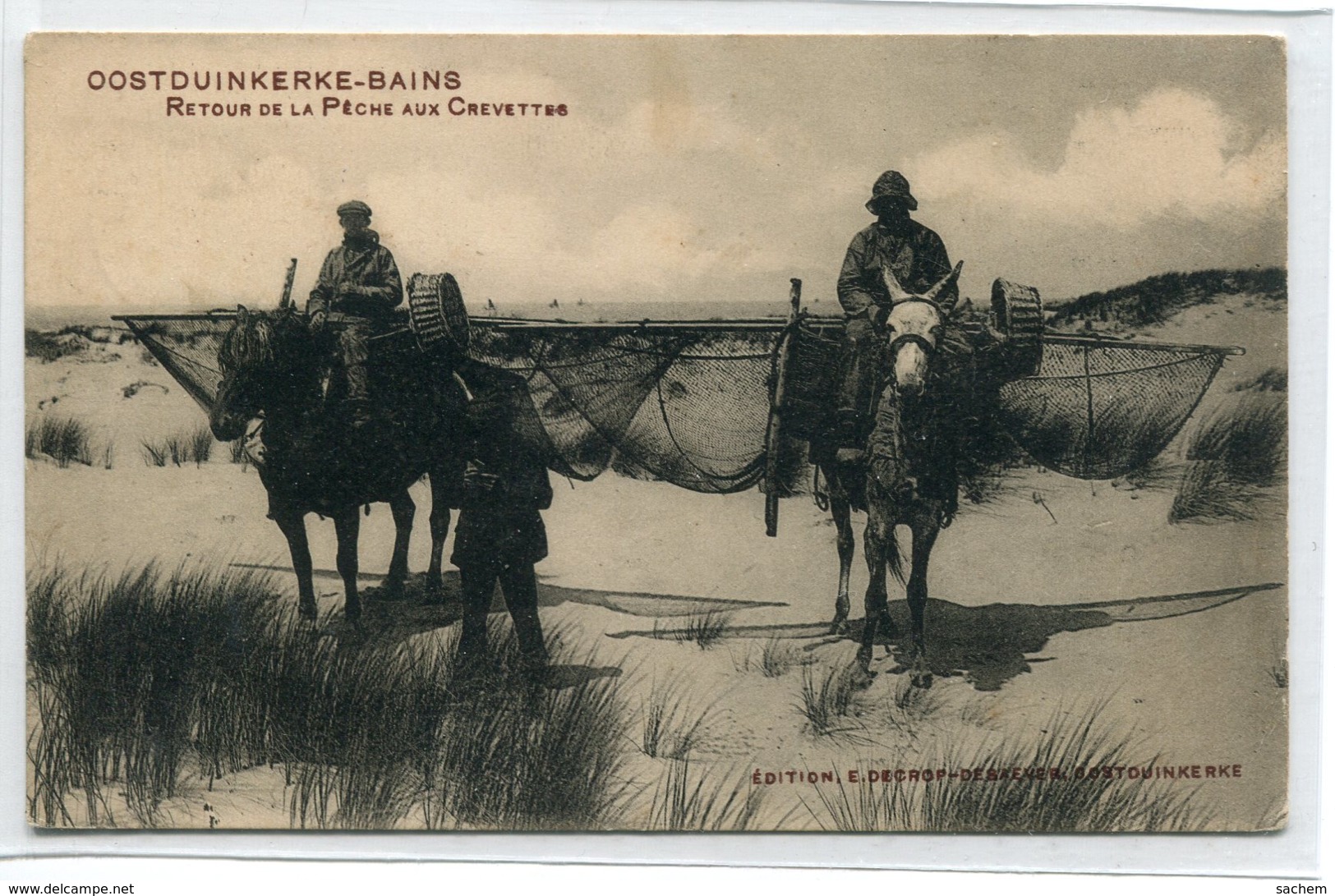
A l'âge adulte, André LEGEIN, effectue son service militaire en 1935 à Beauvais et il devient fraçais. Il est manoeuvrier à Montataire (60) quand il épouse le 22/01/1939 Elisabeth Marie Joseph COQUEL, racoutreuse. André LEGEIN est incorporé au sein du 6° Régiment d’Infanterie comme soldat de 2° classe, Il a sans doute combattu héroïquement sur l'Aisne de mai à juin 1940 où son régiment d'est illustré dans le secteur de Villers-en-Prayères. ISelon son dossier,il décède le 22 mai 1940 tué à l'ennemi. "Tombé dans un secteur soumis sans arrêt aux balles ennemies, il a été impossible malgré de nombreux efforts de ramener le corps dans noslignes. D'où le retard de l'avis de décès, certaines preuves de l'identité de ce militaire nous ayant manquées jusqu'à ces derniers jours.Il a été déclaré mort par jugement le 25/4/1941 et celui-ci a été transcrit sur la commune de Thiverny, le 12/05/1941, oùréside son épouse rue de la Cavée.
André LEGEIN a une histoire toute française. Ses parents belges étaient réfugiés à Séné pendant la 1ère Guerre Mondiale. Il est né Belge à Séné. Il a choisit la nationalité française. Il est Mort pour la France. C’est tout un symbole ! Son nom, porté au monument aux mort de Thiverny, doit aussi l'être porté au monument aux mort de Séné.

Eugène Claude BENOIT [28/07/1910 - 20/06/1940]
Eugène Claude BENOIT nait à Cariel le 28/07/1910. La famille Benoit est bien connue à Séné, c'est un des boulangers de la commune. Il se marie le 11/05/1938 à Arradon avec Louise LE PELVE née le 23/03/1914 dans cette ville.
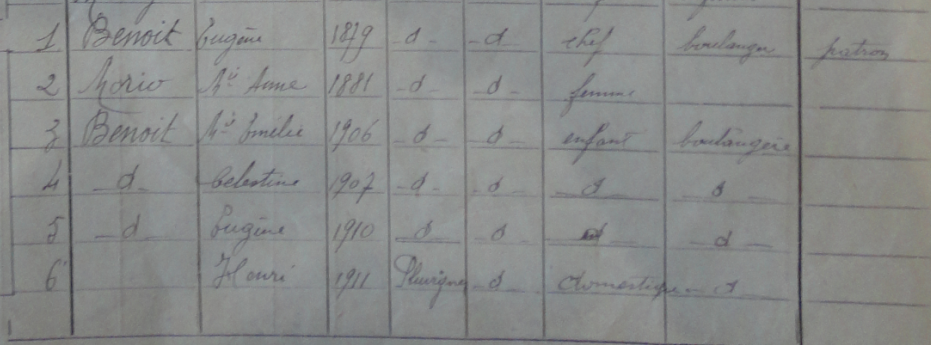
Lorsque la France déclare la guerre à l'Allemange nazie, le site "Mémoire des Hoimmes" nous indique qu'il incorpore le 4° (?) Régiment d'Infanterie. Après la "drôle de guerre", la campagne de France voit déferler les divisions blindées de la Wermarcht qui mettent les troupes françaises en déroute. Les régiments désorganisés reculent au milieu d'une population en exode. Le soldat BENOIT arrive près de Vatan dans le département de l'Indre

L'exode dans l'Indre
"Depuis le début de l'offensive allemande, le 10 mai, 2 millions de civils belges et 8 millions de Français originaires du Nord, des Ardennes au Pas-de-Calais, de la Région parisienne, de la Normandie, de l'Orléanais et de la Touraine, abandonnant tout ou partie de leurs biens, se sont jetés sur les routes en direction du Sud. A pied, à bicyclette ou bien entassés dans des voitures, des autobus et des charrettes, ils n'ont qu'un désir : s'éloigner des villes bombardées et des zones de combats. (...). Dans le flot chaotique de la débâcle générale, circulent les colonnes hétéroclites de soldats désemparés. Chaque jour des milliers de réfugiés se répandent dans les villages et les villes de l'Indre ou poursuivent leur route vers les départements voisins : Creuse, Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne.
Le 17 juin, le maréchal Pétain, chef du gouvernement depuis la veille s'adresse à la Nation pour annoncer qu'il faut cesser le combat.
Le 19 juin, un arrêté de la préfecture de l'Indre enjoint aux réfugiés de demeurer sur place; mais la plupart de ceux auxquels ils s'adressent sont déjà partis.
Ajoutant à l'anarchie et à l'horreur, l'aviation allemande bombarde les routes et les villes du département : Issoudun (19-20 juin), où 100 civils sont tués et 65 immeubles détruits; Levroux, où l'on relève 40 morts; Valençay et surtout Châteauroux (10 juin) qui compte alors plus de 150 000 habitants et réfugiés.

Déjà désespérés, les combats en cours perdent leur sens; les troupes françaises au contact de l'ennemi se replient à une cadence accélérée; les soldats jettent leurs armes dans les fossés et les caniveaux, abandonnent même leur armement lourd.
Quelques unités, cependant, résistent héroïquement à l'avance allemande. La population locale ne semble pas apprécier ces barouds d'honneur et n'est guère désireuse de faire les frais d'un combat qu'elle juge inutile depuis la demande d'armistice : à Châteauroux, elle dispose des draps blancs sur les toits pour éviter les bombardements ; au Blanc, les anciens combattants désamorcent les mines qui doivent faire sauter le pont, commandant un des passages de la Creuse.
C'est dans cette confusion totale que les troupes allemandes du hauptman (capitaine) Stadelmayer occupent Châteauroux, le 23 juin, faisant prisonnier les 6000 hommes de la garnison.
Deux jours plus tard, à l'entrée en vigueur de l'armistice, l'avance extrême atteintes par les unités de la Wehrmacht passe par une ligne joignant La Châtre et Montmorillon dans la Vienne.
Les Allemands, cependant, doivent bientôt se replier au delà de la Ligne de démarcation (le 30 juin), matérialisée au nord du département de l'Indre par le Cher."
Dans cette exode, dans cette débacle des armées françaises, Eugène BENOIT recule devant un ennemi supérieur en nombre et en armement. Sa retraite le conduit avec d'autres à combattre à Vatan en Indre. Il est blessé et meurt le 20 juin 1940, lors d'un bombardement allemand. Il décède quelques jours avant l'Armistice de Rethondes (22/06/1940) "suite de blessures de guerre, déposé à l'hospice par un camion militaire de passage alors qu'il était mourant et inhumé au cimetière de la commune.; Son décès est enregistré à Vatan, et retranscrit à Séné."
Lors de son décès, le soldat sinagot portait ces effets personnels:
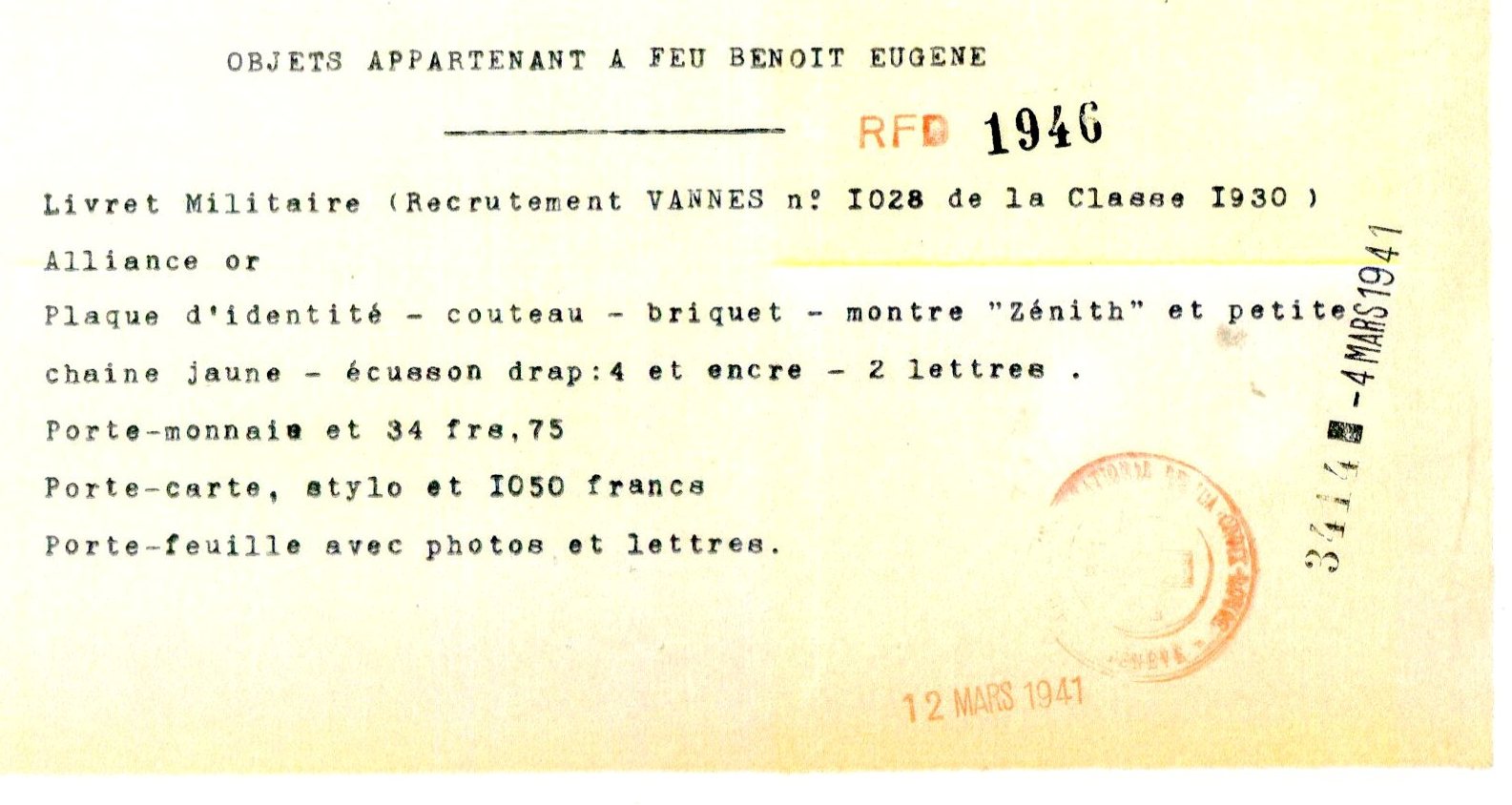
Jean Henri LE PRIELLEC [6/11/1919 - 3/07/1940]
Le parcours attentif des registres des décès à la mairie de Séné, permet d'identifier l'acte de Jean Henri LE PRIELLEC. On comprend qu'il est le fils naturel de Marie Madeleine LE PREILLEC.
On y apprend qu'il était quartier Maitre Fusilier sur le Bretagne, quand la marine anglaise a attaqué la flottre française stationnée à Mers El Kebir. Le 3/07/1940, on dénombrera 1297 Français morts lors de cette attaque dont Jean Henri LE PRIELLEC et Henri Célestin CADERO.
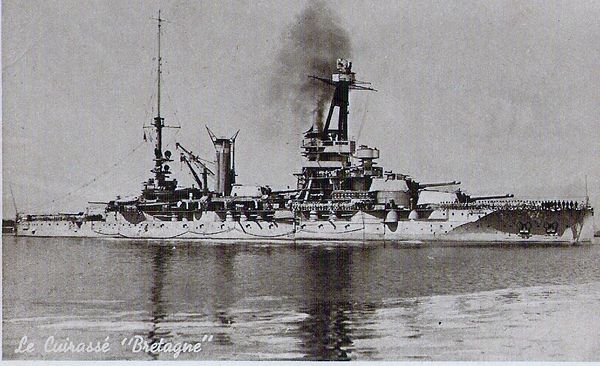
Ces données son confirmées par le site "mémoire des Hommes" où on retrouve sa fiche.

Le nom de Jean Henri LE PRIELLEC, né à Vannes le 6/11/1919, figure au monument aux morts de la ville de Vannes. En 1936, Jean Henri LEPRIELLEC est domestique de ferme à Séné comme nous l'indique le dénombrement.
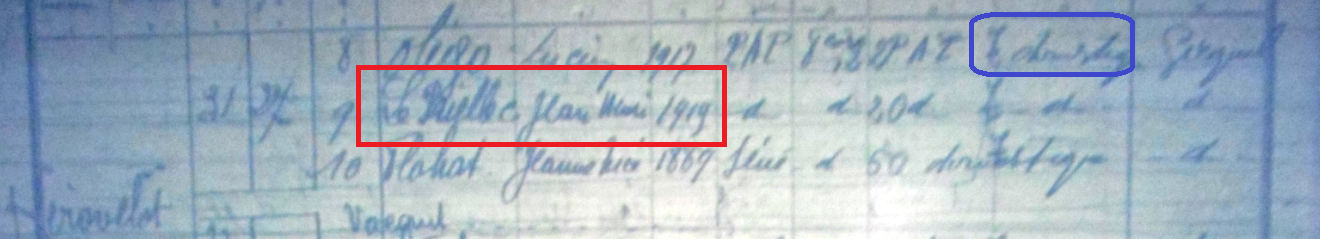
Au moment de la mobilisation, il vit donc bien à Séné, dernier domicile connu.. A ce titre comme tous soldats dont l'acte de décès est retranscrit à Séné, son nom doit figurer au monument aux morts.
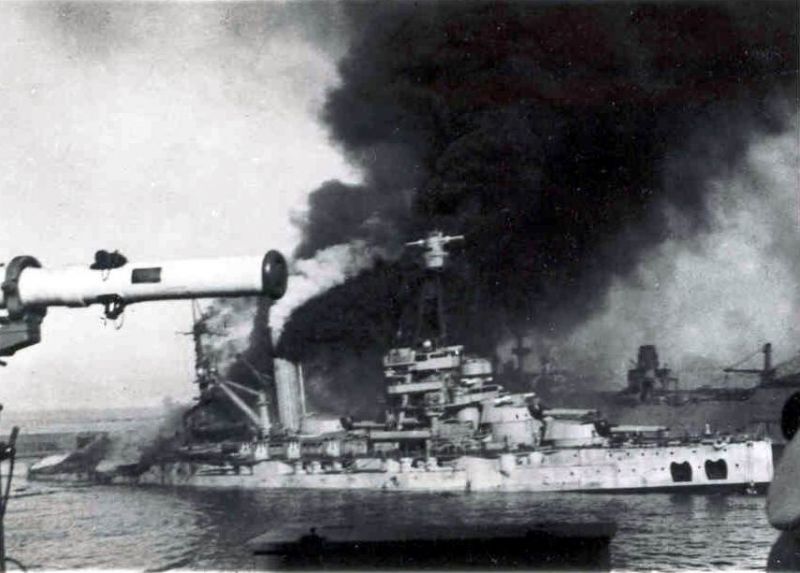
Henri Célestin Marie CADERO [1/071909 - 6/07/1940]
Le site "Mémoire des Hommes" nous livre quelques informations sur le parcours militaire de Henri CADERO. On y apprend qu'il est militaire de carrière dans la Marine Nationale avec le grade de Quartier Maitre Canonnier, à bord du dragueur Estérel qui fut torpillé le 3/07/1941 à Mers el Kébir département d'Oran en Algérie.
Après l'armistice demandée par la Maréchal Pétain, le Royaume-Uni est seul en guerre contre l'Allemagne nazie et craint que la flotte de la marine française stationnée dans les colonies ne passe à l'ennemi. La Royal Navy qui n'obtient pas la rédition de la flotte à Mers El Kébir, décide de la couler le 3 juillet 1940.
Pour en savoir plus : http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/mersel01.html
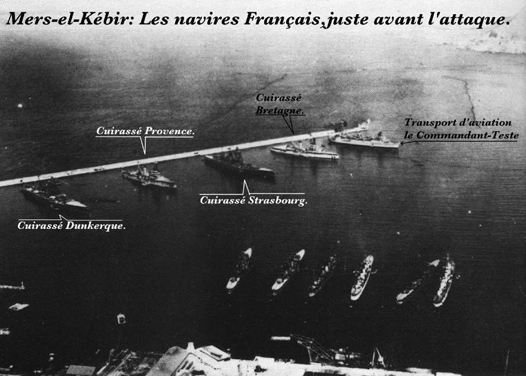
Parmi les bateau ancrés au port de Mers el Kébir, l'Estérel est un ancien navire civil, réquisitionné et transformé en un arraisonneur-dragueur. Du 5 septembre 1939 à août 1940, il naviguera à Cannes, Nice, et il est coulé ce 3 juillet 1940 à Mers el-Kébir.
Ancien matelot des Douanes à Béni-Saf, Henri Célestin CADERO fera l'objet d'une citation à l'ordre de l'armée N° 1760 FNF du 9 septembre 1940 : "Quartier maitre canonnier ayant toujours montré de belles qualités morales: mort glorieusement des suites de blessures reçues lors du torpillage de son bâtiment L'Esterel le 06/06/1940". Son nom est inscrit au livre d'or du corps des Douanes - guerre de 1939-1945.
5 autres marins français perdirent également la vie lors du torpillage de l'Estérel et l'attaque anglaise fit 1297 morts chez les marins français, dont Jean Henri LE PRIELLEC, habitant de Séné (lire article).
La consultation de son acte de naissance nous apprend qu'il s'est marié le 26/12/1933 avec Marie Bernadette Jacaob. Une mention marginale attire notre attention :"Adopté par la Nation".
Le nom de CADER résonne à la mémoire de l'historien local qui a travaillé sur la guerre de 1914-18. Effectivement, le dénombrement de 1921 permet d'apporter cette précision d'importance.
Henri Célestin Marie CADERO, fils de Marie Vincente DANET et de Henri Louis Marie CADERO, soldat de la Grande Guerre, mort tué à l'ennemi le 25/09/1915 en Champagne.
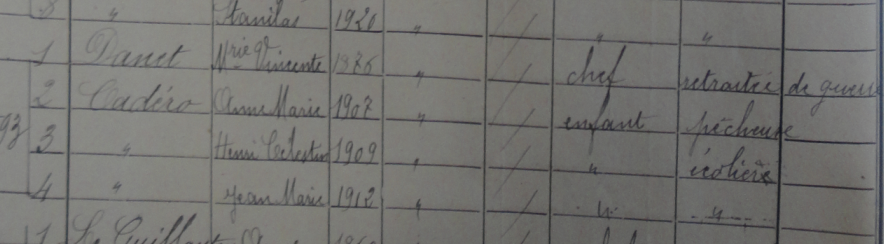
Ainsi, notre monument aux morts mentionne à 25 ans d'intervalle, les noms de deux HENRI CADERO, le père et le fils "Morts pour la France". Marie Vincente DANET était veuve de guerre depuis l'âge de 29 ans, avec 3 enfants à charge, Dure contributation à sa patrie.
CADERO Henri Louis Marie du 52° Régiment d'Infanterie "Tué à l'ennemi" le 25/09/1915 à Souain.
Henri CADERO Henri nait au village du Ranquin le 21/01/1879.
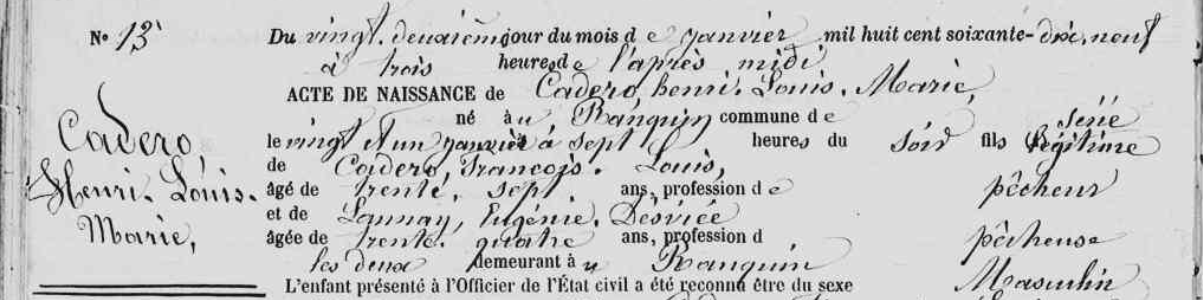
Sa fiche de matricule nous apprend qu'il sera un temps marin car il effectuera sa conscription comme matelot.
Il est renvoyé à Canivar’ch le 3/01/1903. De retour, il se marie le 11 janvier 1904 avec Marie Vincente Mathurine DANET. Il fonde une famille qui apparait au dénombrmeent de 1911 et compte trois enfants : Suzanne 1904, Anne Marie 1907, Henri Célestin 1909.
Il est tué à l'ennemi ce 25 septembre 1915 à Souain.
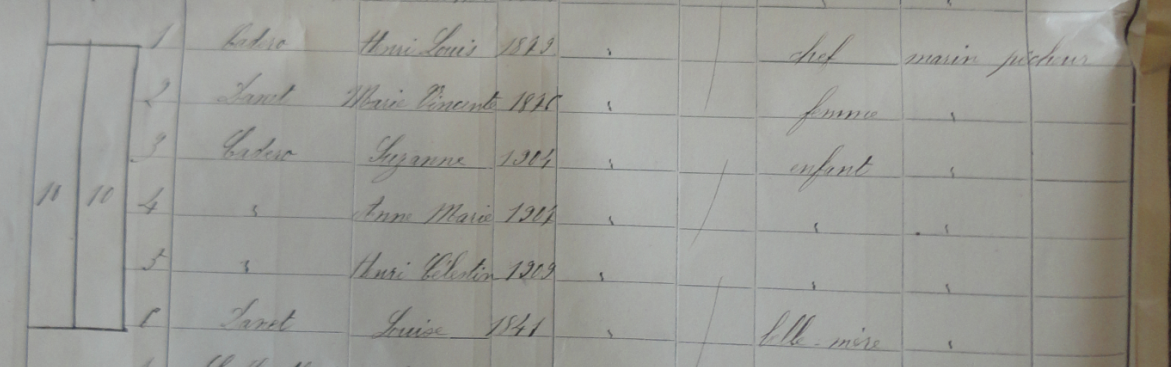
Marcel Yves Louis Marie LACROIX [13/09/1902 - 23/04/1951]
Marcel LACROIX nait à Michotte. Son père est paludier et sa mère cultivatrice comme nous l'indique son extrait de naissance.
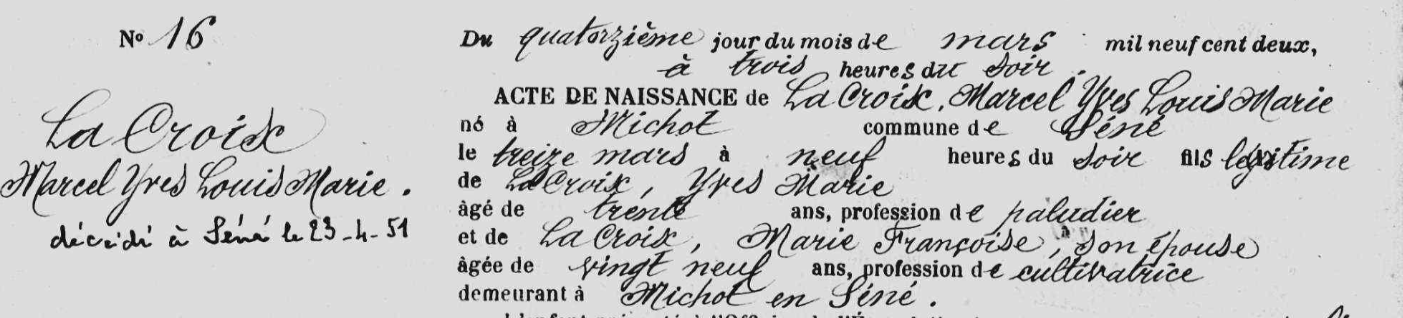
Au dénombrement de 1911, la famille Lacroix abrite le grand-père, les trois enfants du couple et deux cousins des enfants ainsi qu'un domestique.
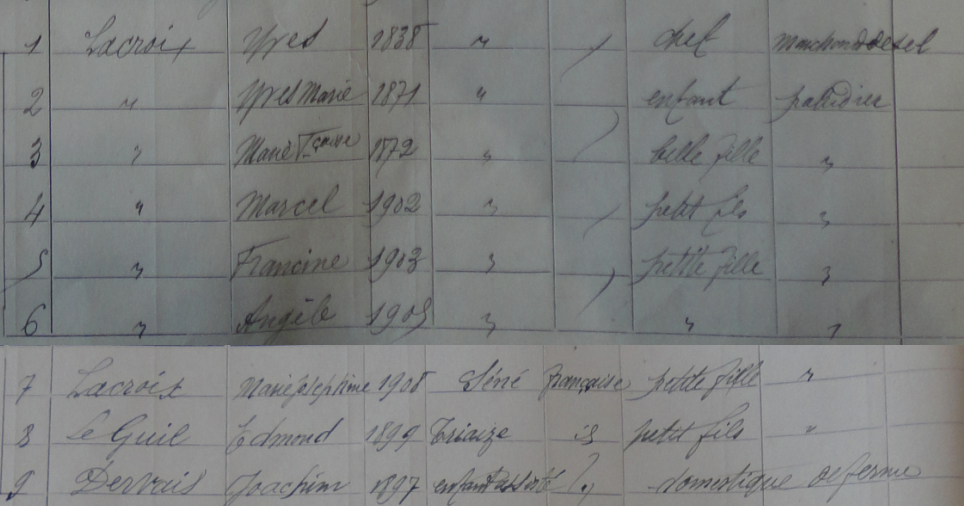
On lit également sur son acte de naissance, son mariage le 29/08/1930 avec Simone Amélie LE GALLIC cultivatrice à Kerarden. Au dénombrement de 1931, il est est établi à Michotte comme agriculteur avec sa femme.
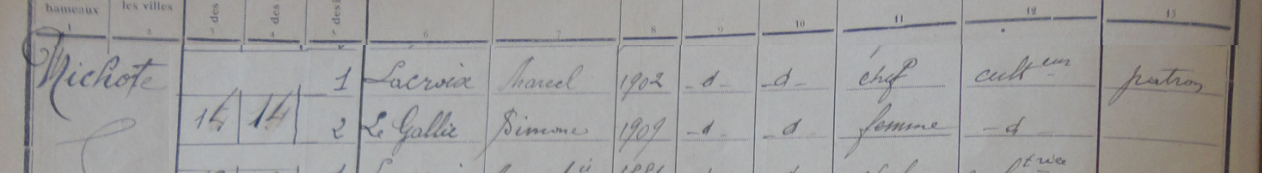
Le SHD de Caen contacté précise que Marcel LACROIX est mobilisé en 1939 comme soldat de 1ère classe au sein du 183° régiment d'artillerie Lourde à Fontainebleau. Il est capturé par la Wehrmacht le 15 juin 1940 près d'Auxerre pendant la débacle et fait prisonnier.
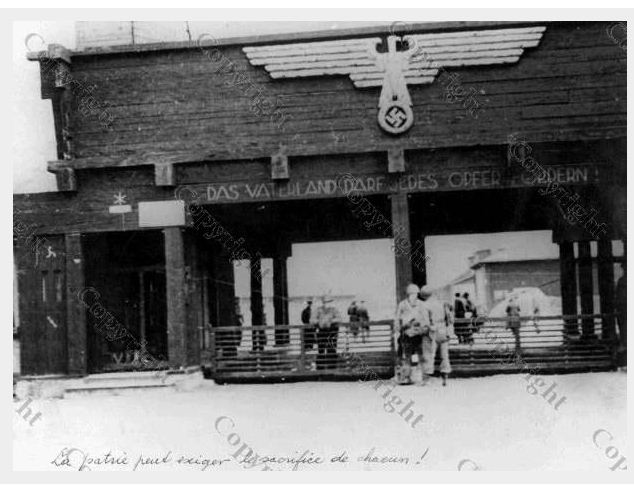
Il rejoint le Stalag Slammlager VI J de Fichtenchein/Krefeld près de Dusseldorf le 15/09/1940 sus le matricule 8836. Il sera libéré par les Alliés le 29/03/1945. Après son décès à l'âge de 49 ans, par décision du Ministère des Anciens Combattant du 10/07/1952, il a été reconnu "Mort pour la France" pour être décédé des suites de la tuberculose contractée pendant sa captivité. Son nom doit également figurer au monument au morts de Séné.
Sa tombe se trouve au cimetière de Séné.